Un ‘blanc mulet’ (śvata aśvatara) a donné son nom à la Śvetāśvatara–Upaniṣad. Pourquoi ? Son auteur, Śvetāśvatara, était-il amateur de beauté équine, ou de promenades équestres? Siddheswar Varmai et Gambhīrānanda préfèrent comprendre ce nom comme une métaphore signifiant ‘celui dont les organes des sens sont purs’ (‘One whose organs of sense are very pure’)ii.
Il fallait sans doute une réelle pureté de sens (et d’intelligence), en effet, pour s’attaquer aux questions que traite cette Upaniṣad :
« Le brahman est-il la causeiii ? D’où sommes-nous nés ? Par quoi vivons-nous ? Sur quoi prenons-nous appui ? »iv
La réponse à toutes ces questions se trouve dans l’Un.
L’Un, – c’est-à-dire le brahman, se manifeste dans le monde par ses attributs et ses pouvoirs (guṇa), auxquels on a donné des noms divins (Brahmā, Viṣṇu et Śiva). Ces trois noms symbolisent respectivement la Conscience (sattva, la pureté, la vérité, l’intelligence), la Passion (rájas, la force, le désir, l’action) et la Ténèbre (támas, l’obscurité, l’ignorance, l’inertie, ou la limitation).
La ‘grande roue du brahman’v donne la vie au Tout, dans le flux sans fin des renaissances (saṃsāra).
L’âme individuelle ‘erre ici et là’ dans le grand Tout, comme une ‘oie sauvage’ (haṃsa)vi. En quête de délivrance, cette volaille à la dérive s’égare lorsqu’elle vole séparée du Soi. Mais lorsqu’elle s’y attache, lorsqu’elle en goûte la ‘joie’, elle atteint l’immortalité.
Le Tout est un grand mélange, de mortels et d’immortels, de réalités et d’apparences. L’oie qui vole libre en lui, sans savoir où elle va, est en réalité liée, garrottée. Elle se croit sujet conscient, mais n’est qu’un simple soi, sourd et aveugle, ignorant la joie, le Soi du brahman.
Pour se mettre sur sa voie, elle doit trouver en elle une image trinitaire de l’Un, une triade intérieure, composée de son âme (jīva), de son seigneur personnel (Īśvara) et de sa nature (prakṛti). Cette triade est à la fois ‘trine’ et ‘une’, ce qui est aussi une image familière au christianisme, – apparue sous la plume de Jean, plus de deux mille ans après le Véda.
Cette âme trine n’est pas simplement une image, elle est déjà brahman, elle est dans le brahman, elle est avec le brahman. L’Un.
L’Un gouverne le Tout, le périssable, l’impérissable et le Soi. C’est en méditant sur l’Un, et s’unissant à lui, que le soi peut se délivrer de la ‘puissance de la mesure’ qui règne sur le monde, – la fameuse māyā.
La māyā signifie originairement et étymologiquement la ‘toute-puissance divine’, – une puissance de création, de connaissance, d’intelligence, de sagesse.
L’acception de māyā comme ‘illusion’ n’est que dérivée. Elle prend ce sens (paradoxalement) antonyme de ‘tromperie’, d’‘apparence’, lorsque le soi ne reconnaît pas la présence de la puissance. Quand la connaissance, l’intelligence et la sagesse sont absentes, l’illusion prend leur place et occupe tout le terrain.
Ainsi māyā peut se comprendre (véritablement) comme puissance, mesure et sagesse, lorsqu’on la voit à l’œuvre, ou bien (faussement) comme illusion, lorsqu’on lui est aveugle.
Ce n’est pas la māyā en tant que telle qui est ‘illusion’. L’illusion ne vient, à propos du monde, que lorsque la puissance créatrice de la māyā n’est pas reconnue comme telle, mais qu’on se laisse prendre par le résultat de son opération.
Par sa nature duelle, par sa puissance d’occultation et de manifestation, la māyā cache mais aussi révèle le principe divin, le brahman qui en est le maître et la source.
Connaître l’essence de la māyā, c’est connaître ce principe, – le brahman. Pour y atteindre, il faut se délier de tous liens, sortir de la voie de la naissance et de la mort, pour s’unir au Seigneur suprême et secret, accomplir Son désir, et demeurer dans le Soi (Ātman).
La māyā est comparée à un filetvii. Elle enveloppe tout. On ne lui échappe pas. Elle est la puissance cosmique du Seigneur, en acte dans le Tout. Elle est le Tout.
Pour lui échapper enfin, il faut la voir à l’œuvre, la comprendre dans son essence, s’en faire une compagne.
Double face, donc, dualité de la vérité et de l’illusion. C’est par la māyā que l’on peut connaître māyā, et son créateur, le brahman.
C’est pourquoi il est dit qu’il y a deux sortes de māyā, l’une qui conduit au divin (vidhyā-māyā) et l’autre qui en éloigne (avidhyā-māyā).
Toute chose, même le nom du brahman, est doublement māyā, à la fois illusion et sagesse.
« C’est uniquement grâce à māyā que l’on peut conquérir la suprême Sagesse, la béatitude. Comment aurions-nous pu imaginer ces choses sans māyā ? D’elle seule viennent la dualité et la relativité. »viii
On a aussi comparé la māyā aux couleurs innombrables que produit l’Un qui Lui, est « sans couleur », comme la lumière se diffracte dans l’arc-en-ciel.
« L’Un, le sans couleur, par la voie de son pouvoir produit de multiples couleurs dans un but caché. »ix
La nature témoigne, avec le bleu, le vert, le jaune, l’éclat de l’éclair, la couleur des saisons ou des océans. Le rouge, le blanc, le noir, sont la couleur du feu, de l’eau, de la terrex.
« Tu es l’abeille bleu-nuit, [l’oiseau] vert aux yeux jaunes, [les nuages] porteurs d’éclairs, les saisons, les mers. »xi
Pour voir la māyā il faut la considérer à la fois sous ses deux aspects, indissociables.
Un jour Nārada dit au Seigneur de l’univers : « Seigneur, montre-moi Ta māyā, qui rend possible l’impossible ».
Le Seigneur accepta et lui demanda d’aller lui chercher de l’eau. Parti vers la rivière, il rencontra une ravissante jeune fille près du rivage et oublia alors tout de sa quête. Il tomba amoureux, et perdit la notion du temps. Et il passa sa vie dans un rêve, dans ‘l’illusion’, sans se rendre compte qu’il avait devant les yeux ce qu’il avait demandé au Seigneur de ‘voir’. Il voyait la māyā à l’œuvre, mais sans le savoir, sans en être conscient. Seulement à la fin de ses jours, peut-être se réveilla-t-il de son rêve.
Appeler māyā « l’illusion », c’est ne voir que le voile, et non ce que ce voile recouvre.
Une tout autre ligne de compréhension du sens de māyā se dessine lorsqu’on choisit de lui rendre son sens originaire, étymologique, de « puissance (yā) de la mesure (mā)».
Tout est māyā, le monde, le temps, la sagesse, le rêve, l’action et le sacrifice. Le divin est aussi māyā, dans son essence, dans sa puissance, dans sa ‘mesure’.
« Le hymnes, les sacrifices, les rites, les observances, le passé et le futur, et ce que les Veda proclament – hors de lui, le maître de la mesure a créé ce Tout, et en lui, l’autre est enfermé par cette puissance de mesure (māyā). Qu’on sache que la nature primordiale est puissance de mesure (māyā), que le Grand Seigneur est maître de la mesure (māyin). Tout ce monde est ainsi pénétré par les êtres qui forment ses membres.»xii
Ces deux versets essentiels de la Śvetāśvatara–Upaniṣad (4.9 et 4.10) se lisent, en sanskrit :

On reconnaîtra les mots importants :
माया māyā, «la puissance de la mesure » ou « l’illusion »,
महेश्वरम् maheśvaram, « le Grand Seigneur »,
मायिनं māyin, « le maître de la mesure » ou « de l’illusion »,
प्रकृति prakṛti, « la nature matérielle ou primordiale ».
Il y a une réelle différence d’interprétation entre les traducteurs qui donnent à māyā le sens de « puissance de la mesure », comme on vient de voir chez Alyette Degrâces, et ceux qui lui donnent le sens d’ « illusion », ainsi que le fait Michel Hulin :
« Comprends la nature matérielle (प्रकृति prakṛti) comme illusion (माया māyā) et le Grand Seigneur (महेश्वरम् maheśvaram) comme illusionniste (मायिनं māyin). »xiii
Le célèbre sanskritiste Max Müller a choisi de ne pas traduire māyā, proposant seulement entre parenthèses le mot ‘Art’, ce qui donne:
« That from which the maker (māyin) sends forth all this – the sacred verses, the offerings, the sacrifice, the panaceas, the past, the future, and all that the Vedas declare – in that the other is bound up through that māyā.
Know then Prakṛti (nature) is Māyā (Art), and the great Lord the Māyin (maker) ; the whole world is filled with what are his members. »xiv
En note, Müller commente :
« Il est impossible de trouver des termes correspondant à māyā et māyin. Māyā signifie ‘fabrication’ ou ‘art’, mais comme toute fabrication ou création est seulement phénomène ou illusion, pour autant que le Soi Suprême est concerné, māyā porte aussi le sens d’illusion. De manière semblable, māyin est le fabricateur, l’artiste, mais aussi le magicien, le jongleur. Ce qui semble être signifié par ce verset, est que tout, tout ce qui existe ou semble exister, procède de l’akṣara [l’immortel], qui correspond au brahman, mais que le créateur effectif, ou l’auteur de toutes les émanations est Īśa, le Seigneur, qui, comme créateur, agit par la māyā ou devātmaśakti. Il est possible, par ailleurs que anya, ‘l’autre’, soit employé pour signifier le puruṣa individuel. »xv
A la suite de Max Müller, Alyette Degrâces refuse catégoriquement d’employer les mots ‘illusion’ et ‘illusionniste’. A propos du mot māyin elle explique, s’inspirant manifestement de la position du sanskritiste allemand :
« Ce terme est impossible à traduire, et surtout pas comme ‘illusionniste’ ainsi qu’on le trouve dans beaucoup de traductions (mais pas Max Müller ni les traducteurs indiens). La māyā, d’une racine MĀ « mesurer », signifie « une puissance de mesure », où la mesure désigne la connaissance. Si la mesure est mauvaise, on parlera alors d’illusion, mais pas avant. Brahman est ici māyin « maître de la mesure, de cette puissance de mesure », par laquelle le monde se manifeste. Lorsque le brahman prend un aspect relatif et qu’il crée le monde, le maintient ou le résorbe, il est défini par des attributs, il est dit saguṇa, aparaṃ brahman ou le maître de la mesure (māyin) par lequel le monde est déployé et par rapport auquel l’être humain doit actualiser son pouvoir de mesure pour ne pas surimposer ni confondre les deux niveaux du brahman, dont l’un est le support de tout. »xvi
Aparaṃ brahman, c’est le brahman « inférieur », non-suprême, doué de « qualités », de « vertus » (saguṇa). Il est le brahman créateur de l’Univers et il se distingue du brahman suprême, qui est quant à lui, sans nom, sans qualité, sans désir.
En consultant le dictionnaire de Monier-Williams au mot māyā, on voit que les sens les plus anciens du mot n’ont en effet rien à voir avec la notion d’illusion, mais renvoient vers les sens de « sagesse », de « pouvoir surnaturel ou extraordinaire ». C’est seulement dans le Ṛg Veda, donc plus tardivement, qu’apparaissent les notions que Monier-Williams énumère ainsi : « Illusion, unreality, deception, fraud, trick, sorcery, witchcraft, magic. An unreal or illusory image, phantom, apparition. »
Ces dernières acceptions sont toutes franchement péjoratives, et contrastent nettement avec les sens originels du mot, « sagesse », « pouvoir », s’appuyant sur l’étymologie de « mesure » (MĀ-).
On peut considérer qu’il y eut avant l’âge du Ṛg Veda, déjà lui-même fort ancien (plus d’un millénaire avant Abraham, Isaac et Jacob), un renversement presque complet du sens du mot māyā, passant de « sagesse » à « tromperie, fraude, illusion ».
Ces considérations peuvent nous mettre en mesure, si je puis dire, de tenter de répondre à la question initiale du « pourquoi ? » de la Création.
Pourquoi le brahman ‘paraṃ’ , ‘cause’ suprême, a-t-il délégué le soin au brahman ‘aparaṃ’ le soin de créer un univers si plein de maux et d’illusions ?
La raison est que māyā, originairement, représente non une illusion mais sa « Sagesse » et sa « Puissance ».
Le brahman est le maître de Māyā, Sagesse, Puissance, Mesure.
Et toute la Création, – le Tout, a aussi vocation à s’approprier cette Māyā.
Un millénaire plus tard, les Écritures (hébraïques) reprirent l’idée.
D’abord, elles mirent la sagesse au fondement et à l’origine du Tout.
« Mais avant toute chose fut créée la sagesse. »xvii
Avant le Siracide, les Upaniṣad avaient aussi décrit cette création primordiale, avant que rien ne fût :
« De lui est créée l’ancienne sagesse. »xviii
« Ce Dieu qui se manifeste pas sa propre intelligence – en lui, moi qui désire la délivrance, je prends refuge. »xix
Ensuite, les Écritures mirent en scène une sorte de délégation de pouvoir comparable à celle que l’on vient de voir entre le paraṃ brahman (le suprême brahman) et l’aparaṃ brahman (le non-suprême brahman).
Dans les Écritures, YHVH joue un rôle analogue à celui du brahman et délègue à la Sagesse (ḥokhmah) le soin de fonder la terre :
« YHVH, par la sagesse, a fondé la terre. »xx
Enfin il est intéressant de noter que le prophète (Job) ne dédaigne pas de contempler la Sagesse (divine) à l’œuvre, immanente, dans toutes les créatures.
« Qui a mis dans l’ibis la sagesse ? »xxi
Job avait compris l’essence de Māyā, en la distinguant même sous le couvert d’un volatile des marécages, au plumage blanc et noir. Ce n’était certes pas une ‘oie sauvage’, mais l’ibis pouvait lui être avantageusement comparé sur les bords du Nil (ou du Jourdain).
En citant l’Ibis comme image de la sagesse, Job n’ignorait pas que cet oiseau était le symbole du Dieu égyptien Thôt, Dieu de la Sagesse.
Non effrayé de reprendre des éléments culturels appartenant aux goyim égyptiens, Job préfigurait avec grâce le génie de l’anthropologie comparée du divin, sous toutes ses formes…
Puisqu’on en est à parler de syncrétisme, Thôt est une étrange préfiguration égyptienne du Verbe Créateur, dont un texte trouvé à Edfou relate la naissance et annonce la mission : « Au sein de l’océan primordial apparut la terre émergée. Sur celle-ci, les Huit vinrent à l’existence. Ils firent apparaître un lotus d’où sortit Rê, assimilé à Shou. Puis il vint un bouton de lotus d’où émergea une naine, une femme nécessaire, que Rê vit et désira. De leur union naquit Thôt qui créa le monde par le Verbe. »xxii
Après ce court détour par la ḥokhmah des Écritures, et par l’Ibis et le Dieu Thôt, figures de la sagesse dans l’Égypte ancienne, revenons à la sagesse védique, et à sa curieuse et paradoxale alliance avec la notion d’ignorance, , en brahman même.
Dans le Véda, c’est l’aparaṃ brahman qui crée la Sagesse. En revanche, dans le paraṃ brahman, dans le brahman suprême, il y a non seulement la Connaissance, il y a aussi l’Ignorance.
« Dans l’impérissable (akṣara), dans le suprême brahmanxxiii, infini, où les deux, la connaissance et l’ignorance, se tiennent cachées, l’ignorance est périssablexxiv, tandis que la connaissance est immortellexxv. Et celui qui règne sur les deux, connaissance et ignorance, est autre. »xxvi
Comment se fait-il qu’au sein du brahman suprême puisse se tenir cachée de ‘l’ignorance’ ?
De plus, comment pourrait-il y avoir quelque chose de ‘périssable’ au sein même de ‘l’impérissable’ (akṣara), au sein de l’immortel,?
Si l’on tient à respecter la lettre et l’esprit du Véda (révélé), il faut se résoudre à imaginer que même le brahman n’est pas et ne peut pas être ‘omniscient’.
Et aussi qu’il y a en lui, l’Éternel, quelque chose de ‘périssable’.
Contradiction ?
Comment l’expliquer ?
Voici comment je vois les choses.
Le brahman ne connaît pas encore ‘actuellement’ l’infinité infinie dont Il est porteur ‘en puissance’.
Imaginons que le brahman soit symbolisé par une infinité de points, chacun d’eux étant chargés d’une nouvelle infinité de points, eux-mêmes en puissance de potentialités infinies, et ainsi de suite, répétons ces récurrences infiniment. Et imaginons que cette infinité à la puissance infiniment répétée de puissances infinies est de plus non pas simplement arithmétique ou géométrique (des ‘points’), mais qu’elle est bien vivante, chaque ‘point’ étant en fait une ‘âme’, se développant sans cesse d’une vie propre.
Si l’on comprend la portée de cette image, on pourra alors peut-être concevoir que le brahman, quoique se connaissant lui-même en puissance, ne se connaît pas absolument ‘en acte’.
Sa puissance, sa Māyā, est si ‘infiniment infinie’ que même sa connaissance, certes déjà infinie, n’a pas encore pu faire le tour de tout ce qu’il y a encore à connaître, parce que tout ce qui est encore à être et à devenir n’existe tout simplement pas, et dort encore dans le non-savoir, et dans l’ignorance de ce qui est encore à naître, un jour, possiblement.
La sagesse, ‘infiniment infinie’, du brahman, n’a donc pas encore pu prendre toute la mesure de la hauteur, de la profondeur et de la largeur de la sagesse à laquelle le brahman peut atteindre.
Il y a des infinis qui dépassent l’infiniment infini même.
On pourrait appeler ces sortes d’infinis infiniment infinis, des « transfinis », pour reprendre un mot inventé par Georg Cantor. Conscient des implications théologiques de ses travaux en mathématiques, Cantor avait même comparé à Dieu l’« infini absolu », l’infini d’une classe comme celle de tous les cardinaux ou de tous les ordinauxxxvii.
Identifier un ensemble transfini de transfinis au brahman ne devrait donc pas être trop inconcevable a priori.
Mais c’est la conséquence de l’interprétation métaphysique de ces empilements d’entités transfinies qui est potentiellement la plus polémique.
Elle nous invite à considérer l’existence d’une sorte d’ignorance ‘en acte’ au cœur du brahman.
Un autre verset accumule les indices en ce sens.
On y parle du brahman, ‘bienveillant’, qui ‘fait la non existence’.
« Connu par le mental, appelé incorporel, lui le bienveillant qui fait l’existence et la non-existence, lui le Dieu qui fait la création avec ses parties – ceux qui le connaissent ont laissé leur corps. »xxviii
Comment un Dieu suprême et bienveillant peut-il ‘faire’ du ‘non-existant’ ?
On peut comprendre que ce que ce Dieu fait ne se fait que parce qu’il s’ampute de certaines ‘parties’ de Lui-même.
C’est avec ce sacrifice, ce départ du divin d’avec le divin, que peuvent advenir à l’existence ce qui serait demeuré dans la non-existence.
Autre manière de comprendre : c’est parce que le Dieu consent à une certaine forme de non-existence, en Lui, que de l’existant peut venir à l’existence.
Il n’est pas inutile de comparer la version de A. Degrâces avec la traduction de Max Müller, qui apporte une clarté supplémentaire sur ces lignes obscures.
« Those who know him who is to be grasped by the mind, who is not to be called the nest (the body), who makes existence and non-existence, the happy one (Śiva), who also creates the elements, they have left the body. »xxix
Traduction de la traduction :
‘Ceux qui le connaissent, lui qui doit être saisi par l’esprit, lui qui ne doit pas être appelé le nid (le corps), lui qui fait l’existence et la non-existence, cet heureux (Śiva), lui qui crée aussi les éléments, ceux-là ont quitté leur corps.’
‘The nest, the body’. Le mot sanskrit vient du verbe: nīdhā, नीधा, « déposer, poser, placer ; cacher, confier à ». D’où les idées de ‘nid’, de ‘cachette’, de ‘trésor’, implicitement associées à celle de ‘corps’.
Cependant, Müller note que Śaṅkara préfère lire ici le mot anilākhyam, ‘ce qui est appelé le vent’, ce qui est prāṇasya prāṇa, le ‘souffle du souffle’.
L’image est belle : c’est par le souffle, qui vient puis qui quitte le corps, que se continue la vie.
‘Who also creates the elements.’ ‘Lui qui crée les éléments’, kalāsargakaram. Müller mentionne plusieurs interprétations possibles de cette expression.
Celle de Śaṅkara, qui comprend :’Lui qui crée les seize kalās mentionnés par les Âtharvaṇikas, commençant avec le souffle (prāṇa) et se terminant avec le nom (nāman).La liste de ces kalās est, selon Śaṅkarānanda : prāṇa,śraddhā, kha, vāyu, jyotih, ap, pṛthivī, indriya, manaḥ, anna, vīrya, tapah, mantra, karman, kalā, nāman.
Vigñānātman suggère deux autres explications, ‘Lui qui crée par le moyen du kalā, [sa puissance propre]’, ou encore ‘Lui qui crée les Védas et les autres sciences’.
L’idée générale est que pour ‘connaître’ l’Immortel, le brahman, le Bienveillant, le créateur de l’existence et de la non-existence, il faut quitter le ‘nid’.
Il faut partir en exil.
Il y a la même idée chez Abraham et Moïse.
La dernière partie de la Śvetāśvatara–Upaniṣad évoque le ‘Seigneur suprême des seigneurs’, la ‘Divinité suprême des divinités’, expressions qui sont, formellement du moins, analogues aux noms YHVH Elohim et YHVH Tsabaoth, – apparus dans la conscience des Hébreux plus de mille ans après l’idée védique.
« Lui, le Seigneur suprême des seigneurs, lui la Divinité suprême des divinités, le Maître suprême des maîtres, lui qui est au-delà, trouvons-le comme le Dieu, le Seigneur du monde qui est à louer. »xxx
A nouveau, proposons la version de Max Müller :
« Let us know that highest great Lord of lords, the highest deity of deities, the master of masters, the highest above, as God, the Lord of the world, the adorable. »xxxi

Le premier hémistiche se lit:
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं
Tam īśvarāṇām paramam Maheśvaram.
‘Lui, des seigneurs, – le suprême Seigneur ’.
Qui sont les ‘seigneurs’ (īśvarāṇām)? Śaṅkara, dans son commentaire, cite la Mort, le fils du Soleil et d’autres encore (Cf. SUb 6.7).
Et surtout, qui est ce ‘Lui’ (tam) ?
Une série de qualifiants est énumérée :
Lui, le Dieu suprême des dieux (devatānām paramam Daivatam).
Lui, le Maître (patīnām) des maîtres, le Maître des Prajāpatis, – qui sont au nombre de dix : Marīci, Atri, Aṅgiras, Pulastya, Pulaka, Kratu, Vasiṣṭa, Pracetas, Bhṛgu, Nārata.
Lui, qui est ‘Plus-Haut’ (paramam) ‘que le Haut’ (parastāt)
Lui, qui est ‘Plus-Haut’ que la Sagesse (la Māyā)
Lui, qui est le Seigneur des mondes (bhuvaneśam)
Lui, qui est digne d’adoration (īdyam)
Et la litanie continue :
Lui, il est la Cause (saḥ kāraṇam)xxxii.
Lui, le Dieu Un (ekaḥ devaḥ), caché (gūḍhaḥ) dans tous les êtres (sarva-bhūteṣu), le Tout-pénétrant (sarva-vyāpī), il est le soi intérieur de tous les êtres(sarva-bhūta-antarātmā), il est le Veilleur de tous les actes (karma-adhyakṣaḥ), il réside en tous les êtres (sarva-bhūta-adhivāsaḥ), il est le Témoin ou le Voyant (en anglais Seer, et en sanskrit sākṣī), le Connaisseur, celui qui donne l’intelligence (cetā), l’unique Absolu (kevalaḥ), celui qui est au-delà des qualités (nirguṇaḥ).xxxiii
Lui : « Il est l’Éternel parmi les éternels, l’Intelligent parmi les intelligents, l’Un qui accomplit les désirs de beaucoup ».xxxiv
A nouveau, il faut se tourner vers Max Müller, pour déceler ici un autre niveau de sens, qui mérite l’approfondissement.
Müller écrit en effet en note : « I have formerly translated this verse, according to the reading nityo ’nityānām cetanaś cetanānām, the eternal thinker of non-eternalxxxv thoughts. This would be a true description of the Highest Self, who, though himself eternal and passive, has to think (jivātman) non-eternal thoughts. I took the first cetanah in the sens of cettā, the second in the sense of cetanamxxxvi. The commentators, however, take a different, and it may be, from their point, a more correct view. Śaṅkara says : ‘He is the eternal of the eternals, i.e. as he possesses eternity among living souls (jīvas), these living souls also may claim eternity. Or the eternals may be meant for earth, water, &c. And in the same way, he is the thinker among thinkers.’
Śaṅkarānanda says: ‘He is eternal, imperishable, among eternal, imperishable things, such as the ether, &c. He is thinking among thinkers.’
Vigñānātman says : ‘The Highest Lord is the cause of eternity in eternal things on earth, and the cause of thought in the thinkers on earth.’ But he allows another construction, namely, that he is the eternal thinker of those who on earth are endowed with eternity and thought. In the end all these interpretations come to the same, viz. that there is only one eternal, and only one thinker, from whom all that is (or seems to be) eternal and all that is thought on earth is derived. »xxxvii
On lit dans le commentaire de Śaṅkara de ce même verset, traduit par Gambhirananda : « nityaḥ, ‘the eternal’, nityānām, ‘among the eternal, among the individual souls’ – the idea being that the eternality of these is derived from His eternality ; so also, cetanaḥ, the consciousness, cetanānām, among the conscious, the knowers. (…) How is the consciousness of the conscious ?»xxxviii
A cette dernière question, ‘Comment est la conscience du conscient ?’, Śaṅkara répond par la strophe suivante de l’Upaniṣad:
« There the sun does not shine, neither do the moon and the stars ; nor do these flashes of lightning shine. How can this fire ? He shining, all these shine ; through His lustre all these are variously illumined. »xxxix
« Là ni le soleil brille, ni la lune ni les étoiles, ni les éclairs ne brillent, encore moins ce feu. A sa suite, quand il brille, tout brille, par la lumière ce Tout est éclairé. »xl
Le sens en est que le brahman est la lumière qui illumine toutes les autres lumières. Leur brillance a pour cause la lumière intérieure de la conscience du Soi qu’est le brahman, selon Śaṅkaraxli .
Le brahman illumine et brille à travers toutes les sortes de lumières qui se manifestent dans le monde. D’elles on induit que la ‘conscience du conscient’, la conscience du brahman est en essence ‘fulguration’, le Soi ‘effulgent’.
Max Müller avait initialement décidé de traduire le verset SU 6.13 en le lisant littéralement : nityo ’nityānām cetanaś cetanānām, ce qu’il comprend ainsi : ‘le penseur éternel de pensées non-éternelles’.
Idée paradoxale, ouvrant d’un coup, immensément, la réflexion métaphysique sur la nature même de la pensée et sur celle de l’éternité…
Cependant, vu l’accord presque unanime des divers commentateurs historiques qu’il cite a contrario de sa propre intuition, Müller semble renoncer, non sans un certain regret, à cette stimulante traduction, et il traduit finalement, en reprenant la version de Śaṅkarānanda :
« He is the eternal among the eternals, the thinker among thinkers, who, though one, fulfils the desire of many. »xlii
‘Il est l’Éternel entre les éternels, le Penseur parmi les penseurs, Lui, qui quoique Un, accomplit les désirs de beaucoup.’
Dommage. Il y a beaucoup à creuser dans l’idée d’un ‘penseur éternel’ qui penserait des ‘pensées non-éternelles’.
L’implication littéralement sidérante de cette idée est que des pensées non-éternelles de l’Éternel seraient constitutives de l’existence du temps lui-même (par nature non-éternel). Elles seraient aussi, de plus, la condition de la possibilité d’existence des créations (non-éternelles).
Ces pensées et ces créations ‘non-éternelles’, seraient intrinsèquement en croissance, métamorphiques, évolutives, en gésine, en puissance.
Peut-être serait-ce là aussi le début de intuition d’une métaphysique de la pitié et de la merci, une reconnaissance de la grâce que le Dieu pourrait éprouver pour sa Création, considérant sa faiblesse, sa chute et son éventuelle rédemption ?
Autrement dit, le fait même que le Dieu, le brahman, pourrait avoir des pensées non-éternelles serait la condition nécessaire pour que, par sa grâce, par son renoncement à l’absoluité et à l’éternité de ses jugements a priori, les créatures non-éternelles soient admises à passer de la non-éternité à l’éternité.
Car si les pensées du brahman devaient être éternelles par nature, alors plus moyen de changer un monde clos, prédéterminé de toute éternité, et conséquemment manquant tout-à-fait de sens, – et de miséricorde.
On a peut-être une indication permettant de soutenir cette vue, lorsqu’on lit :
« Lui, qui d’abord créa Brahmā, qui en vérité lui présenta les Veda, ce Dieu qui se manifeste lui-même par sa propre intelligencexliii – en Lui, moi qui désire la délivrance, je cherche refuge. »xliv
‘Ce Dieu qui se manifeste lui-même par sa propre intelligence’.
Śaṅkara donne plusieurs autres interprétations du texte original.
Les uns lisent ici en sanskrit ātma-buddhi-prasādam, ‘celui qui rend favorable la connaissance du Soi’. Car, lorsque le Seigneur suprême en fait parfois la grâce, l’intelligence de la créature acquiert un savoir valide à Son sujet, se libère alors de son existence relative, puis continue de s’identifier avec le brahman.
D’autres lisent ici ātma-buddhi-prakāśam, ‘celui qui révèle la connaissance du Soi’.
Autre interprétation encore: ātmā (le Soi) est Lui-même le buddhi (la Sagesse, la Connaissance). Celui qui se révèle Lui-même en tant que connaissance du Soi est ātma-buddhi-prakāśam.xlv
‘En Lui, désireux de délivrance (mumukṣuḥ) je cherche (prapadye) refuge (śaraṇam)’ : n’est-ce pas là l’intuition védique, avérée, de la miséricorde du brahman envers sa créature ?
On le voit, le Véda était pénétré de la puissance explosive de plusieurs directions de recherche sur la nature du brahman. Mais l’histoire montre que le développement explicite de ces recherches vers l’idée de ‘miséricorde divine’ devait faire plus spécifiquement partie de l’apport subséquent d’autres religions, qui restaient encore à venir, comme la juive, la bouddhiste et la chrétienne.
En les attendant, le Véda affirme déjà en grand éclaireur, en témoin premier, son génie propre : le brahman, Lui, il est ‘l’oie sauvage’, il est le Soi, il est ‘le feu entré dans l’océan’, il est la ‘matrice’ et le ‘tout-pénétrant’.
« Il est Lui, l’oie sauvage, l’Une au milieu de cet univers. Il est en vérité le feu qui est entré dans l’océan. Et seulement quand on Le connaît, on dépasse la mort. Il n’y a pas d’autre chemin pour y aller. »xlvi
‘Il est Lui, l’oie sauvage, l’Une au milieu de cet univers’. On a déjà rencontré au début de l’Upaniṣad l’image de ‘l’oie sauvage’ (haṃsa)xlvii, qui s’appliquait à l’âme individuelle, ‘errant ici et là’ dans le grand Tout. Désormais cette oie est plus que l’âme, plus que le Tout, elle est le brahman même.
‘Et seulement quand on Le connaît, on dépasse la mort. Il n’y a pas d’autre chemin pour y aller.’ Śaṅkara décompose chaque mot du verset, qui révèle alors son rythme 3-3 4-3 4 4-3 :
Viditvā, en connaissant ; tam eva, Lui seul ; atiyety, on va au-delà ; mṛtyum, de la mort ; na vidyate, il n’y a pas ; anyaḥ panthāḥ, d’autre chemin ; ayanā, par où aller.xlviii
Les images de la ‘matrice’ et du ‘Tout-pénétrant’ apparaissent dans les deux strophes suivantes (SU 6.16 et 6.17) :
« Il est le créateur de Tout, le connaisseur de Tout, il est le Soi et la matrice, le connaisseur, le créateur du temps.»xlix
‘Il est le Soi et la matrice’, ātma-yoniḥ. Śaṅkara propose trois interprétations de cette curieuse expression : Il est sa propre cause – Il est le Soi et la matrice (yoni) – Il est la matrice (la source), de toutes choses.
Si le brahman est yoni, il est aussi le Tout-pénétrant.
« Lui qui devient cela [lumière]l, immortel, établi comme le Seigneur, le connaisseur, le tout-pénétrant, le protecteur de cet univers, c’est Lui qui gouverne à jamais ce monde. Il n’y a pas d’autre cause à la souveraineté. »li
Au début et à la fin de l’Upaniṣad du ‘blanc mulet’, on trouve donc répétée cette image, blanche et noire, de l’oie – du Soi – volant dans le ciel.
L’oie vole dans un ciel qui voile.
Que voile ce ciel? – La fin de la souffrance.
C’est ce que dit l’un des versets finaux :
« Quand les hommes auront enroulé le ciel comme une peau, alors seulement prendra fin la souffrance, au cas Dieu n’aurait pas été reconnu. »lii
‘Quand les hommes auront enroulé le ciel.’
Plus loin vers l’Occident, à peu près au même moment, le prophète Isaïe usa d’une métaphore analogue à celle choisie par Śvetāśvatara :
« Les cieux s’enroulent comme un livre »liii.
וְנָגֹלּוּ כַסֵּפֶר הַשָּׁמָיִם Vé-nagollou kha–sfèr ha-chamaïm.
Il y a en effet un point commun entre ces deux intuitions, la védique et la juive.
De façon parfaitement non orthodoxe, je vais utiliser l’hébreu pour expliquer le sanskrit, et réciproquement.
Pour dire ‘enrouler’ les cieux, l’hébreu emploie comme métaphore le verbe גָּלָה galah, « se découvrir, apparaître ; émigrer, être exilé ; et au niphal, être découvert, à nu, se manifester, se révéler ».
Lorsqu’on ‘enroule’ les cieux, alors Dieu peut ‘se manifester, se révéler’. Ou au contraire, Il peut ‘s’exiler, s’éloigner’.
Ambiguïté et double sens du mot, qui se lit dans cet autre verset d’Isaïe : « Le temps (dor) [de ma vie] est rompu et s’éloigne de moi ».liv
L’homme juif enroule les rouleaux du livre de la Torah, quand il en a terminé la lecture.
L’homme védique enroule les rouleaux du ciel quand il a fini sa vie de vol et d’errance. C’est-à-dire qu’il enroule sa vie, comme une ‘tente’ de bergers, lorsqu’ils décampent.
Mais cette tente peut aussi être ‘arrachée’ (נִסַּע nessa’), et jetée (וְנִגְלָה vé–niglah) au loin.lv
Ces métaphores ont été filées par Isaïe.
« Je disais : Au milieu de mes jours, je m’en vais, aux portes du shéol je serai gardé pour le reste de mes ans.
Je disais : Je ne verrai pas YHVH sur la terre des vivants, je n’aurai plus un regard pour personne parmi les habitants du monde.
Mon temps [de vie] est arraché, et jeté loin de moi, comme une tente de bergers; comme un tisserand j’ai enroulé ma vie. »lvi
Le ciel védique, comme la vie de l’homme, est une sorte de tente.
L’oie sauvage montre le chemin.
Il faut enrouler le ciel et sa vie, et partir en transhumance.
iiŚvetāśvatara–Upaniṣad with the commentary of Śaṅkarācārya. Trad. Swami Gambhirananda. Ed. Adavaita Ashrama. Kolkata 2009, p.v
iiiJ’adapte ici légèrement la traduction d’Alyette Degrâces du mot karāṇa en ajoutant l’article, m’appuyant sur la traduction de Max Müller : « Is Brahman the cause ? », qui s’adosse elle-même, selon Müller, sur les préférences de Śaṅkara. Cf. Max Muller. Sacred Books of The East. Śvetāśvatara–Upaniṣad 1.1.Oxford 1884.Vol XV, p.231, note 1. Le dictionnaire Huet donne pour karāṇa : ‘raison, cause, motif ; origine ; principe’. Quant à lui, Gambhirananda traduit par ‘source’: « What is the nature of Brahman, the source ? »
ivŚvetāśvatara–Upaniṣad 1.1. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p.396
vŚvetāśvatara–Upaniṣad 1.6. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p.397
viŚvetāśvatara–Upaniṣad 1.6. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p.397
viiŚvetāśvatara–Upaniṣad 3.1. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p.403
viiiL’enseignement de Râmakrishna. Trad Jean Herbert. Albin Michel. 2005, p.45
ixŚvetāśvatara–Upaniṣad 4.1. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p.407
xSUb 4.5. Cf. Note 1760. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p.407
xiŚvetāśvatara–Upaniṣad 4.4. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p.407
xiiŚvetāśvatara–Upaniṣad 4.9-10. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 408-409
xiiiŚvetāśvatara–Upaniṣad 4.10. Trad. Michel Hulin. Shankara et la non-dualité. Ed. Bayard. 2001, p.144
xivMax Muller. Sacred Books of The East. Upaniṣad. Oxford 1884. Vol XV, p.251, n.1
xvMax Muller. Sacred Books of The East. Śvetāśvatara–Upaniṣad 4.9-10.Oxford 1884.Vol XV, p.251-252
xviLes Upaniṣad. Śvetāśvatara–Upaniṣad 4.9. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 408, note 1171
xviiiLes Upaniṣad. Śvetāśvatara–Upaniṣad 4.18. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 410
xixLes Upaniṣad. Śvetāśvatara–Upaniṣad 6.18. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 417
xxiiiLe param brahman est ce qui est au-delà (para) de Brahmā.
xxivPérissable : kṣara. Śaṅkara explique en Sub 5.1 que ce caractère ‘périssable’ est la ‘cause de l’existence au monde’ (saṃsṛtikārana). Immortelle : akṣara. Śaṅkara explique que ce caractère d’immortalité est la ‘cause de la délivrance’ (mokṣahetu).
xxvPérissable : kṣara. Śaṅkara explique en Sub 5.1 que ce caractère ‘périssable’ est la ‘cause de l’existence au monde’ (saṃsṛtikārana). Immortelle : akṣara. Śaṅkara explique que ce caractère d’immortalité est la ‘cause de la délivrance’ (mokṣahetu).
xxvi Śvetāśvatara–Upaniṣad 5.1.Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 411
xxviiIgnacio Jané, « The role of the absolute infinite in Cantor’s conception of set », Erkenntnis, vol. 42, no 3, mai 1995, p. 375-402 (DOI 10.1007/BF01129011)
xxviiiŚvetāśvatara–Upaniṣad 5.14.Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 413
xxixMax Muller. Sacred Books of The East. Śvetāśvatara–Upaniṣad 4.9-10.Oxford 1884.Vol XV, p.258-259
xxxŚvetāśvatara–Upaniṣad 6.7.Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 415
xxxiMax Muller. Sacred Books of The East. Śvetāśvatara–Upaniṣad 6.7.Oxford 1884.Vol XV, p.263
xxxiiŚvetāśvatara–Upaniṣad 6.9.Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 416
xxxiiiŚvetāśvatara–Upaniṣad 6.11.Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 416
xxxivŚvetāśvatara–Upaniṣad 6.13.Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 416
xxxvMüller lit : ’nityānām, non éternel (mot souligné par moi).
xxxviCes nuances correspondent à deux cas déclinés du nom cetana, respectivement, le premier au nominatif (penseur) et le second au génitif pluriel (des pensées). Le Dictionnaire Sanskrit-Anglais de Monier Monier-Williams donne pour cetana : ‘conscious, intelligent, sentient ; an intelligent being; soul, mind ; consciousness, understanding, sense, intelligence’. Pour cetas : ‘splendour ; consciousness, intelligence, thinking soul, heart, mind’. Par ailleurs, le Dictionnaire Sanskrit-Français de Huet donne pour cetana : ‘intelligence, âme ; conscience, sensibilité ; compréhension, intelligence.’ La racine est cet-, ‘penser, réfléchir, comprendre ; connaître, savoir.’ Pour cetas : ‘conscience, esprit, cœur, sagesse, pensée’.
xxxviiMax Muller. Sacred Books of The East. Śvetāśvatara–Upaniṣad 6.13.Oxford 1884.Vol XV, p.264, note 4
xxxviiiŚvetāśvatara–Upaniṣad with the commentary of Śaṅkarācārya. Trad. Swami Gambhirananda. Ed. Adavaita Ashrama. Kolkata 2009, SU 6.13, p.193
xxxixŚvetāśvatara–Upaniṣad with the commentary of Śaṅkarācārya. Trad. Swami Gambhirananda. Ed. Adavaita Ashrama. Kolkata 2009, SU 6.14, p.193
xlVoir des strophes presque identiques dans MuU 2.2.11, KaU 2.2.15, BhG 15.6
xliiMax Muller. Sacred Books of The East. Śvetāśvatara–Upaniṣad 6.13.Oxford 1884.Vol XV, p.264
xliiiMax Muller traduit : « I go for refuge to that God who is the light of his own thoughts ». Sacred Books of The East. Śvetāśvatara–Upaniṣad 6.18.Oxford 1884.Vol XV, p.265
xlivŚvetāśvatara–Upaniṣad 6.18.Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 417
xlvŚvetāśvatara–Upaniṣad with the commentary of Śaṅkarācārya. Trad. Swami Gambhirananda. Ed. Adavaita Ashrama. Kolkata 2009, SU 6.18, p.198
xlviŚvetāśvatara–Upaniṣad 6.16.Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 417
xlviiŚvetāśvatara–Upaniṣad 1.6. Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p.397
xlviiiŚvetāśvatara–Upaniṣad with the commentary of Śaṅkarācārya. Trad. Swami Gambhirananda. Ed. Adavaita Ashrama. Kolkata 2009, SU 6.15, p.195
xlixŚvetāśvatara–Upaniṣad 6.16.Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 417
lŚaṅkara comprend ici le mot tanmayaḥ (‘fait de cela’) comme signifiant en réalité jyotirmaya, ‘fait de lumière’, cf. Sub 6,17
liŚvetāśvatara–Upaniṣad 6.17.Trad. Alyette Degrâces, Fayard, 2014, p. 417
lii« Only when men shall roll up the sky like a hide, will there be an end of misery, unless God has first been known. ». Max Muller. Sacred Books of The East. Śvetāśvatara–Upaniṣad 6.20.Oxford 1884.Vol XV, p.266
Partage (et 'agitprop' ...) :





















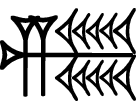









Vous devez être connecté pour poster un commentaire.