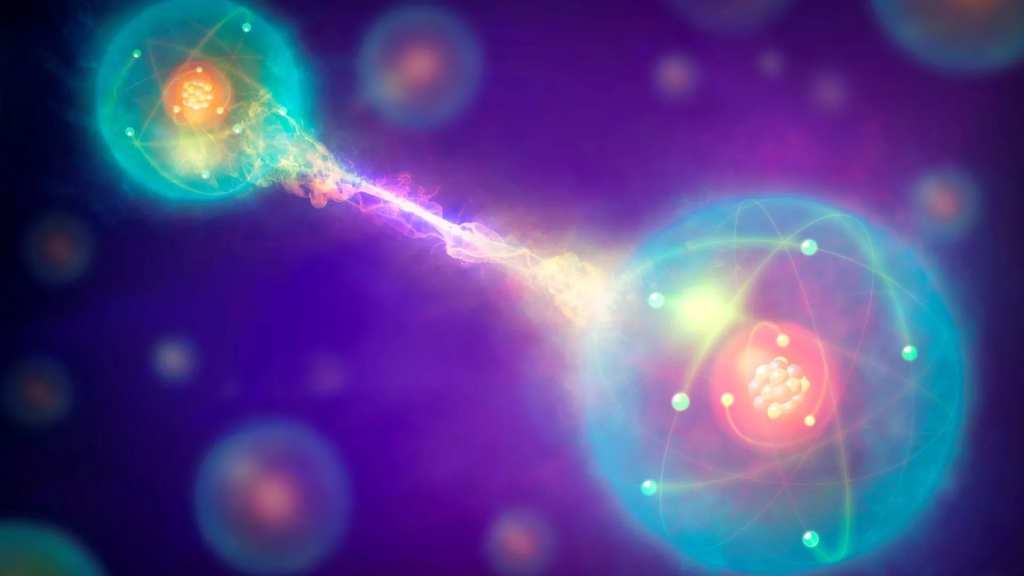
De « l’Un », à l’évidence, on ne peut jamais rien dire d’autre qu’il est « un ». Non seulement l’Un est un, et donc seulement un, mais il ne peut se dire d’aucune « autre » manière, justement parce qu’il est un. Comment l’un pourrait-il être « autre » qu’un ? D’ailleurs ce nom, « l’Un », est déjà en trop. Il obscurcit sa véritable essence (qui est de n’en avoir point). Cette assignation à « être un » réduit et affadit son existence (qui relève sans doute de l’ordre de l’infini, et non seulement de l’un). Il est vrai que le concept de « l’Un » est censé être absolument simple, infiniment élevé, et radicalement différent de tout ce qui se trouve ici-bas. Il se distingue de toutes les sortes de multiplicités qui se trouvent dans le monde. Mais, paradoxalement, l’idée même d’« unité » vient du monde ; et on trouve beaucoup de sortes d’unité dans le monde. Cette idée, aussi élevée soit-elle, ne peut donc être attribuée sans hésitation à ce qui, clairement, ne relève pas de ce monde. Parler de « l’Un » est déjà une sorte de subtile défiguration de sa vraie nature (qui est de n’en avoir point de définissable). Il faut admettre que le divin, fût-il « un » ne peut pas être l’objet de discours humains. Le mieux serait de se taire, et de ne le nommer pas. Dire qu’il est « l’Un », c’est déjà errer, c’est d’emblée prononcer (même en toute bonne foi) une inexactitude formelle, et même, si on creuse un peu, une ineptie, intellectuellement parlant. Car le mot « un » n’est en somme qu’un mot. L’hébreu אֶחָד (êḥad) et le grec ἕν (hen) aussi, ne sont jamais que des mots. Or aucun mot ne peut rendre compte de ce que l’Un est. Car l’Un, en réalité, n’a pas d’essence : il est au-delà de toute essence. S’il en avait une, elle lui serait identique, et donc elle nous serait inconcevable, ineffable. A son propos, le silence serait mieux approprié.
Pourtant, il faut bien parler, dire, penser, concevoir. La vie humaine est ainsi faite. Et penser revient parfois à classer et à hiérarchiser les concepts, et les êtres. D’où cette gradation : être, vivre, penser… Il y a la matière qui ‘est’, mais qui reste ‘non-vivante’, ‘inconsciente’ ; puis il y a l’être ‘vivant’, et enfin il y a l’être pleinement ‘conscient’, ‘pensant’. Glorification de l’évolution ! Self-célébration de l’homme pensant par lui-même ! Quelques philosophes (pré-modernes) eurent d’autres idées, et conçurent d’autres gradations. Pour Plotin, la ‘vie’ se trouve aux extrêmes, le plus bas et le plus haut, et la ‘conscience’ réfléchie ne se trouve qu’à un étage intermédiaire. Il y a la ‘vie’ du bas, une vie aveugle, sourde, immanente, inconsciente, mais qui reste puissamment liée à l’univers entier, et il y a la ‘vie’ supérieure, une vie qui dépasse de loin ce qu’on appelle la ‘conscience’, une vie très haute, infinie, qui sourd de l’Un même. Cet Un, on vient certes d’en dire que l’on ne peut rien en ‘dire’. On peut au moins en dire ceci, qu’il doit être ‘Créateur’, et que la vie en sourd, toujours. Comme l’on peut voir que la vie fourmille et grouille sous nos yeux, ici-bas, il serait bien possible que cette vie-là pourrait peut-être nous donner un moyen de comprendre ce qu’est la ‘vie’ supérieure, dont elle serait peut-être comme une image, bien meilleure, assurément, que tout ce que la ‘conscience’ elle-même pourrait concevoir d’autre pour la saisir.
Quelle serait l’essence de cette ‘vie supérieure’ (si elle existe) ? Comment la décrire ? Que peut-on en penser ? Comment s’assurer de son existence ? S’agit-il de la ‘vie’ divine elle-même, dans toute sa transcendance, tout à fait hors de notre atteinte ? Qu’aurait-elle alors de commun avec la vie inconsciente, immanente, ou la vie terrestre, humaine ? Le point commun entre toutes les sortes de vies est indubitablement le fait de ‘vivre’, même si toutes les vies vivent selon des modalités bien différentes.
La vie serait donc un point commun possible entre le divin et l’humain. Le divin vit (éternellement). L’humain vit (pour un temps). L’idée de ‘vie’ est essentielle à la divinité. Elle est aussi essentielle à l’humain. Que peut-on dire de plus, à propos de la ‘vie divine’, en termes humains? Est-elle une vie particulièrement consciente ? Plus consciente que la conscience humaine ? Ou peut-être même, en un sens, moins consciente ?
Est-ce que l’entité ‘divine’ (si elle existe sous une forme telle que l’on pourrait la désigner comme une ‘entité’) peut être dite ‘intelligente’ ? Peut-elle être, mieux encore, appelée « l’Intelligence » ? Il y a de l’intelligence dans ce monde (par exemple chez les humains), de même qu’il y a de la vie. Peut-on en inférer qu’il y a donc aussi de l’« intelligence » dans le Principe qui a créé le monde et lui a donné la ‘vie’ ? Cela semble raisonnable de le penser, mais il ne faut pas se précipiter vers une conclusion hâtive. Peut-être le concept d’intelligence, en effet, pourrait-il ne pas convenir au Principe premier, au Principe créateur de Tout, et donc aussi créateur de l’intelligence ?
Si ce concept cependant lui convenait, le Principe créateur ne serait pas seulement ‘intelligent’, il devrait être l’Intelligence avec un I majuscule, « l’Intelligence » en soi, et tout ce qui viendrait du Principe pour aller vers les créatures serait alors ‘inférieur’ (en intelligence) à cette Intelligence première. Mais une intelligence créée serait sans doute, par nature, essentiellement différente de l’Intelligence créatrice (tout comme l’intelligence ‘artificielle’ est essentiellement différente de l’intelligence humaine, si l’on désire une analogie). Ici, on peut émettre une objection. Si l’Intelligence existe en tant qu’essence, cette essence ne peut se séparer ou se distinguer d’elle-même, car une essence ne se divise ni ne se diminue, elle reste toujours essentiellement elle-même. Donc l’essence de l’Intelligence devrait être de la même essence que l’essence de l’intelligence. Nous en somme réduits à considérer cette alternative : ou bien le Principe premier peut être dit ‘intelligent’ ou même être ‘l’Intelligence en soi’, et alors les créatures ‘intelligentes’ participent de cette Intelligence, et sont potentiellement capables d’en hériter ; ou bien, le Principe premier ne peut pas être dit ‘intelligent’, car cet attribut serait trop faible, trop inadapté à son cas. Alors, il faut renoncer à donner au Principe premier le nom « Intelligence ». Il serait, en essence, au-delà de l’intelligence, et mettre une majuscule au mot Intelligence ne changerait rien à cette conclusion.
La pensée humaine (qui est la seule pensée sur laquelle on peut s’efforcer de penser avec quelque espoir de la comprendre) est un acte de l’intelligence (humaine). La pensée ‘voit’ l’intelligible : elle ‘comprend’ ce qu’il y a d’intelligible dans telle chose ou tel être. Elle se tourne vers tout ce qui lui est, en principe, intelligible, et elle en reçoit satisfaction, achèvement, plénitude, gratification. C’est l’intelligible, en tant qu’il est vu et compris par la pensée qui révèle en quelque sorte la pensée à elle-même, et nourrit la conscience. Dans cette interprétation, la pensée, ou l’intelligence en acte, se tourne vers quelque chose qui lui est supérieur, l’intelligible, qui lui donne à voir quelque chose qu’elle n’avait encore jamais vu.
Si l’on revient à l’essence du Principe premier, on pourrait donc dire, à la rigueur, qu’il n’est pas l’Intelligence, puisqu’il est bien au-delà de toute intelligence, mais qu’il est, du moins en partie, et de quelque manière, « intelligible ». Dans ce contexte, « intelligible » serait aussi un synonyme du « Bien » que le Principe divin représente, ce « Bien » qu’il faut tenter d’approcher et de comprendre.
L’intelligence, dans cette vue, ne serait certes pas identique au Principe premier ou à ce que l’on appelle l’Un, et qui, en tant qu’Un n’est certainement pas le Multiple. L’intelligence, quant à elle, n’est pas simple, elle est évidemment multiple, elle est capable de voir et de comprendre une innombrable multiplicité de choses, et de s’adapter à des myriades de situations, et de contextes. Elle est déjà elle-même multiple à ses propres yeux : elle se voit comme ‘pensante’ et elle se voit aussi comme objet de ‘pensée’, comme objet de sa propre pensée.
Comment l’intelligence apparaît-elle dans le monde créé ? Est-elle liée de quelque manière à l’intelligible ? Cela serait assez logique que l’intelligence (ici-bas) soit liée à l’intelligible (là-haut), mais comment cela s’initierait-il, et comment cela s’articulerait-il ? L’intelligence est-elle, par le truchement de l’intelligible, liée à la nature divine, au Principe premier ? On conjecture que le Principe premier, l’Un, reste toujours en lui-même, et n’a pas besoin de se comprendre lui-même. Il n’aurait guère d’usage, en tant qu’Un, pour cet attribut un peu superflu que lui serait une Intelligence… L’Un est ce qu’il est ou qui il est, et toute intelligence de cet état lui serait superflue, puisqu’il est, vit et jouit de son être selon sa propre nature, dont rien ne nous dit qu’elle a nécessairement besoin d’une ‘intelligence’, pour être, vivre et jouir.
Ce qu’il y a d’intelligible en l’Un, tout comme ce qui nous semble inintelligible en lui, participent de son unité interne, essentielle. La conception que le Principe peut avoir de lui-même pourrait être interprétée comme une ‘sorte de conscience’. Cette ‘sorte de conscience’ n’est rien d’autre que sa propre essence. Sa ‘conscience’ n’est que la pensée de cette essence. Cette pensée est sans doute fort différente de la pensée de l’intelligence, la pensée de notre intelligence. Quand l’Un, ou le Principe, reste seulement lui-même, et avec lui-même, Il peut aussi, fort paradoxalement et mystérieusement, créer une Création qui n’est pas lui-même ; Il peut donner être et vie à ce qui n’est pas lui, mais mais qui, néanmoins, vient de lui. Grâce à sa permanence essentielle en son propre être, l’Un crée du devenir, et de l’autre. C’est là un paradoxe que l’on nommera celui de l’intrication de l’être et du devenir, du même et de l’autre, de la permanence et de la spiration. L’Un persiste dans sa propre pensée, comme sujet et objet de sa pensée. Cette pensée, on l’a dit, n’est pas une pensée ‘intelligente’, elle n’est pas une pensée de l’intelligence ; elle est néanmoins une pensée ‘intelligible’, mais intelligible seulement en très faible partie (par nous les humains). Tout ce qui naît de lui, tout ce qui naît de sa pensée intelligible, peut alors devenir à son tour une pensée ‘créée’, une pensée ‘autre’, une pensée qui pourra même devenir ‘intelligente’, une pensée qui pourra par exemple s’efforcer de penser au Principe dont elle est née, une pensée qui, par là, deviendra elle-même une ‘intelligence’, capable de penser à l’intelligible, dans la mesure où cet intelligible se laisse en effet penser. La pensée ‘intelligente’ (de la créature) est essentiellement différente de la pensée ‘intelligible’ (celle du Principe créateur), mais elle est aussi, d’une certaine manière, ‘semblable’ à elle. Semblable en quoi ? Elle n’est pas de même essence, mais elle est comme à son ‘image’.
Le Principe, ou l’Un, n’a pas d’essence concevable, car il est au-delà de toute essence. En effet c’est le Principe qui crée toutes les essences, et l’idée même d’essence. Il n’est donc pas lui-même une essence, et n’a pas non plus d’essence. Il est au-delà de toute essence. Il est la puissance de toutes les essences, comme il est la puissance de toutes choses. Tout ce qui existe vient de l’effet de cette puissance. Il est donc au-delà de tout ce qui existe, et il est au-delà de l’être même.
Plotin dit, avec une sorte de provocation jubilatoire : « L’être n’est pas un cadavre privé de vie et de pensée »i. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire simplement que l’être est le contraire d’un cadavre. L’être n’est pas mort. L’être est totalement ‘vie’ et ‘pensée’. Et Plotin précise même : « L’être est l’identique à l’intelligence. »
L’Un, on l’a dit, est bien au-dessus de l’Être et bien au-delà de l’Intelligence. Mais quand on a dit cela on n’a guère avancé. Qu’est-ce donc que l’Un, puisqu’il est au-delà de notre capacité de comprendre ?
Il nous faut cependant tenter d’avancer. L’Un n’est ni être ni non-être : en tant que Principe premier, il est le créateur de l’être et du non-être ; de même, il est le créateur de la vie et de la non-vie, et il est le créateur de la conscience et de l’inconscient.
Il est donc lié à tout ce qu’il crée, en tant qu’il le crée, et il en est aussi délié en tant qu’il ne s’identifie pas à ce qu’il crée. Une métaphore, tirée de la physique quantique, peut nous aider à dénommer cette situation, qui est paradoxale en un sens, mais pas totalement inintelligible. Cette métaphore est celle de l’intricationii.
L’Un peut s’interpréter comme une intrication d’être et de non-être, de conscience et d’inconscient, d’éternité et de temporalité, de permanence et de flux, de vie et de non-vie.
_________________
iPlotin. Ennéade V, 4. Trad. Emile Bréhier. Belles Lettres, 1967, p.82
iiL’intrication quantique, ou enchevêtrement quantique, est un phénomène dans lequel deux particules (ou groupes de particules) forment un système lié, et présentent des états quantiques dépendant l’un de l’autre quelle que soit la distance qui les sépare. Un tel état est dit « intriqué » ou « enchevêtré », parce qu’il existe des corrélations entre les propriétés physiques observées de ces particules distinctes. (Wikipédia)

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.