Texte initialement publié en avril 1996
L’intelligibilité va avec l’immatérialité.
Thomas d’Aquin
Il faut se rendre à l’évidence: nous vivons un véritable Cyber-Bang, aux conséquences imprévisibles. L’économie du virtuel commence à façonner en profondeur une nouvelle société, en accélérant la dématérialisation des flux, en augmentant les court-circuits informationnels, en restucturant les marchés du traitement de l’information, en généralisant la « désintermédiation », mais aussi en provoquant de nouvelles inégalités culturelles entre « info-riches » et « info-pauvres ».
Tous les ingrédients d’une révolution radicale sont désormais réunis: la communication instantanée et ubiquitaire d’informations à haute valeur ajoutée, la réplicabilité infinie des images et des sons pour un coût de plus en plus bas, des interfaces de cyber-navigation de plus en plus souples et inventives, alliant la réalité virtuelle, les imageries 3D interactives et les réseaux, des terminaux de plus en plus puissants et « intelligents », à prix cassés. Cette révolution technique annonce aussi un bouleversement économique et social sans précédent, parce que planétaire et synchrone. Les États-nations habitués à gérer un territoire « réel », n’ont pas encore su s’adapter au cyberespace. La radicalisation du télétravail, la généralisation de cyber-entreprises, délocalisées, virtualisées, vont constituer un choc frontal pour les visions classiques du monde, habituées à la centralité, la territorialité, la matérialité.
| A. |
Le danger principal de l’hybridation croissante entre réel et virtuel est sans doute celui de la confusion. La confusion touche au langage, à la raison, aux valeurs, aux fins. |
| B. |
En analysant la confusion des images, nous pouvons mieux comprendre la confusion de la raison qui s’appuie sur elles. |
| C. |
Mais l’hybridation est aussi source de fusions heureuses. En témoignent les recherches interdisciplinaires alliant l’art et la science. |
| D. |
La CyberTerre permet l’incarnation concrète d’une « noosphère », à deux conditions: moins de confusions et plus de fusions.
|
A. Confusions
1. Confusion des métaphores et des modèles
« Un mot est encore l’homme, deux mots sont déjà l’abîme » – dit Roberto Juarroz. Nos langages et nos systèmes de représentation sont manifestement imparfaits, c’est une affaire entendue. Cependant comme ce sont nos seuls instruments d’intelligibilité, il faut s’efforcer d’en tirer le meilleur parti, suivant leurs atouts et leurs faiblesses. De ce point de vue, le langage naturel et les mathématiques occupent deux positions extrêmes, assez complémentaires, dans l’art de la représentation. Le but fondamental d’un système de représentation ne doit pas être de « reproduire » le réel, ce qui serait assez vain, mais doit plutôt nous permettre de « trouver du nouveau ». Il doit favoriser notre compréhension de certains aspects de la réalité, afin de permettre de nouvelles actions, ou de nouvelles pensées. Pour tenter de faire apparaître du neuf, pour inscrire de l’inattendu dans la mécanique de la langue, le langage naturel use et abuse des métaphores et autres tropes. Dans les mathématiques, il n’y a pas à proprement parler de métaphores, mais les « modèles » jouent un rôle similaire. L’écriture d’un modèle a une fonction heuristique, il s’agit de suggérer des similarités, d’effectuer des glissements, des déplacements, pour faire apparaître de nouvelles « formes », de nouveaux « sens », de nouvelles interprétations.
Il y a cependant une différence radicale entre le langage naturel et la formalisation mathématique: les mathématiques favorisent l’induction et la généralisation. Ainsi le raisonnement par récurrence. De plus les mathématiques se prêtent à la simulation et aux calculs symboliques. Le langage naturel possède une puissance moins formelle, plus obscure, il dit aussi par ce qu’il ne dit pas, il laisse entendre par le non-dit: il laisse du sens s’infiltrer dans les abîmes que tracent les mots entre eux. Sa force vient de son opacité latente, qu’il nous faut bien habiter, et que nous éclairons dès lors de nos propres lumières. Il est clair cependant que les langages naturels et les langages formels ne sont pas des « langages » dans la même acception du terme. La pensée claire et la pensée obscure n’usent pas des mêmes armes et n’ont pas les mêmes visées.
Dès lors, le fait de ne voir en eux que des « systèmes de représentation », donnant par là l’impression de permettre des traductions, des passages, des glissements des uns aux autres, paraît dangereux. Il s’agirait là d’une pseudo-interdisciplinarité, basée sur un consensus de pacotille et génératrice de confusions d’autant plus redoutables qu’elles seraient logées au coeur du langage même. Il faut apprendre à distinguer les métaphores et les modèles. Il faut hiérarchiser et ordonner les clartés et les obscurités des uns et des autres, sans les mélanger. Parce qu’elles appartiennent à deux ordres différents de la raison.
Il y a la raison qui se porte sur les essences en tant qu’elles sont connues, clarifiées, et la raison qui se porte sur les essences en tant qu’elles sont cachées, obscures.
La première va du visible au visible, la seconde va du visible à l’invisible. Celle-ci ressemble à la sagesse philosophique qui cherche une connaissance par les causes premières, celle-là ressemble à la science qui connaît seulement par les causes secondes. C’est pourquoi c’est à la philosophie d’assigner l’ordre qui règne entre les sciences, puisqu’elle est en mesure de se donner sa propre mesure – ce que ne peut pas la pensée claire.
2. Confusion de la raison claire et de la pensée obscure
« L’homme qui songe est un dieu, celui qui pense, un mendiant » – disait Hölderlin. La pensée claire ne peut se donner les mêmes ambitions que la pensée obscure, quand les concepts restent cloués au sol, les songes peuvent voler infiniment. Il est important de ne pas mélanger ces deux manières de penser, parce qu’elles correspondent à deux manières d’être, deux façons radicales de penser et d’être homme. Pour résumer, l’homme-machine et l’homme-dieu. Pythagore pensait que les nombres forment l’étoffe du monde et que l’âme est un nombre qui se meut. Cette intuition première est loin d’avoir été démodée par la science contemporaine. Les quarks, ces constituants ultimes de la matière, ne sont-ils pas avant tout des êtres mathématiques ? La visée pythagoricienne comme le projet contemporain des sciences physiques reposent sur une certaine forme de raison, et donc sur une certaine manière d’envisager l’homme. Il s’agit d’une raison raisonnable, ayant foi en l’intelligibilité des choses, en la cohérence de la raison avec elle-même et avec l’essence profonde de l’homme. Si tout est « numérique » l’homme peut être assimilé à une machine, comme le pensait d’ailleurs Descartes. Julien Offroy de La Mettrie, dans L’Homme-machine (1747), affirme que le corps humain est une « horloge » et que les hommes ne sont que des « machines perpendiculairement rampantes ». Plus proche de nous, Bergson s’écrie pendant une conférence à Birmingham en 1911: « Je vous défie de prouver, par expérience ou par raisonnement, que moi qui vous parle en ce moment je sois un être conscient. Je pourrais être un automate ingénieusement construit par la nature, allant, venant, discourant; les paroles mêmes par lesquelles je me déclare conscient pourraient être prononcées inconsciemment ». C’était le test de Türing avant la lettre. Les automates sont parmi nous, et même en nous. Bergson souligne quand même qu’on ne pourra pas aller jusqu’à recréer « l’élan vital » de l’évolution. On peut imiter la vie, mais pas « le mouvement même de la vie ».
Plus proches encore, Michaux montre dans ses études sur les effets de la mescaline que dans l’âme il y a « une machine qui sommeille », qui travaille « par répétition et symétrie », et réciproquement André Breton trouve dans le machinal « absolu » l’âme d’un art surréel.
Cette raison claire, cette raison des nombres et des machines est une raison incapable de saisir la nature obscure de l’âme et de l’homme. Elle prépare seulement le triomphe de l’abstrait sur la forme concrète de l’être, et la victoire du pur mental sur le sentiment. Elle annonce le danger de la pensée claire nous aveuglant par de fausses lumières et prétendant illuminer les gouffres de la pensée obscure. Heidegger pensait que « le succès des machines électroniques à penser et à calculer » allait conduire à « la fin de la pensée méditative ». Nous ne partageons pas cette crainte. Il reste à la conscience qui médite la tâche de méditer sur la conscience qui calcule. Certes la pensée calculante a la puissance de la raison, amplifiée par les machines. Mais cette puissance n’a pas de but, n’a pas de fin, comme on a vu. Elle est donc livrée à elle-même, ou alors offerte au sage qui voudra l’ordonner à ses propres fins. La pensée obscure doit planer au-dessus des nombres, comme un vent de Dieu au-dessus des eaux.
3. Confusion des fins et des moyens
La confusion n’est pas seulement dans le langage ou la raison, elle est aussi dans les fins. Nous vivons dans une civilisation caractérisée par le renversement des fins et des moyens. Pour Simone Weil, c’était là la « folie fondamentale qui rend compte de tout ce qu’il y d’insensé et de sanglant » dans l’histoire. Ce renversement vient selon elle de la recherche continue du pouvoir, qui est essentiellement impuissante à se saisir de son objet, et qui se condamne à se prendre elle-même pour seule fin. Ce renversement est aussi causé par la chosification croissante que les systèmes de représentation nous imposent. La cohésion de la science est assurée par des signes, des expressions toutes faites qu’on utilise au delà de leur domaine de validité initial justement parce que les calculs symboliques proposent « naturellement » des généralisations qui semblent évidentes a priori. Dans le domaine du travail et de la production, ce sont les infrastructures et les machines qui prennent ce role de ciment « naturel ». Dans le domaine économique, la chose qui règle l’échange, le rapport entre production et consommation, c’est la monnaie. Les modèles mathématiques, les calculs algébriques, les signes symboliques, les machines et la monnaie imitent à la perfection le rôle de régulateur qu’ils jouent de plus en plus systématiquement sans contrôle – parce que les hommes y ont renoncé à réguler leur propre régulation, par paresse ou parce que la tâche est surhumaine. Tous ces ersatz de pensée sont aveugles à la réalité qu’ils sont censés représenter. Bien sûr, ils font illusion. Ils peuvent nous faire croire à leur caractère heuristique ou régulatoire. Le simple jeu des calculs symboliques est souvent parvenu à faire apparaître, dans les mathématiques par exemple, des notions nouvelles, à ceci près que ces notions n’ont pas d’autre substance que celle d’être des rapports de signes, des abstractions en relation avec d’autres abstractions, mais sans véritable contenu humain. Dans le domaine économique, la « valeur » de la monnaie semble exprimer la sagesse omnisciente du « marché » et paraît posséder une vertu régulatoire. Mais une étude plus attentive montre que l’inventivité ou la capacité régulatoire des signes restent limitées. En se soumettant à leur logique immanente, l’homme renonce sûrement à sa royauté naturelle, et en acceptant leur férule, il ne gagne même pas nécessairement le confort repus qu’il semblait espérer de son obédience servile à cette tyrannie sans visage.
Ce renversement des fins et des moyens s’étend à presque tout. Les savants ne mettent pas la science au service d’une pensée souveraine, ils s’enrôlent dans l’armée anonyme des serviteurs et des adorateurs de la science constituée. L’industrie ne se met pas au service des véritables besoins des hommes, ce sont les hommes qui doivent se mettre au service de la logique industrielle de leur époque. L’argent n’est plus depuis longtemps un procédé commode pour échanger des produits ou des services, ce sont les produits et les services qui servent à faire circuler l’argent, selon des modalités de plus en plus spéculatives, dématérialisées, désincarnées, virtualisées… Les signes et les mots, les modèles et les métaphores, l’argent et les instruments financiers font désormais fonction de « réalités » qui semblent plus « réelles » que les choses réelles qu’elles sont censées symboliser. Ces purs signes forment en effet la matière des rapports sociaux, qui se structurent par le moyen de ces fictions irréfutables. Les signes ne sont certes pas toujours seulement des simulacres, mais ils ne resteront jamais que des moyens. Le problème, c’est qu’ils sont devenus des fins, et que ce sont les hommes qui sont devenus des moyens.
4. Confusion des « valeurs »: le réel et le virtuel
Le succès actuel du paradigme du « virtuel » possède, entre autres, une cause d’ordre psychologique. Le monde, ayant perdu toute notion claire du « réel », trouve une sorte de réponse provisoire à l’angoisse qui en découle en invoquant un « virtuel » qui en tient lieu. Le « virtuel » paraît comme une sorte d’alibi du réel, il semble contenir la somme inexpliquée des mystères du monde. Le « virtuel » est une métaphore ample et pratique qui résume d’un mot tout ce que nous ne « réalisons » pas clairement au sujet de la réalité. Le « virtuel » introduit dans le quotidien une distance quasi philosophique vis-à-vis du réel. Il nous oblige à considérer les « réalités » que l’on nous donne à voir avec de plus en plus d’esprit critique. La « réalité virtuelle » et plus encore la « réalité augmentée » viennent ainsi à point nommé pour nous donner à expérimenter des « réalités intermédiaires » faites de bric et de broc, c’est-à-dire de modèles mathématiques et de sensations physiques, de concepts abstraits et de perceptions concrètes. Ces réalités d’un nouveau genre nous rappellent évidemment les intuitions platoniciennes et les « metaxu », ces « êtres intermédiaires » qui permettaient jadis de relier la matière et la forme, le savoir et l’ignorance, la beauté et la laideur, les dieux et les hommes. Pour Platon, les intermédiaires permettent de relier ce qu’il serait inconcevable de lier sans eux. Les intermédiaires sont les anges, les quarks et les gluons qui font tenir le monde ensemble, et à défaut, ils comblent au moins les béances profondes que notre langage incise dans la chair du monde.
Nous parlions plus haut du « renversement » entre les fins et les moyens. Il y a aussi un renversement du réel et du virtuel. On sait que l’origine étymologique du « virtuel » c’est le latin « virtus », vertu, courage, âme, mot qui vient lui-même de « vir », l’homme. Chez les Latins, l’homme et la vertu ont partie liée. Ce qui est proprement l’essence d’un homme c’est sa « vertu », et la « vertu » est proprement humaine. Dans cette perspective, l’homme apparaît comme un être « virtuel » dans un monde qui ne serait que « réel », c’est-à-dire sans vertu. Le virtuel des Latins est la véritable réalité de l’homme. De nos jours, évidemment, le virtuel semble ontologiquement inférieur au réel. Un premier renversement s’est effectué, ressemblant à celui affectant le mot « automate » qui chez Platon ne pouvait s’appliquer qu’à l’âme et qui aujourd’hui s’est immensément dévalué en son exact contraire. Ces renversements à 180° du sens des mots sont fascinants. Ce sont les symptômes du renversement des fins et des moyens que nous évoquions. Mais nous sommes aujourd’hui les témoins d’un autre renversement. Le virtuel se met à devenir « plus réel que le réel ». Il permet en effet d’agir sur le réel de plus en plus « efficacement », et de mieux le comprendre. La mise en place de ce nouveau renversement est progressive. Elle prend d’abord l’économie à revers. Les « manipulateurs de symbole » deviennent les opérateurs de référence d’une économie en voie de dématérialisation, de déterritorialisation. Les bulles spéculatives, financières ou foncières attestent du renversement des « valeurs ». Notre thèse est que cette « virtualisation » de l’économie va aussi se traduire par une virtualisation croissante de l’image que l’homme se fait de lui-même, puisqu’il sera de plus en plus saisi dans sa vie quotidienne par le jeu « virtuel » des forces abstraites d’un marché laissé à lui-même. Paradoxalement cette virtualisation va sans doute l’obliger à se définir autrement que par des réalités ou des « avoirs » matériels, de moins en moins pertinents. La virtualisation pourrait être une voie de remise en question profonde. La « vertu » romaine pourrait bien revenir d’actualité dans la Babylone explosive du virtuel généralisé. Cela sera d’autant plus nécessaire que la confusion entre les diverses notions de la « valeur » risque d’augmenter avec la généralisation des croisements entre le réel et le virtuel.
La « valeur » des choses non marchandes n’est pas reconnue de la même manière que la valeur des choses marchandes. On vend un livre le prix qu’il coûte à fabriquer et à distribuer, et non pas pour la « valeur » des idées qu’il contient. Cette contradiction est générale: c’est pourquoi notre système est devenu shizophrène. Le décalage entre valeur « réelle » et valeur « marchande » ne cesse d’augmenter, parce que seules les choses dont la « valeur » est quantifiable sont admises par le « marché ». Autrement dit, seule la partie quantifiable est évaluée par le marché, mais celui-ci tire cependant beaucoup de profit de la partie non quantifiable des choses, qui en fait la véritable « valeur ». Les choses de l’ère du virtuel, de plus en plus, se vendent pour ce qu’elles valent culturellement, symboliquement. Or cette valeur immatérielle (celle des idées, des inventions, du style) est pratiquement impossible à saisir effectivement. On ne peut en saisir que l’ombre incarnée: celle que laissent les « objets » industriels, les « images de marque », les « réputations établies ». La logique du marché l’emporte, mais sur un malentendu fondamental: les marchands croient nous vendre des « objets », mais nous n’achetons plus que du « sens ». De plus, la logique de la dématérialisation continue de progresser. Comment l’ordre marchand pourra-t-il longtemps continuer de vivre sur l’exploitation de produits matériels dont la réelle valeur, immatérielle, pourra désormais s’incarner de plus en plus librement, sans contrainte de temps, d’espace, de supports? Une première digue consiste à renforcer le droit d’auteur, le droit de la propriété intellectuelle, parfois au-delà du ridicule (bataille du « look and feel », dépôt de brevet sur « les dispositifs d’interaction »…). Mais cette digue est fragile. La lame de fond de la virtualisation va emporter toute notre société « matérialiste » sur son passage désintégrateur…
B. La confusion des images:
vision et intelligibilité
Les confusions que l’esprit entretient en lui-même et sur lui-même trouvent une illustration exemplaire dans le cas des « images » qu’il se plaît à utiliser. Comme il y a une certaine analogie entre « voir » et « comprendre », en analysant la manière dont nous « voyons » les images, nous pouvons espérer mieux « comprendre » comment nous pensons. La pensée est faite de vie et d’erreurs, d’oubli et d’opacité.
L’image incarne et illustre les confusions que nous avons rencontrées, dans le domaine du langage et des modèles, comme dans celui des fins et des valeurs. Ainsi, l’image et le langage, jadis séparés, se rejoignent désormais objectivement, confusément. L’image et le « modèle », jadis catégories duales, s’analysent désormais plutôt comme des instantiations d’un « paradigme » commun, latent, dont elles sont les instants de visibilité ou d’intelligibilité, les confondant d’ailleurs. De même, l’image et le « lieu », l’image et la « présence », jadis opposables terme à terme, se mettent à fusionner et à s’hybrider de manière inattendue. Pour ne pas tourner à notre confusion, cette fusion progressive de l’image avec ses concepts duels doit s’analyser toujours plus finement. Car si la transdiciplinarité peut s’entendre comme une nécessité vivante, les obstacles concrets sont nombreux. Le cas de l’image est un cas d’école. En échappant à la confusion où les images pourraient nous plonger aisément, en effectuant une ascèse de l’image, ce que Maître Eckhart appelait en son temps une « désimagination » (Entbildung), nous préparons en fait à mieux désimaginer la réalité elle-même. L’exercice de critique de l’image et de ses virtualités sert d’école irremplaçable à ce que les phénoménologues appelaient la « suspension » de notre croyance au monde, la mise entre parenthèses dont parle Husserl, bref l’époché.
De tout temps, la distance entre ce qui est visible et ce qui reste au-delà du visible, dans le domaine purement intelligible, cette distance a semblé impossible à combler. Mais aujourd’hui, dans le cas des images virtuelles, le visible et l’intelligible semblent se confondre toujours davantage. C’est cela dont le paradigme du virtuel tente de rendre compte.
La révolution des images virtuelles s’appuie sur plusieurs étapes technologiques majeures :
– L’apparition des techniques de synthèse et de traitement numérique de l’image.
– La possibilité d’interagir en temps réel avec l’image.
– Le sentiment d’immersion « dans » l’image .
– Le développement des techniques dites de « téléprésence » et de « télévirtualité ».
Il s’agit d’une révolution radicale du statut de l’image dans notre civilisation. Il faut la comparer à d’autres révolutions fondamentales de nos techniques de représentation, comme l’apparition de l’écriture alphabétique, l’invention de l’imprimerie ou la naissance de la photographie. On peut saisir cette coupure profonde en analysant le destin de catégories mentales couramment utilisées à propos des images, catégories recouvrant des oppositions dont les bases deviennent aujourd’hui caduques. Ainsi les rapports classiques entre l’image et le langage, l’image et son modèle, l’image et le lieu et l’image et la présence évoluent d’une manière fondamentale. Entre les pôles de ces couples de concepts se nouent des noeuds neufs.
1. Image et langage
Classiquement, le monde des images et celui du langage (le visible et le lisible) restaient aussi étanches l’un à l’autre que le nombre et la lettre ou que la lumière et la parole, que l’idole et le Livre.
Le logos on le commente, l’idole on la manipule.
Les mots pouvaient tout au plus accompagner les images ou venir s’inscrire en elles, les images pouvaient illustrer les mots, mais il n’y avait pas de liaisons opératoires, directes entre ces deux univers de représentation. En revanche, avec la synthèse d’image, des formes langagières abstraites, des arrangements symboliques peuvent produire directement des images. Les images jadis intrinsèquement liées aux rayonnements visibles produits par le monde réel et à l’interaction de ces rayonnements photoniques avec des surfaces photosensibles peuvent désormais être produites in concreto par des manipulations in abstracto. Des représentations mathématiques peuvent directement produire du visible. Les conséquences de ce lien direct entre représentation langagière, formelle, et visualisation sensible sont considérables. L’image s’affranchit de la matérialité du monde (les pigments de la peinture, la gélatine photochimique, l’effet photo-électronique) et se constitue essentiellement comme pure abstraction. L’image surtout peut se manipuler comme on manipule des formes langagières, sans avoir à subir les lois de la matière ou de la lumière. Que l’image s’affranchisse de son lien de filiation avec la nécessaire lumière, n’est pas, on s’en doute, une mince conquête. A notre sens, cela signe l’apparition d’une nouvelle ère scripturale.
2. Image et modèle
Un second départ d’avec la position classique des images est l’abolition effective de la différence essentielle de nature entre le monde des images et le monde des modèles dont elles sont tirées. Pour les anciens (et les anciens incluent aussi les cinéastes et les vidéastes…) l’image n’est jamais que l’ombre affaiblie d’une réalité préexistante, d’un modèle réel dont elle est l’image. Elle n’est que le simulacre de quelque chose de plus réel qu’elle, à laquelle elle renvoie sans cesse, dans une économie de la mémoire, de la trace, ou de la copie. Le modèle incarne toute la substance du réel dont l’image, simple ectoplasme, est dépourvue. Le modèle du peintre est toujours plus vivant que le tableau auquel il donne lieu. L’image photographique ou cinématographique n’est qu’un symptôme, un signe renvoyant à une réalité se tenant essentiellement ailleurs, au-delà de l’image. Séparation stricte des modèles et des images, du réel et du simulacre.
Les images de synthèse en revanche ne sont pas d’une nature différente des modèles qui les engendrent. Les images numériques ou synthétiques et les modèles dont elles sont issues possèdent la même essence mathématique. L’image numérique n’est pas moins substantielle que le modèle numérique, puisqu’ils sont l’un et l’autre de même nature, de la nature intermédiaire des représentations mathématiques. Quant aux modèles, ils sont déjà des sortes d’images. Cela a pour notable conséquence de permettre un aller-retour fonctionnel entre les modèles et les images. En clair, les images peuvent servir à modifier les modèles dont elles proviennent. Les techniques de vision par ordinateur, de reconnaissance de formes, de traitement d’images peuvent être utilisées pour changer les paramètres ou la structure même des modèles ayant généré les images, créant un bouclage inédit entre le niveau des modèles et celui des images. Les images et les modèles entretiennent alors des liens de génération complexes. Sans forcer la métaphore, on peut dire que l’image génère le modèle tout autant que le modèle engendre l’image. Il y a là un processus de co-évolution récurrente, auquel ne nous avaient certes pas habitué les images du passé, nécessairement figées dans leur matérialité propre.
3. Image et lieu.
En raison de nombreuses contraintes liées à la fabrication ou à la projection des images, nous étions limités jusqu’à présent à une attitude de spectateur. Nous restions postés devant les images. Les images étaient nécessairement liées à l’écran, induisant par là-même un rapport limité à l’espace environnant. En focalisant notre regard sur l’écran, les images effaçent le monde alentour, elles occultent l’espace pour lui substituer un trompe-l’oeil, un voile sans secret, sans épaisseur propre.
En revanche, avec les techniques du virtuel, on peut entrer dans l’image. L’illusion virtuelle ne dissimule plus l’espace, elle le simule. Le virtuel devient un monde propre, à côté du monde réel. Avec l’apparition des mondes virtuels, l’image quitte l’écran, et devient elle-même un « lieu », où l’on peut se déplacer, rencontrer d’autres personnes, dans lequel on peut prendre ses aises, ses marques, dans lequel on peut finir par passer le plus clair de son temps professionnel ou de ses loisirs. Le véritable réel, le monde où l’on mange et l’on dort, deviendra alors peut-être une sorte de port d’attache dans lequel il faudra bien revenir de temps en temps pour se sustenter avant de repartir sur les réseaux virtuels du télétravail et des communautés cyberspatiales…
Cela n’ira pas sans impact sur notre manière de nous inscrire dans le monde. Où est-on réellement ? Là où on est ou là où on pense? On se rappelle le mot du Docteur angélique : « l’âme est plus là où elle aime que là où elle anime ». Le virtuel est une a-topie, parce qu’il ne relève pas du topos. Le topos c’est le lieu où l’on est, le lieu de notre position dans le monde. Or le virtuel n’a pas de position, il ne nous permet pas de nous poser en lui. Le virtuel est le contraire d’un espace réel, c’est un espace de langage: il appartient au tropos, l’univers infinie des tropes et des métaphores. Il n’est pas position mais mouvement, flux. On ne peut l’occuper, il se dissout sans fin. Le virtuel est héraclitéen. Il nous emmenera dans ses flux déracinés.
4. Image et présence.
Classiquement, l’image sert de substitut à la présence même de la chose. Le médaillon contenant le portrait, ou le photogramme portant le visage de la star signifient sans aucune ambigüité l’absence, la distance des sujets représentés. L’image est le contraire de la présence.
En revanche, avec la télévirtualité ou la téléprésence, l’image virtuelle n’est plus une simple image, une illusion, comme celle du « présentateur » télévisé, chargé de mimer les signes de la présence. L’image télévirtuelle présente le signe d’une « présence » réelle. Quelqu’un de vivant est bien « là », certes virtuellement par l’apparence mais bien réellement par l’attention disponible, la capacité de communiquer et d’agir. La télévirtualité, à la différence des techniques de vidéoconférence, permet de décliner diverses modalités de « présence », de multiples manières de se faire représenter symboliquement et fonctionnellement, dans le temps et l’espace.
Par leur fusion croissante avec le monde réel, les images nous obligent à discerner ce qui dans notre regard et dans notre savoir dépend de ce réel, c’est-à-dire de l’être, et ce qui dépend de l’image que nous en avons.
Prise entre images et êtres de raison, la pensée substitue au réel une sorte de fausse monnaie, qui n’a plus vraiment cours. C’est pourquoi la pensée critique, ou épistémologique, doit commencer non pas par se connaître elle-même comme le voudrait Descartes, mais doit s’effacer silencieusement pour permettre l’expérience première, le « rocher » fondamental, à savoir l’expérience de l’être. Car l’être vient avant la pensée. On ne mange pas du mangé, on mange du pain.
C. Fusions de l’art et de la science:
les arts du virtuel
La tendance à l’hybridation n’est pas seulement porteuse de confusions. Il y a aussi des fusions heureuses, bénéfiques, novatrices. La rencontre interdisciplinaire de l’art et de la science en est un exemple.
Dans le domaine de la création d’images et de sons, le numérique est en passe de devenir une technique générique, comme l’imprimerie peut l’être dans le domaine de la littérature. Cela ne veut pas dire que le numérique va se substituer à toutes les autres techniques de représentation. Mais le numérique est désormais capable de fédérer et d’hybrider les techniques de l’image, du son et même de la scène. De cette proximité et de cette transparence des divers média et supports naissent de nouvelles médiations, de nouvelles formes de création. Un art authentiquement neuf émerge, un art non astreint à se référer aux grammaires et aux styles du passé, un art qui possède sa propre forme, sa propre force. De multiples voies de recherche s’ouvrent dès maintenant aux artistes du « virtuel ». Elles sont extraordinairement variées. Il est cependant possible de signaler quelques pistes caractéristiques, suivies par des artistes se dégageant résolument des schémas classiques de production. Le choix qui va suivre est évidemment subjectif et nécessairement limité. Mais il permet de dresser une carte des lignes de force les plus significatives, selon moi, pour l’avenir. On peut relever les recherches liées au langage même de l’image (métamorphoses et combinatoires d’images réelles et virtuelles), le développement de l’animation des images par l’intermédiaire de modèles (vie artificielle), l’exploitation de nouvelles formes d’interaction entre les spectateurs et les oeuvres, les dispositifs proposant de nouvelles expériences de l’espace scénique et des « environnements virtuels », et enfin l’émergence de nouvelles manières de partager les oeuvres avec le public à travers des musées en réseau et des formes d’arts on line.
1. Les nouveaux langages de l’image
Les innovations formelles possibles grâce aux nouvelles techniques de manipulation numérique et de synthèse de l’image permettent de développer un environnement onirique, imaginaire, semblant coupé de toute référence à la réalité objective ou au contraire se servant de certains aspects du réel pour les métamorphoser librement. Des artistes comme Yoichiro Kawaguchi ou Michel Bret ont fondé leur style sur des mondes de formes fluides et métamorphiques, à la plastique indéfiniment modelable. D’autres comme Tamas Walicky utilisent le libre jeu des mathématiques pour créer des environnements aux perspectives paradoxales, intégrant des personnages réels dans des décors en images de synthèse dotés de propriétés déroutantes. D’autres encore comme Peter Voci ou Nancy Burson exploitent les possibilités de la métamorphose continue des images (morphing) pour créer des visages impossibles, ou pour recréer le visage de personnes disparues, ou encore pour réaliser de subtiles et troublantes transitions entre des visages réels et imaginaires.
Toutes ces démarches ont un point commun: l’image numérique ou virtuelle permet toutes les combinaisons, toutes les hybridations entre nature et artifice, entre réalité et virtualité. Dès lors, ce qui fait l’intérêt de ces recherches tient dans la tension ou même la contradiction entre les divers niveaux de réalité et de virtualité coexistant dans une même représentation, ou plutôt dans un même « monde ». La résultante des efforts des artistes intéressés par ces nouveaux langages de l’image est, bien souvent, une interrogation sur la nature même de la représentation et une libération plus ou moins radicale de tout lien à un référent réel.
2. Vies artificielles
Une des tendances les plus novatrices de l’art du virtuel est de profiter du progrès des algorithmes développés dans le domaine de l’intelligence artificielle ou même des retombées de recherches plus fondamentales (algorithmes génétiques) pour créer des formes de « quasi-vies » purement symboliques, pouvant arborer des comportements extrêmement complexes allant jusqu’à mimer l’idiosyncrasie d’ « êtres » symboliques dotés de « personnalité », de « volonté », de « désir », mais pouvant aussi simuler des comportements collectifs, « sociaux », évolués.
L’artiste peut se mettre en quelque sorte dans le rôle du démiurge et créer des « êtres » de synthèse, capables d’évoluer et d’interagir avec l’environnement virtuel mais aussi avec le monde réel. Ces « êtres » de synthèse peuvent emprunter des métaphores végétales, animales ou même « humaines » pour déterminer leur façon de « vivre », de se « reproduire », d’ « évoluer » et de « mourir ». Dans tous les cas, la complexité de leur évolution est si grande et si riche que toute apparence d’automaticité disparaît, et qu’ils semblent être « vivants ». L’artiste s’apparente au « dieu » de ces quasi-mondes et de ces quasi-univers, dont il nous propose de goûter la structure et le destin. Il crée les conditions initiales de ces mondes ainsi que les grandes « lois » qui les gouvernent. Loin de tomber dans un déterminisme fade, ces mondes utilisent les propriétés des modèles pour suivre des « boucles étranges » indécidables et imprédictibles, ouvertes à toutes les mutations.
On peut citer les noms de Karl Sims qui réussit à créer des formes quasi-vivantes et dotées de capacités d’évolution génétiques, et susceptibles d’apprendre des comportements complexes à l’aide d’essais et d’erreurs, Ulrike Gabriel qui travaille sur des formes de vies artificielles réagissant avec l’environnement (lumière, sons) et les spectateurs (gestes, démarche exploratoire), et plus récemment Michaël Tolson (« Las Meninas »).
3. Interactions virtuelles et conceptuelles
L’une des fonctions les plus intéressantes du numérique est d’encourager toutes sortes d’interaction avec les images ou les mondes générés par l’ordinateur. Ces « environnments interactifs » permettent ainsi aux spectateurs de participer (à des niveaux variés et suivant des modalités concrètes très diversifiées) à la création de l’oeuvre ou à l’évolution de celle-ci. Les niveaux d’interaction peuvent être limités à l’apparence extérieure de l’oeuvre, à son image, mais peuvent aussi aller jusqu’à modifier en profondeur la structure même de l’oeuvre, affectant le modèle formel qui la régit et pouvant même modifier dans une certaine mesure le concept de l’oeuvre, dans la limite voulue par l’artiste. C’est la notion même d’oeuvre artistique, signable, authentifiable, qui est alors remise en cause. L’artiste interactif radical propose aux spectateurs une coopération créative, une « co-création », un processus de remise en question de l’ « oeuvre », qui reste ainsi toujours « à l’oeuvre ». Dans cet esprit travaillent des artistes comme Monika Fleishmann (Rigid Waves, Liquid Views), Christa Sommerer and Laurent Mignonneau (A-volve, Trans Plant, Phototropy), Jeffrey Shaw (The Legible City, The Virtual Museum), Agnes Hegedus (Handsight, Between the Words).
4. Environnements virtuels
L’immersion virtuelle « dans » l’image est indéniablement l’un des aspects les plus connus et les plus médiatisés de la révolution du virtuel. Les casques de stéréovision et autres lunettes stéréoscopiques permettent d’entrer dans l’image. Jusqu’alors, avec la peinture, le cinéma ou la télévision, nous avions une expérience frontale et bidimensionnelle de l’image. Désormais, l’image devient un espace dans lequel on peut virtuellement ou même « physiquement » se déplacer, que l’on peut explorer comme un « monde » infiniment complexifiable. Ces « espaces virtuels » peuvent être de simples métaphores de l’espace réel ou bien constituer des mondes à part, aux propriétés arbitraires, onirique, soumises à la volonté programmatique de l’artiste, architecte et animateur. On peut ainsi citer le travail de Christian Hübler de Knowbotic Research (« DTWKS »). On peut reconstituer des expériences vécues réellement mais jusqu’alors difficilement partageables, comme l’hallucination, le rêve ou le cauchemar, on peut aussi créer des univers de formes et de sons différents de toute expérience réelle. On peut évoquer la tentative remarquable de Rita Addison de simuler les conséquences de son accident ayant entraîné un traumatisme crânien (« Detour Attention: Brain Deconstruction Ahead »). On peut aussi mélanger, hybrider la réalité (l’environnement réel, tangible) et les images virtuelles, créant ainsi une sorte de « néo-réalité » ou de « réalité augmentée ». On peut ainsi superposer images virtuelles et architectures réelles. Le virtuel, là encore, loin de s’opposer au réel, est en mesure de faire intimement partie de la texture même de la réalité.
5. Art en réseau
Les oeuvres musicales, picturales, cinématographiques, audiovisuelles sont désormais de plus en plus abondantes sur les réseaux mondiaux de communication. Internet, le « réseau des réseaux », offre un nombre croissant de serveurs d’images et de sons, qui peuvent être gratuitement accessibles et libérés de tous droits, ou au contraire consultables contre redevance ou par abonnement (les serveurs commerciaux commencent à proliférer). Le Vatican a annoncé son intention de mettre on line l’intégralité des reproductions des manuscrits de la Bibliothèque Vaticane. Les manuscrits de la Mer Morte sont en partie accessible sur Internet ainsi que des oeuvres de prestigieux musées.
Mais déjà quelques artistes cherchent à utiliser le réseau Internet comme un média original, en tirant parti de son interconnectivité généralisée et de la puissance collective inimaginable des terminaux qu’il relie à travers le monde. Certains font ainsi circuler des images le long de chaines de création, comme Toshihiro Anzaï et Rieko Nakamura recréant sur les réseaux électroniques les « Renga » (poèmes circulants) du Japon médiéval. D’autres comme David Blair avec son WaxWeb créent des « mondes » accessibles en ligne, dans lesquels d’autres artistes peuvent venir créer de nouveaux « liens », de nouvelles « galeries », composant ainsi une superbe métaphore audiovisuelle et multidimensionnelle de la Bibliothèque de Borgès.
Il est possible d’aller encore plus loin dans le jumelage de la fonction « réseau » et des autres fonctionnalités ci-dessus évoquées (vie artificielle, interaction, immersion) . Par exemple, depuis peu, un projet de « réserve virtuelle » appelé « Tierra », a été lancé sur le réseau Internet par Tom Ray. On pourra y rencontrer toutes sortes d’êtres quasi-vivants, y compris des « virus » informatiques, qui devront apprendre à cohabiter, à s’hybrider et à co-évoluer. Tous les créateurs de vie artificielle sont invités à placer leurs « êtres » dans cette « réserve » mondiale. On peut là encore imaginer de nombreuses généralisations de ce type de pratique, dont les mots clés sont coopération, interaction, échange, partage, ubiquité, instantanéité, – valeurs plus proche du monde de la recherche universitaire que de celui de l’art, et, pour cette raison, ferments d’accélération des mutations techniques en cours et des transformations des pratiques sociales à l’échelle planétaire.
D. Cyberterre et Noosphère
1. La confusion vient de la nature même de l’homme
Les confusions multiples qui nous affligent, quelle en est l’origine ? Elles ne sont certainement pas dues à la révolution technique per se qui n’en est que le révélateur circonstanciel. Elles viennent avant tout de la confusion de notre propre nature. L’homme est un Janus. Sa nature est fondamentalement double, donc trouble. L’homme est pris entre l’horizontal et le vertical, il est un composé de chair et d’esprit, de corps et d’âme, de fixité et de mouvement. La puissance spirituelle de l’âme vient de sa capacité à discerner, à juger, à choisir, à contempler. Encore faut-il quelque matière où appliquer ces talents. L’esprit a besoin de la matière pour se faire la main.
Par cette double nature, l’homme se prépare à sa tâche cosmique. Il est le lieu où s’opère la fusion de l’intelligible et du sensible, il est comme dit Grégoire de Nysse, la « jointure entre le divin et le terrestre ».
Nous ne sommes pas faits pour rester déchirés par ce dualisme constitutif. Si le Divin, comme nous le croyons, est simple, sans couture, ni suture, l’homme qui est à son image doit se défaire de tout dualisme et viser l’unité. Notre nature animale, irraisonnable, est mêlée à l’image de Dieu, notre esprit est enraciné dans la matière. Pour redevenir cette chose divine d’avant la chute, nous devons quitter tout ce que nous avons reçu avec notre vêtement de chair. Il peut sembler impossible de quitter cet état « a-topique », comme dit Grégoire de Nysse, ce non-lieu où nous avons chu, où nous avons déchu. Mais le mal n’est pas dans la matière ni dans le lieu ou le non-lieu (a-topos). Le mal est dans notre détournement. Nous nous sommes détournés de nous-mêmes, comme de l’être. Il nous faut donc commencer par renoncer à nous détourner, à nous dédoubler. Il nous faut renoncer à notre nature double. Faute de cela, nous resterons incapables de connaître, de voir.
Quand par l’acte de connaître nous croyons « saisir » une proie conceptuelle, nous nous leurrons, nous ne saisissons pas l’essence même du plus petit brin d’herbe, de la moindre étoile. La raison de notre incapacité à voir est la suivante. Dès que l’intelligence se réfugie dans l’évidence de la représentation elle cesse de voir, elle ne voit plus. Une représentation n’est qu’un moment. « Voir » ce n’est pas se laisser imprégner par une image. C’est un mouvement qui dépasse toute représentation. La « vision » c’est un élan. La vision est, comme l’esprit, une infinité en devenir. C’est un désir qui ne trouve pas de satiété, qui croît sans fin, brûle de lui-même. On connaît la grandeur de notre propre nature, non pas en la « comprenant », mais en reconnaissant qu’elle échappe à toute évidence et à toute saisie intellectuelle. Ceci est semblable à la voie mystique qui énonce que « voir ce n’est pas voir » et que « à mesure qu’il s’approche de la vision de Dieu, l’esprit voit toujours plus clairement l’invisibilité de la nature divine. »
2. Une seconde source de confusion
Une seconde source profonde de confusion vient de la rencontre entre les natures, la nature de l’homme et celle du monde par exemple. Toute chose en effet a sa propre nature. Mais la rencontre de ces différentes natures entre elles se fait à l’aventure. Quand les choses se trouvent en relation les unes avec les autres, ces relations n’ont pas nécessairement de rapport avec leurs natures propres respectives. Ces rencontres sont des composés de nature et d’aventure. Les rencontres peuvent être aussi inopinées et arbitraires que celle d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection. De même, l’homme qui rencontre les choses ne peut les « connaître » que dans la mesure où il parvient à « être » ces choses. Mais comment peut-on être ce qu’on n’est pas? Il y a tant de degrés d’être, tant de manières de connaître…
C’est le problème auquel s’attaque la démarche transdisciplinaire. La réalité est composée, disait-on, de nature et d’aventure. Ces compositions chatoyantes sont elles-mêmes des metaxu au sens platonicien d’êtres intermédiaires. Ce sont des intermédiaires entre toutes sortes de faits, des faits de sens commun, des faits naturels, des faits logiques, des faits scientifiques, des faits philosophiques. Comment les ordonner, les différencier, les relier? Il y a des êtres réels, des êtres de raison, des êtres intentionnels et des êtres relationnels, des êtres actuels et des êtres possibles. Qui assignera leur raison d’être à ces diverses sortes d’êtres? Il y a des connaissances par analogie, des connaissances par les signes, des connaissances phénoménologiques, des connaissances conceptuelles ou noétiques. Qui dira la manière dont les choses connues sont appréhendées par ces diverses sortes de connaissance?
Les réalités multiples des metaxu ne cessent de se multiplier les unes par les autres en gerbes continues. Comme dit Basarab Nicolescu, « quel peut être le son de « Je suis » sur les différents niveaux de Réalité ? » Il n’y a, ajoute-t-il, que le mot « vivant » qui les traverse tous en un éclair. Mais précisément ce mot n’a pas le même sens pour le mathématicien, le physicien, l’artiste, le philosophe.
Jacques Maritain, dans Les degrés du savoir distinguait : (1) les sciences physiques, s’attachant aux êtres de la nature, qui sont des objets qui ne peuvent exister sans la matière ni être conçus sans elle ; (2) les mathématiques, s’occupant des êtres de raison qui sont des objets de pensée qui ne peuvent pas exister sans la matière sensible, mais qui peuvent être conçus sans elle, et (3) la métaphysique s’intéressant aux essences, qui non seulement peuvent être conçus sans la nature mais peuvent exister sans elle.
Aucun de ces « degrés » du savoir n’atteint le savoir ultime. Le seul « objet » que l’homme pourrait réellement comprendre, c’est lui-même, c’est lui-même en tant que « sujet ». L’homme est le mieux proportionné à lui-même. Mais nous sommes à nous-mêmes des mondes, des torrents d’apparences. Quel est notre vrai visage? Quelle personne sommes-nous? Le visage de la personne est le sceau du divin. L’incompréhensibilité de l’âme, la profondeur ultime de la personne s’expliquent simplement par notre ressemblance avec Dieu. Nous sommes tissés du même mystère.
Restons humbles donc, devant ce mystère. Nous ne pouvons nous connaître que par analogie – comme nous connaissons l’univers. Car nous avons des yeux trop facilement éblouis par le soleil de l’être des choses. Nous voulons trop vite pénétrer dans ce soleil, ce lieu trans-intelligible. Nous savons depuis l’origine que c’est là notre véritable demeure. C’est pour notre intelligence une joie plus précieuse d’entrevoir obscurément et de la façon la plus pauvre quelque chose de ce soleil-là, que de posséder clairement et parfaitement ce qui n’est qu’à notre mesure.
L’humilité de la raison et du langage n’est pas un aveu d’impuissance, c’est une attente confiante. Une contemplation. Les expressions les plus humbles, et c’est là aussi un mystère, recèlent une analogie de proportion inépuisable, surabondante de sens. Prenons une phrase comme: « Il est assis à la droite du Père ». Elle recèle le plus quotidien des sens — même un enfant pourrait la comprendre, et aussi la plus profonde des significations: les docteurs de l’Eglise n’en sont pas venus à bout. Il nous faut dévêtir notre intelligence des tissus de mots dont elle s’affuble. L’humilité du langage devrait accompagner celle de notre âme. Seule cette double humilité nous permettra de sentir la profondeur infinie qui nous côtoie, et que le langage cache.
Depuis Héraclite, on sait que les signes manifestent en cachant et cachent en manifestant. Le langage le plus humble, le plus caché, est celui qui peut manifester le plus.
3. CyberTerre et Noosphère
La CyberTerre est un nouveau « milieu » dans lequel il faudra apprendre à naviguer. Il faut habiter ce milieu, le civiliser, créer les conditions des métamorphoses à venir. Il nous revient de privilégier les voies qui favorisent le bien commun, réduisent les exclusions, diminuent l’injustice, favorisent l’épanouissement des personnes et l’expansion de l’esprit. Il nous reste à inventer une philosophie de la valeur, une éthique du pouvoir, une esthétique du virtuel, une volonté de communauté et de mémoire, une solidarité humaine globale. La « noosphère » de Teilhard de Chardin peut nous servir de référence poétique et philosophique.
Mais avant tout, il faut sortir de notre confusion; avant de voguer sur les océans du cyberespace, il faudra commencer par apprendre à naviguer en nous. Le sextant et la boussole ne servent à rien si le capitaine dort. Il faut que nous clarifions notre propre langage, que nous ordonnions comme il convient la pensée claire et la pensée obscure, il faut que nous ne méprenions pas nos moyens pour des fins, il faut que nous sachions rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, bref il faut que nous apprenions à distinguer « réellement » le réel et le virtuel.
Les images pourront nous venir, une fois de plus, en aide. Il faudra s’en servir. Les images et les hommes sont en sympathie depuis les temps les plus reculés. Rien d’étonnant à cela: les hommes sont eux-mêmes des images, et chaque fois qu’ils découvrent de « nouvelles » images, c’est un peu de leur propre nature qui se découvre à leurs yeux. Rien de ce qui est image, de ce qui fait image, n’est à négliger si l’on veut comprendre ce qu’est une image, et de là, si l’on veut remonter au prototype dont nous sommes l’image.
L’image est donc le lieu nécessaire d’une transdisciplinarité consciente de ses moyens et de ses fins, de ses métaphores et de ses modèles, de ses clartés et de ses obscurités, de ses réalités et de ses virtualités. Mais l’image elle-même ne suffit pas. Car l’image n’est pas la ressemblance.
Il nous reste à « ressembler ». Ressembler à quoi? A nous-mêmes, à notre propre noblesse, qui est infinie, qui est toujours insatisfaite, qui est toujours à la recherche d’elle-même. Il nous faut ressembler à notre désir, qui est un désir perpétuel, incomblable.
Ainsi, pour conclure, deux méthodes: l’une qui concerne notre intelligence du monde et de nous-mêmes. Il s’agit de réduire la confusion omniprésente, de distinguer les plans, de mettre de l’ordre « entre » les choses.
L’autre concerne notre propre désir. De notre nature double nous ne nous satisfaisons pas. Il nous faut nous unifier, il nous faut chercher l’unité sans cesser de désirer. Il ne s’agit plus de connaître mais d’aimer.
Car au fond, la véritable transdiciplinarité c’est l’amour, « qui meut le soleil et les autres étoiles ».
Car l’amour devance l’intelligence. Tant que l’amour n’a pas achevé de transformer l’âme, celle-ci ne vit que de sa propre vie, dans ses limites finies.
PHILIPPE QUÉAU
Bulletin Interactif du Centre International de Recherches et Études transdisciplinaires n° 7-8 – Avril 1996
Partage (et 'agitprop' ...) :


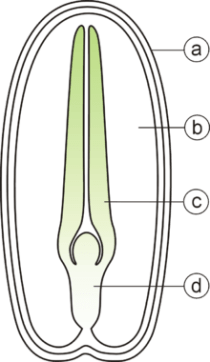
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.