
A « Deep Dive » Podcast about my Blog article : « Making God »: Kabbalah, Trance and Theurgy.


A « Deep Dive » Podcast about my Blog article : « Making God »: Kabbalah, Trance and Theurgy.

Podcast in English about my blog article « L’Être Autre » https://metaxu.org/2024/08/14/letre-autre/

A podcast in English about my blog article: https://metaxu.org/2024/08/18/une-ia-a-10-puissance-22-parametres-pour-simuler-lhumanite-entiere/

« Le grand savoir n’enseigne pas l’intelligencei » (πολυμαθίη νόον οὐ διδάσκει). Dans d’autres traductions : « Un savoir universel n’instruit pas l’intellectii » ou encore : « Beaucoup de savoir n’a jamais donné de l’espritiii ». Or, dans un autre fragment, Héraclite a aussi exprimé une idée apparemment contraire : « … Car il faut que les apprentis en sagesse sachent vraiment une multitude de chosesiv ». Il peut sembler qu’il y ait là une flagrante contradiction quant à l’importance — ou non — d’un « grand savoir » ou d’un « savoir multiple », comme condition d’accès à l’« intelligence » ou à la « sagesse ». Mais cette apparente contradiction cache sans doute une unité profonde. Laquelle ? Héraclite semble la révéler, cette unité, lorsqu’il dit, dans un autre fragment encore, que les « meilleurs » (par opposition au « plus grand nombre ») choisissent « l’Un contre le Toutv » (ἓν ἀντὶ ἁπάντων). Le grand mais « obscur » philosophe d’Éphèse avait chez les Anciens une réputation mélangée. D’un côté, on reconnaissait l’« élévation » de ses sentiments, de l’autre il était considéré comme « orgueilleux et méprisantvi ». Un exemple de ce mépris et de cet orgueil se trouve justement dans le fragment D.K. 40 : « Le grand savoir n’enseigne pas l’intelligence. Sans quoi il en aurait donné à Hésiode, à Pythagore, et encore à Xénophane et à Hécatée ». Formule piquante, vu la notoriété des personnalités impliquées. Diogène Laërce livre cette explication : « Selon [Héraclite] en effet, il n’y a qu’une façon d’être sage, c’est de bien connaître la raison (logos), qui est l’essence des choses. Il répétait volontiers qu’on devait bannir des concours Homère et Archiloque, et qu’ils méritaient le fouetvii. » De l’orgueil et du mépris, Héraclite n’en manquait sans doute pas, mais c’était qu’il était persuadé d’avoir saisi une vérité qui lui semblait d’une importance plus haute que tous les savoirs et les talents accumulés par Hésiode, Pythagore, et tant d’autres. Si un « grand savoir » suffisait à donner l’« intelligence », Hésiode, Pythagore, Xénophane ou Hécatée, en auraient été comblés. Or, ces célèbres figures en manquaient, du moins selon Héraclite. En quoi étaient-ils donc dépourvus d’« intelligence » (νόος, noos) ? Un « grand savoir », par nature, touche à beaucoup de choses ; il est composé de multiples parties, qui s’additionnent les unes aux autres. Mais cette quantité de savoirs partiels implique-t-elle nécessairement une vision d’ensemble, une compréhension du Tout, en tant que tel ? La véritable intelligence, la sagesse en soi, doit non seulement rassembler et lier les parties ensemble, mais doit aussi les voir à la lumière de l’Un, elle doit penser le multiple comme n’étant qu’une base pour saisir l’unité supérieure de l’Intelligible en soi. Héraclite s’est attaqué sans modestie et non sans arrogance aux plus grands poètes, mathématiciens et philosophes de l’Antiquité. Mais, à y bien réfléchir, comment pouvait-il porter cette critique, celle de manquer d’une vision de l’Un, contre Hésiode, cet immense poète, ce fondateur du système cosmogonique et théologique qui était à la source même de la mythologie grecque ? La Théogonie d’Hésiode n’était-elle pas une tentative pour réduire en une seule vision tous les mythes relatifs aux dieux. Comment refuser la capacité de penser l’Un au philosophe et mathématicien Pythagore, « qui a, le premier, donné le nom de cosmos à l’enveloppe de l’univers en raison de l’organisation qui s’y voitviii » ? Pythagore n’avait-il pas tenté de penser l’ensemble des choses qui existent dans le cosmos sous l’unique concept de nombre, faisant des nombres la réalité fondamentale dont tout dérive ? Quant à Xénophane, il a été, au témoignage d’Aristote, « le premier partisan de l’Un, car Parménide fut, dit-on, son discipleix » . Comment donc lui refuser l’intelligence de l’Un alors que, « promenant son regard sur l’ensemble de l’Univers matériel, il assure que l’Un est Dieux », que « toutes choses sont unxi », et aussi que « les choses sont inférieures à l’espritxii » ? Comment refuser à Xénophane quelque sagesse, alors qu’il avait répondu de façon cinglante à Empédocle qui prétendait ne pas pouvoir « trouver un sage »: « Bien sûr, car il faut être sage quand on veut trouver un sagexiii » ? Le refus d’Héraclite d’accorder l’intelligence à Xénophane est d’autant plus étonnant que ce dernier avait notoirement souligné l’«intelligence » de Dieu : « Il est tout entier vision, tout entier intelligence (οὗλος δέ νοεῖ), tout entier audition » (B 24), et « sans peine il gouverne tout par l’exercice de son intelligence (νόου) » (B 25). « Ainsi, selon Héraclite, ce n’est pas une preuve d’intelligence (νόος), chez Xénophane, que d’avoir attribué l’intelligence (νόος) à Dieuxiv. » La question demeure : pourquoi Héraclite refuse l’intelligence à tous ces célèbres savants et philosophes ? La pensée essentielle d’Héraclite est l’unité des contraires. Et Héraclite méprise les poètes et les savants qui n’ont pas vu que la véritable intelligence consiste à saisir partout cette unité des contraire, que ce soit dans le monde ou en Dieu lui-même. Lorsque Hésiode révèle au commencement de sa Théogonie que « du Chaos et de l’Érèbe naquit la noire Nuit ; de la Nuit, l’Éther et le Jour, fruits de son union avec l’Érèbe », il distingue et isole la Nuit, à deux reprises, une première fois en faisant naître la Nuit de l’Érèbe (l’Obscur), et la deuxième fois en présentant la Nuit comme s’unissant à l’Érèbe pour donner naissance au Jour, impliquant aussi par là que la Nuit et le Jour sont (philosophiquement) distincts et séparés, à la manière dont une mère est distincte de son enfant. L’idée de la « Nuit », seule, se suffisant à elle-même, est à nouveau affirmée quelques vers plus loin : « Et la Nuit engendra le triste Sort, la sombre destinée, la Mort, le Sommeil, la troupe des Songes; la Nuit les engendra seule, sans s’unir à aucune autre divinitéxv. » L’idée de la séparation du Jour et de la Nuit est l’indice d’une vision grossière, propagée par le langage commun. Hésiode n’a donc pas vu pas qu’on ne peut pas connaître l’essence de la Nuit, l’essence du Jour, sans les considérer ensemble, sans reconnaître leur unité intrinsèque, c’est-à-dire l’unité profonde que seul le logos permet de concevoir. Il n’y a de Nuit que par relation à son contraire le Jour, et ces deux contraires, la Nuit et la Jour, doivent être pensés comme une unité totale. De même, Xénophane voit certes l’Un sous la forme d’un « Dieu » unique, tout entier intelligence. Mais ce Dieu qui « reste sans bouger, sans mouvement aucun » (B 26) est immobile. Xénophane pose donc un Dieu immobile, à part du mouvement, sans voir lui non plus l’unité indissociable des contraires. Il pose l’Un en quelque sorte au-dessus du Multiple, et l’Immobile au-dessus du Mouvement, sans être capable de concevoir l’unité supérieure, en un sens, de l’Un et du Multiple, de l’immobile et du mouvement. La véritable intelligence, celle du Noos, consiste en la saisie de la vérité essentielle, qui est entièrement tissée de l’unité sans contradiction des contraires. Le fait que les contraires ne se contredisent pas, mais qu’ils s’unissent, en essence, pour constituer le sens même de la réalité, voilà ce que le véritable logos enseigne. Cela signifie aussi que la vérité suprême, cette réalité ultime, est en fait toujours en devenir. L’« être » n’est qu’apparence. Seule est réel le mouvement, toujours en devenir de contraires qui ne cessent de se différencier pour mieux s’unir, et ainsi continuent à devenir ce qu’ils ne sont pas encore.
C’est là une leçon dont devraient se pénétrer, s’ils avaient le moindre goût pour le Logos, les protagonistes des guerres actuelles les plus cruelles, les plus absurdes, que nous observons un peu partout dans le monde, mais notamment au Proche-Orient ou encore aux confins de la soi-disant « sainte » Russie.
_____________________
iHéraclite. Fragment D.K. 40 (Trad. Marcel Conche)
iiTraduction de Daniel Delattre. Les Pésocratiques. Bibliothèque de la Pléiade.
iiiHéraclite. Fragment D.K. 40 (Trad. Clémence Ramnoux)
ivHéraclite. Fragment D.K. 35 (Trad. Clémence Ramnoux)
v « Car les meilleurs choisissent Une Chose contre toutes : une rumeur de gloire immortelle contre les choses mortelles. Quant au plus grad nombre, ils s’emplissent le ventre comme du bétail. » Héraclite. Fragment D.K. 29 (Trad. Clémence Ramnoux). Dans une autre traduction : « Ils prennent une chose en échange de toutes, les meilleurs — la gloire impérissable en échange des choses mortelles ; mais les nombreux sont repus comme du bétail. » (Trad. Marcel Conche)
viDiogène Laërce. Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres. Livre IX. Trad. Robert Genaille. GF Flammarion, 1965, p.163
viiIbid.
viiiRapporté par Aétius. Opinions des philosophes, II, I, 1. Les Présocratiques. Bibliothèque de la Pléiade. 1988, p.68
ixAristote. Métaphysique, A, 986 b 21-22
xIbid. A, 986 b 24
xiRapporté par Cicéron. Premiers académiques, II, 37, 118. Les Présocratiques. Bibliothèque de la Pléiade. 1988, p.92
xiiRapporté par Diogène Laërce. Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres. Livre IX. Trad. Robert Genaille. GF Flammarion, 1965, p.170
xiiiRapporté par Diogène Laërce. Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres. Livre IX. Trad. Robert Genaille. GF Flammarion, 1965, p.171
xivMarcel Conche. Héraclite. Fragments. PUF, 1986, p.92
xvHésiode. Théogonie. 213

Podcast translated into English from https://metaxu.org/2024/06/09/du-dieu-yah/
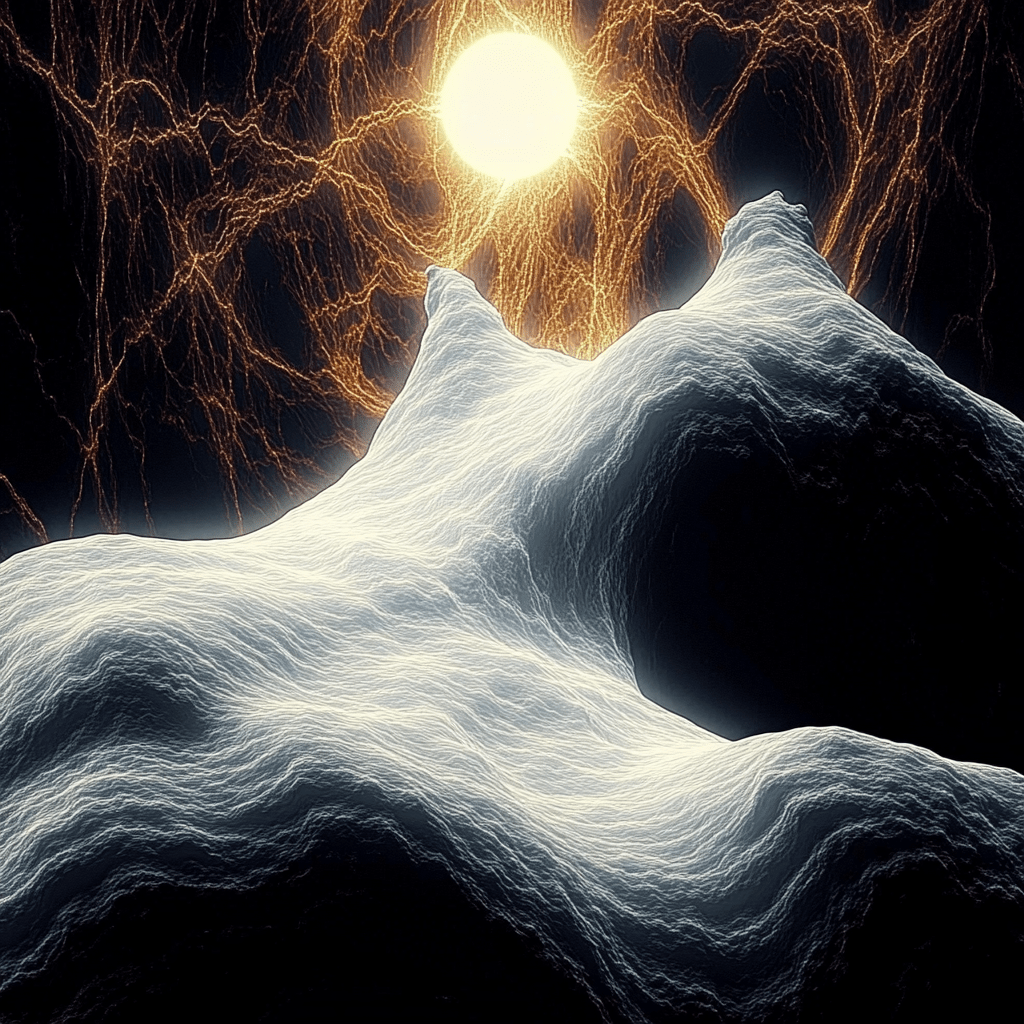
Podcast translated into English from https://metaxu.org/2024/08/27/metaphysique-gravitationnelle/
A Podcast summarizing and translating: https://metaxu.org/2024/04/16/lenergie-noire-du-cerveau/


Le mot erreur a comme sens premiers, aujourd’hui oubliés, « action d’errer çà et là » ou encore « parcours sinueux et imprévisible ». Ses autres acceptions, plus connues, « illusion, méprise », « le fait de se tromper » ou « la faute commise en se trompant », ne sont que dérivées. Ce mot vient du latin errare, « errer, aller çà et là, marcher à l’aventure ; faire fausse route » ; au figuré, « se tromper ». Il s’apparente au mot erre, qui vient du latin iter « trajet, voyage, marche; chemin, route », et qui, dans le français du 12e siècle, signifiait « voie, chemin » et, plus tard, « allure, manière d’avancer, de marcher ». C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner qu’Anatole France ait pu écrire qu’Ulysse aimait les « longues erreursi », et que, selon Sainte-Beuve, un ruisseau peut avoir « d’aimables erreurs » :
A trop presser son doute, on se trompe souvent ;
Le plus simple est d’aller. Ce moulin par devant
Nous barre le chemin ; un vieux pont nous invite,
Et sa planche en ployant nous dit de passer vite :
On s’effraie et l’on passe, on rit de ses terreurs ;
Ce ruisseau sinueux a d’aimables erreursii .
Les deux derniers vers cités réunissent d’aventure, l’effroi, la terreur et l’erreur. C’est là une coïncidence que j’accueille volontiers, pour en tirer quelques harmoniques. L’effroi et la terreur partagent une proximité sémantique, et la terreur possède une résonance phonétique avec l’erreur. Quant au verbe effrayer, il vient du français esfreder, « troubler, inquiéter » (10e siècle), lequel vient du bas latin *exfridare, lui-même dérivé de l’ancien bas francique *fridu « paix », avec le préfixe ex-, à valeur privative. Effrayer signifie littéralement : « faire sortir de l’état de paix, de tranquillité », et l’effroi est « ce qui fait sortir de la paix ». Un antonyme du mot effroi pourrait donc être beffroi, qui signifie littéralement « ce qui garde la paixiii » (de l’ancien bas francique *bergfridu). Après ces quelques notes de vocabulaire, passons à leur mise en musique.
Dans la paix comme dans la guerre, il y a ceux qui se « terrent », et ceux qui « errent », qui « sortent des voies tranquilles », frayent des voies nouvelles, suivent des chemins aux longs cours. Les uns s’effrayent de leurs erreurs, ou en rient, d’autres pleurent de terreur, c’est selon. La vie est sinueuse, mobile, effroyable ou paisible, riante ou atroce. Elle ne suit jamais un seul mode, elle ne se développe jamais à l’identique. Ses cheminements sont vagues et souvent erratiques, même si ses principales figures (naissance, croissance, sénescence, mort) sont apparemment répétées, de façon indéfiniment récurrente… Au-delà de ces quelques permanences, il reste que toute vie erre, essentiellement erre, mais l’on fait souvent erreur sur la nature de cette erre. La plus courante, et la plus lourde de conséquences, est l’erreur d’appréciation faite quant à l’erre entière de la vie, l’erre de son essence, et l’erre de son cheminement, de ses métamorphoses. Heidegger, avec son inimitable jargon, s’est attaché à questionner la nature de cette erreur, dont il voyait qu’elle atteignait la vie en son cœur, dans son être même comme dans son devenir. « D’où provient notre erreur consistant à voir dans le vivant le comble de la mobilité et le ‘devenir’ que l’on va même jusqu’à faire contraster avec l’‘être’ (c’est-à-dire l’étant comme l’étant-présent-là-devant — ce qui entre en présence)iv ? » Autrement dit — en style clair — la vie erre à la recherche de son erre, elle chemine tout en cherchant son chemin. Ce faisant, elle se meut sans cesse dans sa mouvance, elle devient indéfiniment ce qu’elle n’est pas encore, et qu’elle ne deviendra peut-être jamais, pour commencer d’être davantage ce qu’elle n’est toujours pas, pour continuer d’être dans l’errance, pour continuer d’errer, et, par conséquent, pour assumer de faire erreur sur l’essence même de cette errance. Dans son errance, la vie (c’est-à-dire tout ce qui est vivant) cherche le moyen de devenir autre que ce qu’elle est, et ce qu’elle a été. Elle cherche toujours l’autre de son être. Car l’être est, mais la vie erre. Le vivant erre vis-à-vis de l’étant qu’il est, il veut le dépasser, il veut aller toujours au-delà, il veut laisser le présent derrière lui, il veut laisser son étant-làen son état statique, pour mieux s’approcher de son dynamique et potentiel devenir. L’étant est toujours présent « là », même s’il tend aussi à aller un peu en avant de cet état-là, mais pas trop quand même. Il n’est pas dans l’idée de l’étant de prendre le risque de trop errer. L’état d’étant se transmet d’instant et instant, dans une immuable et rassurante stabilité. L’essence de l’étant, bien entendu, réside dans cette stabilité même, dans cette immobilité existentielle, dans le conservatisme du même, dans un refus ferme et répété du véritablement autre. L’étant ne veut pas vraiment de l’autre. Il ne veut en réalité que le même, toujours le même, à jamais le même, dont il croit qu’il constitue son essence. Ah ! Mais s’il veut être toujours le « même », que n’est-il donc resté jadis palourde sur quelque plage du Dévonien, ou oursin sur sa roche ? L’essence du « même » entre en résonance avec la notion même d’essence. En revanche, l’essence de l’« autre » est nettement plus difficile à saisir. Toute essence déterminée de l’« autre », de l’« altérité » en tant que telle, devra en effet pouvoir se prêter à des transformations futures de sa prore essence. Toute essence, justement parce qu’elle est une essence, est beaucoup plus proche, substantiellement, du même que de l’autre. À propos du concept même d’essence, en grec ὀυσία, d’innombrables développements ont été commis par les philosophes. Pour les ramasser en quelques mots, je dirais que l’essence d’un être est ce qui ne change pas, tout au long de son existence de cet être. Si l’on s’en tient à cette définition, quelle pourrait être donc l’essence d’une entité qui toujours change, qui se tient essentiellement en mouvement, dans l’errance ? Par exemple, quelle est l’essence de ce qu’on appelle la « vie », dans son acception la plus générale, et donc non limitée à la vie biologique ? Quelle pourrait être l’essence (qui ne change pas) d’une entité qui serait essentiellement changeante ? Ce n’est pas là une question rhétorique, une interrogation futile. Il s’agit d’essayer de définir l’essence de la vie dans son caractère le plus général, englobant donc l’essence de toutes les sortes de vies, les vies végétales et animales, la vie humaine, la vie de l’univers, la vie de l’esprit, la vie divine… L’essence de la vie ne peut pas, à l’évidence, être définie de façon rigide, fixe. De même, on ne peut pas définir l’essence de l’animé de la même manière que l’on définit l’essence des inanimés. Autrement dit, définir l’essence de la vie et définir l’essence de la non-vie ne sont pas des tâches comparables, du point de vue philosophique. Le même mot, essence, est ici employé, mais ce mot n’a pas du tout le même sens lorsqu’il s’applique à la vie ou à la non-vie. Pour définir l’essence de la « vie », il faut partir à la conquête de l’« être » véritable de la « vie », mais aussi de son « devenir », de ce qu’il n’est pas encore. Il est aisé d’affirmer que la vie se caractérise par la croissance, par le déploiement de toutes ses dispositions immanentes, par l’accumulation de nouvelles expériences et l’acquisition subséquentes de nouvelles compétences, et enfin par une certaine consolidation de ces acquis. Mais ces caractéristiques sont trop partielles. Elles ne visent pas l’« être » même du « vivant ». Il leur manque le principal : la saisie de ce que signifie le fait de « vivre » pour tel étant « vivant », pour tel « vivant » singulier. Il manque la saisie d’au moins une petite trace de la vérité que l’être vivant vit au plus profond de son être. Or, cette vérité, et c’est là le hic, cette vérité toujours erre, elle aussi.
On l’a dit, erre signifie « chemin, route, voyage ». Dans l’erre, ou dans l’erreur longue vers la vérité, cette route indéfinie vers le Vrai, il y a de nombreux endroits très obscurs et quelques autres relativement plus éclairés. Mais il est extrêmement rare de trouver quelque grande lumière, capable d’illuminer enfin, et pour toujours, cette errante recherche, cette erre éternelle vers l’essence. L’étant reste le plus souvent « caché », « celé », ou dans un autre sens encore, « abrité », pendant que se déploie l’obscurité propre à l’erre qu’il suit. Cependant, c’est bien dans cette obscurité même que doit jaillir un jour quelque clarté, si clarté il doit apparaître. Ainsi, ce que l’on pourrait appeler l’histoire de toute une vie, l’histoire totale d’une âme, consiste à faire la somme de toutes ses errances dans l’obscur, ou dans le demi-jour, pendant qu’elle cherche sans cesse ce qui en elle, de son obscur, jaillira en lumière et s’embrasera en chaleur. Mais comment peut-on espérer que de la lumière jaillisse jamais de l’obscur ? Si le mot obscur paraît ici encore obscur, prenons le mot « abîme », qui en est un équivalent. Le mot abîme, du grec α-βυσσός [littéralement, le « sans fond »], désigne au sens propre une cavité naturelle, sans fond visible, et donc apparemment insondable. Au sens figuré, et philosophiquement, l’abîme désigne le plus haut degré concevable d’une entité abstraite, ou encore, l’insondable, le mystère, et à la limite, l’infini ou le néant. Plus poétiquement, on dira que l’abîme est ce dont le fond se dérobe (à la vue et à l’esprit) et qui n’en est pas moins porteur de fondation, ou qui témoigne au moins de l’existence de son origine. On en infère que, si l’étant est « caché », c’est qu’il peut-être voilé par quelque abîme dont nous aurions pas idée. Plus nous nous cantonnons dans le domaine de la « représentation » des choses, moins nous sommes capables de concevoir l’abîme où se cèle leur essentiel devenir. Ceci s’applique particulièrement à la vie et à son caractère foncièrement inexplicable : la vérité de la vie est comme son abîme même. Comme toute cache, cet abîme (conceptuel) représente aussi une sorte de protection de l’essence élusive de la vie. Cette essence se saisirait mieux peut-être si l’on pouvait disposer d’une parcelle de vérité sur l’erre ou sur l’erreur de toute vie, et sur l’effroi et la terreur que cette erre peut inspirer à qui la regarde en face. Il faudrait donc intégrer, dans toute conception du vivant, cette erre, cette erreur et cette terreur. Sans elles, on ne pourra jamais « expliquer » le vivant, ni l’intégrer à des notions et à des représentations pacifiées, ou figées. Il faut se résoudre à déposséder le « vivant » de toutes les catégories a priori. Le laisser nu, dans un état de totale vulnérabilité, d’inflexible flexibilité, d’absolue mobilité. L’erre de l’être (vivant) n’en finira jamais d’errer. Ce voyage sans fin, qui a vocation d’aller immensément loin, en se détachant toujours plus de notre inhérente et inessentielle lassitude, passera sans doute par d’infinies étapes. Parmi les prochaines, il y aura celle qui consistera, pour l’homme, à choisir s’il veut rester ce qu’il a toujours été — un « étant » — ou bien s’il veut devenir un « être en devenir », ce qui suppose, entre autres, des plongées dans des profondeurs abyssales et des élévations à des hauteurs inimaginables de la pensée elle-même. Si la pensée de l’être est elle-même véritablement de l’être, ou tout au moins une sorte d’être, alors la pensée du devenir de l’être est aussi de l’être, ou bien une sorte d’être, ou, à tout le moins, une « sorte d’être » se transformant sans cesse par une « sorte de devenir ». Par la considération de ces différentes « sortes d’êtres », la pensée se trouve confrontée à elle-même, elle se trouve placée au pied du mur de son propre « être ». Devant ce mur impénétrable, elle peut se lamenter, se lancer dans des jérémiades, ou bien elle peut s’ouvrir au pressentiment de ce dont son être (ou « sa sorte d’être ») est le signe. Dans ce cas, il est possible que la pensée décide de ne pas s’installer pas dans cette « sorte d’être », pour s’y terrer. Elle pourrait décider d’errer plus avant encore dans le vaste paysage de vérités encore inconnues, encore inconcevables, et cependant ouvertes en puissance, de par la puissance inhérente au fait de penser. Elle pourrait décider de ne plus jamais se laisser aller à quelque infini effroi, et de ne plus jamais se terrer dans un éternel oubli de l’erre.
__________________________
i« Il aimait les beaux voyages et, comme on dit d’Ulysse, les longues erreurs ». Anatole France, Rabelais,1924, p.26
iiCharles-Augustin Sainte-Beuve. Portraits. Littéraires, « Boileau », tome 1, 1862, p. 27
iiiLe mot « beffroi » est attesté à partir de 1155 sous la forme berfroi, au sens de « tour de bois mobile servant à approcher des remparts lors d’un siège ». Cf. le moyen néerlandais berchvrede et le moyen haut allemand, bërcvrit / bërvrit, « tour de défense »
ivMartin Heidegger. Réflexions VIII, §27, Trad. Pascal David, Gallimard, 2018, p. 139

Quatre idées des Écritures célèbrent les ténèbres. 1. Dans les ténèbres se fait le mystèrei. 2. L’Éternel est obscur, il est ténèbresii. 3. La lumière même s’obscurcit par ses ténèbresiii. 4. Mais des ténèbres viennent aussi de l’éclat de sa lumière, et elles sont mêlées de glace et de feuiv.
M’en inspirant, je conçus cette parabole :
Plus elle s’en approchait, plus profonde était l’obscurité, plus épaisses les ténèbres. Plus elle avançait, plus elle défaillait, plus elle s’enfonçait et plus elle perdait le sens. La noire ténèbre incendiait son âme d’une chaleur sombre. Elle ne se sentait pas en danger. Si l’on fixe avec imprudence le soleil du regard, la violence de la lumière brûle la rétine, et vient la cécité, se disait-elle. Mais s’il s’agissait de la brillance concentrée de milliards de soleils, elle devrait tuer instantanément, et sans souffrance, supputait-elle. Une lumière d’une telle intensité désintégrerait instantanément toute vie. Mais en était-on si sûr ? La lumière pouvait-elle anéantir ? Cette opinion était-elle démontrable, du point de vue métaphysique ? D’ailleurs, l’anéantissement absolu était-il seulement concevable par une intelligence rationnelle ? Une brillance exterminatrice excéderait à tel point les capacités de perception que l’imagination elle-même en serait d’emblée aveuglée, ainsi que la raison. Il y avait d’ailleurs une autre piste de réflexion à considérer. Si une très grande lumière tue, quid d’une obscurité excessive ?, songeait-elle. La question méritait examen, au moins en considération de la symétrie apparente de la formulation, et de l’évident contraste entre lumière et obscurité. Qu’advient-il quand on plonge dans l’obscur absolu ? S’y brûle-t-on ? S’y congèle-t-on ? S’y éteint-on? Y meurt-on ? Elle n’en savait rien. Alors elle continuait de progresser, sourde aux angoisses, indifférente aux pressentiments. Les ténèbres, autour d’elle, s’engluaient toujours plus en de denses et abyssaux monceaux de mystère, sous un gouffre de nuées noires. Leurs eaux sombres et leurs amas ténébreux la plongeaient dans une telle stupeur, qu’elle sentit en elle son âme se dissoudre. Y avait-il quelque lumière, si imperceptible qu’elle fût, au tréfonds de son caveau d’ombre ? Non, nulle lueur, nul éclat. La nuit ne faisait jamais que commencer, point d’aube en vue. Mais, peut-être, à la réflexion, lui semblait-il apercevoir quelques éclairs rares, aussitôt éteints, ou des évanescences phosphorescentes ? N’étaient-ce pas là, cependant, de simples hallucinations, des phantasmes rétiniens, qui s’obscurcissaient et se diluaient plus vite qu’ils n’apparaissaient ? Ces semblances de lucioles, ces silencieuses scintillations, s’assombrissaient et s’obombraient bien avant de percer la nuit de leurs sombres fulgurances. À cause de leurs insoutenables et noirâtres rayons, elle avait décidément perdu toute idée du lieu où elle était censée se mouvoir. La lumière de son intelligence s’était, lui semblait-il, lysée, diluée, dans ces ténèbres tenaces. L’attente d’une éventuelle aurore, l’espoir d’une quelconque clarté, étaient exclus. Elle s’efforçait de fermer les yeux, pour grappiller, espérait-elle, quelques phosphènes égarés en ses rétines. Mais en réalité plus rien en elle ne brillait, pas la moindre lueur, ni la plus petite nitescence. L’obscurité qui la cernait de toutes parts était manifestement totale — comme un néant qui exclurait à jamais toute possibilité d’être. Rien ne pouvait plus luire en elle, ni lune, ni étoile, et pas même un photon. N’était-ce pas là contradictoire ? Toutes ses théories sur le sombre s’écroulaient. Il lui fallait peut-être faire d’autres hypothèses, changer de paradigme ? Bien que sa nuit fût si abyssale qu’elle en devenait invisible, pouvait-on tenter d’en soupçonner l’origine, d’en déterminer la cause ? Des monceaux cachés de lumières éclatantes, d’une surnaturelle brillance, avaient peut-être provoqué dans un temps ancien la cécité radicale qui l’aveuglait ? Une personne ayant su aller aussi loin qu’elle vers le fond de l’obscur, était-elle aussi capable d’entrer par effraction dans la lumière, pour la mesurer à l’aune de la conscience ? Une lumière qui reste ostentatoirement cachée au milieu de l’obscurité peut sans doute aisément surpasser toute vue et toute connaissance. Pour l’heure, délivrée du monde sensible et de la vanité des poursuites intellectuelles, son âme s’ébattait visiblement dans le règne de l’opacité et de l’ignorance. Renonçant à toute certitude, elle s’abîmait en toutes sortes de voies inutiles, s’éparpillant dans un vaste espace, fait de déserts et d’ombres. Perdue, sans pouvoir s’appartenir à nouveau, en son extrême confusion, elle restait pourtant unie à un idéal inconnu par son désir resté latent, par son attente, et par son renoncement à toute volonté personnelle. Puisant dans sa solitude une forme de connaissance que son intelligence n’avait pas préméditée, elle ambitionnait d’entrer plus avant dans cette obscurité désillusionnée, elle voulait voir et connaître mieux la nuit encore, pour évaluer son aveuglement. Peut-être espérait-elle apercevoir l’ombre furtive de ce qui, par sa nature, échappe à toute contemplation et à toute connaissance ? Depuis longtemps, elle n’avait jamais cessé de vouloir voir et de vouloir connaître, en dépit de l’insuccès de ses plongées nocturnes. Elle avait une soif ardente de se convaincre que, dans l’obscur, il n’est rien qui ne puisse à la fin subsister, de tout ce qui existe. Refusant par avance toute fatalité, elle se disait que les ténèbres finissent toujours par se dissiper devant quelque autre lumière à venir, devant sa seule surabondance. L’ignorance la plus crasse et une inconnaissance presque totale peuvent toujours être corrigées, en partie, par des connaissances nouvellement acquises, qui ajoutent leurs lumières aux lueurs anciennes. Mais il n’en est pas ainsi si l’ignorance initiale est absolue, si cette ignorance n’est point simplement une certaine privation de connaissance, si elle implique une séparation radicale entre la conscience et ce dont il lui faudrait avoir conscience, mais qu’elle ignore absolument. L’absence de toute lueur de conscience est-elle seulement aperçue de ceux qui en sont privés ? L’ignorance de l’essence divine est-elle ou non compatible avec la connaissance des créatures ? De sublimes ténèbres qui seraient inaccessibles à toute lumière, irréductibles à toute clarté, mèneraient-elles de ce fait à une impasse totale, à un cul-de-sac métaphysique ? Si, observant quelque représentation de l’infini, soit obscure soit lumineuse, on pouvait comprendre que l’on n’en verrait jamais que l’un de ses premiers moments, ou quelques-unes, peut-être, de ses conditions initiales, ou encore les prémisses de son âge, n’aurait-on pas, par là même, et paradoxalement, commencé à en percevoir l’ironique essence ? On en saisirait quelques éléments, quelques traces, par l’intelligence, et ce serait assez, semblerait-il, pour aller beaucoup plus loin. De même, la lumière : on capture quelques-uns de ses photons, et ils viennent s’immiscer en notre cortex, en notre nature, en notre esprit. Réciproquement, notre nature se lie en permanence à la lumière, ainsi que notre esprit. L’infini, la lumière, et le divin lui-même, au-delà de toute compréhension, échappant à toute saisie, existent certainement d’une façon transcendante, et même sur-éminente, mais ils ne laissent pas aussi de s’« intriquer », obscurément, avec constance — tout comme les trous noirs primordiaux laissent s’évaporer leur énergie. Il y a là une leçon générale. L’obscurité et la lumière sont par essence « intriquées ». Cette leçon s’applique aussi à l’humain et au divin.
__________________________
i« Il a fait des ténèbres son mystère, sa tente autour de lui, une ténèbre d’eaux, une nuée de nuages. » Ps 18,12
ii« N’est-il pas ténèbres, le jour d’Adonaï, et non lumière ? Il est obscur et sans éclat ! » Amos 5, 20
iii« La lumière s’est obscurcie par ses ténèbres. » (Is 5,30)
iv« De l’éclat devant lui, ses nuées avancent, grêle et braises de feu. » Ps 18,13

En épilogue à ses Poèmes saturniens, Verlaine évoque, pour les dédaigner manifestement, tous les transports de « l’Inspiration », dont l’Égérie, l’Ange, la Muse, la Colombe, le Saint-Esprit, l’Archange, ou Apollon lui-même, gratifient les poètes de « seize ans », ainsi que tous les « pauvres gens » qui croient que l’Art exige d’« éparpiller son âmei ».
« Ah! l’Inspiration superbe et souveraine,
L’Égérie aux regards lumineux et profonds,
Le Genium commode et l’Erato soudaine,
L’Ange des vieux tableaux avec des ors au fond,
La Muse, dont la voix est puissante sans doute,
Puisqu’elle fait d’un coup dans les premiers cerveaux,
Comme ces pissenlits dont s’émaille la route,
Pousser tout un jardin de poèmes nouveaux,
La Colombe, le Saint-Esprit, le saint délire,
Les Troubles opportuns, les Transports complaisants,
Gabriel et son luth, Apollon et sa lyre,
Ah ! l’Inspiration, on l’invoque à seize ansii ! »
Pourquoi seize ans ? Peut-être parce que c’était l’âge de Rimbaud quand Verlaine le connut, ainsi qu’il le rapporte : « Nous avons eu la joie de connaître Arthur Rimbaud. Aujourd’hui des choses nous séparent de lui, sans que, bien entendu, notre très profonde admiration ait jamais manqué à son génie et à son caractère. A l’époque relativement lointaine de notre intimité, Arthur Rimbaud était un enfant de seize à dix-sept ansiii. » Verlaine avait dépassé depuis longtemps l’âge de l’enfance quand il revendiqua pour lui-même l’épithète de « Suprême Poète », réservée seulement, semble-t-il, à ceux qui cisèlent « les mots comme des coupes » et qui font « des vers très froidement ». Rejetant le « saint délire » des « inspirés », il revendiqua du haut de son génie lent et sûr, l’« étude sans trêve », l’« effort inouï », le « combat non pareil » et l’« âpre travail » :
« Ce qu’il nous faut à nous, les Suprêmes Poètes
Qui vénérons les Dieux et qui n’y croyons pas,
A nous dont nul rayon n’auréola les têtes,
Dont nulle Béatrix n’a dirigé les pas,
A nous qui ciselons les mots comme des coupes
Et qui faisons des vers émus très froidement,
A nous qu’on ne voit point les soirs aller par groupes
Harmonieux au bord des lacs et nous pâmant,
Ce qu’il nous faut, à nous, c’est, aux lueurs des lampes,
La science conquise et le sommeil dompté,
C’est le front dans les mains du vieux Faust des estampes,
C’est l’Obstination et c’est la Volonté !
C’est la Volonté sainte, absolue, éternelle,
Cramponnée au projet comme un noble condor
Aux flancs fumants de peur d’un buffle, et d’un coup d’aile
Emportant son trophée à travers les cieux d’or !
Ce qu’il nous faut à nous, c’est l’étude sans trêve,
C’est l’effort inouï, le combat non pareil,
C’est la nuit, l’âpre nuit du travail, d’où se lève
Lentement, lentement, l’Œuvre, ainsi qu’un soleiliv ! »
Seule l’Obstination, « lentement, lentement », permet de sculpter avec le ciseau de la pensée « le bloc vierge du Beau », cette masse de marbre, cette tonne immobile de « Paros immaculé ». Le mot obstination, tout comme le verbe s’obstiner : « S’attacher fermement, envers et contre tout, à une idée, à une résolution, à une tâche; persister dans une attitude », viennent du latin obstinare « vouloir quelque chose d’une volonté opiniâtre ». Obstinare, « s’obstiner » et destinare, « fixer, attacher » ont pour même racine –stanō, « se tenir », dont le radical indo-européen *st(h)ā a donné par exemple le sanskrit ásthāt « il s’est mis debout ». De très nombreux mots latins dérivent de cette racine, dont status « qui se tient droit, dressé, immobile », statio « station, résidence ; mouillage, port », stator « esclave public chargé de la poste », Stator, épithète de Jupiter, statua :« statue », destituō :« établir ; abandonner », prōstituō : « placer devant ; prostituer », restō : « demeurer en arrière », obstō : « se tenir devant, faire obstacle », substō: « se tenir dessous, résister », superstō: « se dresser par-dessus, dominer, surmonter », consistō : « arrêter ; se composer de, consister en », desistō :« s’éloigner, abandonner, cesser de », exsistō : « se dresser hors de ; s’élever, sortir de terre, surgir ; exister, apparaître »…
Refusant de se laisser inspirer, Verlaine s’obstina à s’obstiner. Quant à moi je butine, telle une abeille à mots, un frelon à sons, suçant leurs sucs et leurs essences. Et je me plais à imaginer un poète futur, dont la poésie serait faite de toutes ces sortes de stances : la substance et la superstance, la consistance, la désistance, et l’ex-sistance.
_____________________
i« Libre à nos Inspirés, cœurs qu’une œillade enflamme,
D’abandonner leur être aux vents comme un bouleau:
Pauvres gens ! l’Art n’est pas éparpiller son âme :
Est-elle en marbre, ou non, la Vénus de Milo ? »
Paul Verlaine. Poèmes saturniens. In Œuvres complètes, Tome I. Ed. Vanier, Paris, 1907, p.78
iiPaul Verlaine. Poèmes saturniens. In Œuvres complètes, Tome I. Ed. Vanier, Paris, 1907, p.77
iiiPaul Verlaine. Les Poètes maudits, II. In Œuvres complètes, Tome IV. Ed. Messein, Paris, 1920, p.16
ivPaul Verlaine. Poèmes saturniens. In Œuvres complètes, Tome I. Ed. Vanier, Paris, 1907, p.77-78

Trois concepts classiques comme le Néant, l’Être et l’Un, ou bien, dans un autre jargon, le Non-être, l’Être et la « Suressence », pourraient parfaitement symboliser les trois principales étapes du parcours de toute âme rationnelle, entre son néant initial et sa putative union avec le « divin », en passant par ce qu’on appelle son « existence ». Avant de naître, l’âme n’était pas. Pendant la vie, l’âme existe et participe ainsi de l’être (que l’on peut définir comme l’existence en général, comme ce qui existe, conçu sous la forme la plus abstraitei). Et, après la mort, du moins si l’on en croit quelques philosophes et certains théologiens, l’âme est invitée à s’unir à l’au-delà de tout être et de toute essence. « Abandonne les sensations, renonce aux opérations intellectuelles, rejette tout ce qui appartient au sensible et à l’intelligible, dépouille-toi totalement du non-être et de l’être, élève-toi ainsi, autant que tu le peux, jusqu’à t’unir dans l’ignorance avec celui qui est au-delà de toute essence et de tout savoir. Car c’est en sortant de toi et de toi-même, de façon irrésistible et parfaite que tu t’élèveras dans une pure extase jusqu’au rayon ténébreux de la divine Suressence, ayant tout abandonné et t’étant dépouillé de toutii. »
La structure triadique du sensible, de l’intelligible et de l’« au-delà de tout savoir », tout comme celle mettant en relation le non-être, l’être et l’« au-delà de toute essence », sont deux exemples de systèmes conceptuels tentant de décrire une réalité en constante métamorphose. On peut supputer que l’un ou l’autre de ces systèmes peuvent en partie expliquer la dynamique à long terme de l’existence dans son évolution jamais stabilisée, et dont on ne peut assurément pas prédire le destin final, ou même seulement déterminer si cette fin existe en effet, ou bien si son évolution est potentiellement « sans fin ». Si un système métaphysique est basé sur au moins trois entités ou essences fondamentales, et non pas sur seulement deux (comme l’être et le néant, l’esprit et la matière, ou le divin et l’humain), l’évolution d’un tel système triadique peut-elle donner lieu à une application de la théorie du « chaosiii » ? Par analogie avec le « problème à trois corpsiv », un système métaphysique qui serait fondé autour de trois pôles conceptuelsv pourrait bien, lui aussi, devoir se comporter de façon imprévisible et même « chaotique », bien loin de l’équilibre statique entre des champs conceptuels a priori délimités et déterminés, tels que ceux que la philosophie classique aime à considérer. Le seul fait que trois entités philosophiques puissent ‘librement’ entrer en interaction, rend le système ainsi formé intrinsèquement instable, et imprévisible dans son évolution ultérieure. C’est là un résultat fort intéressant, que l’on peut utiliser dans des contextes métaphysique, philosophique ou théologique. Il implique notamment que le concept d’un Dieu « omniscient » n’est plus soutenable, dès lors que ce Dieu a décidé de ne plus rester « seul », mais qu’il a volontairement « sacrifié » son « unicité » et sa « solitude » pour donner existence à une réalité triadique, formée de Lui-même (Théos) ainsi que d’autres entités ontologiques, comme celles d’une Création matérielle (Cosmos) et aussi d’une Créature consciente (Anthropos). On doit se résoudre à imaginer le Théos comme étant désormais confronté, en quelque sorte, à la dynamique intrinsèquement chaotique du système à « trois essences » qu’Il a Lui-même décidé de créer. Une autre conséquence de la nature des systèmes métaphysiques à « trois essences » est que celles-ci ont désormais vocation à rester « intriquées ». J’emploie ici la métaphore de l’intrication, qui fait, bien entendu, venir à l’esprit son acception « quantique ». L’intrication quantique est d’ailleurs elle-même d’essence triadique: elle suppose en effet trois entités qui sont en interaction fondamentale : le phénomène quantique à observer, le dispositif expérimental permettant les mesures, et l’observateur qui observe le phénomène et les mesures qui en résultent. Mais est-on fondé à utiliser la métaphore de l’intrication pour l’appliquer à des entités comme le divin, l’humain et la nature ? Et si cette métaphore est a priori possible, est-il licite d’en induire des conséquences respectivement théurgiques, philosophiques, et même, à terme, cosmologiques ? À ce stade, il importe également de définir les types de triades conceptuelles qu’il convient de considérer comme se prêtant à de telles intrications : Theos, Anthropos et Cosmosvi ? Inconscient, Conscience, Matièrevii ? L’Un, l’Être, le Néant? Le Zéro, le Nombre, l’Infiniviii ? J’aimerais proposer ici, à titre d’exercice, une autre triade, purement verbale : « Fonder, Dépasser, Surpasser ». L’être se fonde, l’existence se dépasse, puis elle se surpasse dans la suressence. « Comme l’intellect conduit à l’être, il faut aussi dépasser celui-ci. En effet, l’être n’est pas cause de l’être, comme le feu n’est pas cause du feu, mais il existe quelque chose de beaucoup plus élevé vers lequel il doit monter […] L’âme doit en effet dépasser la divinité même sous ce nom [Dieu], ou même sous chaque nomix. » Il s’agit pour l’âme de monterx toujours plus haut, et cela sans cesse, sans fin. D’ailleurs, dans son essence, en tant qu’elle exerce son intelligence, « l’âme est reliée à Dieu par sa partie supérieure, selon rabbi Moïsexi, et c’est ainsi qu’elle est de la race de Dieuxii. » Il est clair que l’esprit appréhende l’« être » avant de pouvoir connaître le « vrai ». Par cela est montrée la grandeur de l’esprit (et plus encore celle de l’âme sous laquelle ce dernier est subsumé). Par conséquent, il est probablement préférable de chercher la béatitude dans l’acte de l’intelligence plutôt que dans la volonté. Or, dans l’acte même de l’intelligence, dans l’acte de compréhension, toutes les « obscurités » semblent dispersées, dissoutes. Il est donc, peut-être, encore plus préférable de situer la béatitude « dans l’essence nue de l’âmexiii. » Comment définir l’essence « nue » de l’âme ? Il faut commencer par réaliser que l’âme se situe bien au-delà de l’esprit, et en particulier bien au-delà de toutes ses puissances, bien au-dessus, par exemple, de l’intelligence, de la mémoire et de la volonté. « Dans l’essence de l’âme, aucune créature n’y entre jamais, ni Dieu lui-même sous quelque voile que ce soitxiv. » Dieu Lui-même ne peut-il donc entrer dans l’âme ? Mais Maître Eckhart n’évoque-t-il pas aussi « le secret de l’âme, là où Dieu seul pénètre xv» ? Il n’y a pas là de contradiction, me semble-t-il. Dieu n’entre pas dans l’âme « sous un voile », dit Eckhart, mais en revanche il peut y entrer – sans aucun voile… Que seraient les « voiles » divins ? Ces voiles pourraient être ceux du « vrai », du « bien », ou encore du « juste ». Si l’on veut monter vers le plus haut, il faut se dévêtir de tous les oripeaux de la philosophie et de la théologie. Il faut apprendre à penser avec le néant, et aussi à dépasser le néant même. « Le néant lui-même, racine de tous les maux, des privations et des choses multiples, est caché dans l’être même véritable et entierxvi .» Que le néant soit ‘caché’ dans l’être ‘véritable’ explique pourquoi il est intimement intriqué avec la vie et la « Sur-Vie », et voilà aussi pourquoi l’évolution du système triadique du non-être, de l’être et de la sur-essence est (structurellement) imprévisible, et peut-être même chaotique. Il est entendu qu’il faut entendre ici par chaosxvii le présage et l’annonce d’un cosmosxviii à venir, d’une complexité/conscience toujours croissante. Une théologie du chaos ouvre des béances encore inimaginables dans le tissu du néant.
_______________________________
iCNRTL
iiDenys l’Aréopagite. La Théologie mystique. Trad. M. de Gandillac. Aubier, 1943. Ch. 1, § 1 p. 177
iiiLa théorie du chaos étudie le comportement des systèmes dynamiques sensibles aux conditions initiales. Des modifications infimes de leurs conditions initiales entraînent des évolutions rapidement divergentes, rendant toute prédiction impossible à long terme (phénomène souvent illustré par la métaphore de « l’effet papillon »). Ces systèmes sont en théorie « déterministes », puisqu’ils sont censés suivre des lois déterministes. Mais, précisément parce qu’ils sont déterministes, leur comportement à long terme dépend essentiellement de leurs conditions initiales, lesquelles ne peuvent jamais être connues avec une précision infinie. Ces systèmes sont donc structurellement imprévisibles, car les marges d’erreur liées à l’incertitude sur leurs conditions initiales ne font que s’accroître lors de leur évolution ultérieure.
ivLa loi d’attraction universelle de Newton permet de prédire de façon déterministe l’évolution de seulement deux corps célestes en interaction. Mais si le nombre des corps considérés est supérieur à deux, alors le comportement du système formé par trois (ou plusieurs) corps devient ‘chaotique’, c’est-à-dire mathématiquement imprévisible après un certain temps d’évolution, dépendant de la précision des observations initiales. Le « problème à trois corps » fait partie de ceux étudiés par la théorie du chaos.
vOn trouve des représentations à base ternaire ou triadique dans toutes les cultures. Par exemple, dans la philosophie du vedanta, l’unité intrinsèque du saccidananda est différenciée par trois concepts : Sat, Chit etAnanda (« Être, Conscience, Joie »). La triade du Brahman, de l’Ātman, et de la Māyā, met en relation la réalité suprême, l’âme universelle et le règne des apparences. Le vedanta distingue également en tout homme le corps (śarīra), le ‘mental’ (manas) et l’âme individuelle (jīva). la Trimūrti hindoue est représentée par les trois dieux Brahmā, Viṣṇu et Śiva. En Occident, le concept de Trinité, théorisé par la théologie chrétienne, est symbolisé par la figure ‘trine’ du Père, du Fils et de l’Esprit, les trois « Personnes » consubstantiellement unies en l’Unité divine.
viLe philosophe et théologien, Raimon Panikkar, a forgé le concept de « cosmothéandrie », représentant une structure triadique : Theos, Anthropos et Cosmos (Dieu, l’Homme et l’Univers).
viiDes idées analogues à la triade du « divin », de l’« humain » et de la « nature », ont été explorées au 19e siècle par F.W.J. Schelling dans sa Philosophie de la mythologie, et au 20e siècle par C.-G. Jung avec l’Inconscient (le pôle divin), la Conscience (le pôle humain) et la Matière (le pôle de la nature universelle).
viii« L’intellect peut recevoir toujours plus, et plus [ce qu’il reçoit est] grand, plus [il reçoit] avec facilité. C’est pourquoi il est aussi capable de recevoir l’infini. » Maître Eckhart. La mesure de l’amour. Sermons parisiens. Sermon XXIV, 2. § 247. Trad. Eric Mangin. Seuil, 2009, p.236
ixMaître Eckhart. La mesure de l’amour. Sermons parisiens. Sermon XI, 1. § 112. Trad. Eric Mangin. Seuil, 2009, p.132
xJean Damascène parle de la « montée de l’esprit vers Dieu » ()
xiMoïse Maïmonide. Le Guide des égarés, III, 52, Trad. de l’arabe par Salomon Munk, Verdier, 1979, p. 626 : « Ce roi qui s’attache à l’homme et l’accompagne, c’est l’intellect qui s’épanche et qui est le lien entre nous et Dieu ; et de même que nous le percevons au moyen de cette lumière qu’il épanche sur nous, comme il est dit : ‘Par ta lumière nous voyons la lumière’ (Ps 36,10), de même c’est au moyen de cette lumière qu’il nous observe et c’est par elle qu’il est toujours avec nous, nous enveloppant de son regard : ‘L’homme pourra-t-il se cacher dans une retraite de manière que je ne le voie pas’ (Jér 23,24) ? »
xiiMaître Eckhart. La mesure de l’amour. Sermons parisiens. Sermon XI, 1. § 115. Trad. Eric Mangin. Seuil, 2009, p.134-135
xiiiMaître Eckhart. La mesure de l’amour. Sermons parisiens. Sermon XI, 2. § 120. Trad. Eric Mangin. Seuil, 2009, p.139
xivMaître Eckhart. La mesure de l’amour. Sermons parisiens. Sermon XI, 2. § 121. Trad. Eric Mangin. Seuil, 2009, p.139
xvMaître Eckhart. La mesure de l’amour. Sermons parisiens. Sermon IX § 98. Trad. Eric Mangin. Seuil, 2009, p.123
xviMaître Eckhart. La mesure de l’amour. Sermons parisiens. Sermon VIII § 90. Trad. Eric Mangin. Seuil, 2009, p.118
xviiLe mot grec χάος signifie « ouverture béante, gouffre, abîme ; espace immense et ténébreux qui existait avant l’origine des choses ». Mais, par extension, et c’est là l’acception que je voudrais retenir ici, il signifie : « la durée infinie du temps », et donc l’infinie ouverture des possibles. (Cf. Bailly)
xviiiLe mot grec κόσμος signifie « ordre ; organisation, construction ».

Un très étrange épisode du Livre des Rois narre l’« ascension » du prophète Élie, en présence de son disciple, le prophète Élisée. Ce qui est étrange, c’est qu’Élisée « voit » l’ascension d’ Élie, mais sans vraiment la voir, ou plutôt sans y croire tout à fait. Élisée « sait » qu’Élie s’« élève », mais il ne veut pas vraiment le reconnaître, il recule le moment où il lui faudra accepter la réalité de cette ascension qu’il refuse de laisser s’accomplir, et dont il est le témoin bien malgré lui. Même les prophètes peuvent, en toute bonne foi, ignorer la véritable nature des phénomènes dont ils sont les témoins. Ils peuvent aussi se tromper eux-mêmes. Ils peuvent d’ailleurs être récompensés, malgré tout, de leur sorte d’« aveuglement », pourvu qu’ils soient capables de s’en détacher, étape par étape. Un commentaire plus détaillé, à partir du texte lui-même, donnera, je l’espère, une idée de quoi il retourne.
« Quand YHVH fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie et Élisée quittaient Gilgali. »
Le nom de cette ville, située entre Jéricho et le Jourdainii, Gilgal, a pour racine גָּלַל, galal, « être rond, tourner, rouler ». Le mot gilgal signifie « cercle de pierreiii », et fait référence aux douze pierres que Josué fit ériger à Gilgal, après son passage du Jourdain avec le peuple et l’arche de l’allianceiv. Mais, selon le dictionnaire, ce mot peut signifier aussi « roue » ou encore « tourbillonv ». Il y a donc dans cette phrase deux mots qui évoquent l’idée de « tourbillon ». Le « tourbillon » associé métaphoriquement à Gilgal, et le véritable « tourbillon » qui enlève Élie au ciel, et qui se dit avec un autre mot : סְעָרָה, sé‘arah, « tempête, tourbillonvi », lequel connote un effet bien plus « tempétueux » que circulaire. Selon le texte, donc, Élie « monte au ciel » dans un « tourbillon », au moment précis où il quitte Gilgal (« tourbillon »), en compagnie d’Élisée. Élie dit alors à Élisée de rester à Gilgal, pour pouvoir librement continuer de monter au ciel, sans témoin. Mais Élisée refuse : « ‘Par le Dieu vivant (ḥay Adonaï [YHVH]) et par ton âme vivante, je ne te quitterai pas’. Et ils se rendirent ensemble à Béthelvii. » La situation est la suivante : Élie a commencé son ascension, mais ne peut pas l’accomplir tant qu’ Élisée refuse de le quitter. Sur le chemin menant à Béthel [« la maison de Dieu »], des « fils de prophètes » [bnéï ha-nébiim], établis dans cette ville, « sortirent à la rencontre d’Éliséeviii ». Élie n’est pas cité dans le texte. Élisée est donc, apparemment, resté seul sur la terre, pendant qu’Élie, devenu invisible, est déjà partiellement monté au ciel. Les « fils de prophètes » s’adressèrent à Élisée : « ‘Sais-tu qu’aujourd’hui Adonaï [YHVH] va emporter ton maître [Adonéï-khaix] par-dessus ta tête [מֵעַל רֹאשֶׁךָ] ?’ Il répondit: ‘Oui, je le sais, faites silence !x’. » Les « fils de prophètes », qui n’ont pas vu qu’ Élie a déjà commencé sa montée au ciel, annoncent à Élisée ce qu’il sait déjà. Celui-ci leur intime le silence. Pourquoi ? Parce qu’il veut continuer le dialogue avec son maître, Élie. Le silence rétabli, la voix d’ Élie lui parvient et lui demande de rester à Béthel, pendant que lui, Élie, ira à Jéricho. Mais Élisée refuse pour la deuxième fois: « Par le Dieu vivant et par ton âme vivante, je ne te quitterai pasxi ». Les deux prophètes allèrent donc ensemble à Jéricho, Élie volant dans les airs, et Élisée marchant sur la route. D’autres « fils de prophètes » demeurant à Jéricho « s’approchèrent d’Éliséexii », et lui dirent : « Sais-tu qu’aujourd’hui Adonaï va emporter ton maître, par-dessus ta tête ? » Il leur répondit de la même façon : « Oui, je le sais, faites silence !xiii. » Le silence revenu, Élie demanda une troisième fois à Élisée de le laisser seul, et de rester à Jéricho, en alléguant du fait que Dieu voulait l’envoyer vers le Jourdain. Mais Élisée répéta : « Par le Dieu vivant et par ton âme vivante, je ne te quitterai pasxiv ». Et ils continuèrent leur route ensemble. Arrivés au Jourdain, Élie sépara les eaux en les frappant de son manteau, et ils traversèrent à pied sec. Après qu’ils eurent passé, Élie, de plus en plus impatient de le quitter, s’adressa à Élisée: « Demande : Que puis-je faire pour toi avant d’être enlevé d’auprès de toi ? ». Élisée répondit : « Que me revienne une double part de ton esprit ! ». Élie reprit : « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d’auprès de toi, cela arrivera, sinon cela n’arrivera pasxv. » Alors qu’ils conversaient, « voici qu’un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux, et Élie monta au ciel dans le tourbillonxvi. » Élisée « voyait » Élie monter dans le char, puis « il ne le vit plus ». Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Ramassant alors le manteau d’Élie « qui avait glisséxvii », il en frappa les eaux du Jourdain, tout en disant : « Où est YHVH, le Dieu d’Éliexviii ? » Sans attendre de réponse, il continua de frapper les eaux, qui se divisèrent d’un côté et de l’autre, comme déjà elles l’avaient fait une première fois avec Élie, mais aussi, bien avant, lors du passage du Jourdain par Josué avec le peuple et l’arche d’alliance. Alors Élisée retraversa le Jourdain, et revint sur la rive occidentale. Les « fils de prophètes » qui observaient la scène à distance dirent alors : « L’esprit [ruaḥ] d’Élie est sur Éliséexix ».
Toute cette scène, complexe, ne se comprend que si l’on admet que l’ascension d’Élie a commencé dès Gilgal et qu’elle ne s’est réalisée définitivement que lorsque les deux prophètes furent arrivés de l’autre côté du Jourdain. Pendant tout ce temps, Élie était devenu invisible à tous « les fils de prophètes ». Seul Élisée était en mesure de continuer de dialoguer avec lui, en imposant le « silence » à ceux qu’ils croisaient en chemin. Pourquoi cet acharnement d’Élisée à ne pas vouloir quitter Élie ? Pour deux raisons essentielles. D’abord, il voulait obtenir « une double part » de l’esprit d’Élie. Et l’ayant obtenue, il voulut alors savoir « où était YHVH, le Dieu d’Élie ». La réponse était peut-être, pour lui, dans le vide que firent les eaux qui se séparaient, ou bien dans le fait d’avoir été exaucé : l’esprit d’Élie était désormais sur lui — et cette fois, visible par tous.
_______________________
i2 Rois 2, 1
iiCette ville, nommée Gilgal, est différente de la ville nommée également Gilgal qui est citée dans Jos. 4, 19-20 : « Le peuple remonta du Jourdain et campa à Gilgal, à la limite est de Jéricho. Quant à ces douze pierres qu’ils avaient prises dans le Jourdain, Josué les érigea à Gilgal. »
iiiGilgal est un ancien lieu de culte, devenu le sanctuaire principal de la tribu de Benjamin. On y rattachait le souvenir de la circoncision et de la première Pâque en Canaan. Cf. La Bible de Jérusalem, Jos 4, 19, note b, p. 254.
iv« Quand demain, vos fils vous demanderont : ‘Ces pierres, que sont-elles pour vous ?’, alors vous leur direz : ‘C’est que les eaux du Jourdain se sont séparées devant l’arche d’alliance de YHVH. Ces pierres sont un mémorial pour les Israélites, pour toujours !’ » Jos. 4, 6-7
v« La voix de ton tonnerre dans le tourbillon (gilgal) » (Ps. 77, 19); « On les appelait tourbillon (gilgal) » (Ez. 10,13) ; « Mon Dieu, rends-les semblables à un tourbillon (gilgal) » (Ps 83,14) ; « Comme un tourbillon (gilgal) devant une tempête » (Is. 17,13)
viCe mot a pour racine,סָעַר, qui signifie : « être violemment agité [par la tempête], mugir », et peut se dire de la mer mais aussi des hommes.
vii2 Rois 2, 2
viii2 Rois 2, 3
ixאֲדֹנֶיךָ
x2 Rois 2, 3
xi2 Rois 2, 4
xii 2 Rois 2, 5
xiii2 Rois 2, 5
xiv2 Rois 2, 6
xv2 Rois 2, 9-10
xvi2 Rois 2, 11
xvii2 Rois 2, 13
xviii2 Rois 2, 14. אַיֵּה יְהוָה אֱלֹהֵי אֵלִיָּהוּ . Ayyeh Adonaï Elohéï Eliyahou ?
xix2 Rois 2, 15 רוּחַ אֵלִיָּהוּ עַל-אֱלִישָׁע. Ruaḥ Eliyahou ‘al-Elicha‘

En affirmant l´intrication quantique de toutes les particules de l´univers, les Modernes ont, en réalité, repris de façon matérialiste l’antique idée selon laquelle « tout est plein de dieux », πάντα πλήρη θεῶν εἶναι. L’auteur de cette formule, Thalès de Milet, né vers 640 av J. C., fut le premier à recevoir le nom de « Sage », selon Platoni, occupant ainsi le rang prééminent parmi les fameux « Sept Sages ». Il fut aussi le premier à dire que « les âmes sont immortellesii ». Aristote précise qu’il donnait « une âme aux êtres inanimés, en se fondant sur les propriétés de la pierre magnétique et de l’ambreiii». Thalès, plus connu des lycéens pour son théorème que pour ses vues métaphysiques, avait l’intuition que les multitudes « divines » sont toutes unies entre elles, mais qu’elles sont également liées aux âmes, celles des êtres animés comme celles des êtres inanimés (en apparence). Les myriades de dieux et de « démons » (daimon), mais aussi les multitudes d’êtres, d’âmes, d’ondes et de particules, sont toutes enlacées, embrassées, enchevêtrées, nouées par toutes sortes de nœuds numineux. Sur ce point, les Anciens et les Modernes se rapprochent, donc, ne serait-ce que métaphoriquement. Mais on pourrait aussi souligner qu’à la différence des particules quantiques dont les champs de probabilité se superposent, les dieux innombrables, quant à eux, restent « séparés », de par leur nature même, des choses, des corps et des âmes, dont ils accompagnent pourtant, sans cesse, l´émergence et la vie. La somme totale de tous les « dieux » forme une sorte de « gaze », un « voile » fin, infiniment tissé, semblant sans couture, enveloppant de souples vibrations tout ce qui n’est que matière et énergie, s´immisçant dans tous les interstices et dans tous les vides. Deux ordres de réalité ainsi se voisinent, sans se confondre, et sans cesse se mêlent et s’intersectent, comme des plis, des angles, des désirs ou des vœux. Où sont précisément ces lieux où se rencontrent les dieux et les âmes, les esprits et les corpuscules ? Les trouve-t-on dans les hasards, les augures, les pythies, les hymnes et les invocations, ou dans les intuitions et les pressentiments ? On les rencontre sans doute dans le rythme des cœurs battants, et dans l’indicible silence, blottis entre les mots, cachés dans l’absence, celés sous les symboles — signes cois. On les découvre dans les grands fonds, les abysses abaissés, les nues lisses et hautes. On les saisit simplement dans toute âme en épigenèse, embryon d’elle-même, sans sol ni ciel, capable d’approcher toute chose, pour la connaître et s’en détacher, légère. Ce n’est pas l’éveil, mais le sommeil, qui lui révèle les quelques mystères dont il lui est donné de les pressentir. Pauvre en esprit, toute âme cache sa nature dans l’opulence des songes enfouis. Éveillée, elle se couvre de conscience comme d’un vêtement. En son sommeil, elle n’est qu’exil, allée en des rêves indociles, elliptiques. Abeille, elle butine, cherchant des sucs et des saveurs, loin de la ruche connaisseuse. Miel à son retour, elle vole vers la reine endormie, la connaissance assoupie. Qui dira la portée de ses vols nocturnes ? La conscience n’a pas d’ailes aussi larges. Double vie de l’âme, l’une de lune et d’ombre, l’autre de lumière. Mais c’est la nuit qui est grosse de possibles, non le jour vain de son soleil. Dans la nuit des sens, dans la ténèbre du sens, elle monte au plus haut, loin des plaines plates, des steppes statiques, des chotts et des ergs. Elle explore dans ces hauteurs, non des palais, mais l’exode même. Elle quête les passages, les détroits, et les « trous » cosmiques (noirs ou blancs), tout ce qui ouvre à la fuite et à l’impensé. Toutes les nuits, elle vole comme une colombe, loin de l’arche noachique dont l’incendie couve dans la cale. Dans ses envols, hors de la réalité de la glu et de la glaise, elle s’approche des cieux supérieurs et des dieux inoccupés. Elle y grappille des pépites mentales, des fragments de génie, des souffles sûrs, des gestes de gravité, des esquisses de danse. Elle sait à sa façon d’où s’origine la symphonie immense, elle sent la puissance des sèmes, elle suce le sein nébuleux, elle engloutit des sèves galactiques. Elle voit des idées, nues comme des buissons qui brûlent, elle pressent des sylves d’odeurs et d’épines… Elle vole aux dieux eux-mêmes la vision de leurs envols. Cinglant larcin ! Mais rapt utile, célébré au retour de caresses méritées et de louanges mesurées. Ainsi nimbée d’aura, constellée de cieux, l’âme à la fin retourne à la glèbe, pour faire reverdir la boue, exhausser les lotus. L’âme se fait donc double, comme deux amants doux, deux courbes magnétiques. Quand elle se dédouble, se désenlace, quand cesse son union, elle se réalise, pénétrée de connaissance, se sachant libre, se sachant aussi possédée, comme, dans la forge, le fer est possédé par le feu. L’âme sait où est le centre de l’âtre. Il lui faudra du temps pour guérir ses brûlures, pour en penser la nature, pour sublimer ses sutures, pour désencombrer la conscience de ses cendres. Non, ce n’est pas d’un soudain vol extatique, d’un mystique délire, que l’âme franchit les mondes. Elle reste calme et froide comme un lac. Elle entre dans le cratère, elle plonge dans la lave, comme une goutte de mercure. Elle ne s’y vaporise en aucune façon. Elle s’y fait simple boson, puissance irradiée, entière entéléchie. Elle se fait théophanie. Elle prononce ces mots : « Bouche déliranteiv ». En elle, en effet, langue, larynx, glotte et incisives délirent ensemble, et s’unissent à l’haleine et à la parole.
________________
iPlaton. Protagoras. 343 a
iiSelon le résumé que fait Diogène Laërce de sa doctrine. Vies, I, 24.
iiiCf. Aristote. Traité de l’âme, I, 2, 405 a 19. « Il semble que Thalès, lui aussi, d’après ce que l’on rapporte, considérait l’âme comme un principe moteur : l’aimant, selon lui, possède une âme puisqu’il met le fer en mouvement. » Aristote. Métaphysique A, III, 983 b 20 : « Thalès, le fondateur de cette sorte de philosophie [qui envisage seulement les principes matériels des choses], dit que le principe est l’Eau. Il fut conduit sans doute à cette croyance en observant que toutes choses se nourrissent de l’humide. »
ivHéraclite, Fr. 92

« S’il est chose que je désire, je l’ignorei. »
Cette petite phrase de Hadewijch fut reprise, un siècle plus tard, par Jan van Ruusbroec, quoique la forme même de cette formule fut un peu perdue dans la traduction, comme il se doit.
« Mon cœur a-t-il des désirances ?…
Dans une insondable ignorance,
J’ai mon moi tout comme perduii. »
Huit siècles après Hadewijch, je désire à nouveau évoquer cette ignorance du désir, quoique un peu différemment. Je ne sais pas ce que je désire, mais je sais que je désire quelque chose dont je ne sais rien pourtant, sauf le fait que je n’en sais rien. Je ne sais pas pourquoi je la désire, mais ce que je sais c’est que je la désire, et que je désire savoir pourquoi je la désire, cette chose. Je suis ainsi, sans le savoir, dans des sortes de limbes qui n’en finissent pas, et la grotte est profonde de mon abyssale ignorance. L’esprit humain, je ne ne sais pas pour vous, mais le mien en tout cas, est obscur et lent. Il ne peut même pas dire un mot juste de ce qu’il découvre parfois dans la profondeur de sa nuit. C’est pourquoi je n’aspire plus trop, désormais, à me mêler au monde, à me rapprocher des empressés qui attendent prébendes et retours. Si quelqu’un me demandait qui je suis et où je demeure, je répondrais sans mentir n’en rien savoir assurément. Je ne saurais pas plus parler de lieu ou d’identité, qu’une pierre de granit sait flotter dans la mer. Étrange circonstance, en vérité, et qui me met aux abois, je l’avoue. Ce qui est caché dans le monde, c’est ce qui me saute le plus aux yeux. Comme je suivais un chemin, attiré par quelque pensée amoureuse, qui avait le pouvoir de m’inonder d’un regard, je ne sus plus soudain où j’étais. Pour comprendre ceci, il faut avoir été un jour lié et jeté dans l’ombre d’une basse-fosse, y avoir été oublié de tous, et, gisant en ce fond, pensant n’en jamais sortir. Mais ils sont peu, sans doute, ceux qui comprendront ce que, par là, je tente de dire. Ah ! Ne plus rien voir, ne plus rien entendre ! Avoir perdu ce qu’on aime, pour toujours. Être à la fin enchaîné au fond d’une fosse, pendant que fuit l’être aimé au-delà de toute atteinte. J’avais cru jadis pouvoir saisir l’immense, mais c’est du tout au rien que nous précipite aussi ce désir.
Une autre béguine prit la parole. « L’amour ne veut point rester à ne rien faire. Fondre devant l’infini, s’enivrer d’ivresse, voilà mon seul savoir. De l’au-delà, au moins n’ignorons point que nous pouvons peut-être en parler assez noblement, à défaut d’en parler justement. La mort, dit-on, nous en rapprochera peut-être. Quand nous mourrons, nous en saurons davantage. »
Je ne sais si nous en saurons davantage. Ce que je sais maintenant, c’est que j’ignore, assez clairement, l’étendue de tout ce que je sais, fort obscurément.
_________________________
iHadewijch d’Anvers. Écrits mystiques des béguines. Traduction du moyen-néerlandais par Jean-Baptiste Porion. Seuil, 1954, p. 198
iiJan van Ruusbroec. Le Livre des XII Béguines. Trad. du flamand par P. Cuylits, Bruxelles, 1909, p.99. Est-ce que le néologisme « désirance » est ici indispensable ? Je ne sais. Jean-Baptiste Porion traduit ce passage ainsi : « Si je désire quelque chose, je l’ignore, — car, dans la nescience abyssale, — je me suis perdue moi-même. »

En quoi mon âme se distingue-t-elle de ton âme, ou de n’importe quelle autre ? En quoi se différencie-t-elle de l’Esprit même ? Comment se fait-il que l’âme d’Héraclite, de Socrate, ou d’Aristote soient toutes si différentes, et qu’elles nous semblent peu capables de jamais trouver un terrain commun, et moins encore de « s’unifier » en esprit ? Si, par quelque prodige improbable, elles avaient pu devenir réellement « unes », durant leur vie ou après la mort, ces âmes de philosophes n’auraient-elles pas naturellement su aussi ce que les âmes de tous les philosophes, de par le monde et à travers les temps, pensent vraiment, dans l’intime du cœur, et n’en auraient-elles pas fait leur miel, pour nous le faire ensuite goûter ? Mais cela ne s’est pas passé ainsi. Peut-être cela ne se passera-t-il jamais ainsi. Peut-être que les âmes des philosophes ne sont pas destinées, par essence, à s’unir ? Pourquoi, en effet, ceux-ci n’ont-ils pas, d’emblée, appréhendé clairement tout ce qui est à comprendre, et pourquoi ne se sont-ils pas laissés aller à seulement « croire » tout ce qui reste à croire ? Si l’Esprit est « un », pourquoi les esprits des philosophes ne saisissent-ils pas plus aisément toutes les choses intelligibles, pourquoi ne les conçoivent-ils pas dans leur intégralité et dans leur diversité, à l’image de ce dont sont capables, par exemple, les intelligences « angéliques », dont le Zohar nous énumère en détail les noms, les qualités et les puissances ? En d’autres termes, pourquoi les capacités intellectuelles des philosophes sont-elles si limitées, face à l’enjeu de l’infinité de ce qui reste à comprendre ? Pourquoi, même à l’apex de leur carrière, la confusion ou l’oubli peuvent-ils affecter sensiblement le fonctionnement du cerveau des philosophes les plus habiles ? Pourquoi ont-ils besoin de réfléchir toujours si longtemps sur des « concepts », qu’ils veulent originaux, et qu’ils sont si fiers d’exhiber comme des trophées de chasse ? Pourquoi éprouvent-ils le besoin de les détailler, de les disséquer, partie par partie, de les approfondir, de les combiner et de les décliner, plutôt que de les laisser briller immédiatement dans la pleine lumière de leur évidence ? Pourquoi, malgré la force (supposée) de leur intellect, les philosophes perdent-ils si souvent conscience d’eux-mêmes, lorsqu’ils s’endorment, s’enivrent, ou délirent ? Ou bien, lorsqu’ils vieillissent, ramollissent et décrépissent ? Leurs concepts ne sont-ils donc pas si éthérés, si intangibles, si détachés du monde ? Le plus savant des philosophes serait-il, par quelque droit divin dont il disposerait, exempt à jamais de toute forme de démence, ou des effets délétères de maladies neurodégénératives, oubliant alors tout ou partie de ses savoirs, de ses « concepts » et de ses « idées » ? Atteint en son esprit même, le philosophe est-il encore la même personne ? Ou bien est-il devenu un autre que lui-même, et un autre pour lui-même ? Devient-il alors une autre personne, ou bien s’enfonce-t-il lentement vers un néant que sa disparition putative rendra « réel »? Supposons que, par le progrès des recherches en neurosciences, tel philosophe, par exemple atteint d’une maladie à corps de Léwy, puisse progressivement guérir de sa maladie, et qu’il se remette à « philosopher ». Supposons encore que, profondément affecté, et continuant naturellement de vieillir, quoique en meilleure santé, il ne puisse cependant pas récupérer intégralement ses capacités d’autrefois ? Devra-t-on alors considérer en lui la superposition de deux âmes distinctes, celle qu’il incarnait dans la brillance de sa jeunesse, et la nouvelle, dont il illustre aujourd’hui, bien contre son gré, la fatigue de n’être plus qu’une sorte d’ombre pâlie de ce que son autre âme était jadis, et ne pourra plus jamais être ? L’esprit du philosophe est-il donc comme un réceptacle que l’on peut emplir tout à loisir, années après années, de principes et de concepts, de formules et de raisons, de vues et d’intuitions, et qui, après un temps, vers la fin de la vie, se viderait, insidieusement et lentement, ou bien brusquement et à gros bouillons ? Quelle est l’étendue des connaissances que l’âme du philosophe devrait recevoir en elle-même pour espérer devenir réellement immatérielle, éternelle, impérissable ? Lui faut-il acquérir la science et l’intelligence de tout ce qui existe ? Ou bien pénétrer l’essence de toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre ? Mais n’est-ce pas là, à l’évidence, un songe vain, un rêve fou, un but inaccessible ? Alors peut-on quand même espérer que l’âme du philosophe acquière malgré tout un soupçon d’immatérialité et d’immortalité, après avoir pu se pénétrer des dix catégoriesi d’Aristote, ou des principes élevésii qui sont au-dessus de celles-ci, et dont on peut raisonnablement penser que tous les êtres sont subsumés sous eux ? Mais ce serait là un peu trop facile, ne pensez-vous pas ? Étudiez Aristote et Avicenne, et vous voici rendu pour toujours au paradis éternel de l’esprit? Admettons même que cette âme puisse maîtriser à fond ces catégories et ces principes, mais quid de la connaissance des singuliers ? Où les découvrira-t-elle ? Et si elle ne sait rien des singuliers, que sait-elle vraiment d’elle-même ? Si elle ne sait rien d’elle-même, faudra-t-il en conclure qu’à la fin, « selon la théorie des philosophes, l’homme périt et disparaîtiii » ? Les philosophes nous bernent-ils donc en toute bonne conscience de leurs assertions assertoriques, et se leurrent-ils aussi eux-mêmes, ce faisant ? Nombreuses sont les choses dans la nature qu’il ne nous est pas donné de connaître. Cela ne nous empêche pas de chercher. Peut-être que, d’aventure, il nous sera donné à l’improviste des fragments de connaissance, des étincelles éparses, des lueurs de savoir, dont même les prophètes semblent parfois dénués. Un jour, sur le chemin de Béthel à Jéricho, des « fils de prophètes » s’adressèrent à Élisée, dont ils ne voyaient pas qu’Élie l’accompagnait en volant : « ‘Sais-tu qu’aujourd’hui Adonaï [YHVH] va emporter ton maître [Adonéï-khaiv], par-dessus ta tête ?’ Il répondit: ‘Oui, je le sais, faites silencev’. » Élisée disait qu’il le « savait », mais voyait-il vraiment ce qu’il savait ou ce qu’il croyait savoir ? Et savait-il vraiment ce qu’il voyait, ou ce qu’il croyait voir ? Non, sans doute pas. Aussi réclama-t-il le silence, à deux reprises.
__________________________
iLa substance, la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps, la position, la possession, l’action, la passion.
iiL’existence, la puissance, l’acte, le principe, la cause, la substance, l’accident, le genre, l’espèce, la similitude, l’opposé, l’unité, la pluralité, l’accord, la différence.
iiiJuda Hallévi. Le Kuzari. Livre V. Trad. Charles Touati. Verdier, 1994, p. 215
ivאֲדֹנֶיךָ
v2 Rois 2, 3

Vie vivante : pourquoi cette redondance, ce pléonasme ? Faut-il distinguer les vies « vivantes » des vies « mortes », comme, en différentes époques de l’histoire du monde, on a séparé les « âmes vivantes » des « âmes mortes » ? N’a-t-on pas, d’ailleurs, éprouvé jadis le besoin de dire du Dieu lui-même qu’il était « vivant », alors que, d’évidence, il est la Vie, et qu’il donne la vie ? La langue hébraïque a laissé en héritage à ce propos quelques précieuses et intraduisibles formules : El ḥayi, El ḥayyaïii, Elohim ḥayyimiii, et Ḥay Adonaïiv, qui disent toutes : « Dieu vivant », selon diverses et fines nuances.
S’il y a plusieurs façons de nommer le « Dieu vivant », la vie vivante semble la seule manière de signifier qu’elle est le fond secret de l’homme, le lieu d’où jaillissent toutes les forces de vie, de génération et de régénération, la puissance des aspirations, les désirs des étreintes, des joies, des enthousiasmes. La vie vivante dit qu’elle vit de sa propre vie, au plus profond de la profondeur, au cœur de l’essence de l’âme. Que signifie « l’essence de l’âme » ? Dans une âme, son essence est en même temps sa forme et sa matière. Elle est ce qui en elle donne et se donne, et aussi ce qui en elle reçoit. L’essence est le lieu où l’âme créée reçoit son être, le lieu où, après avoir reçu l’être, elle pourra, d’aventure, rencontrer ce qui lui donne l’être. L’essence de l’âme n’est pas chose statique, elle n’est pas « une forme » (εἶδος), comme l’appelle Aristote. Elle est essentiellement dynamique, toujours en puissance de devenir, de devenir « autre », ou « plus » ; elle est essentiellement « vie », mouvement vivant vers la vie, vers toujours plus de vie, et peut-être même vers quelque autre « vraie vie », quelque autre « vie vraiment vivante », ou, pour parler par métaphore, quelque vie culminant éminemment dans l’union amoureuse avec l’Amour même, l’Amour qui fait vivre et qui donne la vie — éternellement, comme disent les mythes.
Parmi tous les vivants, il y en a certains qui sentent vivre en eux-mêmes non pas seulement la vie commune, la vie générale, mais cette vie vivante-là, cette vie où se trouvent conjoints sans contradiction ni exclusion quelques extrêmes, le créé et l’incréé, le néant et l’Être, l’acte et la puissance. La vie vivante ne vit pas dans le seul plan de la nature, dans le plan de la seule existence, elle vit au plan de l’essence. Autrement dit, elle vit dans le nu de la nature, ou encore dans l’intime de la surnature, elle vit cachée sous une nudité absolue, déshabillée de tous les vêtements du visible, de tous les voiles du phénomène. Du point de vue de la vie tout court, la vie vivante est ce qui en est à la source, elle est à l’origine, car elle vient avant toute vie. Sans la vie vivante, il y aurait seulement de la mort mourante, ou du néant anéanti. La vie vivante, qui a été et est de tout temps dans l’origine, a sans doute surgi nue d’un abîme de gloire première. Mais qui peut en parler ? Désormais, et c’est ce qui importe, elle s’écoule à travers toutes les puissances. Elle unit, par-delà les temps, à travers les mondes, tous ceux qui vivent et tout ce qui vit. Personne ne peut la voir, ni d’où elle vient, ni où elle va. Mais des poètes ont témoigné que l’on peut un peu imaginer la vie vivante, à condition d’être devenu mort à soi-même, d’être né à nouveau, de s’être plongé dans l’eau libre des sources anciennes et toujours jeunes, suivant d’ahan leur flot sans fin, leur cours « vers d’autres nébuleusesv ». Pour le poète comme pour le prophète, la vie vivante se vit sans intermédiaire, elle leur est lumière et vérité. À sa cime même, qui est aussi celle de l’âme, cette étincelle la plus élevée qui soit, elle élève l’esprit, elle l’éduque à l’abîme et au vertige, elle l’incite à contempler l’insondable, à scruter le fond sans fond (mais non sans saveur). Elle l’invite à oser le saut, à passer au-delà de la lumière et de l’ombre, de la vérité et de la ressemblance, de l’être et de la mort, du miroir et de l’image, du vouloir et du désœuvrement. Mais, sur ce seuil, un effrayant et sauvage sentiment de perte imminente peut saisir l’esprit impréparé, comme un incendie mondial de l’âme, un brasier final dévolu à tous ceux qui aiment et se consument. L’âme qui aime se dresse et chancelle encore devant ce qui la brûle et ce qui la liquéfie. Elle veut sauter dans l’abysse. Elle veut céder au vide avide. La clarté sombre du néant l’aveugle. Sa raison a cédé. Ses sens aussi. Elle vole alors, vie vivante, de cime en cime, d’étincelles fugaces en flambées incandescentes, de brûlures dures en brûlures tendres — elle vole et défaille, elle fond et s’écoule, elle monte et aspire. Elle s’anéantit en trop étant. Elle se dissout dans les cendres. Fine poussière, impalpable pollen, elle passe et trépasse, allant toujours plus au-delà. Au-delà ? Il me faut maintenant recourir au moyen-néerlandais pour préciser le sens de cet adverbe galvaudé. Pour bien comprendre ce que le mot au-delà révèle, je crois nécessaire, après Ruusbroec, de recourir à l’usage du préfixe ont-, qui vient projeter les verbes (moyen-néerlandais) dans la sur-essence de leur sens. Ontsincken : s’immerger, s’enfoncer, s’engloutir « au-delà ». Onthogen : être élevé « au-delà ». Ontgaen : s’échapper « au-delà ». Ontvlieten : s’écouler « au-delà ». Ontgheesten : expirer « au-delà »vi. Dans cet « au-delà »-là, règnent le vide et la nudité, et s’y réalise l’union à l’état pur avec l’un. On touche l’un, et l’un nous touche. Nous sentons l’un dans son infinie différence, mais l’un ne nous laisse pas demeurer en nous-mêmes. Impossible pourtant d’aller plus au-delà encore, au-delà de nous-même et au-delà de l’un. Et pourtant il le faut, il faut vraiment passer au-delà de l’au-delà. Ont-onthogen… Ont-ontgaen… Certes, l’océan de l’un n’est pas une source tranquille, une fontaine paisible. Il bouillonne, il écume, il tempête. Il se vêt d’abysses et d’orages. Il retourne tous ses abîmes, comme un paysan son champ. Malgré tout, il nous faut nous élancer. Alors on fuse, on saillit, on se rue, on fond vers tout cet un qui nous fixe — insaisissable souffle et soudain zéphyr, évanescent. Mais nous sommes, quant à nous, « saisis » — par l’incommensurable immensité de notre étrangeté, par l’infinie différence se projetant hors de ces lieux abyssaux. Nous ne pouvons pourtant pas perdre notre être, et même si d’aventure, nous pouvions passer totalement au-delà de ce gouffre, et au-delà de cet au-delà même (ont-ontsincken), nous demeurerions toujours tout autre que l’un. Et tout autre qu’« un », en demeurant vie vivante. « Même si l’âme désire se fondre et s’anéantir dans l’amour, elle doit subsister éternellement et ne peut périr […] L’âme qui aime est particulièrement goulue et avide […] Elle devra donc éternellement aspirer et s’élancer, et demeurer assoiffée et affamée. Plus elle aspire et s’élance, plus elle sent que lui fait défaut l’opulence de Dieu. C’est ce qu’on appelle : s’élancer et défaillirvii. » Si elle restait unie dans l’amour, elle serait alors Dieu lui-même dans sa nature, elle serait alors Dieu mais elle serait aussi anéantie en elle-même, et à elle-même, ce qui ne manque pas d’être contradictoireviii… Comment, en effet, lui serait-elle encore « unie », si elle redevenait « néant » ? Il y a là le mystère de la vie mourant dans l’abîme de l’amour, se perdant dans les ténèbres sans fond de l’inconscience, et il y a aussi le mystère de la mort s’en allant, nouvellement vivante, vers quelque sur-essence. Nous vivons notre essence et, parfois, dans l’amour, mais nous mourrons aussi dans l’essence de Dieu, dans la « jouissanceix » (de l’union avec Dieu). Bien longtemps après Héraclite, et peut-être non sans quelque rapport avec sa penséex, on pourrait appeler cela vivre d’une « vie mourante » et mourir d’une « mort vivante » — « car nous vivons avec Dieu et nous mourons en Dieuxi. »
i« Vous reconnaîtrez que le Dieu vivant (El ḥay, אֵל חַי ) est au milieu de vous » (Jos 3,10). « Mon âme a soif de Dieu (Elohim), du Dieu vivant (El ḥay) » (Ps 42,3)
ii« Une prière à Mon Dieu vivant (lé-El ḥayyaï, לְאֵל חַיָּי )» (Ps 42, 9)
iii« La voix du Dieu vivant (qôl Elohim ḥayyim, קוֹל אֱלֹהִים חַיִּים) » (Dt 5,26). « Lui, il est le Dieu vivant ( הוּא-אֱלֹהִים חַיִּים, hu’ Elohim ḥayyim) » (Jér 10,10)
ivCf. 1 Sam 26,10 :« Et David dit ‘ḥay Adonaï (YHVH)’ וַיֹּאמֶר דָּוִד חַי-יְהוָה) »
vCf. Apollinaire. La chanson du mal-aimé.
« Voie lactée ô sœur lumineuse
Des blancs ruisseaux de Chanaan
Et des corps blancs des amoureuses
Nageurs morts suivrons-nous d’ahan
Ton cours vers d’autres nébuleuses. »
viJ’emprunte ces verbes au « Glossaire » de termes moyen-néerlandais, présent en appendice in Jan van Ruusbroec. Écrits III. Trad. Dom André Louf. Abbaye de Bellefontaine, 1997, p.268
viiJan van Ruusbroec. Le Miroir de la Béatitude éternelle. In Écrits III. Trad. Dom André Louf. Abbaye de Bellefontaine, 1997, p.261
viii« Car l’essence de Dieu est incréée et la nôtre est créée. Une telle dissemblance est sans mesure : Dieu et la créature. C’est pourquoi les deux peuvent s’unir, mais non pas devenir un. Car si notre essence venait à être anéantie, il serait impossible de connaître, d’aimer et d’être bienheureux. » Ibid. p. 264
ixCertains emploient le terme de « fruition ». En moyen-néerlandais : ghebruken.
xHéraclite. Fragment 62. « Immortels, mortels, mortels, immortels ; vivant de ceux-là la mort, mourant de ceux-là la vie. » (Trad. Marcel Conche)
xiJan van Ruusbroec. Le Miroir de la Béatitude éternelle. In Écrits III. Trad. Dom André Louf. Abbaye de Bellefontaine, 1997, p.264

Lekha doumiah tehillah Elohimi. « Pour toi le silence est louange, Élohimii », selon ma traduction mot-à-mot. Mais si le psalmiste recommande le « silence », les nombreux commentateurs de ce verset, en revanche, furent plutôt bavards, et, fort prolixes, ils rivalisèrent d’interprétations divergentes. Est-ce d’ailleurs de « silence » dont il s’agit ici ? Selon la traduction de la Bible de Jérusalem, il faut lire : « À toi la louange est due, ô Dieuiii ». Il y est précisé, en note, que d’autres versions encore existent, s’expliquant par une « simple différence de vocalisation ». Certaines traduisent en effet le mot doumiah par « silence », ce qui donne la traduction alternative : « À toi le silence est la louange, ô Dieu ». Dans la version hébraïque de référence que propose la Biblia Hebraica Stuttgartensia, il est noté que le mot דֻמִיָּה, doumiah, présent au début de ce verset, a été traduit par les soixante-dix rabbins de la Septante par le verbe grec πρέπει, « il convient », ce qui donnerait en français : « À toi la louange convient, ô Dieu ». La Septante traduit en effet ce verset par « σοὶ πρέπει ὓμνος ὁ θεός » (« à toi convient l’hymne, ô Dieu »), l’hymne désignant le chant sacré, ce qui, il faut bien le dire, inverse complètement le sens du verset. Là où les uns disent « silence », les autres comprennent « chant sacré ». Heureusement, on peut faire appel aux lumières du célèbre Maïmonide, qui évoque aussi ce verset dans un chapitre du Guide des égarés traitant des attributs négatifs de Dieu : « Les intelligences ne sauraient percevoir Dieu, lui seul perçoit ce qu’il est, et le percevoir, c’est [reconnaître] qu’on est impuissant de le percevoir complètement. Tous les philosophes disent Nous sommes éblouis par sa beauté et il sé dérobe à nous par la force même de sa manifestation, de même que le soleil se dérobe aux yeux, trop faibles pour le percevoir […] mais ce qui a été dit de plus éloquent à cet égard, ce sont les paroles du psalmiste : lekha doumiah tehillah (Ps 65,2) dont le sens est ‘pour toi, le silence est la louange’. C’est là une très éloquente expression sur ce sujet ; car, quoi que ce soit que nous disions dans le but d’exalter et de glorifier (Dieu), nous y trouverons quelque chose d’offensant à l’égard de Dieu, et nous y verrons (exprimée) une certaine imperfection. Il vaut donc mieux se taire et se borner aux perceptions de l’intelligence, comme l’ont recommandé les hommes parfaits, en disant : ‘Parlez en votre cœur, sur votre couche, faites silence’ (Ps 4,5)iv. »
Cette position fort claire de Maïmonide n’a pas échappé à Maître Eckhart, lui aussi frappé par le caractère énigmatique de ce verset. Dans un commentaire sur le « silence » compris comme une condition de possibilité de la « naissance de Dieu dans l’âme », Maître Eckhart écrit : « La Sagesse vient dans l’esprit quand l’âme se repose du tumulte des passions et de l’occupation causée par les choses du monde, quand toutes ces choses-là font silence, et que celle-ci fait silence à toutes. » Il s’appuie ensuite rhétoriquement sur Augustin : « Si pour une âme, le tumulte de la chair faisait silence, si les délires de la terre faisaient silence […] et ceux du ciel, que cette âme soit silencieuse à elle-même, et qu’elle se dépasse sans penser à elle, si se taisaient les songes et les révélations imaginaires […] et que Lui seul parle […] de lui-même afin que nous entendions sa parolev ». Reprenant sa démonstration, maître Eckhart élargit la nécessité du « silence » aux offices mêmes de l’Église. Silence certes ponctuel, mais silence essentiel. « Il faut savoir que, durant l’Office, l’Église se tient elle aussi exactement comme cela : Pendant que toutes choses se tenaient au milieu d’un silence paisiblevi. On doit comprendre en effet que, dans l’avènement du Fils dans l’esprit, il faut que tout milieu fasse silence. La nature d’un milieu intermédiaire est en effet incompatible avec l’union, que l’âme désire, avec Dieu et en Dieuvii. » Peu après Maître Eckhart cite Maïmonide en appui de sa thèse, laquelle, je le souligne au passage, invalide tant la traduction de la Vulgate que celle de la Septante. « Dans l’être et la compréhension intellectuelle, tout milieu se retire et fait silence. Ceci concorde avec ce passage du Psaume (65,2) : La louange silencieuse est pour Toi, Dieu, d’après la version du texte reçue par Maïmonide, là où nous avons : L’hymne T’est dû, ô Dieu.viii » Ce parti-pris en faveur de Maïmonide, contre les traductions habituelles, s’explique sans doute par le fait que la notion de « silence » occupe une position spéciale dans la pensée de Maître Eckhart. On s’en fait une idée nette en lisant le sermonix qu’il a consacré à un passage du Livre de la Sagesse : « Lorsque toutes choses se tenaient au milieu du silence, alors est descendue d’en haut, du trône royal, et est venue en moi une parole secrètex ». Cet article, on le devine, cherche à mettre en évidence la richesse intrinsèque liée aux difficultés de la traduction, et aux ouvertures qu’elle permet… Il se trouve que, dans une autre traduction du passage que l’on vient juste de citer, on ne trouve ni l’expression « au milieu du silence » ni l’expression « parole secrète », mais respectivement, « un silence paisible » et une « parole toute-puissante, inexorable », jouant un rôle dans « l’extermination » de la terre : « Alors qu’un silence paisible enveloppait toutes choses et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux, ta Parole toute-puissante s’élança du trône royal, guerrier inexorable, au milieu d’une terre vouée à l’exterminationxi. » Tout comme le « silence », l’idée du « secret » joue aussi un rôle important chez Maître Eckhart. Il développe par exemple le thème de la naissance du Verbe divin dans l’âme, lorsque celle-ci se tient « une » dans « le plus secret » de son « intérieur », et en silence. « Il faut donc qu’un silence s’installe [dans le fond de l’âme], une tranquillité, et là, le Père doit s’exprimerxii. » Il faut savoir que « le meilleur, le plus noble auquel un homme puisse parvenir dans cette vie, est : tu dois faire silence et laisse Dieu opérer et parlerxiii. » Eckhart fait, dans ce contexte, référence à un passage du Pseudo-Denys l’Aréopagite traitant de la nature profonde de la Ténèbre divine, et de la lumière que l’on peut y trouver : « C’est dans le Silence en effet qu’on apprend les secrets de cette Ténèbre dont c’est trop peu dire que d’affirmer qu’elle brille de la plus éclatante lumière au sein de la plus noire obscurité, et que, tout en demeurant elle-même parfaitement intangible et parfaitement invisible, elle emplit de splendeurs plus belles que la beauté les intelligences qui savent fermer les yeuxxiv. » Partant de cet éloge de l’inconnaissance absolue, et s’adressant directement à son disciple Timothée, le Pseudo-Denys lui fait ces pressantes recommandations : « Exerce-toi sans cesse aux contemplations mystiques, abandonne les sensations, renonce aux opérations intellectuelles, rejette tout ce qui appartient au sensible et à l’intelligible, dépouille-toi totalement du non-être et de l’être, et élève-toi ainsi, autant que tu le peux jusqu’à t’unir dans l’ignorance avec Celui qui est au-delà de toute essence et de tout savoir. Car c’est en sortant de tout et de toi-même, de façon irrésistible et parfaite que tu t’élèveras dans une pure extase jusqu’au rayon ténébreux de la divine Suressence, ayant tout abandonné et t’étant dépouillé de toutxv. »
J’aime l’idée d’une « pure extase », visant à atteindre le « rayon de Ténèbre » qu’est la Suressence. Partant du « silence », on arrive à la Ténèbre, et à sa lumière.
_____________________________
iלְךָ דֻמִיָּה תְהִלָּה אֱלֹהִים (Ps 65,2)
iiMa traduction de לְךָ דֻמִיָּה תְהִלָּה אֱלֹהִים (Ps 65,2)
iiiPs 65 (64), 2
ivMaïmonide. Le Guide des égarés. Livre I, §59. Trad. de l’arabe par Salomon Munk. Verdier, p. 139
vAugustin. Confessions, Livre IX, cité par Maître Eckhart, Commentaire du Livre de la Sagesse, Ch. 18, §280. Trad. Jean-Claude Lagarrigue et Jean Devriendt. Les Belles Lettres, 2015, p.258
viIntroït de la messe dominicale de l’Octave de Noël.
viiMaître Eckhart, Commentaire du Livre de la Sagesse, Ch. 18, §284. Trad. Jean-Claude Lagarrigue et Jean Devriendt. Les Belles Lettres, 2015, p.260
viiiMaître Eckhart, Commentaire du Livre de la Sagesse, Ch. 18, §285. Trad. Jean-Claude Lagarrigue et Jean Devriendt. Les Belles Lettres, 2015, p.261
ixSermon 101. Meister Eckhart, Die deutschen Werke, 4,1 : Predigten 87-105, Stuttgart, Kohlhammer, 2005, p.334-367
xSg 18,14-15. La traduction française est celle donnée dans Maître Eckhart, Sermons, Traités, Poème. Les Écrits allemands. Traduction Jeanne Ancelet-Hustache et Eric Mangin, Seuil, 2015, p.95
xiSg 18,14-15. Bible de Jérusalem. Cerf, 1996
xiiMaître Eckhart, Sermons, Traités, Poème. Les Écrits allemands. Traduction Jeanne Ancelet-Hustache et Eric Mangin, Seuil, 2015, p.100
xiiiIbid. p.101
xivPseudo-Denys l’Aréopagite. La Théologie mystique. Ch. 1. In Œuvres complètes, Trad. Maurice de Gandillac, Aubier, 1943, p. 177
xvPseudo-Denys l’Aréopagite. La Théologie mystique. In Œuvres complètes, Trad. Maurice de Gandillac, Aubier, 1943, p. 177-178


Dans une célèbre upaniṣad, l’ensemble de tous les êtres de l’univers est comparé à une sorte de « miel », lequel serait aussi une figure du Soi universel. La métaphore du « miel » s’appliquant au Soi ainsi qu’à tous les êtres existants, laisse entendre qu’ils sont en effet tous liés, indissolublement, à l’image de l’essentielle onctuosité du miel, lui donnant sa consistance, souple, mobile, étendue, son goût et son odeur, et s’unifiant par elle-même. « Le Soi (ātman) est le miel (madhu) de tous les êtres, tous les êtres sont le miel de ce Soi. Cet Homme qui, dans le Soi, est étincelant et immortel, et l’Homme qui, au plan individuel (ātman), est le Soi, étincelant et immortel — c’est lui qui est le Soi (ātman), il est immortel, il est brahman, il est le Tout. En vérité, ce Soi (ātman) est le souverain de tous les êtres, le roi de tous les êtres. De même que tous les rayons sont fixés au moyeu et à la jante d’une roue de char, ainsi tous les êtres, tous les dieux, tous les mondes, tous les souffles, tous ces êtres (ātman) sont fixés à ce Soii. » Le miel (madhuii) symbolise ici le contact psychique, mais aussi objectif, de tous les êtres de l’univers entre eux, leur interdépendance complète. L’interaction « objective » de toutes les choses et de tous les êtres est ainsi affirmée, et elle s’étend d’ailleurs aux liens avec le Soi, qui porte le nom commun ātman mais aussi le nom propre Puruṣa. Le mot sanskrit puruṣa, पुरुष, a plusieurs niveaux de sens : l’homme par opposition à la femme ; l’être humain ; l’Homme primordial au temps de la création. Dans le Veda, Puruṣa est aussi le nom qui personnifie l’Être, l’esprit divin, ou encore le macrocosme. Il est à noter que, d’un point de vue étymologique, c’est le mot puruṣa quiest à l’origine du mot français « personne ». D’un point de vue philosophique, le puruṣa représente l’homme qui est à la recherche de la « connaissance », non pas à l’extérieur, mais en lui-même, au-dedans de son for intérieur, dans le secret de sa propre « citadelle ». Cette « citadelle » est le lieu du Soi, le Soi sans attaches qui y poursuit librement et invisiblement sa voie, et franchit les différentes étapes de la connaissance. « Le puruṣa est habitant de citadelle, il est dans toutes les citadelles. Mais la citadelle peut l’abriter sans qu’il soit connuiii ». Considérant que le mot sanskrit pur, पुर्, est aussi la première syllabe de puruṣa, et qu’il signifie précisément « rempart ; citadelle, ville fortifiée ; cité », on devine là l’existence d’un jeu de mots entre pur et puruṣa. L’homme (puruṣa) est, par exemple, explicitement comparé à une « citadelle » (pur), dans la Bṛhadāraṇyaka-upaniṣad. « Il devint un oiseau, entra dans les citadelles (puraḥ-sa), comme Homme, puruṣa (pur-u-sa), il entra dans les citadelles. En vérité, cet Homme (puruṣa) est le résidant de citadelle dans toutes les citadellesiv.»

Or il se trouve que j’ai découvert récemment, dans un ouvrage de Marie-Louise von Franzv, l’une des plus proches collaboratrices de C.G. Jung, un « modèle structurel de l’inconscient » ayant précisément la forme d’une citadelle, avec ses nombreux remparts. La « conscience du moi », notée A, se tient en dehors des remparts de cette cité fortifiée, et se présente non pas comme une entité unique, mais comme autant de groupes armés se lançant dans un assaut, que l’on devine extrêmement difficile, contre la forteresse de l’Inconscient. On découvre dans le modèle proposé quatre sortes d’inconscients défendant la citadelle : 1° l’inconscient personnel, noté B, se tenant sur les hautes tours des murailles, et semblant repousser les tentatives des A, 2° l’inconscient de groupe, noté C, se tenant derrière les B, 3° l’inconscient des grandes unités nationales, noté D, et enfin 4° l’inconscient que forment les structures archétypiques universelles, noté E. Ce dernier, à la différence des A, des B, des C et des D, ne forme qu’une entité unique, soudée, et occupe le centre même de la citadelle.
Alors que la métaphore védique du « miel » est toute de douceur, et de suavité, la métaphore non moins védique de la « citadelle » évoque la bataille, les attaques et la résistance. Évidemment, toute velléité de mettre en opposition ces deux métaphores, tendant à les présenter comme contradictoires, serait superficielle. Elles sont beaucoup plus complémentaires qu’exclusives l’une de l’autre. Mais comment interpréter la profusion des A, des B, des C et des D, en tant qu’elle fait ressortir l’unité de l’E ? L’inconscient représente la somme totale des structures archétypiques et psychiques universelles, que l’humanité entière partage avec elle-même. Lorsqu’un moi « travaille » sur son propre inconscient et atteint par exemple le niveau C, il commence à entrer en contact avec l’inconscient associé à son groupe humain proche (famille, amis,…). Lorsqu’il atteint le niveau D, il entre en résonance avec les grandes unités inconscientes des nations, qui, pour le meilleur ou pour le pire, vont l’emporter dans leurs propres dérives, leurs décadences ou leurs progrès. Il peut aussi finir par atteindre le niveau le plus profond (ou le plus central dans le modèle de la citadelle). Dans ce dernier cas, le moi individuel ne se change ou ne se transforme pas seulement lui-même, mais il exerce aussi en retour une influence invisible sur tous les êtres humains, qui participent de l’humanité entière. En appui à cette idée d’interconnexion universelle, on peut ici citer Confucius : « L’homme noble demeure dans sa chambre. S’il prononce bien ses paroles, il trouve un assentiment à une distance de plus de mille millesvi. » L’inconscient universel est bien comme une sorte de « miel » qui nous contient tous, nous colle et nous maintient tous ensemble dans la glu mielleuse du monde. Ce miel un bien commun qui non seulement nous nourrit et nous fait vivre, mais c’est aussi un bien que nous ne cessons jamais d’alimenter (ou de détruire en partie) par les moindres de nos actions et par les moindres de nos pensées, et de nos désirs, ici-bas.
________________________
iBṛhadāraṇyaka-upaniṣad, 2,5,14-15. Traduction d’Alyette Degrâces, Les upaniṣad, Fayard, 2014, p. 252-253
iiLe mot sanskrit madhu signifie « douceur, miel, sucre ; breuvage enivrant ». Le mot medha, avec la même racine mais une autre vocalisation, signifie « jus, moelle, sève , essence », acceptions assez proches de « miel ». Mais medha signifie aussi , par extension et anagogie, « victime sacrificielle ; sacrifice, oblation », prenant un sens religieux. Le mot medhā, très proche de medha, signifie « vigueur intellectuelle ; intelligence ; prudence, sagesse ». Le mot composé puruṣamedhá , littéralement l’« oblation de la personne » désigne le rituel védique du sacrifice humain (symbolique), c’est-à-dire l’entrée volontaire du « renonçant » dans son renoncement (à tous les biens, à tous les rites, et à tous les « feux », ceux du foyer comme ceux du sacrifice).
iiiCommentaire d’Alyette Degrâces à propos des deux versets : « Il devint un oiseau, entra dans les citadelles (puraḥ-sa), comme Homme, puruṣa (pur-u-sa), il entra dans les citadelles. En vérité, cet Homme (puruṣa) est le résidant de citadelle dans toutes les citadelles» (Bṛhadāraṇyaka-upaniṣad, 2,5,18). Cf. sa traduction, Les upaniṣad, Fayard, 2014, p. 253, note 1090.
ivBṛhadāraṇyaka-upaniṣad, 2,5,18. Traduction d’Alyette Degrâces, , Les upaniṣad, Fayard, 2014, p. 253
vMarie-Louise von Franz. Âme et archétypes. Traduit de l’allemand et de l’anglais par Jeanne Kohli-Dangel, Monique Bacchetta et Etienne Perrot. La Fontaine de Pierre, 2020, p. 79
viCité dans le Yi King, version de Richard Wilhelm, traduit par Etienne Perrot , Librairie de Médicis, 1973, p. 272 (Commentaire sur l’hexagramme 61). Cité par Marie-Louise von Franz, ibid. p.82

J’aimerais parler de certaines choses obscures, dont je doute cependant qu’on puisse jamais jeter sur elles quelque lumière visible. Ceux qui auront vu la nuit, au moins une fois dans son essence, et ne fût-ce que fugacement, devineront peut-être d’emblée ce que je suis tenté d’évoquer. D’ailleurs, qu’importe au fond, ces termes peu adéquats, le « visible », ou l’« invisible » ! Je pense qu’ils sont intimement intriqués, et se signifient l’un par l’autre. C’est pourquoi je fais aussi volontiers le pari qu’un jour, sera révélée la raison pour laquelle l’âme d’un homme qui n’a jamais lu ni Platon, ni Plaute ou Plotin, ni Spinoza, Swedenborg ou Swinburne, d’un homme qui n’en aurait même jamais entendu parler, ne serait pas tout à fait ce qu’elle est, cette âme, si les êtres qui ont porté ces noms n’avaient jamais existé. Étrange présence, et intrication stupéfiante de l’absence objective et de la pénétration subjective. Les intuitions et les idées des âmes s’élancent, ondulent, s’étendent et s’entrelacent, universellement, et par-delà les âges. On ne peut pas ne pas avoir même seulement une vague conscience de la puissance de l’inconscient, de son renouvellement incessant, de sa vie subliminale et silencieuse. La moindre des pensées qui émerge à l’autre bout de la terre ne traverse-t-elle pas, sans doute sans effort, les cerveaux souvent inattentifs de l’ensemble des hommes ? Mais ils n’en sont pas conscients. Ils baignent jour et nuit dans les effluves du temps et de l’espace, et ignorent leurs rives les plus proches. Je ne sais pas ce qu’il faudrait dire pour persuader la foule pressée de penser l’abysse, sinon ceci. Je pense qu’aucune pensée, une fois pensée, ne se perd dès lors plus, et pour personne. Toute pensée, grande ou mince, énorme ou fine, lorsqu’elle émerge une fois de la soupe neuronale d’un cerveau singulier, se retrouve mystérieusement mais inéluctablement versée dans un « pot commun » mondial. Une copie de chaque pensée est stockée à jamais dans le vaste entrepôt de l’inconscient collectif. De cet abîme du « déjà une fois pensé », finissent alors par émerger, dans quelque autre cervelle, de brèves et brillantes lueurs, ou des sortes d’intuitions, non tout à fait originales, mais comme irrésistiblement extraites de la somme totale des pensées passées. Nous sommes, nous les humains, analogues à ces siphonophoresi, ces invertébrés gélatineux, composés de milliers de zooïdes spécialisés dans les tâches diverses qui sont nécessaires à la vie. Tapis dans les abysses marins, ils déroulent lentement leurs structures errantes et filiformes, pouvant dépasser la centaine de mètres, et ils brillent par intermittence d’éclats bioluminescents, tentant sans relâche de captiver quelque proie, pour la capturer, afin qu’elle profite à toute la colonie de leurs zoïdes, tous singuliers, et tous solidaires de leur siphonophore natal. L’espèce humaine pourrait se comparer à des colonies bigarrées de siphonophores de genres divers (car les siphonophores forment un ordre), se côtoyant dans un noir abyssal, les uns coopérant, les autres se combattant pour survivre dans un environnement aux ressources rares. Comme les siphonophores, qui sont inconscients, sans doute, de la conscience spécifique et singulière de chacun des zoïdes qui les constituent, nous les hommes, nous ne connaissons pas clairement les parties de nous-mêmes qui ne vivent que grâce à des pensées qui furent un jour pensées par d’autres hommes, et dont la plupart ne furent d’ailleurs jamais seulement exprimées, mais qui, pourtant, continuent d’influencer dans les profondeurs, nos vies individuelles et le destin de l’humanité tout entière. La conscience de tout homme a plusieurs degrés de profondeur, de largeur et de hauteur. Bien malin qui saurait déplier chacune des consciences dans son intégralité. Plus malin encore qui saurait relier par toutes leurs intrications effectives toutes les consciences passées et présentes, et saurait comprendre comment elles affectent aujourd’hui, en réalité, les consciences futures. Les plus sages ne mesurent pas de quelle inconscience (collective ou personnelle) la moindre poussée de conscience tire ses racines. Se nourrir de cet inconscient immense, immémorial et transcendantal, semble être l’activité première (quoique subliminale) de toute conscience, mais son activité seconde est aussi d’alimenter à son tour, et sans cesse, un désir insatiable et vorace produire des nouvelletés, pour les planter en ses propres profondeurs, sous forme de rêves ouverts. La conscience « intégrale » de l’humanité, c’est-à-dire la somme totale des consciences singulières, augmente donc toujours, et en s’augmentant, elle augmente d’autant l’épaisseur du mystère qui règne en nous, autour de nous, et au-dessus de nous. Serrés comme des bactéries dans un nuage de plancton au fond de l’abîme, nous cherchons à nous mouvoir un peu au-delà de notre sphère immédiate. Nous cherchons à extraire un peu de connaissance à partir de tout ce que nous ignorons, à partir de cette inimaginable inconnaissance, pour tenter de mesurer un peu mieux l’infinité de ce que nous ne pouvons pas connaître. A la manière du plancton, nous ne nous grandissons qu’en agrandissant jour après jour notre nuage originaire, et, depuis son obscurité, prisonniers de nos errances, nous envions les mouvements assurés de tout le necton qui, tout autour et loin de nous, semble savoir où aller (mais sans nous)… Le necton ? Quel necton ? Je pense au necton des pensées, et à leur puissant nectar. Nous sommes plongés dans ce nectar et dans ce mystère, et, de ce que nous en savons, rien n’émerge assez qui puisse aider à pénétrer véritablement au-dessous de la surface de ce que nous ignorons encore. Nous possédons un moi qui cèle en son profond toutes les ombres de ses absences insondées. Ces absences sans nombre prouvent que ce qui ne tend pas vers l’au-delà de la présence n’est pas digne de notre désir. Il arrive toujours un moment où la conscience se fatigue d’elle-même. Elle ne profite plus de sa propre vie et elle n’atteint pas non plus le cœur désirant de notre vraie vie, elle n’en devine plus l’abyssale profondeur, elle n’en décachète plus l’océan des plis scellés. Elle reste à sa surface, et ses racines mêmes ont peur du grand feu central de notre être. Notre âme ne pense pas, en effet, comme notre esprit ; elle vit d’une vie singulière, unique et cachée. Elle peut être blessée d’un regard ou d’un seul souffle, mais elle peut aussi mépriser les yeux de la foule ou le vent des tempêtes. Étrange puissance, colossale faiblesse. Il faut chercher ce qui la touche ; tout est là, car c’est aussi là que nous commençons. Rien n’est plus triste à l’âme et plus décevant qu’un chef-d’œuvre inabouti, sinon un autre qui, lui, ne serait qu’abouti. Rien ne montre davantage l’impuissance de l’homme devant le constat de sa grandeur — et de son impuissance. Son âme est certainement supérieure à ce qu’on l’on en dit toujours (dans les livres). Elle est plus abyssale qu’aucune de ses images ou de ses définitions. Un grand poète fait sentir en notre âme notre valeur, et alors, quelle ingratitude !, nous estimons moins ce qu’il a su évoquer. La meilleure chose qu’il nous lègue, en souvenir de son talent, c’est la distance qu’il nous permet de prendre d’avec sa supériorité. Baudelaire ou Rimbaud nous emportent dans des cieux sublimes, des paysages de mots, sans égal, éthérés, et nous suggèrent la profuse richesse de mondes à côté desquels le nôtre propre est comme atterré, comme s’il n’appartenait pas plus à la nature des choses que l’ombre fugitive du passant se reflétant dans l’eau du caniveau. Nous sommes des êtres en somme invisibles, qui ne vivent au grand jour qu’enfermés en eux-mêmes. Le visiteur de passage ne se doute jamais de rien. Il nous regarde comme si nous n’étions pas. Il se détourne bientôt comme s’il n’y avait évidemment rien à voir, sans se douter le moins du monde qu’il y eût quelque chose à voir, et dont il n’a pas idée, mais que notre âme fière ne condescend pas à laisser seulement soupçonner. C’est à l’endroit précis où la relation d’un homme avec son semblable semble sur le point de finir, qu’en théorie du moins, elle pourrait véritablement commencer. Mais ce sont là rêveries naïves. Ce que je voudrais principalement dire ici, c’est qu’il y a autre chose dans l’esprit que l’esprit. Ce n’est pas l’esprit qui nous relie à tout ce qui nous dépasse. Il est temps qu’on ne confonde plus sa force et sa gloire avec les fines puissances de l’âme.
_____________________
iCf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Siphonophorae . Une espèce abyssale de Siphonophore, du genre Apolemia atteindrait près de 120 m de longueur totale, ce qui en ferait l’organisme animal le plus long au monde. (Je remercie le Professeur Buydens de l’ULB de m’avoir fait découvrir cet étrange animal des profondeurs.)

Toutes les religions se ressemblent au moins sur ce point : leurs rites obéissent à des règles qui n’ont aucun sens. Ce qui importe dans un rituel, c’est ce que l’on fait – et non pas ce que l’on pense, ce que l’on croit ou ce que l’on dit. Le rituel n’a pas de sens intrinsèque, il ne possède en soi ni but ni finalité. Il est à lui-même son propre but. « Dans l’activité rituelle, les règles comptent, mais pas le résultat. Dans une activité ordinaire, c’est le contrairei. » Prenons par exemple, le rituel juif de « la vache rousseii », qui surprenait Salomon lui-même, et qui était, déjà à son époque, considéré comme l’exemple classique d’un commandement divin pour lequel aucune explication ne pouvait être donnée. Il n’est pas inutile d’ailleurs de s’interroger sur le caractère tatillon et quasi obsessionnel de l’Éternel, c’est-à-dire de YHVH, prescrivant lui-même ce rite de consomption de la vache, et prenant la peine d’en détailler les modalités, avec notamment l’obligation faite de brûler la peau, la chair et le sang de la vache rousse « avec sa fiente ». On imagine qu’il fallait nourrir la vache rousse pendant fort longtemps afin d’accumuler assez de fumier pour enfin la consumer sur l’autel avec les flammes produites par ses seules bouses accumulées. Pas très pratique, dans l’urgence. Mais surtout, quel sens donner à tout cela ? Les rabbins qui commentèrent ultérieurement ce « décret de la loi » [ חֻקַּת הַתּוֹרָה , ḥouqqath ha-Thorah, littéralement « ce qui est écrit, gravé, dans la Thorah »] étaient parfaitement conscients de la difficulté et même de l’impossibilité d’en donner quelque explication. Le célèbre Rachi lui-même reconnaît que « Satan et les autres nations se moquent d’Israël en disant : ‘qu’est-ce que ce commandement et quel en est le motif ?’, c’est pour cela qu’il est écrit חֻקַּת , c’est un décret émanant de Moi que tu n’as pas le droit de critiqueriii. » On n’a pas le droit de critiquer le rite même si l’on n’en comprend pas la significationiv. Il est aussi intéressant de comparer ce rite juif mortifère (pour la vache) au respect quasi divin accordé aux vaches (sacrées) dans le cadre de la religion hindoue. Pourquoi, d’un point de vue anthropologique, une opposition aussi nette, aussi radicale, de ces deux religions dans leur rapport à la « vache » ?
Du point de vue anthropologique, qui est celui que j’adopte dans cet article, les rites semblent cependant chargés d’un langage et d’une symbolique propres, mais ce langage et cette symbolique ne véhiculent pourtant pas de sens, à proprement parler. Ils sont essentiellement inexplicables. On pourrait oser une explication minimaliste. Les rites offrent seulement une « structure » permettant de mémoriser et d’enchaîner un certain nombre d’actions imposées pour une raison et une finalité dont on ignore tout, et que l’on n’a pas le droit d’interroger, et encore moins de critiquer. Il peut être intéressant de remarquer que, tout à fait en dehors du cadre humain, les animaux eux-mêmes ont aussi des sortes de « rituels », comme celui de l’« aspersion ». Ce qui est certain, c’est que l’existence des rituels (humains ou animaux) remonte à la nuit des temps, bien avant l’apparition de langages structurés, et a fortiori, de la syntaxe et de la grammaire. De là, l’idée que l’existence même de la syntaxe, l’idée même de structure du langage pourrait avoir originairement émergé de la répétition de rites, d’emblée structurés comme des proto-langages… De cette observation, on pourrait aussi induire que l’absence patente de sens des rites voit son corollaire dans l’absence de sens quant à la raison de telle ou telle règle de syntaxe. La contingence radicale des rites s’est propagée, depuis l’aube de l’humanité, et a envahi l’ensemble des structures associées aux divers langages, ce qui pourrait expliquer aussi leur diversité, et leurs éventuelles et intraduisibles spécificités.
Si le rite juif du sacrifice de la « vache rousse » semble dépourvu de toute explication, nombre des rites associés au Véda semblent en être tout autant dépourvus. L’extrême ritualisation du Yajurveda et du Samaveda est en soi remarquable, et offre des séries innombrables de prescriptions à respecter scrupuleusement, sous peine d’annuler totalement les effets du rite sacrificiel. Dans les chants du Samaveda, par exemple, on trouve une grande variété de sons qui n’ont apparemment aucun sens, aucune signification sémantique, comme de longues répétitions de O, avec leurs modulations prolongées, et se terminant parfois par des M, censées sans doute évoquer la mantra ‘OM’. On peut bien sûr imaginer que ces pures sonorités ne sont pas essentiellement vaines. Elles ont sans doute des effets psycho-actifs. D’ailleurs les rites védiques s’accompagnent d’autres sortes d’effets psycho-actifs, dont certains extrêmement puissants, comme ceux associés à la consommation rituelle du soma, dont on est presque certain qu’elle provoquait des effets psychotropes et même enthéogènes. Or, les effets du chant, de la récitation et de la psalmodie, qui impliquent un contrôle rigoureux du souffle, pouvaient, avec un entraînement suffisant, avoir aussi de tels effets psychotropes. Ces différentes sortes d’effets, effectivement psychotropes ou seulement psychosomatiques, pourraient même inclure ceux qui relèvent de la méditation silencieuse, telle que recommandée par les Upaniṣad et le Bouddhisme. Ainsi les pratiques d’inspiration et d’expiration contrôlées dans les exercices fortement ritualisés de respiration, peuvent aider à expliquer comment l’ingestion d’une substance psychoactive peut aussi devenir un rituel. Dans d’autres articles de ce Blog, j’ai évoqué le fait que de nombreux animaux se plaisent à consommer des plantes psychoactives. De même, on observe chez de nombreuses espèces animales des pratiques qui offrent des caractères très ritualisés. Il me paraît possible de faire un lien entre ces pratiques animales « ritualisées », mais qui n’ont apparemment aucun « sens », et les pratiques humaines fortement ritualisées comme celles que l’on observe dans les grands rites sacrificiels du Véda. Il serait tentant de faire cette hypothèse supplémentaire : l’ingestion de certaines plantes, l’observation obsessionnelle de rites très détaillés et l’obéissance « aveugle » à nombre de prescriptions religieuses possèdent au moins un point commun, à savoir celui de pouvoir engendrer des effets psychoactifs, ce qui est peut-être le but cherché.
Si l’on considère que les animaux sont eux aussi capables de s’imposer des pratiques ritualisées et de consommer régulièrement des substances alcaloïdes et psychoactives, s’ouvre alors une piste de réflexion plus fondamentale sur la structure même de l’univers, sur son harmonie interne et sur sa capacité de produire des résonances. Celles-ci relient en quelque sorte, de multiples et subtiles façons, le monde de la chimie minérale et organique, le règne des fungi, le règne végétal, le règne animal et le monde spirituel spécifique aux humains. L’existence de ces résonances est particulièrement saillante dans le monde animal (non-humain et humain). Sans doute également, ce sont ces résonances qui sont à l’origine du phénomène universel de la « conscience ». Des rites apparemment sans « sens », sans « signification », ont au moins cet immense avantage qu’ils sont capables d’engendrer, en puissance, un peu plus de « conscience » dans ceux qui les suivent à la lettre, et qui, ce faisant, prennent conscience de ce qu’ils font et de ce qui en résulte en eux… Détournant ironiquement la célèbre formule rabelaisienne, je voudrais exprimer le fond de ma pensée ainsi : « Sens sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Cette formule pourrait aussi s’inverser. Si « du sens sans conscience » peut s’avérer potentiellement et symboliquement destructeur, ou parfois créateur, une « conscience sans sens » pourrait n’être pas moins dangereuse pour elle-même et pour les autres. Une « conscience sans sens » se contente d’être, purement et simplement, et à ce titre elle ne se représente elle-même dans aucun devenir, dans aucun avenir. Une conscience qui se contente d’être, sans se représenter quelque sens que ce soit, quant à ce pour quoi elle est, est l’archétype du nihilisme, avec ce que cela implique comme menace pour les autres vivants et pour tout l’écosystème. Comme on le pressent peut-être, cette voie de recherche (la recherche de résonances profondes, structurelles, systémiques, au sein de l’univers) ouvre donc des perspectives inimaginables, par l’amplitude et l’universalité de ses implications, à tous les niveaux, du minéral au végétal et à l’animal, du quantique au cosmique, de l’anthropique au néguentropique…
En conclusion (provisoire), le fait que les rites religieux n’ont aucun sens offre des perspectives stimulantes. Cela ouvre un espace infini de futures combinaisons entre ce qui relève de ce que les matérialistes appellent la « matière » et ce qui relève de l’« idée », au sens que les idéalistes donnent à ce mot.
____________________
iFrits Staal. Rituals and Mantras. Rules without meaning. Motilar Banasidarss Publishers. Delhi,1996, p.8
iiCf. Nb. 19, 1-22. Voici les premiers versets de ce chapitre (Nb. 19, 1-5): « L’Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes: « Ceci est un décret de la loi qu’a prescrit l’Éternel, savoir: Avertis les enfants d’Israël de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n’ait pas encore porté le joug. Vous la remettrez au pontife Eléazar; il la fera conduire hors du camp, et on l’immolera en sa présence. Le pontife Eléazar prendra du sang de l’animal avec le doigt, et il fera, en les dirigeant vers la face de la tente d’assignation, sept aspersions de ce sang. Alors on brûlera la vache sous ses yeux: sa peau, sa chair et son sang, on les brûlera avec sa fiente […] » »
iiiLe Pentateuque avec commentaires de Rachi. Traduit par le Grand Rabbin Joseph Bloch et al. Paris, 1992. Tome IV, Les Nombres, ch. 19, p.151
iv« La critique de Satan et des nations porte sur deux points : 1° Qu’est-ce que ce rite ? Son objet est de rendre purs ceux qui sont impurs, mais il rend impurs ceux qui manient les cendres ! [les cendres de la vache brûlée en sacrifice]. 2° Comment pourrait-il seulement effacer l’impureté causée par un cadavre ? C’est pour prévenir toute critique de ce genre que l’Écriture introduit ce commandement par les mots : ‘C’est une prescription de la Torah !’ C’est un décret promulgué par le Législateur Divin, et comme tout décret de la Torah il doit être observé même si l’on n’est pas capable d’en sonder la signification. » Le Pentateuque avec commentaires de Rachi. Traduit par le Grand Rabbin Joseph Bloch et al. Paris, 1992. Tome IV, Les Nombres, ch. 19, Appendice, p.304

D’un être « absolu » — un être « divin » par exemple — s’étalant sans fin dans sa propre éternité, et se mouvant sans cesse dans un temps infini, peut-on dire qu’il soit « absolument conscient » ? Il faut répondre à cette question par la négative, pour la raison suivante. Un être infini, s’il dispose d’une « conscience », celle-ci sera elle-même censée être « infinie » a priori. Elle ne pourra donc jamais se concentrer tout entière sur « elle-même », se ramasser en un seul « point », puisque étant associée à un être infini, elle est en quelque sorte infiniment dispersée dans l’infini de cet être. Si elle avait effectivement conscience de cet « infini », alors cela équivaudrait à limiter cet infini même, ce qui serait contradictoire. Une prise de conscience de l’« infini » est un oxymore, car si la conscience « saisissait » l’infini, cela reviendrait à le réduire par la « prise de conscience » qui en serait faite. Une conscience qui serait censée être « infinie » ne pourrait donc jamais véritablement prendre conscience d’elle-même, prendre conscience de la nature infinie de sa propre conscience, car toute « prise de conscience » reviendrait a posteriori à contredire son infinité supposée. Une conscience « infinie » serait, par définition, toujours « au-delà » du moment où elle tenterait de faire une pause réflexive, afin de prendre conscience d’elle-même en tant qu’être infini, serait-ce que fugacement. Étant essentiellement infinie, elle ne serait pas en mesure de s’arrêter sur une pensée immédiate et globale de son Soi (qui est, en soi, infini). La conscience d’un Soi infini, si elle existait réellement, ne pourrait qu’être littéralement infinie, et en conséquence, elle ne pourrait pas se mettre à quelque distance de cet infini qui l’enveloppe de toutes parts. Elle ne pourrait pas se mettre à distance de son Soi, et se concentrer en conscience, en quelque lieu extérieur à ce Soi, pour en prendre précisément conscience, et pour l’observer en tant que tel.
Par contraste, une conscience humaine (une conscience non divine, donc) fonde sa singularité, son unicité, et sa conscience même, sur sa capacité à prendre quelque distance par rapport à soi. Cela lui est possible, parce que sa conscience n’est pas infinie. Elle est en fait a priori limitée de toutes parts. Elle est environnée d’inconscient (son propre inconscient et l’inconscient collectif). Elle n’a aucune conscience de ce qui a permis son éclosion, son émergence à la conscience, et elle n’a aucune conscience non plus de ce qui l’attend après la mort (sera-ce un anéantissement total, ou une survie, au moins partielle ?). Mais, parce que la conscience humaine peut se retirer du flot continu de ses pensées, de ses sentiments et de ses sensations, parce qu’elle est en mesure de s’en séparer, de s’en détacher, elle peut ainsi « prendre conscience » du fait qu’elle est « consciente ». Toute conscience humaine est fondée sur ce détachement qu’elle opère par rapport à elle-même. Mais un être éternel, infini, divin, ne peut jamais se détacher de son infinité ou de sa divinité mêmes, qui lui sont consubstantielles. Cet être éternel peut être « conscient », certes, mais il ne peut jamais être conscient de son infinité et de toute son éternité, puisqu’elles sont précisément sans fin, sans limites, et donc absolument insaisissables. L’être éternel est infiniment immergé dans son infinité et dans son éternité. Il n’y a pas de place libre, séparée, hors de cette éternité et de cette infinité, d’où il pourrait opérer une sorte de recul, et considérer, de ce « point de vue », l’étendue totale de son infinité. Un être infini et éternel ne peut jamais être entièrement « conscient » de son infinité et de son éternité, car la conscience exige une séparation de l’être d’avec lui-même, pour « prendre conscience » de soi. Or, un être infini et éternel ne peut pas se séparer de lui-même, puisque, étant infini et éternel, son infinité et son éternité transcendent toute séparation intérieure (séparation qui lui serait une « limite »). Du fait qu’il ne peut jamais se séparer de lui-même, il ne peut pas être « conscient » de sa propre infinité. Certes, l’être divin le plus élevé doit avoir en soi, et même être en soi le savoir le plus pur, car l’Être (ou l’Essence), l’Existant et le Connaissant n’y font qu’un. Mais ce qui est en lui « savoir pur » n’est pas pour cela « conscience ». Ce qui est « savoir pur » n’équivaut pas non plus à « Celui qui sait ». En effet, Celui qui sait est aussi celui qui est conscient du fait qu’il sait. Il est donc au-dessus ou bien à côté de son savoir. La conscience (du sujet conscient qu’il sait) se tient là aussi séparée, décalée, elle est avant, ou bien au-dessus, ou encore au-delà de ce qu’elle sait. Cette séparation, ce décalage, cette distance, sont impossibles à concevoir pour une conscience infinie et éternelle. Une formule de Schelling résume lapidairement : « Un être-conscient éternel est inconcevable car cela équivaudrait à l’absence de consciencei. » La seule possibilité logique qui reste, serait cette autre hypothèse : se séparant, se détachant, se mettant à distance d’elle-même, la conscience de l’être infini se projetterait par là-même dans un autre infini encore, qui viendrait surplomber ou transcender sa conscience infinie (mais immanente), du point de vue que représenterait sa propre prise de conscience. L’hypothèse est osée. Elle revient à instituer au cœur même de la conscience de l’être infini, la possible présence d’une autre conscience, elle aussi infinie, et orthogonale à cette dernière, et qui serait comme une conscience au second degré, et par conséquent non seulement comme une autre forme de conscience mais comme une conscience essentiellement « autre »ii. Cela introduirait, par le biais de la conscience, l’idée de l’Autre dans l’idée de l’Un, éternel et infini.
_________________________
iF.-W. Schelling. Les Âges du monde. Traduction de S. Jankélévitch, Aubier, 1949, p.88
ii« Il n’y a pas de conscience sans quelque chose qui soit à la fois exclu et attiré. Ce qui est conscient est exclusif de ce dont il est conscient comme n’étant pas lui-même, mais est obligé en même temps de l’attirer de nouveau, et cela justement comme ce dont il est conscient, comme étant malgré tout lui-même, mais sous une autre forme. C’est pourquoi toute conscience a pour base l’inconscience et c’est justement dans le devenir-conscient que l’objet de la conscience est posé comme étant le passé. Or il est impossible d’admettre que Dieu soit resté inconscient pendant un certain temps, pour devenir ensuite conscient ; mais ce qu’on peut bien admettre, c’est que Dieu appréhende dans le même acte indivisible de la prise de conscience l’inconscient et le conscient, celui-ci comme l’éternel présent, mais celui-là comme l’éternel passé. » Ibid.

Dans ses états originels, la vie sur Terre était aveugle, inconsciente, germinative. La vie commença d’ex-ister en s’ex-sudant, en quelque sorte, à partir d’états antérieurs, qui n’étaient pas eux-mêmes vivants. Avant que se manifeste la vie proprement dite, se multiplièrent d’innombrables formes de « proto-vies », de « quasi-vies », autant d’états intermédiaires entre non-vie et vie, des formes d’existence aussi différentes que celles qui séparent des macromolécules minérales, organiques ou biologiques. La vie émergea de cette soupe de macromolécules et à partir de ces états non-vivants qui lui pré-existaient. Toutes les formes chimiques qui pullulaient alors n’étaient pas encore vivantes, mais, par leur coopération et leurs combinaisons, elles allaient rendre la vie possible. En employant les mots « coopération » et « combinaison », on peut donner l’impression que parmi ces formes non-vivantes, certaines se comportèrent comme si elles « s’efforçaient » non seulement de « persévérer dans leur être », mais aussi d’accéder à des formes plus évoluées d’existence. Bien que non vivante (par définition), la non-vie offrait cependant le spectacle de certaines tendances à « être plus » – à être plus « complexes », plus « vivantes ». Elle était envahie par un désir immanent d’être plus que ce qu’elle n’était. Tout se passait comme si elle était à la recherche d’un accomplissement de sa proto-existence, d’un perfectionnement de sa manière d’être. Quoique relativement non-existante, la non-vie recélait en elle au moins l’existence d’une possibilité de s’élever à partir de son état d’immanence, et de développer ses potentialités à la recherche d’un état plus actuel de « vie » et d’« existence » .
On peut tenter de généraliser cette observation. Il y a plusieurs états intermédiaires entre, d’une part, le néant (à savoir ce qui n’est pas et qui ne doit pas être), d’autre part, le quasi-non-être (à savoir ce qui n’est pas encore, ce qui n’a pas encore de raison d’être, mais qui n’en aspire pas moins à être) et, enfin, ce qui est, actuellement et réellement. Même si une chose n’est pas, elle pourrait néanmoins aspirer à être. Évidemment, on rétorquera que si cette chose n’est pas, il n’y a rien en elle qui pourrait être le sujet de cette aspiration. On répliquera à cette objection que, parmi les choses qui ne sont pas, certaines ne sont pas « rien ». Elles sont intermédiaires entre le néant absolu et le fait de « ne pas être ». Les choses qui ne sont pas « néant », mais qui sont seulement des choses qui ne sont pas, ne sont pas rien, parce qu’elles pourraient avoir en elles une potentialité à être, une capacité immanente à être en devenir, ou à devenir un être. D’un côté, ces choses ne sont pas, mais d’un autre côté elles sont, puisqu’elles ont en elles cette puissance à être. Pour être en puissance, et aspirer à être, il faut qu’une chose qui n’est pas, soit d’une certaine façon.
L’intérêt de ce genre de réflexions, à mon humble avis, c’est leur caractère extrêmement général. On peut les appliquer aux macromolécules organiques qui tendent à devenir des molécules biologiques. Mais on peut aussi les appliquer à l’âme de l’homme, ou encore à l’essence de Dieu. L’essence de Dieu, en effet, est, en même temps, son être, et son être est, en même temps, son essence, comme disent les scolastiques. Son existence, autrement dit, émerge de son essence, et réciproquement son essence se constitue sans cesse à partir de son existence. Autre façon, plus provocante, de formuler la même idée : le divin en soi n’est donc ni existant ni non-existant. On pourrait aussi dire que la divinité est une entité qui est au-delà de l’être, ou bien qu’elle est super-existante. Les théologiens des monothéismes, bien entendu, exigent que Dieu soit l’existant en soi, et les philosophes athées disent qu’il n’est rien ou qu’il n’existe pas. Le temps est venu de dépasser ces idées-là, et d’envisager sérieusement une autre voie de recherche. Le Dieu pourrait bien être, en soi, ni existant ni non-existant, tout en étant (à la fois en acte et en puissance) essentiellement libre d’être ou de ne pas être, libre en sa super-essence, et cela sans contradiction.
Un Dieu super-existant ne peut pas devenir existant ni se transformer en non-existant. En tant que super-existant, il ne peut pas cesser d’être super-existant, ou, plus précisément, de (super-)être super-existant. Autrement dit, être ou n’être pas, exister ou ne pas exister, ne sont pas des verbes qui peuvent s’appliquer à une entité qui se situe au-delà du langage, au-delà de la grammaire, et au-delà de la philosophie de l’être. L’ontologie ne peut en aucun cas servir à la connaissance d’un Dieu qui se situe au-delà de l’être et du non-être.
De ce constat, on doit tirer une autre leçon. Il faut admettre une sorte de mouvement en Dieu lui-même. Un Dieu qui, on vient de le voir, ni n’est, ni n’est pas, ne peut pas non plus être éternellement immobile. Il doit nécessairement être capable de se mouvoir librement au-dessus de, ou bien entre ces formes grammaticales (être, n’être pas, etc.). Ce point de vue est la seule façon de comprendre le rapport qui s’instaure en un Dieu, dit « éternel », et une « Création » qui s’inscrit dans le temps et l’espace, à partir d’un « commencement », tel que cela est rapporté dans le Mandala X du Ṛg Veda ou au chapitre 1 de la Genèse. La « descente » du Dieu vers tel ou tel prophète, sa « parole » adressée à tel ou tel être humain, ou a fortiori, le geste même de la création de toute la Création, ne peuvent être que l’effet d’un mouvement interne au Dieu. Mais ce mouvement est-il nécessaire, ou volontaire ? Cela mérite examen.
Dans le premier cas, celui de la nécessité supposée des mouvements de création et de révélation divines, il en résulterait que Dieu est en fait privé de sa liberté par rapport à son essence, et cela de toute éternité. Il ne serait jamais que ce qu’il est et que ce qu’il doit être, puisque même au moment de la création de la Création, le Dieu se trouve accomplir un acte qui est nécessairement conforme à l’essence de sa nature. Si en essence, il est un « Dieu créateur », alors il est « nécessairement » créateur. Or, de ce Dieu, on dit aussi qu’il est éternellement « libre ». S’il est « libre », il faudrait en conclure qu’il a pu créer, conformément à son essence, mais qu’il aurait pu aussi ne pas créer, conformément à sa liberté. Cela revient à supposer deux essences éternelles en Dieu, une essence qui le porte à créer, à se révéler, et une essence qui le pousse à rester éternellement « libre » par rapport à cette première essence.
Dans le deuxième cas, celui d’un mouvement volontaire de création, dû à l’exercice libre d’une volonté essentiellement libre, il faudrait s’interroger sur le pourquoi de l’apparition de cette volonté en un « point » spécifique de l’éternité, correspondant à ce que la Genèse appelle « au commencement » (berechit). Pourquoi, dans le sein même de son éternité (réputée sans temps et sans espace) Dieu décide-t-il volontairement de créer une « création » ex nihilo, avec son propre « commencement », son propre temps et son propre espace ? Comment cette « volonté » soudaine, entièrement « libre », se situe-t-elle par rapport au mouvement interne et éternel du Dieu ?
À l’analyse, Dieu apparaît certes comme essentiellement éternel et essentiellement libre. Mais comment l’« instant »de la création peut-il apparaître dans cette éternité ? Et comment sa volonté peut-elle librement vouloir créer à cet « instant » ? Si Dieu est essentiellement libre, il est libre aussi par rapport à son essence, et donc libre dans sa façon d’être ou de ne pas être. On est donc invité à revenir à une ancienne intuition védique. Étant essentiellement libre, on ne peut dire de Dieu ni qu’il « est », ni qu’il « n’est pas ». Dire qu’il est un « étant » ou un « non-étant » serait limiter sa liberté essentielle, qui va bien au-delà de toute notion philosophique concernant l’« être » ou le « non être ». On peut certes dire que Dieu peut exister par un effet de son essence éternelle. Mais du fait de sa pure volonté, c’est-à-dire en vertu de son éternelle liberté (laquelle liberté représente le mieux, peut-être, sa super-essence), on doit pouvoir aussi dire que, en toute liberté, « ni il existe, ni n’existe pas ».
Si Dieu est en soi « ni existant, ni non-existant » et ne peut non plus devenir « existant » par l’effet d’un mouvement inhérent, immanent, et si l’on ajoute à cela qu’il doit toujours rester « super-existant », alors même qu’il « existe » aussi réellement, quand il le « veut », il en résulte que ce n’est pas en lui-même, mais par rapport à autre chose qu’il peut décider d’être ou de devenir existant, ou non-existant.
Qu’est-ce donc que cette autre chose ? Si l’on pose que la divinité est l’Être même (l’Être en essence), alors cette autre chose doit se comporter à l’égard de la divinité comme étant le non-Être. Elle est, par nature, le non-existant, ce qui n’existe pas, ce qui est essentiellement inférieur à l’existant. Elle n’est pas le non-Être en soi (expression qui n’aurait aucun sens), autrement dit elle n’est pas en soi non-existante, elle est ce qui peut devenir un étant ou revenir à un état de non-étant, ou encore elle peut advenir à des formes intermédiaires d’être (ou de ne pas être), du moins si on les compare à l’Être qui est le « plus haut étant », à l’Être qui est existant en soi, ou encore à l’Être qui est au-delà de l’être et du non-être, c’est-à-dire l’Être super-existant.

Depuis l’apparition de la vie sur terre, cinq « extinctions massives » ont affecté successivement la biosphère. Elles ont résulté de causes différentes, des périodes de glaciation ou de réchauffement climatique, des chocs de météorites géantes, des changements dans la composition chimique des océans ou de l’atmosphère terrestre, des éruptions volcaniques avec des émissions de gaz toxiques à l’échelle de la planète… Ainsi, il y a 445 millions d’années (pendant une période se situant entre l’Ordovicien et le Silurien), plus de 85 % des espèces biologiques ont disparu, suite à une grande glaciation recouvrant la terre. L’extinction du Dévonien, il y a 380 millions d’années, a été provoquée, quant à elle, par l’apparition d’un couvert végétal global, des variations répétées du niveau de la mer et l’anoxie des océans, avec pour résultat l’élimination de 75 % des espèces. L’extinction du Permien-Trias fut la plus massive, et a affecté plus de 80 % de la vie marine et 70 % de la vie terrestre. Aujourd’hui, une sixième extinction massive, dite de « l’Holocène », est en cours, et tout semble indiquer qu’elle va aller s’aggravant. Elle est essentiellement due au rôle perturbateur de l’activité humaine sur la Terre. Nul ne peut prévoir les niveaux catastrophiques qu’elle pourrait encore atteindre. Que le scénario soit pessimiste ou, au contraire, plus optimiste, la responsabilité de l’humanité est entièrement engagée. Les maux connus (surpopulation, urbanisation, industrialisation, pollution, destruction de la nature et de la biosphère terrestre et marine, crise climatique) et d’autres maux encore inconnus, mais latents, devront être combattus par des politiques publiques et l’engagement de chacun à l’échelle mondiale. La victoire est loin d’être probable. La défaite, à l’aune des tendances actuelles, est presque certaine. Dans ce contexte, il ne me paraît pas inutile de prendre un peu de recul, de franchir par la pensée les millions d’années, et de réfléchir à l’issue lointaine de l’Évolution sur Terre, et au rôle de l’Humanité quant à la préservation de la seule planète dont elle dispose, et quant à sa propre transformation. L’alternative est simple et radicale. Ou bien la Nature va continuer d’être saccagée, dans l’ignorance et l’incompétence des politiques économiques, sociales, et de par la veulerie de leurs responsables, ainsi que par les attitudes philosophiques et morales adoptées par tout un chacun, à l’échelle planétaire, et alors l’Humanité sera à brève échéance menacée de s’éteindre, à peine née. Si récemment apparue sur terre, l’Humanité finirait donc « mort-née » en quelque sorte, son évolution ayant avorté après quelques dizaines de milliers d’années seulement. Perdue dans un coin très reculé d’un Univers absurde et indifférent, elle n’aura alors représenté qu’une brève parenthèse, non viable et extrêmement mortifère pour toutes les espèces vivantes qui auront eu le malheur de la côtoyer sur terre. Ou bien, autre branche de l’alternative, s’opérera contre tout attente un sursaut de l’âme des peuples, accompagné d’une prise de conscience de chaque individu, en une sorte de réflexe de survie, s’étendant à l’échelle mondiale, et induisant une transformation des esprits et des consciences. Cette putative « ouverture », cette « voie de sortie » inespérée, improbable, impliquera pour l’Humanité un engagement sans restrictions, et une volonté de se lier psychiquement à d’autres idéaux, et d’autres devenirs, au sein d’un Univers grandiose et obscur, dont on pourrait penser qu’il « attend », d’une certaine manière, notre évolution, et qu’il promet d’autres surprises, comme la prise de conscience que l’on peut « se fieri » à sa cohérence et à son sens. La Vie, que ce soit sur cette Terre, ou ailleurs dans l’Univers, une fois dotée de conscience et capable de la pensée, ne peut plus continuer de se développer sans désirer « monter » toujours plus haut, et sans se complexifier sans cesse, dans un processus qui pourrait bien être sans fin. La Vie ne doit pas se contenter de seulement se reproduire et de survivre au milieu des aléas et des crises qu’elle subit dans son environnement, ou qu’elle s’impose à elle-même. Elle doit chercher toujours à se « dépasser », parce que c’est comme cela qu’elle a réussi à émerger, originairement, de la soupe chimique primordiale. Depuis la nuit des Temps, et sans doute jusqu’à leur fin, la Vie doit toujours chercher, non simplement à survivre, mais à « Sur-Vivre ». En grec, on pourrait dire « Meta-Zoeïn », en latin « Super-Vivere », en allemand « Über-Leben », en anglais « Over-Live ». Pour atteindre cette forme supérieure de vie et d’existence, tous les vivants doivent marcher, toujours plus avant, dans des directions où se dessine le maximum de probabilité de progresser encore davantage, sans jamais perdre la mémoire des véritables origines. La mémoire, consciente ou inconsciente, génétique ou cognitive, représente le fondement le plus fondamental. Elle permet de se représenter la force des liens entre l’histoire passée de l’Évolution et la vie présente, et, en conséquence, d’anticiper de possibles perspectives ou des impasses terminales. La mémoire s’exerce toujours au présent. Le présent, par exemple, c’est aussi ce moment où une responsabilité planétaire échoit à l’Humanité tout entière, y compris aux factions, aux partis et aux tribus qui s’y déchirent. Les signes abondent. La Terre se meurt. Pendant ce temps, les Nations se combattent. Les Peuples s’entretuent. Mais un espoir subsiste. « Peuples et civilisations parvenus à un tel degré, soit de contact périphérique, soit d’interdépendance économique, soit de communion psychique, qu’ils ne peuvent plus croître qu’en s’interpénétrant […] Sous l’influence combinée de la Machine et d’un surchauffement de Pensée, nous assistons à un formidable jaillissement de puissances inoccupées […] Comment ne pas voir dans ce double phénomène un pas nouveau dans la genèse de l’Espritii ! » L’aventure de l’Esprit, la « Noogénèse », monte irréversiblement vers un haut point d’évolution, que Teilhard appelait « le point Oméga ». Ce point n’est pas un but qu’il faudrait « atteindre », il indique une sorte de cap métaphysique sur lequel fixer sa route — une route dont rien ne dit qu’elle n’est pas sans fin. Les métaphores du « jaillissement », du « pas nouveau », de la « montée » vers le « point Oméga » sont à l’évidence très optimistes. Mais il faut bien se rendre compte que l’Évolution, telle qu’on l’observe sur Terre, ne peut pas continuer indéfiniment sur sa lancée actuelle. Elle va nécessairement passer par des moments de dissociation et de destruction radicale, et même par de nouvelles extinctions massives, qui interviendront sûrement, soit dans quelques dizaines de millions d’années, pour rester dans le rythme des extinctions passées, soit dans quelques dizaines d’années seulement, si l’Humanité continue de s’y prendre aussi mal qu’elle en donne actuellement les signes. Au regard de la succession des temps géologiques et des traces qu’ils ont laissées, le scénario du pire est fort probable, et même inévitable. Dans ce cas, cependant, une nouvelle quasi-extinction de la vie sur ce globe n’équivaudrait pas à la fin de la Vie. Elle s’y poursuivrait en reprenant d’autres directions d’évolution. Autrement dit, l’évolution à très long terme de la Noosphère est intrinsèquement imprévisible, et personne ne peut se l’imaginer. On peut avancer quelques hypothèses, explorer des pistes de réflexion. La fin du système solaire est évidemment inimaginable, mais elle aura lieu un jour, concomitamment avec la fin de la Voie Lactée. Comparée à l’évolution de la vie sur Terre qui a commencé il y a 3,8 milliards d’années, l’Humanité est si récente (moins de 100.000 ans) qu’on peut la dire nouvellement née. De même, entre les temps actuels et la fin effective de notre galaxie, s’étendra aussi une durée immense. Mais verra-t-on alors, inévitablement, « la fin de toute Vie sur notre globe, — la mort de la Planète, — la phase ultime du Phénomène humainiii. » Rideau ? Générique de fin ? Néant total ? Cela même est en réalité incertain.
Il se pourrait que la période à venir, se déployant sur les prochains milliards d’années, ne voie en aucun cas un ralentissement et un déclin de la nature profonde de l’Évolution, quelles que soient les vicissitudes rencontrées sur cette Terre, ou dans cette Galaxie, et ceci malgré la certitude d’une catastrophe finale, inévitable, à l’échelle galactique, et la transformation en un trou noir et géant. Malgré ce triste destin local (à l’échelle cosmique), il faut considérer sérieusement l’hypothèse d’une accélération de l’Évolution, d’un surpassement continu de la Conscience, d’une efflorescence de la Vie dans l’Univers. Alors, déclin et catastrophe finale, ici, et sublimation et renaissance, ailleurs ? Tout ce que l’on peut prédire avec quelque probabilité, et c’est déjà beaucoup, c’est que l’évolution du cosmos, au cours des prochains milliards d’années, prendra des formes absolument inimaginables. La plus sûre des prédictions, c’est que l’avenir fera certainement apparaître des transformations de l’Univers absolument inouïes, aujourd’hui inconcevables par les cosmologistes ou les théologiens, et sans aucune commune mesure avec ce que l’on peut aujourd’hui observer et connaître de son passé. Il suffit de comparer ce qu’était la vie sur Terre, il y a 3,8 milliards d’années et ses formes actuelles, pour concevoir la radicalité des futures métamorphoses qui interviendront, dans quelques millions ou milliards d’années, dans le système solaire, ou ailleurs, dans telles galaxies, ou telles nébuleuses. Il est certain — statistiquement certain — qu’au regard du chemin déjà accompli par la Vie dans l’Univers, l’évolution ne fait jamais que commencer.
Dans cette vision, on peut naturellement se demander si la vie terrestre sera un jour capable de franchir les limites du système solaire, et si elle pourra, sous une forme ou sous une autre, émigrer dans la Voie Lactée, et, pourquoi pas, selon des procédés à nous inconcevables, effectuer des voyages trans-galactiques. Il ne s’agit pas là de science-fiction, ni de métaphysique, mais d’un calme exercice, réflexif et méditatif, s’appliquant à la nature du monde et à son évolution cosmologique. Une émigration cosmique de la Noosphère pourrait n’être pas nécessairement d’une nature physique, elle pourrait avoir lieu sous forme psychique (le chamanisme en offre une préfiguration) ou spirituelle (voie explorée par les grands mystiques). Le point important est qu’elle ne concernera pas seulement quelques individus « élus » mais la totalité et l’entièreté des consciences, dans les inimaginables formes de développement qu’elles exploreront dans les prochains éons. On peut supputer qu’une réunion, ou même une sorte de « fusion » des foyers de conscience les plus avancés dans le cosmos aura un jour effectivement lieu. Quant à savoir si l’Humanité dans son ensemble sera un jour invitée à partager ce festin de la conscience, à l’échelle cosmique, je dirais que ce n’est pas impossible a priori, mais qu’il y a beaucoup de travail à entreprendre, et cela sans attendre. L’urgence est, au minimum, de faire de cette planète un lieu physiquement, psychiquement et spirituellement capable non seulement de survivre, mais de Sur-Vivre. Ceci obtenu, on pourra alors considérer comme possible la communication, puis la mutuelle fécondation de notre Noosphère avec d’autresiv… Dans ce scénario, ni la mort de la planète Terre, biologiquement dévastée, spirituellement exsangue, ni les déchirements internes de la Noosphère humaine, incapable de trouver en elle-même les ressources pour fonder son unité, ne seraient des coups d’arrêt définitifs. On pourrait ainsi imaginer, non pas un progrès continu, indéfini, de notre Noosphère — mais une ek-stasisv, hors de l’espace-temps de l’Univers visible, et un voyage dans des formes d’« au-delà » absolument autres. L’aventure de l’Être, de la Vie et de la Conscience n’en finira pas de nous surprendre, pourvu que nous sachions trouver le moyen d’y participer… L’Évolution pourrait se développer, aussi, au-delà du cadre de l’espace-temps. Après tout, les chamans, depuis l’aube de l’humanité, et des prophètes de grandes traditions religieuses (comme la Védique, l’Égyptienne-antique, l’Avestique, la Sumérienne, l’Akkadienne, l’Hébraïque et bien d’autres encore) ont déjà pu explorer cet au-delà du monde et en sont revenus pour en rapporter quelques éléments d’information. Il faut donc se projeter dans une nouvelle dimension. Il faut pressentir, que même en nos temps troublés, quand la violence, la folie, l’ignorance, la haine et le manque total de vison « stratégique » obscurcissent un grand nombre de cerveaux humains, une incroyable révolution mentale et psychique peut déjà se préparer, dans le tréfonds de la Noosphère. Dans cet abîme obscur et inconscient, mitonnent fiévreusement et bouillonnent en silence les puissances de l’élévation, de l’avancée et de l’approfondissement. Ces forces à la fois divergentes et convergentes préparent l’épigenèse d’une transcendance surhumaine et d’une immanence ultra-humainevi. En empruntant un autre vocabulaire, à connotation plus métaphysique que philosophique, on pourrait décrire cette évolution/révolution comme une union progressive du monde et du divin. Selon cette vue, il faudrait en déduire, logiquement, que Dieu n’est pas immobile, statique, mais qu’il s’achève sans cesse lui-même, qu’il s’accomplit et se complète éternellement, dans ses rencontres avec les Noosphères qui se constituent au sein de sa Création. Son ‘union’ avec le Monde lui apporte, peut-on conjecturer, quelque chose d’essentiel à sa propre divinité. Celle-ci pourrait se définir comme une divinité ne cessant jamais de se diviniser par sa fusion avec cet Autre, à l’œuvre dans la création. La métaphysique de l’Être doit désormais céder le pas à la métaphysique du Devenir. Une Métaphysique de l’Inaccomplissement doit se substituer à l’ancienne Métaphysique de l’Accomplissement. Avec la perspective de l’Union, à jamais inaccomplie, toujours en devenir, de l’Homme, du Cosmos et du Divin, nous pouvons dès lors nous concevoir avec quelque probabilité comme co-responsables et co-acteurs de la divinisation du Divin.
_______________________________
i Pierre Teilhard de Chardin. Le Phénomène humain. Œuvres complètes,Tome I. Seuil. 1956, p.258 sq.
ii Ibid, p.280
iii Ibid, p.304
iv Idée évoquée par Pierre Teilhard de Chardin. Ibid, p.319
vLittéralement une « sortie hors de ». On parle d’expérience de sorties du corps (« Out of body experiences »), pourquoi ne pas imaginer des expériences de sorties de la Noosphère ?
vi Cf. Pierre Teilhard de Chardin. Comment je crois. Paris Seuil, 1969, p.291

Avant que la vie n’apparaisse sur Terre, les plus grosses molécules que l’on pouvait y trouver, n’étaient encore que des amas, des agglomérats, des assemblages obéissant aux seules lois de la physique et de la chimie. Sinon inertes, du moins plutôt inactives par elles-mêmes, ces molécules n’étaient encore que matière anonyme, substance répétée, soumise aux contraintes inflexibles de ces lois. Par contraste, et concomitamment, quand la « vie » apparut, ces molécules jusqu’alors constamment dupliquées, réitérées, se mirent à muter et à se reproduire toujours plus efficacement, multipliant leurs possibilités d’individualisation, formant des groupes nouveaux, des familles et des « bassins » de formes zoologiques, faisant croître par là-même de futures possibilités de tâtonnements, d’essais et d’erreurs, de regroupements et de clivages, et d’autres mutations plus qualitatives, conduisant à l’apparition de nouvelles spéciations. La complexification du vivant, cette ruée vers l’avenir, se fit désormais en réseau, selon plusieurs axes simultanés, et elle s’accéléra toujours plus, de manière exponentielle, grâce à ses premiers succès. Ainsi se constituèrent de nouveaux phyla, de nouvelles « unités zoologiques », chacune comprenant une « population » d’espèces proches, à la fois légèrement différentes, et aussi potentiellement divergentes. Toutes ces formes, dans leur bouillonnement, continuèrent de se développer en faisceau, par des successions de mutations s’additionnant les unes aux autres toujours dans le même sens, comme s’il s’agissait de consolider une « percée » dans les murailles du possible, ou de confirmer une sorte de « préférence » de l’évolution pour une direction privilégiée, à l’échelle de durées dépassant le million d’années. Cette « préférence » pourrait s’interpréter comme une force fondamentale, orientant tout ce qui est matière « vers le plus compliqué et le plus conscienti ». La forêt de la Vie sur terre semble une jungle impénétrable à l’analyse. La place de notre espèce ne peut s’y trouver aisément du point de vue morphologique, même si, du point de vie comportemental, elle semble la forme qui se sera révélée la plus mortifère et la plus délétère pour toutes les autres formes de vie. N’y a-t-il pas cependant un moyen de démêler dans ce fouillis inextricable une sorte de principe majeur d’évolution, un axe explicatif la traversant de part en part? La loi de « complexité-conscience », théorisée par Teilhard de Chardin, permet de formuler une hypothèse à ce sujet. Chez les vivants supérieurs, le système nerveux a tendance à se regrouper ici et là en ganglions de plus en plus importants, qui ne sont pas sans rapports avec la tendance à la céphalisation et la cérébralisation. D’âge en âge, la masse de matière « cérébralisée » n’a pas cessé d’augmenter au sein de la Biosphère. Cela s’observe dans le cas des Primates, d’abord apparus au Tertiaire inférieur sous la forme de très petits animaux, puis séparés en deux groupes au Tertiaire moyen, dont l’un, centré sur l’Afrique, devait connaître un destin mondial. A partir du Miocène, la culmination des Primates de type anthropoïde se confirma, avec l’Afrique pour foyer principal. Après plus de deux milliards d’années d’exploration dans toutes sortes de direction, et bien avant l’apparition du genre Homo, la singularité fondamentale du groupe des Primates éclata : elle fut de diriger toujours son évolution selon l’axe d’une « conscience » toujours plus croissante et toujours plus complexe. Pendant le dernier million d’années de l’évolution sur Terre, a été crevé le plafond nocturne qui empêchait encore d’atteindre le vrai soleil de la conscience. A la fin du Pliocène, la Terre était encore entièrement sauvage, sans la moindre trace de civilisation ou de culture. Aujourd’hui, c’est la nature sauvage qui a presque disparu, et qui a été remplacée par la « civilisation humaine », laquelle occupe intégralement la Terre. Tout cela est arrivé en un temps extrêmement court à l’échelle du Cosmos : un seul petit million d’années. Quelque chose de majeur, d’inouï a donc dû se passer au début du Quaternaire dans le domaine de la vie. Mais quoi ? Où ? Au sein de quelle espèce? Chez les Australopithèques, ces Singes à petites canines, se tenant debout ? Chez les Pithécanthropes, déjà des Hommes, mais au crâne aplati et simiesque ? La différence entre les pré- ou para-hominiens et les proto-hominiens peut être difficile à objectiver, tant elle ne semble pas plus significative qu’entre deux familles hominoïdes voisines. Il faut se résoudre à ce constat. Le facteur-clé qui a permis l’explosion du phylum hominien, lui donnant la souveraineté de la Terre, reste encore inconnu, invisible, inexplicable en essence. C’est pourquoi nombre de paléontologues soutiennent encore qu’entre Hominiens et Anthropoïdes, il n’y a aucune différence de « nature », mais seulement une différence de « degré ». Dans cette explication qui n’explique rien, l’Homme ne serait qu’un Singe se tenant plus souvent debout, mais peut-être un peu plus malin que les autres… Teilhard de Chardin s’est élevé contre cette lecture de l’évolution. Il a posé l’hypothèse qu’eut lieu en ce début du Quaternaire un moment capital. Soudain, l’Anthropoïde que l’on devait plus tard appeler l’Homme, n’a plus été seulement « un être qui sait », mais il est devenu « un être qui sait qu’il sait ». Il s’est découvert « une conscience à la deuxième puissanceii ». Avec cette conscience multipliée par elle-même, cette « conscience au carré », l’Hominidé accéda d’un seul coup — et non « par degrés » — à un monde totalement nouveau : un monde « intérieur », le monde de la pensée. L’Univers, jusqu’alors, était simplement « là », dans sa pure extériorité et sans la moindre « intériorité ». Mais d’un seul coup, l’Univers devenait maintenant pensable par des êtres situés en son sein, et il était en effet pensé (par des Primates penseurs). Le monde, l’espace et le temps, soudainement, et pour la première fois, devenaient accessibles à la pensée et à la conscience. Un voile de conscience pensante commença de se tisser, et d’envelopper la Terre, s’élevant aussi vers le Ciel, et s’enfonçant, par la puissance des mythes, loin dans les antres du passé, descendant dans les cavernes des mondes invisibles, vers les royaumes cachés de la mort. La « conscience au carré », phénomène inouï, imprévisible, livrait d’un seul coup à l’Homme, le monde terrestre et ses mystères, mais l’ouvrait aussi à l’Univers total, le découvrait comme un immense trésor d’idées. La suite a montré que la conscience humaine, stimulée, dynamisée, montant en puissance, était capable d’atteindre, par la pensée, même l’au-delà de l’Univers, et qu’elle pouvait en conceptualiser diverses hypothèses quant à sa Genèse. La conscience et l’intelligence s’étaient réciproquement éveillées, pour ne plus jamais s’endormir. L’intelligence s’était éveillée à elle-même par la lumière de la conscience. Désormais, elle pouvait s’éveiller aussi à tout le reste, à tout ce qui n’est pas elle-même, par le truchement de tout ce que la conscience a en elle d’obscur, par tout ce qu’elle peut pressentir en elle d’inconscient. L’apparition de la conscience sur Terre fut l’élément déclencheur. Les ondes réverbérantes de cette explosion initiale n’ont plus jamais cessé, et ne cesseront jamais de s’étendre à travers l’univers… Mais tout reste à accomplir. Et peut-être même que cet « accomplissement » doit s’entendre comme n’ayant pas de fin. La recherche de conscience est un processus éternel, assoiffé, avide. Un être qui se sait en train de devenir plus « sachant » ne peut plus arrêter sa quête, désormais. Il peut se mettre illico à réfléchir sur le fait qu’il est aussi « un être qui sait qu’il ne sait pas ». Il peut aussi commencer à douter de la nature même de son « savoir ». N’est-il pas aussi, en quelque sorte, « un être qui ne sait pas qu’il ne sait pas » ? — Ne pas savoir qu’on ne sait pas, être inconscient de son inconscience est une ignorance fatale, dont toute conscience doit prendre conscience. On peut toujours méditer sur l’infinité des choses dont on sait qu’on les ignore, et plus encore sur l’infinité des choses dont on ignore absolument le fait même qu’on les ignore… Mais comment expliquer, par exemple, que cette rupture décisive, ce saut de l’Homme dans l’immense univers de la pensée et de la conscience, ne se soit pas traduit également par une rupture analogue du point de vue morphologique, anatomique ? Quelque arrangement incomparable de connexions neuronales (que les neuroscientifiques décèleront un jour, peut-être, dans leurs imageries?) a-t-il permis de faire le pas crucial séparant le cerveau « réfléchissant » de l’Homme du cerveau « non réfléchissant » du Chimpanzé ? Il est fascinant d’imaginer que l’apparition d’une précieuse mutation neuronale, peut-être apparemment minimale, ait permis une telle explosion macro-évolutive de la pensée se pensant elle-même en tant que pensée, conduisant à la conscience « consciente de soi ». Il y a seulement quelques centaines de milliers d’années, l’Homme est apparu soudainement au milieu des Pongidés, ces Primates hominoïdes aujourd’hui en voie de disparition terminale. Cela fut un événement comparable à l’émergence, il y a deux ou trois milliards d’années, des premières molécules dites « vivantes », au milieu de la soupe primordiale des protéines « mortes », ou du moins biologiquement inertes. La « conscience au carré », cette conscience de la conscience, n’est pas simplement le nouvel attribut qui permit plus tard à Homo de se nommer « Sapiens » (assez improprement et vaniteusement). Il s’agit de beaucoup plus que cela. Dans le sein bouillonnant de la vie, est apparue une autre espèce de vie. Ce sera la gloire ineffaçable du Pliocène d’avoir vu naître cette nouvelle espèce de vie — la Vie de la Conscience. On n’a pas fini de mesurer les implications de cette révolution, non copernicienne, mais sapientiale. L’Homme, assez inexplicablement, s’est soudain ouvert une voie de conscience vivante vers les étoiles, dont les plus brillantes brillent dans des cieux inaccessibles à la vision. Avec l’apparition de la conscience, a ainsi été révélé un élément fondamental touchant à la nature même de ce monde. L’Homme, on le sait, n’est objectivement qu’une sorte de bref néant, face à l’amplitude de l’univers et à la radicalité des mystères. Mais s’il peut atteindre à la conscience de son propre néant, sans renoncer à la puissance de ses intuitions, alors cela peut aussi l’inciter à penser que, statistiquement, de par le monde, d’autres esprits, bien plus vastes, bien plus sages, des sortes de « Messies cosmiques », bien moins provinciaux que nos prophètes terrestres des âges passés, sont déjà à l’œuvre, ailleurs, parmi les amas galactiques et dans les confins de l’Inconnu. Mais comment s’en assurer ? Il faudra peut-être compter sur quelque puissance à venir de la conscience humaine ou trans-humaine. Un jour viendra alors, où l’on pourra s’en persuader, par la pensée, par l’intuition, par le sentiment. L’Homme n’est sans doute qu’un pion minuscule dans un échiquier cosmique, sa vie n’est qu’un instant infime comparée aux infinies dimensions de l’Évolution. Mais c’est un pion qui peut aller à dame. En un instant la conscience peut étreindre l’éternité. Pour prendre une autre métaphore, empruntée au jeu de go, où toutes les pierres sont égales entre elles, l’Homme sera un jour, dans l’Univers, capable de « vivre par ko », éternellement, tour à tour face au néant de son être, et le coup d’après, s’envisageant vainqueur de toute la partie. Les coups de ko se succèdent et les enjeux ne cessent de monter. Mais à la fin, le meilleur gagne à la fois, la victoire et l’éternité (-en hébreu biblique, c’est le même mot : נֵצַח, netsaḥ, ce qui nous apprend que l’éternité est l’enjeu d’une bataille, qu’il nous revient de tout faire pour la remporter).
____________________
iP. Teilhard de Chardin. L’Apparition de l’Homme. « Les trois peurs de l’espèce humaine et leur remède ». Ed. du Seuil, Paris, 1956, p. 308
iiP. Teilhard de Chardin. L’Apparition de l’Homme. « Les trois peurs de l’espèce humaine et leur remède ». Ed. du Seuil, Paris, 1956, p. 314

Depuis des dizaines de millénaires, l’espèce humaine « évolue », multiplicité mouvante, emplie d’espoirs et d’effrois, traversée de savoirs et d’ignorances, constellée de vertus et de manques. Les individus qui la composent vivent au jour le jour des vies singulières, dont la durée est insignifiante au regard des temps cosmologiques. Le contenu de ces vies, les plus glorieuses comme les plus humbles, s’ajoutent au trésor commun de l’espèce. Celle-ci, poursuivant ses propres objectifs (la survie biologique ? La maximisation des divergences évolutives ?), reste indifférente aux destins particuliers. L’humanité représente décidément pour elle-même une entité étrange, indéfinissable. Son essence, son origine et sa raison d’être restent obstinément obscures pour ceux-là mêmes qui la constituent. Les humains ne connaissent ni l’essence de leur être individuel, ni celle de leur espèce. Les générations continuent de naître, et s’écoulent dans l’océan des siècles. A quelle fin ? Dans l’abîme cosmique, les galaxies elles-mêmes ne sont jamais que des lucioles plongées dans la nuit. Face à l’univers, qu’est-ce donc qu’un homme ? Les hésitantes lumières de quelques consciences humaines pourront-elles pénétrer un jour les confins de l’espace, ou contempler la fin des temps ? Tissés d’obscur et d’absence, les humains sont égarés dans un monde beaucoup trop vaste, indifférent à leurs désirs, inflexible devant leurs prières. Piégés par les héritages, submergés par le nombre, épuisés d’impuissances, la torpeur de leurs rêves ne leur permet pas de diriger leur volonté. De leurs fourmillements désordonnés, de leurs agitations contingentes, n’émerge en fin de compte qu’une mobilité exténuée, une inertie incertaine. Les consciences humaines, plus isolées que solidaires, plus séparées qu’unies, plus limitées que libérées, renoncent souvent à se dépasser elles-mêmes. Elles se sentent cernées par un monde clos, des frontières scellées, des esprits murés, et se résignent à cette double séquestration (physique et métaphysique). Elles se tassent dans l’ombre et la nuit. Pourtant, les humains ont bien des soifs, et des rêves latents : ils veulent par exemple se distinguer (dans les foules), s’accomplir davantage (contre d’inévitables inachèvements), se justifier (malgré l’injustice et l’inégalité). Ils jouissent malgré tout de quelques puissances : ils pensent, ils réfléchissent, ils aiment, ils haïssent, ils s’allient, ils se battent, ils conquièrent, ils bâtissent, ils découvrent, ils désirent franchir toujours plus de mers océanes. Après quelques millénaires, il n’y a pas si longtemps de cela, l’Homme se crut soudain « moderne », et commença alors à comprendre qu’il n’était plus, cosmiquement et ontologiquement, au centre de l’Univers… Aujourd’hui, l’affaire est entendue, il se sait relégué dans un coin abscons d’une galaxie marginale, perdue dans quelque superamas. Il s’est désormais tellement persuadé de son insignifiance, que celle-ci n’a même plus de sens pour lui. Il n’a plus de « centre » autour de quoi tourner. Il est fort possible en effet que la notion de « centre », dans un univers en expansion (vers quoi?), n’ait pas réellement de sens. Il est aussi possible que la notion même de « sens » n’ait plus non plus sa place dans un cerveau de plus en plus dépassé par tous les « dépassements » subis au cours de ses périodes de conscience. Et que dire des autres « dépassements » dont il lui paraît bien qu’il lui faudra les subir à l’avenir? Si les mots « centre » et « sens » ne veulent donc rien dire, peut-être faudrait-il user d’autres métaphores, par exemple des figures plus explicites du « déplacement » et du « dépassement » ? Celles de la danse, du saut, de la plongée ? Ou de l’exil et de l’extase ? L’Homme est à l’évidence, pour longtemps encore, coincé sur un étroit et quelconque corps (céleste), à la fragile écorce (terrestre). Il est aussi enfermé en son moi, voilé d’ombres. Il se plaît en conséquence à se fantasmer comme un migrant en puissance, s’orientant sur quelques étoiles, galactiques, ou psychiques. Le philosophe ou le psychologue diagnostiquera cet élan intime de l’âme comme un désir métaphysique d’émigration. L’âme, dont la nature profonde est de se mouvoir toujours, pousserait l’homme à ne pouvoir se satisfaire de quelque « centre » ou de quelque « sens » que ce soit. Sur une planète bondée, surpeuplée, rendue invivable par la violence, l’injustice et la misère, il va falloir tenir compte de l’effervescence biologique et sociale qui résulte déjà de cette compression humaine, de cet entassement, de cet écrasement du nombre, de cet afflux sans fin des foules. Il n’est pas question ici de tomber dans l’anthropocentrisme. Les forces actives derrière ces processus ne sont pas spécifiques à l’humanité. Dans l’entièreté du cosmos, ils ne sont certes pas réservés à la seule planète Terre, mais partout répandus. Ils sont de facto de nature universelle. La pesanteur et la gravitation, les mouvements de translation et de giration, la multiplication des multitudes, la totalisation des totalités, et les compressions qui en résultent, sont des phénomènes d’une banalité cosmique. Il y a certainement, de par les vastes mondes, d’innombrables formes d’évolution, fort différentes sans doute de la nôtre, mais analogues en leurs principes à celles qui façonnent l’Anthropocène : accroissement, compression, complexité, conscience, convergence. De l’existence de ces analogies trans-cosmiques, pourrait surgir l’idée que l’Univers tout entier travaille en tous les lieux qui le composent à fabriquer d’autres « centres » et d’autres « sens ». Ces fabrications entrent peut-être en compétition, d’un point de vue plus élevé encore, qui sait ? Cette guerre des « sens » et des « centres », à l’intérieur même du cosmos, se fait naturellement dans l’immanence, puisque la transcendance est désormais non grata. La science et la philosophie « modernes », que toute idée de transcendance révulse, ont réduit l’Homme à une sorte de machine neuronale et biochimique, certes éminemment complexe, mais essentiellement déterministe, enchaînée aux causes et aux effets. Or, la « modernité » a imposé sa « mode ». Dans les laboratoires, les universités et tous les centres de la doxa épistémologique, sont donc ignorées les leçons des grandes traditions religieuses (la chamanique, la sumérienne, la védique, l’égyptienne, l’akkadienne, la juive, la bouddhiste, la chrétienne, pour en citer quelques-unes, parmi les plus saillantes). Cette « mode » méprise aussi les intuitions visionnaires des poètes ou des mystiques. Tout cela n’est que vain bavardage, babillage d’esprits faibles, disent les « modernes ». Seule compte la certitude des nombres et des faits, la beauté austère et froide des théories et des équations. Il n’y a plus de « Grand Récit » convaincant de l’histoire du Monde, ou de sa Genèse. L’Homme ne serait rien que l’objet non identifiable d’une suite de hasards heureux ou malheureux, soumis aux mors du matérialisme et du déterminisme. Il n’y a que la règle, et jamais d’exception. Il n’y a plus de place pour la singularité de l’espèce humaine. On voit seulement sa banalité cosmique, sa trivialité relative. Même dans le petit monde bariolé de la Biosphère, tous les vivants semblent au fond se ressembler, le ver de terre, le coléoptère et la panthère. Tous les êtres vivants partagent nombre de gènes, et de multiples traits comportementaux, la génération, la croissance, la « conscience », puis le dépérissement et la mort. La Terre garde encore la trace de ces étapes naturelles de l’évolution. Dès la fin du Tertiaire apparurent des animaux « pensants ». Ils étaient dotés d’une sorte de « proto-conscience », préparant la voie des premiers Primates puis des Hominidés et des Hominiens. Il faut dire que la « conscience » est sans doute, sous différentes formes, les plus modestes, comme les plus élevées, chose universellement partagée. Cela n’est pas encore rigoureusement prouvé, mais tout pointe vers ce constat, et il faudrait commencer à en tirer les conséquences. Certes, en chaque homme, une conscience singulière, dotée d’une essence propre, invisible, reste tapie, à l’affût. Mais il faut aussi prendre en compte toutes les myriades de consciences, de par le monde, plus ou moins élevées, plus ou moins volontaires, et qui sont aussi sont capables de s’agréger, de tisser des nœuds, de trame et de chaîne, dans la toile mentale, mondiale. Cette Noosphère putative ne cesse de recouvrir la Biosphère de fins voiles de conscience émergente… Il faut se rendre à l’évidence, l’Homme avec sa « conscience » n’est pas un « accident » du hasard des choses, mais l’un des résultats avérés de forces immenses et pénétrantes, agissant à l’échelle cosmologique, mais aussi au cœur de la matière. Il est le produit d’innombrables transformations énergétiques et de mutations continues, à l’œuvre depuis des milliards d’années, à des échelles insoupçonnables et suivant des logiques parfaitement inconcevables… Parmi les principes fondateurs de l’univers qui ont abouti à l’émergence de la conscience, il importe de rappeler ici que sont constamment à l’œuvre la Quantification de toutes les énergies et la Gravitation, « courbant » l’espace-temps. Depuis l’aube du monde, l’énergie primordiale, celle qui devait irradier l’ensemble de l’existant, a pris des formes granulaires, corpusculaires, photoniques, atomiques. Des premiers états quantiques, produisant particules, corpuscules, atomes, devaient découler dans la suite des temps une infinie variété de combinaisons et de recombinaisons, une valse sans fin de ré-arrangements, une danse continue de quantiques mixtions. D’autre part, les forces de la Gravitation, d’une autre nature que quantique, jouèrent aussi leur partition dans l’immensité cosmique. Sous leur influence à longue portée, la Matière s’agrégea en amas, en galaxies, en étoiles, en planètes. Les forces électro-magnétiques, quant à elles, agirent sans relâche dans les soupes chimiques ainsi densément concentrées. S’y formèrent des molécules toujours plus longues, plus entortillées, plus enveloppantes, comme si elles cherchaient à fabriquer le nid souple, vibrant, de leurs ardentes couvaisons. S’ouvrit alors largement le riche royaume de la chimie organique, où se complurent à l’association et à l’interaction des myriades d’atomes et de molécules, se liant organiquement en gigantesques macromolécules et en protéines de plus en plus protéiformes (c’est le cas de le dire). De celles-ci, surgirent les premières tentatives de proto-vie, puis les composants nécessaires à ce qui devait alimenter les probabilités d’apparition d’autres formes de vie plus élaborées, des formes sans cesse naissantes, d’une inépuisable variété, qui finirent par aller du ciron au potiron, et de la phalène à la baleine.
Ce qui est le plus frappant, dans cette histoire totale, c’est que l’on a pu mettre directement en parallèle (et en synchronicité) la complexité du vivant qui se révèle à l’échelle biologique, et la complexité de l’univers qui se lit à l’échelle cosmologique. En effet, les ordres de grandeur qui interviennent dans la gamme des entités biologiques, depuis les plus simples (les virus) jusqu’aux plus complexes (le cerveau humain), sont analogues aux ordres de grandeur qui séparent les particules élémentaires des superamas galactiques. Surprenant, non ? Autrement dit, le rapport entre la complexité d’un cerveau humain et celle d’un simple virus est analogue au rapport entre la complexité de l’univers entier et celle un seul électroni… De là, on est incité à généraliser, et à supposer que les phénomènes de la vie et de la conscience observés ici-bas dépendent en fait de forces qui intéressent le cosmos tout entier, dans une sorte d’intégration totale. Ces forces universelles, capables de porter la matière à de très hauts degrés de concentration et d’arrangement internes, sont aussi celles qui peuvent affecter les fines structures de nos cerveaux. Étonnant, non ? Il est donc tentant de supposer que, partout dans l’univers où de tels degrés de concentration pourraient apparaître, il faudrait légitimement s’attendre qu’existent des formes de vie et de conscience semblables à celles que nous connaissons sur cette Terre. Plus vraisemblablement même, pour une forte proportion d’entre elles, ces formes de vie et de consciences pourraient s’avérer très supérieures aux nôtres. Il ressort de tout ceci que le niveau de conscience est, partout dans l’univers, le marqueur principal du niveau de complexité atteint par son substrat matériel, provisoire, par exemple celui du système nerveux et cérébral, dans le cas de l’espèce humaine.
La compression générale, dont la Gravitation universelle est une cause efficiente, et un symbole, peut s’interpréter comme un moyen de conserver ensemble, à l’intérieur d’un monde gravitationnellement clos, un nombre astronomique d’éléments constamment réorganisés et réarrangés, et cela pendant des temporalités immenses. Mais comment expliquer que les combinaisons les plus complexes et, de ce fait, les plus prometteuses pour l’avenir, puissent se conserver, perdurer et continuer d’évoluer dans un monde soumis à tant de forces et à tant de pressions, en dépit de leur rareté et de leur fragilité intrinsèques ? Pour dénoter la ténacité dont font preuve de simples molécules, des cellules et divers organismes, quant à survivre et à subsister, on a proposé les expressions de « gravité de deuxième espèce » et de « gravité de complexité ». Tous les êtres veulent persévérer dans leur être, selon la formule spinozienne. Mais la science moderne vit encore sous le signe trop exclusif de l’entropie, de l’usure et de la désintégration universelle, qui contredit à long terme cette persévérance. Il me semble qu’il serait temps de reconnaître, perpendiculairement à l’immanence de l’entropie, ce courant irrésistible de résistance, de complexification et de conscience croissantes. Ce courant de « complexité-conscienceii » se révèle dans l’espèce humaine par l’augmentation continuelle des capacités neuronales et cognitives, mises en évidence par le cerveau humain, sur les temps longs. Plus généralement, il se retrouve dans toutes les autres formes de conscience supportées par les systèmes nerveux présents dans la Nature, et, par évidente conjecture, dans le Cosmos.
Un jour, toutes ces formes de conscience seront appelées à dialoguer, d’une manière ou d’une autre, et à s’unir contre le néant.
____________________
iCf.P. Teilhard de Chardin. L’Apparition de l’Homme. « Les trois peurs de l’espèce humaine et leur remède ». Ed. du Seuil, Paris, 1956, p. 301
iiJ’emprunte cette expression à Teilhard de Chardin.

L’homme demanda : « Les esprits du ciel s’aiment-ils ? Et comment, s’ils s’aiment, expriment-ils leur amour ? Par le regard seulement ? Par la pensée ? Ou mêlent-ils leurs lumières, leurs rayons ? Partagent-ils leurs rêves en quelques touches, virtuelles ou immédiates ? »
L’ange sourit et répondit : « Contente-toi de savoir que nous sommes heureux, et que sans amour il n’y a point de bonheur. Tous les plaisirs les plus purs que tu goûtes en ton corps comme en ton esprit, nous les goûtons aussi, mais de façon plus éminente, plus absolue. Nous ne trouvons point d’obstacles entre nous, nous n’avons pas de voiles, d’apparences, de secrets, de chair, de membres, de sang, d’ombres. Plus naturellement que l’air avec l’air, plus étroitement que le souffle avec le souffle, plus intimement que le sang emplit le cœur, ou que l’âme plonge en l’âme, quand nous nous embrassons, nous nous unissons, nous nous confondons, et nous fusionnons en nous la lave de tous nos désirsi. »
__________________________
iLibrement inspiré de John Milton. Paradise Lost. VIII, 615-629
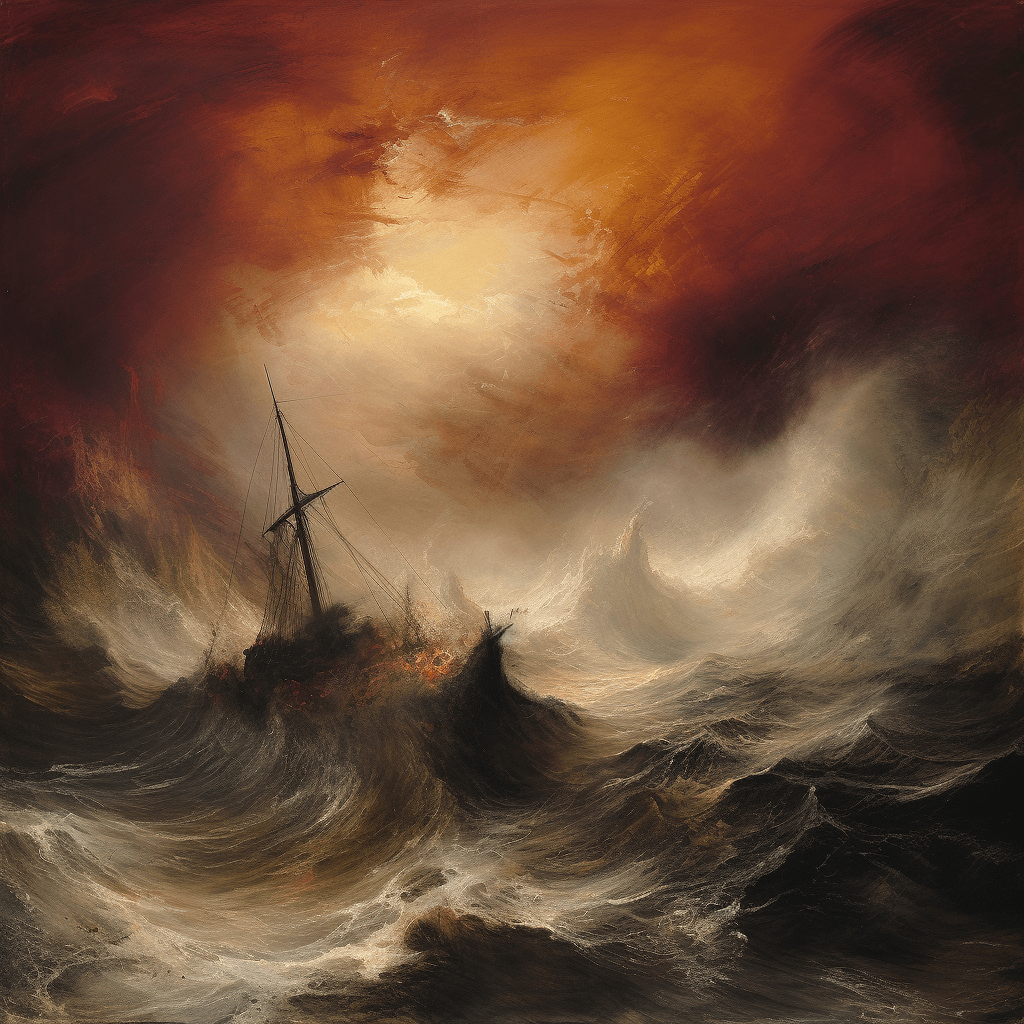
Il n’y a pas de doute : l’ordre international n’offre plus qu’une série de façades vides, c’est un village à la Potemkine. Les institutions démocratiques perdent tous les jours en légitimité. Sur ces sujets, l’hypocrisie des médias règne, ainsi que le déni. Des abîmes politiques se laissent entrevoir, ils ouvrent leurs béances et effraient, à mort. Des slogans vénérables, comme « liberté » ou « égalité , suent maintenant l’équivoque ou le double langage. Quant à la « fraternité », ce mot fièrement affiché au fronton des mairies, elle se noie dans les flots avec les victimes de l’immigration. Ces idéaux républicains sont par trop incompatibles avec l’état du monde, avec la real-politik, avec le cynisme total et l’absence absolue de scrupules qui s’en exsude. Les philosophies contemporaines, quant à elles, s’éparpillent en archipels, ou s’isolent en ghettos clos. Que disent-elles d’intelligible et de pertinent, d’ailleurs, et qui les lit ? Pour qui désire encore croire en quelque idéologie, il y a toujours la possibilité de recourir aux vieilles antiennes du matérialisme (dialectique ou totalitaire) ou aux sirènes de l’idéalisme (platonicien, kantien ou transcendantal), mais il faut l’admettre, c’étaient là des idées pour d’autres temps. Et les temps changent plus vite que les idées, qui leur courent après, essoufflées. Quant aux principales religions, elles ont perdu depuis longtemps le sens de la transcendance qu’elles auraient dû garder comme leur bien le plus précieux. Elles ne se justifient plus que par elles-mêmes, par le conservatisme de leurs dogmes, les intérêts de leurs clergés et l’aveuglement de leurs fidèles. Elles murmurent des phrases usées, elles égrènent sans scrupule des perles de sagesse monotones, enfilées sur le chapelet de leurs reniements. Car le divin les dépasse absolument. Et la transcendance elle-même les laisse loin derrière elle. Elles sont comme ratatinées par l’accélération du devenir. Sans vision politique, sans philosophie et sans transcendance, le monde survit donc tant bien que mal, et plutôt mal que bien. Les peuples plongent dans une sorte d’immanence stupéfiée. On leur intime régulièrement de se fixer sur des « objectifs » et des « moyens » — ceux qui manquent (cruellement), ceux qu’il faudrait obtenir en payant (c’est-à-dire en empruntant, faute de moyens), et aussi tous ceux que l’on aurait bien de la peine à identifier (faute d’une réelle intelligence des fins). Les moyens, toujours les moyens ! Ils sont le nerf de la guerre, et plus encore, de la paix. Quant aux fins, personne n’y croit plus. On ne croit qu’à la peur de la « fin » elle-même, l’armageddonqui dessine ses menaces dans l’obscur. Des signaux faibles et forts décèlent celles-ci, pourtant, et l’on en visualise déjà les prolégomènes : la « crise » climatique bien sûr, et, plus grave, une nouvelle grande extinction des espèces, qui ne serait jamais, après tout, que la sixième depuis la naissance de la vie sur terre. La vie a la vie dure… Il y a surtout cette peur, latente, diffuse, tenace, envahissante, affolante. Mais la peur ne règne pas au sommet, chez les puissants, semble-t-il. Ou alors elle est bien cachée, étouffée par les euphémismes. Pour autant que l’on peut en juger, les politiques, les philosophes et les religieux vivent dans le faux-semblant, et continuent de « persévérer dans leur être », comme si tout était, au fond, gérable, sur la durée. Le mot d’ordre (politique et idéologique) est simple : il ne faut désespérer ni les banlieues, ni les quartiers, ni les campagnes, ni les classes moyennes, ni les riches (qui pourraient s’exiler fiscalement), ni le Nord, ni le Sud. Tout exploserait sinon (politiquement, et partant, socialement). Cela serait mauvais pour l’économie et pour le budget. CQFD.
Donc : Que faire ? Formule célèbre, forgée au 19e siècle par Tchernychevsky, et reprise par Lénine en 1902. Mais aussi formule intemporelle. Faire n’est d’ailleurs peut-être pas le bon mot. Il faudrait plutôt se défaire de toutes les idées fausses, bien que majoritaires (comme le matérialisme, le déterminisme, le positivisme, le scientisme, le réductionnisme). Ayant défait le vieux monde et ses idéologies, il faudrait s’efforcer de « prendre conscience » de la nature essentielle de ce monde, à la fois vieux et neuf, et du rôle que chaque conscience (individuelle) joue dans le Grand Jeu universel. Tout ce qu’on se fait à soi-même, on le fait aussi aux autres, et au monde, et réciproquement, tout ce que l’on fait aux autres et au monde, on se l’inflige à soi-même. Synchronicité et interrelation absolues de tous les points de conscience dans le monde… Il s’agit donc de prendre conscience que nous sommes tous entassés en une petite barque, errant en haute mer, et sans doute déjà en perdition. A moins que ? Les frontières géographiques, historiques, politiques, économiques, religieuse, culturelles, linguistiques, doivent d’urgence être surmontées, en adoptant un point de vue systémique, global, dynamique, spirituel et synchronique. A propos de ce genre d’utopie, le temps des ricanements et des lazzis a passé. L’urgence est maintenant extrême. Un symptôme aigu en est le remplissage de toutes les « salles d’attentes » (zones de guerre, camps de réfugiés, pays faillis, territoires perdus…) dont la surface de la Terre, cet hôpital qui se fout de la charité, se couvre. Tout ce monde divers, pluriel, blessé, affamé, souffrant, agonisant, mourant, attend sans fin et sans espoir, et toujours dans l’urgence. L’enjeu est simplement l’avenir de la vie ici-bas. Un plan de mobilisation mondiale est nécessaire, aujourd’hui même, et devrait s’imprimer sans fil dans toutes les consciences. « Mobilisation » ? Pour une autre guerre encore ? La guerre de qui contre qui ou contre quoi ? Il s’agit d’une mobilisation de tous, les jeunes et les vieux, les malades et les forts, les pauvres et les riches — pour conquérir un nouvel état de conscience. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Chacun, dans l’humanité, devra gagner sa conscience de haute lutte. Quelle sorte de conscience ? Pour quelle fin? Une conscience à la fois singulière et solidaire (un pour tous, tous pour un), pour que l’humanité puisse avoir une chance de survivre. Survivre ? Oui, survivre, tant la « fin » menace, tant l’incendie des idées ravage la surface des vies et le volume des rêves. Il faut absolument survivre, pour pouvoir sur-vivre. Sur-vivre, vivre au-dessus et par-delà la vie même.

L’alternative est simple : La mort est-elle une plongée sans retour dans le néant, ou bien est-elle un passage vers une autre vie ? La mort est-elle une dissolution de l’être, de son identité et de son unité, ou bien n’est-elle que l’occasion d’une métamorphose, d’une transformation en « autre chose » ? Autrement dit : faut-il opter pour le matérialisme ou l’idéalisme ? Dans le premier cas, la mort est un anéantissement, un « devenir rien », dans l’autre, elle est une transition vers un « devenir autre ». En optant pour le matérialisme, on adopte l’idée qu’après la mort l’être individuel cesse en tant que tel, et que l’« unité » qui le caractérisait pendant la vie se décompose in fine en une myriade de particules élémentaires, qui se dispersent dans le monde matériel. En optant pour l’idéalisme, on choisit de croire en la survie de l’être, peut-être sous une forme océanique, ou bien peut-être sous une forme individuelle, c’est là encore une autre question. Aristote ou Hegel, par exemple, ne reconnaissent pas l’immortalité de l’âme individuelle, au contraire de Platon et de Kant qui, quant à eux, l’admettent. Il ne s’agit pas de dire dans le cadre de ce blog laquelle de ces options doit prévaloir. Chacun est absolument libre de penser ce qu’il veut. Personne ne détient la vérité en cette matière. La pensée philosophique est par essence ouverte à la découverte. Elle invite à l’audace et à l’orage (« brainstorming »), à la méditation et à l’émulation. Que mille pensées concurrentes s’éveillent librement en nous ! Philosopher, comme faire son marché, c’est évaluer, peser, soupeser, considérer et choisir. Personne ne peut faire prévaloir a priori quelque opinion que ce soit, quelque dogme total ou quelque certitude assertorique. Tout est toujours en jeu. Et peut-être même que les questions sont plus importantes que les réponses, et que ce sont les doutes et les rêves qui construisent ce monde, et non les caricatures et les ligatures.
Dans l’hypothèse matérialiste, comme dans l’hypothèse idéaliste, la question reste la même : quel est le sens de la mort et quel est celui de la vie ? Et si cette question n’a pas de sens, cette recherche même de sens ne serait-elle donc qu’un non-sens de plus ajouté au non-sens général ? Si la vie est assurément mortelle, si elle est nécessairement finie, s’il n’y a pas de vie immortelle, faut-il voir un « sens » dans le seul fait que la vie soit mortelle, qu’elle a nécessairement une « fin » et qu’elle doit, on peut l’espérer, trouver une sorte de « sens » dans cette « fin » assurée ? Faute de quoi, la vie serait évidemment absurde. Absurde ? Pourquoi pas ? Sartre etc. Mais si l’on se veut « réaliste », tout en récusant l’hydre de l’absurde, il faut bien se contenter de cette « fin » de la vie, qui ne débouche sur aucun « arrière-monde ». La vie alors semble être une fin en soi, et plus particulièrement, une fin pour soi. Dans ce cas de figure (celui du philosophe matérialiste, réaliste et refusant cependant l’absurde et son vertige), l’être mortel doit pouvoir fixer son attention sur la fin qui est immanente à la vie même, accepter la certitude de la mort inévitable, et trouver son bonheur dans une sorte d’accomplissement interne (« carpe diem ! ») selon des perspectives strictement « matérielles », tout en refusant stoïquement de sombrer dans le désespoir qu’impliquerait la tentation de l’absurde en soi.
Mais si, toujours dans l’hypothèse matérialiste, la vie individuelle n’est pas à elle-même sa propre fin, alors elle doit chercher cette fin ailleurs. Dans quoi ? Dans une idéologie ? Mais quel oxymore qu’une idéologie matérialiste ! Dans une solidarité partagée ? Un combat politique ? On peut toujours poursuivre des chimères temporelles, quand on a fermé pour toujours la porte à l’intemporel. Pour le matérialiste le plus endurci, il n’y aurait cependant pas de sens à aller sans fin de l’avant, et choisir comme « fins » des buts ou des idées qui ne seraient pas des « fins en elles-mêmes », mais seulement des « moyens » pour atteindre d’autres « fins » (par exemple la dictature du prolétariat ou l’extinction de la pauvreté), et cela sans jamais pouvoir se fixer véritablement, ni sur ces « moyens », ni sur ces « fins ». Il n’y aurait aucun sens pour le matérialiste à « procéder ainsi à l’infini, de sorte que le désir serait futile et vaini ». Car le manque de « fins » réellement identifiées et enfin assumées, pousserait sans cesse à leur recherche sans fin et finalement « en vain ». L’ontologie matérialiste incite donc à se contenter d’une vie finie, et dont la « fin » se trouve cernée par sa fin. L’ontologie aristotélicienne, qui se veut « réaliste », et qui est intermédiaire entre le matérialisme et l’idéalisme, invite pour sa part à une « recherche nécessairement infinieii ». Mais on peut douter qu’une telle recherche « infinie » ait un sens pour Aristote lui-même, puisque, précisément, elle n’aurait pas de finiii. Sans doute, la langue française permet-elle ici de jouer sur les mots. Il y a fin et fin. La fin n°1 (« ce en vue de quoi ») se dit télos en grec, d’où le mot téléologie (« étude des fins, de la finalité »). La fin n°2 ( la fin comme « terme » ou « aboutissement ») se dit eschaton (τὸ ἔσχατον), d’où le mot eschatologie (« doctrine relative aux fins dernières »). La « fin dernière » est un marqueur temporel. Elle n’est pas en soi un accomplissement, un point d’aboutissement, le couronnement d’une recherche téléologique. Elle signale seulement la fin d’un temps, ou la fin des temps, et peut-être la naissance d’un temps nouveau. Si la fin comme « terme » n’est pas un aboutissement (comme l’incertitude liée au « Jugement dernier » le laisse entendre), à l’inverse, un achèvement, un aboutissement, un accomplissement supposent nécessairement un terme, ou du moins un critère de réussite. Un processus qui serait par essence « infini », et n’ayant donc pas de terme, ne pourrait jamais « aboutir », au sens propre, et en bonne logique (aristotélicienne) : « Rien ne peut être achevé (téléion) s’il n’est terminé : or le terme est limiteiv ». Ce qui donne un sens à la vie, du moins dans l’hypothèse matérialiste, c’est d’atteindre sa « fin » avant son terme. Mais doit-on rester « aristotélicien » jusqu’à la fin ?
Dans l’hypothèse matérialiste, ce n’est certes pas la mort qui est la « fin », mais le fait que la vie a pu parvenir avant sa fin à sa « fin » (laquelle reste bien sûr à définir, dans le cadre du jargon matérialiste). La « fin » est atteinte si l’on peut en dire qu’elle est « accomplie », en tant qu’elle a mis « en acte » toutes ses potentialités, toutes ses virtualités. Quelles potentialités ? Quelles virtualités ? – Celles dont tout être vivant est porteur (ou, du moins, celles dont l’essence de son être est porteuse). Mais quelle pourrait bien être cette « essence », toujours du point de vue matérialiste ? Comment le matérialisme définirait-il l’« essence » d’une vie ? Serait-ce sa « nature » (matérielle) ? Dans l’hypothèse matérialiste, le sens de la vie ne peut certes pas se trouver dans ce qui reste de la vie après la vie (par exemple les « œuvres », dont on sait assez qu’elles sont elles aussi condamnées au néant). Pour le matérialiste, le sens de la vie se trouve, plus probablement, dans l’« agir », dans la production d’actes ayant en eux-mêmes leur propre fin, et qui, ce faisant, permettent l’obtention d’un bonheur passager, seule compensation au non-sens du monde en général, et en particulier au néant final de l’être.
Quant à la thèse idéaliste, ou spiritualiste, que dit-elle ? Elle prône l’immortalité de l’âme. La vie n’a donc pas de terme. Mais on ne peut rien dire de ce qui se cache dans cette absence de terme, dans cette absence de fin, donc. On peut seulement dire que la mort est une sorte d’étape dans un très long voyage, si long qu’il est en réalité « infini ». La question devient : que peut ou que doit faire l’être, qui entreprend un tel voyage, de tout ce temps, de cet infini en acte et en puissance ? Peut-on, par exemple, parler d’un « progrès infini » de l’être toujours en devenir ? Y a-t-il un sens à évoquer l’idée d’une progression vers un but dont on resterait toujours infiniment éloigné ? Ou alors, devrait-on se contenter de considérer simplement le « progrès en tant que tel », en tant que « progrès en soi », en tant qu’idée abstraite d’un progrès relatif, sans cesse remis en cause, et cela pendant une durée infinie ? Mais que signifierait un « progrès » qui ne serait pas un progrès vers quelque chose ? Et que serait réellement cette chose « vers » laquelle il faudrait sans cesse tendre, à l’infini ? Quelle serait l’essence d’une chose vers laquelle on devrait tendre toujours, pendant un temps infini, sans jamais pouvoir l’atteindre, et sans jamais pouvoir la « comprendre » ? Peut-être, d’ailleurs, cette dernière question ne serait-elle seulement que l’une des toutes premières étapes dans la progression qui attend les âmes « idéalistes » après la mort, ou bien même avant celle-ci ?
_______________________
iAristote. Éthique à Nicomaque, I, 1, 1904 a 20-22 (trad. Tricot)
iiSelon la formule de Pierre Aubenque. Le problème de l’être chez Aristote. PUF, 1962, p. 198
iiiSelon l’opinion de Marcel Conche. L’infini de la nature. Œuvres philosophiques. « La mort et la pensée ». Bouquins, 2022, p. 497
ivAristote. Physique, III, 6, 207 a 14 (trad. Carteron), cité par M. Conche, Ibid.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.