
A « Deep Dive » Podcast about my Blog article : « Making God »: Kabbalah, Trance and Theurgy.


A « Deep Dive » Podcast about my Blog article : « Making God »: Kabbalah, Trance and Theurgy.

Podcast translated into English from https://metaxu.org/2024/06/09/du-dieu-yah/

Quatre idées des Écritures célèbrent les ténèbres. 1. Dans les ténèbres se fait le mystèrei. 2. L’Éternel est obscur, il est ténèbresii. 3. La lumière même s’obscurcit par ses ténèbresiii. 4. Mais des ténèbres viennent aussi de l’éclat de sa lumière, et elles sont mêlées de glace et de feuiv.
M’en inspirant, je conçus cette parabole :
Plus elle s’en approchait, plus profonde était l’obscurité, plus épaisses les ténèbres. Plus elle avançait, plus elle défaillait, plus elle s’enfonçait et plus elle perdait le sens. La noire ténèbre incendiait son âme d’une chaleur sombre. Elle ne se sentait pas en danger. Si l’on fixe avec imprudence le soleil du regard, la violence de la lumière brûle la rétine, et vient la cécité, se disait-elle. Mais s’il s’agissait de la brillance concentrée de milliards de soleils, elle devrait tuer instantanément, et sans souffrance, supputait-elle. Une lumière d’une telle intensité désintégrerait instantanément toute vie. Mais en était-on si sûr ? La lumière pouvait-elle anéantir ? Cette opinion était-elle démontrable, du point de vue métaphysique ? D’ailleurs, l’anéantissement absolu était-il seulement concevable par une intelligence rationnelle ? Une brillance exterminatrice excéderait à tel point les capacités de perception que l’imagination elle-même en serait d’emblée aveuglée, ainsi que la raison. Il y avait d’ailleurs une autre piste de réflexion à considérer. Si une très grande lumière tue, quid d’une obscurité excessive ?, songeait-elle. La question méritait examen, au moins en considération de la symétrie apparente de la formulation, et de l’évident contraste entre lumière et obscurité. Qu’advient-il quand on plonge dans l’obscur absolu ? S’y brûle-t-on ? S’y congèle-t-on ? S’y éteint-on? Y meurt-on ? Elle n’en savait rien. Alors elle continuait de progresser, sourde aux angoisses, indifférente aux pressentiments. Les ténèbres, autour d’elle, s’engluaient toujours plus en de denses et abyssaux monceaux de mystère, sous un gouffre de nuées noires. Leurs eaux sombres et leurs amas ténébreux la plongeaient dans une telle stupeur, qu’elle sentit en elle son âme se dissoudre. Y avait-il quelque lumière, si imperceptible qu’elle fût, au tréfonds de son caveau d’ombre ? Non, nulle lueur, nul éclat. La nuit ne faisait jamais que commencer, point d’aube en vue. Mais, peut-être, à la réflexion, lui semblait-il apercevoir quelques éclairs rares, aussitôt éteints, ou des évanescences phosphorescentes ? N’étaient-ce pas là, cependant, de simples hallucinations, des phantasmes rétiniens, qui s’obscurcissaient et se diluaient plus vite qu’ils n’apparaissaient ? Ces semblances de lucioles, ces silencieuses scintillations, s’assombrissaient et s’obombraient bien avant de percer la nuit de leurs sombres fulgurances. À cause de leurs insoutenables et noirâtres rayons, elle avait décidément perdu toute idée du lieu où elle était censée se mouvoir. La lumière de son intelligence s’était, lui semblait-il, lysée, diluée, dans ces ténèbres tenaces. L’attente d’une éventuelle aurore, l’espoir d’une quelconque clarté, étaient exclus. Elle s’efforçait de fermer les yeux, pour grappiller, espérait-elle, quelques phosphènes égarés en ses rétines. Mais en réalité plus rien en elle ne brillait, pas la moindre lueur, ni la plus petite nitescence. L’obscurité qui la cernait de toutes parts était manifestement totale — comme un néant qui exclurait à jamais toute possibilité d’être. Rien ne pouvait plus luire en elle, ni lune, ni étoile, et pas même un photon. N’était-ce pas là contradictoire ? Toutes ses théories sur le sombre s’écroulaient. Il lui fallait peut-être faire d’autres hypothèses, changer de paradigme ? Bien que sa nuit fût si abyssale qu’elle en devenait invisible, pouvait-on tenter d’en soupçonner l’origine, d’en déterminer la cause ? Des monceaux cachés de lumières éclatantes, d’une surnaturelle brillance, avaient peut-être provoqué dans un temps ancien la cécité radicale qui l’aveuglait ? Une personne ayant su aller aussi loin qu’elle vers le fond de l’obscur, était-elle aussi capable d’entrer par effraction dans la lumière, pour la mesurer à l’aune de la conscience ? Une lumière qui reste ostentatoirement cachée au milieu de l’obscurité peut sans doute aisément surpasser toute vue et toute connaissance. Pour l’heure, délivrée du monde sensible et de la vanité des poursuites intellectuelles, son âme s’ébattait visiblement dans le règne de l’opacité et de l’ignorance. Renonçant à toute certitude, elle s’abîmait en toutes sortes de voies inutiles, s’éparpillant dans un vaste espace, fait de déserts et d’ombres. Perdue, sans pouvoir s’appartenir à nouveau, en son extrême confusion, elle restait pourtant unie à un idéal inconnu par son désir resté latent, par son attente, et par son renoncement à toute volonté personnelle. Puisant dans sa solitude une forme de connaissance que son intelligence n’avait pas préméditée, elle ambitionnait d’entrer plus avant dans cette obscurité désillusionnée, elle voulait voir et connaître mieux la nuit encore, pour évaluer son aveuglement. Peut-être espérait-elle apercevoir l’ombre furtive de ce qui, par sa nature, échappe à toute contemplation et à toute connaissance ? Depuis longtemps, elle n’avait jamais cessé de vouloir voir et de vouloir connaître, en dépit de l’insuccès de ses plongées nocturnes. Elle avait une soif ardente de se convaincre que, dans l’obscur, il n’est rien qui ne puisse à la fin subsister, de tout ce qui existe. Refusant par avance toute fatalité, elle se disait que les ténèbres finissent toujours par se dissiper devant quelque autre lumière à venir, devant sa seule surabondance. L’ignorance la plus crasse et une inconnaissance presque totale peuvent toujours être corrigées, en partie, par des connaissances nouvellement acquises, qui ajoutent leurs lumières aux lueurs anciennes. Mais il n’en est pas ainsi si l’ignorance initiale est absolue, si cette ignorance n’est point simplement une certaine privation de connaissance, si elle implique une séparation radicale entre la conscience et ce dont il lui faudrait avoir conscience, mais qu’elle ignore absolument. L’absence de toute lueur de conscience est-elle seulement aperçue de ceux qui en sont privés ? L’ignorance de l’essence divine est-elle ou non compatible avec la connaissance des créatures ? De sublimes ténèbres qui seraient inaccessibles à toute lumière, irréductibles à toute clarté, mèneraient-elles de ce fait à une impasse totale, à un cul-de-sac métaphysique ? Si, observant quelque représentation de l’infini, soit obscure soit lumineuse, on pouvait comprendre que l’on n’en verrait jamais que l’un de ses premiers moments, ou quelques-unes, peut-être, de ses conditions initiales, ou encore les prémisses de son âge, n’aurait-on pas, par là même, et paradoxalement, commencé à en percevoir l’ironique essence ? On en saisirait quelques éléments, quelques traces, par l’intelligence, et ce serait assez, semblerait-il, pour aller beaucoup plus loin. De même, la lumière : on capture quelques-uns de ses photons, et ils viennent s’immiscer en notre cortex, en notre nature, en notre esprit. Réciproquement, notre nature se lie en permanence à la lumière, ainsi que notre esprit. L’infini, la lumière, et le divin lui-même, au-delà de toute compréhension, échappant à toute saisie, existent certainement d’une façon transcendante, et même sur-éminente, mais ils ne laissent pas aussi de s’« intriquer », obscurément, avec constance — tout comme les trous noirs primordiaux laissent s’évaporer leur énergie. Il y a là une leçon générale. L’obscurité et la lumière sont par essence « intriquées ». Cette leçon s’applique aussi à l’humain et au divin.
__________________________
i« Il a fait des ténèbres son mystère, sa tente autour de lui, une ténèbre d’eaux, une nuée de nuages. » Ps 18,12
ii« N’est-il pas ténèbres, le jour d’Adonaï, et non lumière ? Il est obscur et sans éclat ! » Amos 5, 20
iii« La lumière s’est obscurcie par ses ténèbres. » (Is 5,30)
iv« De l’éclat devant lui, ses nuées avancent, grêle et braises de feu. » Ps 18,13

Un très étrange épisode du Livre des Rois narre l’« ascension » du prophète Élie, en présence de son disciple, le prophète Élisée. Ce qui est étrange, c’est qu’Élisée « voit » l’ascension d’ Élie, mais sans vraiment la voir, ou plutôt sans y croire tout à fait. Élisée « sait » qu’Élie s’« élève », mais il ne veut pas vraiment le reconnaître, il recule le moment où il lui faudra accepter la réalité de cette ascension qu’il refuse de laisser s’accomplir, et dont il est le témoin bien malgré lui. Même les prophètes peuvent, en toute bonne foi, ignorer la véritable nature des phénomènes dont ils sont les témoins. Ils peuvent aussi se tromper eux-mêmes. Ils peuvent d’ailleurs être récompensés, malgré tout, de leur sorte d’« aveuglement », pourvu qu’ils soient capables de s’en détacher, étape par étape. Un commentaire plus détaillé, à partir du texte lui-même, donnera, je l’espère, une idée de quoi il retourne.
« Quand YHVH fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie et Élisée quittaient Gilgali. »
Le nom de cette ville, située entre Jéricho et le Jourdainii, Gilgal, a pour racine גָּלַל, galal, « être rond, tourner, rouler ». Le mot gilgal signifie « cercle de pierreiii », et fait référence aux douze pierres que Josué fit ériger à Gilgal, après son passage du Jourdain avec le peuple et l’arche de l’allianceiv. Mais, selon le dictionnaire, ce mot peut signifier aussi « roue » ou encore « tourbillonv ». Il y a donc dans cette phrase deux mots qui évoquent l’idée de « tourbillon ». Le « tourbillon » associé métaphoriquement à Gilgal, et le véritable « tourbillon » qui enlève Élie au ciel, et qui se dit avec un autre mot : סְעָרָה, sé‘arah, « tempête, tourbillonvi », lequel connote un effet bien plus « tempétueux » que circulaire. Selon le texte, donc, Élie « monte au ciel » dans un « tourbillon », au moment précis où il quitte Gilgal (« tourbillon »), en compagnie d’Élisée. Élie dit alors à Élisée de rester à Gilgal, pour pouvoir librement continuer de monter au ciel, sans témoin. Mais Élisée refuse : « ‘Par le Dieu vivant (ḥay Adonaï [YHVH]) et par ton âme vivante, je ne te quitterai pas’. Et ils se rendirent ensemble à Béthelvii. » La situation est la suivante : Élie a commencé son ascension, mais ne peut pas l’accomplir tant qu’ Élisée refuse de le quitter. Sur le chemin menant à Béthel [« la maison de Dieu »], des « fils de prophètes » [bnéï ha-nébiim], établis dans cette ville, « sortirent à la rencontre d’Éliséeviii ». Élie n’est pas cité dans le texte. Élisée est donc, apparemment, resté seul sur la terre, pendant qu’Élie, devenu invisible, est déjà partiellement monté au ciel. Les « fils de prophètes » s’adressèrent à Élisée : « ‘Sais-tu qu’aujourd’hui Adonaï [YHVH] va emporter ton maître [Adonéï-khaix] par-dessus ta tête [מֵעַל רֹאשֶׁךָ] ?’ Il répondit: ‘Oui, je le sais, faites silence !x’. » Les « fils de prophètes », qui n’ont pas vu qu’ Élie a déjà commencé sa montée au ciel, annoncent à Élisée ce qu’il sait déjà. Celui-ci leur intime le silence. Pourquoi ? Parce qu’il veut continuer le dialogue avec son maître, Élie. Le silence rétabli, la voix d’ Élie lui parvient et lui demande de rester à Béthel, pendant que lui, Élie, ira à Jéricho. Mais Élisée refuse pour la deuxième fois: « Par le Dieu vivant et par ton âme vivante, je ne te quitterai pasxi ». Les deux prophètes allèrent donc ensemble à Jéricho, Élie volant dans les airs, et Élisée marchant sur la route. D’autres « fils de prophètes » demeurant à Jéricho « s’approchèrent d’Éliséexii », et lui dirent : « Sais-tu qu’aujourd’hui Adonaï va emporter ton maître, par-dessus ta tête ? » Il leur répondit de la même façon : « Oui, je le sais, faites silence !xiii. » Le silence revenu, Élie demanda une troisième fois à Élisée de le laisser seul, et de rester à Jéricho, en alléguant du fait que Dieu voulait l’envoyer vers le Jourdain. Mais Élisée répéta : « Par le Dieu vivant et par ton âme vivante, je ne te quitterai pasxiv ». Et ils continuèrent leur route ensemble. Arrivés au Jourdain, Élie sépara les eaux en les frappant de son manteau, et ils traversèrent à pied sec. Après qu’ils eurent passé, Élie, de plus en plus impatient de le quitter, s’adressa à Élisée: « Demande : Que puis-je faire pour toi avant d’être enlevé d’auprès de toi ? ». Élisée répondit : « Que me revienne une double part de ton esprit ! ». Élie reprit : « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d’auprès de toi, cela arrivera, sinon cela n’arrivera pasxv. » Alors qu’ils conversaient, « voici qu’un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux, et Élie monta au ciel dans le tourbillonxvi. » Élisée « voyait » Élie monter dans le char, puis « il ne le vit plus ». Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Ramassant alors le manteau d’Élie « qui avait glisséxvii », il en frappa les eaux du Jourdain, tout en disant : « Où est YHVH, le Dieu d’Éliexviii ? » Sans attendre de réponse, il continua de frapper les eaux, qui se divisèrent d’un côté et de l’autre, comme déjà elles l’avaient fait une première fois avec Élie, mais aussi, bien avant, lors du passage du Jourdain par Josué avec le peuple et l’arche d’alliance. Alors Élisée retraversa le Jourdain, et revint sur la rive occidentale. Les « fils de prophètes » qui observaient la scène à distance dirent alors : « L’esprit [ruaḥ] d’Élie est sur Éliséexix ».
Toute cette scène, complexe, ne se comprend que si l’on admet que l’ascension d’Élie a commencé dès Gilgal et qu’elle ne s’est réalisée définitivement que lorsque les deux prophètes furent arrivés de l’autre côté du Jourdain. Pendant tout ce temps, Élie était devenu invisible à tous « les fils de prophètes ». Seul Élisée était en mesure de continuer de dialoguer avec lui, en imposant le « silence » à ceux qu’ils croisaient en chemin. Pourquoi cet acharnement d’Élisée à ne pas vouloir quitter Élie ? Pour deux raisons essentielles. D’abord, il voulait obtenir « une double part » de l’esprit d’Élie. Et l’ayant obtenue, il voulut alors savoir « où était YHVH, le Dieu d’Élie ». La réponse était peut-être, pour lui, dans le vide que firent les eaux qui se séparaient, ou bien dans le fait d’avoir été exaucé : l’esprit d’Élie était désormais sur lui — et cette fois, visible par tous.
_______________________
i2 Rois 2, 1
iiCette ville, nommée Gilgal, est différente de la ville nommée également Gilgal qui est citée dans Jos. 4, 19-20 : « Le peuple remonta du Jourdain et campa à Gilgal, à la limite est de Jéricho. Quant à ces douze pierres qu’ils avaient prises dans le Jourdain, Josué les érigea à Gilgal. »
iiiGilgal est un ancien lieu de culte, devenu le sanctuaire principal de la tribu de Benjamin. On y rattachait le souvenir de la circoncision et de la première Pâque en Canaan. Cf. La Bible de Jérusalem, Jos 4, 19, note b, p. 254.
iv« Quand demain, vos fils vous demanderont : ‘Ces pierres, que sont-elles pour vous ?’, alors vous leur direz : ‘C’est que les eaux du Jourdain se sont séparées devant l’arche d’alliance de YHVH. Ces pierres sont un mémorial pour les Israélites, pour toujours !’ » Jos. 4, 6-7
v« La voix de ton tonnerre dans le tourbillon (gilgal) » (Ps. 77, 19); « On les appelait tourbillon (gilgal) » (Ez. 10,13) ; « Mon Dieu, rends-les semblables à un tourbillon (gilgal) » (Ps 83,14) ; « Comme un tourbillon (gilgal) devant une tempête » (Is. 17,13)
viCe mot a pour racine,סָעַר, qui signifie : « être violemment agité [par la tempête], mugir », et peut se dire de la mer mais aussi des hommes.
vii2 Rois 2, 2
viii2 Rois 2, 3
ixאֲדֹנֶיךָ
x2 Rois 2, 3
xi2 Rois 2, 4
xii 2 Rois 2, 5
xiii2 Rois 2, 5
xiv2 Rois 2, 6
xv2 Rois 2, 9-10
xvi2 Rois 2, 11
xvii2 Rois 2, 13
xviii2 Rois 2, 14. אַיֵּה יְהוָה אֱלֹהֵי אֵלִיָּהוּ . Ayyeh Adonaï Elohéï Eliyahou ?
xix2 Rois 2, 15 רוּחַ אֵלִיָּהוּ עַל-אֱלִישָׁע. Ruaḥ Eliyahou ‘al-Elicha‘

En quoi mon âme se distingue-t-elle de ton âme, ou de n’importe quelle autre ? En quoi se différencie-t-elle de l’Esprit même ? Comment se fait-il que l’âme d’Héraclite, de Socrate, ou d’Aristote soient toutes si différentes, et qu’elles nous semblent peu capables de jamais trouver un terrain commun, et moins encore de « s’unifier » en esprit ? Si, par quelque prodige improbable, elles avaient pu devenir réellement « unes », durant leur vie ou après la mort, ces âmes de philosophes n’auraient-elles pas naturellement su aussi ce que les âmes de tous les philosophes, de par le monde et à travers les temps, pensent vraiment, dans l’intime du cœur, et n’en auraient-elles pas fait leur miel, pour nous le faire ensuite goûter ? Mais cela ne s’est pas passé ainsi. Peut-être cela ne se passera-t-il jamais ainsi. Peut-être que les âmes des philosophes ne sont pas destinées, par essence, à s’unir ? Pourquoi, en effet, ceux-ci n’ont-ils pas, d’emblée, appréhendé clairement tout ce qui est à comprendre, et pourquoi ne se sont-ils pas laissés aller à seulement « croire » tout ce qui reste à croire ? Si l’Esprit est « un », pourquoi les esprits des philosophes ne saisissent-ils pas plus aisément toutes les choses intelligibles, pourquoi ne les conçoivent-ils pas dans leur intégralité et dans leur diversité, à l’image de ce dont sont capables, par exemple, les intelligences « angéliques », dont le Zohar nous énumère en détail les noms, les qualités et les puissances ? En d’autres termes, pourquoi les capacités intellectuelles des philosophes sont-elles si limitées, face à l’enjeu de l’infinité de ce qui reste à comprendre ? Pourquoi, même à l’apex de leur carrière, la confusion ou l’oubli peuvent-ils affecter sensiblement le fonctionnement du cerveau des philosophes les plus habiles ? Pourquoi ont-ils besoin de réfléchir toujours si longtemps sur des « concepts », qu’ils veulent originaux, et qu’ils sont si fiers d’exhiber comme des trophées de chasse ? Pourquoi éprouvent-ils le besoin de les détailler, de les disséquer, partie par partie, de les approfondir, de les combiner et de les décliner, plutôt que de les laisser briller immédiatement dans la pleine lumière de leur évidence ? Pourquoi, malgré la force (supposée) de leur intellect, les philosophes perdent-ils si souvent conscience d’eux-mêmes, lorsqu’ils s’endorment, s’enivrent, ou délirent ? Ou bien, lorsqu’ils vieillissent, ramollissent et décrépissent ? Leurs concepts ne sont-ils donc pas si éthérés, si intangibles, si détachés du monde ? Le plus savant des philosophes serait-il, par quelque droit divin dont il disposerait, exempt à jamais de toute forme de démence, ou des effets délétères de maladies neurodégénératives, oubliant alors tout ou partie de ses savoirs, de ses « concepts » et de ses « idées » ? Atteint en son esprit même, le philosophe est-il encore la même personne ? Ou bien est-il devenu un autre que lui-même, et un autre pour lui-même ? Devient-il alors une autre personne, ou bien s’enfonce-t-il lentement vers un néant que sa disparition putative rendra « réel »? Supposons que, par le progrès des recherches en neurosciences, tel philosophe, par exemple atteint d’une maladie à corps de Léwy, puisse progressivement guérir de sa maladie, et qu’il se remette à « philosopher ». Supposons encore que, profondément affecté, et continuant naturellement de vieillir, quoique en meilleure santé, il ne puisse cependant pas récupérer intégralement ses capacités d’autrefois ? Devra-t-on alors considérer en lui la superposition de deux âmes distinctes, celle qu’il incarnait dans la brillance de sa jeunesse, et la nouvelle, dont il illustre aujourd’hui, bien contre son gré, la fatigue de n’être plus qu’une sorte d’ombre pâlie de ce que son autre âme était jadis, et ne pourra plus jamais être ? L’esprit du philosophe est-il donc comme un réceptacle que l’on peut emplir tout à loisir, années après années, de principes et de concepts, de formules et de raisons, de vues et d’intuitions, et qui, après un temps, vers la fin de la vie, se viderait, insidieusement et lentement, ou bien brusquement et à gros bouillons ? Quelle est l’étendue des connaissances que l’âme du philosophe devrait recevoir en elle-même pour espérer devenir réellement immatérielle, éternelle, impérissable ? Lui faut-il acquérir la science et l’intelligence de tout ce qui existe ? Ou bien pénétrer l’essence de toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre ? Mais n’est-ce pas là, à l’évidence, un songe vain, un rêve fou, un but inaccessible ? Alors peut-on quand même espérer que l’âme du philosophe acquière malgré tout un soupçon d’immatérialité et d’immortalité, après avoir pu se pénétrer des dix catégoriesi d’Aristote, ou des principes élevésii qui sont au-dessus de celles-ci, et dont on peut raisonnablement penser que tous les êtres sont subsumés sous eux ? Mais ce serait là un peu trop facile, ne pensez-vous pas ? Étudiez Aristote et Avicenne, et vous voici rendu pour toujours au paradis éternel de l’esprit? Admettons même que cette âme puisse maîtriser à fond ces catégories et ces principes, mais quid de la connaissance des singuliers ? Où les découvrira-t-elle ? Et si elle ne sait rien des singuliers, que sait-elle vraiment d’elle-même ? Si elle ne sait rien d’elle-même, faudra-t-il en conclure qu’à la fin, « selon la théorie des philosophes, l’homme périt et disparaîtiii » ? Les philosophes nous bernent-ils donc en toute bonne conscience de leurs assertions assertoriques, et se leurrent-ils aussi eux-mêmes, ce faisant ? Nombreuses sont les choses dans la nature qu’il ne nous est pas donné de connaître. Cela ne nous empêche pas de chercher. Peut-être que, d’aventure, il nous sera donné à l’improviste des fragments de connaissance, des étincelles éparses, des lueurs de savoir, dont même les prophètes semblent parfois dénués. Un jour, sur le chemin de Béthel à Jéricho, des « fils de prophètes » s’adressèrent à Élisée, dont ils ne voyaient pas qu’Élie l’accompagnait en volant : « ‘Sais-tu qu’aujourd’hui Adonaï [YHVH] va emporter ton maître [Adonéï-khaiv], par-dessus ta tête ?’ Il répondit: ‘Oui, je le sais, faites silencev’. » Élisée disait qu’il le « savait », mais voyait-il vraiment ce qu’il savait ou ce qu’il croyait savoir ? Et savait-il vraiment ce qu’il voyait, ou ce qu’il croyait voir ? Non, sans doute pas. Aussi réclama-t-il le silence, à deux reprises.
__________________________
iLa substance, la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps, la position, la possession, l’action, la passion.
iiL’existence, la puissance, l’acte, le principe, la cause, la substance, l’accident, le genre, l’espèce, la similitude, l’opposé, l’unité, la pluralité, l’accord, la différence.
iiiJuda Hallévi. Le Kuzari. Livre V. Trad. Charles Touati. Verdier, 1994, p. 215
ivאֲדֹנֶיךָ
v2 Rois 2, 3

Lekha doumiah tehillah Elohimi. « Pour toi le silence est louange, Élohimii », selon ma traduction mot-à-mot. Mais si le psalmiste recommande le « silence », les nombreux commentateurs de ce verset, en revanche, furent plutôt bavards, et, fort prolixes, ils rivalisèrent d’interprétations divergentes. Est-ce d’ailleurs de « silence » dont il s’agit ici ? Selon la traduction de la Bible de Jérusalem, il faut lire : « À toi la louange est due, ô Dieuiii ». Il y est précisé, en note, que d’autres versions encore existent, s’expliquant par une « simple différence de vocalisation ». Certaines traduisent en effet le mot doumiah par « silence », ce qui donne la traduction alternative : « À toi le silence est la louange, ô Dieu ». Dans la version hébraïque de référence que propose la Biblia Hebraica Stuttgartensia, il est noté que le mot דֻמִיָּה, doumiah, présent au début de ce verset, a été traduit par les soixante-dix rabbins de la Septante par le verbe grec πρέπει, « il convient », ce qui donnerait en français : « À toi la louange convient, ô Dieu ». La Septante traduit en effet ce verset par « σοὶ πρέπει ὓμνος ὁ θεός » (« à toi convient l’hymne, ô Dieu »), l’hymne désignant le chant sacré, ce qui, il faut bien le dire, inverse complètement le sens du verset. Là où les uns disent « silence », les autres comprennent « chant sacré ». Heureusement, on peut faire appel aux lumières du célèbre Maïmonide, qui évoque aussi ce verset dans un chapitre du Guide des égarés traitant des attributs négatifs de Dieu : « Les intelligences ne sauraient percevoir Dieu, lui seul perçoit ce qu’il est, et le percevoir, c’est [reconnaître] qu’on est impuissant de le percevoir complètement. Tous les philosophes disent Nous sommes éblouis par sa beauté et il sé dérobe à nous par la force même de sa manifestation, de même que le soleil se dérobe aux yeux, trop faibles pour le percevoir […] mais ce qui a été dit de plus éloquent à cet égard, ce sont les paroles du psalmiste : lekha doumiah tehillah (Ps 65,2) dont le sens est ‘pour toi, le silence est la louange’. C’est là une très éloquente expression sur ce sujet ; car, quoi que ce soit que nous disions dans le but d’exalter et de glorifier (Dieu), nous y trouverons quelque chose d’offensant à l’égard de Dieu, et nous y verrons (exprimée) une certaine imperfection. Il vaut donc mieux se taire et se borner aux perceptions de l’intelligence, comme l’ont recommandé les hommes parfaits, en disant : ‘Parlez en votre cœur, sur votre couche, faites silence’ (Ps 4,5)iv. »
Cette position fort claire de Maïmonide n’a pas échappé à Maître Eckhart, lui aussi frappé par le caractère énigmatique de ce verset. Dans un commentaire sur le « silence » compris comme une condition de possibilité de la « naissance de Dieu dans l’âme », Maître Eckhart écrit : « La Sagesse vient dans l’esprit quand l’âme se repose du tumulte des passions et de l’occupation causée par les choses du monde, quand toutes ces choses-là font silence, et que celle-ci fait silence à toutes. » Il s’appuie ensuite rhétoriquement sur Augustin : « Si pour une âme, le tumulte de la chair faisait silence, si les délires de la terre faisaient silence […] et ceux du ciel, que cette âme soit silencieuse à elle-même, et qu’elle se dépasse sans penser à elle, si se taisaient les songes et les révélations imaginaires […] et que Lui seul parle […] de lui-même afin que nous entendions sa parolev ». Reprenant sa démonstration, maître Eckhart élargit la nécessité du « silence » aux offices mêmes de l’Église. Silence certes ponctuel, mais silence essentiel. « Il faut savoir que, durant l’Office, l’Église se tient elle aussi exactement comme cela : Pendant que toutes choses se tenaient au milieu d’un silence paisiblevi. On doit comprendre en effet que, dans l’avènement du Fils dans l’esprit, il faut que tout milieu fasse silence. La nature d’un milieu intermédiaire est en effet incompatible avec l’union, que l’âme désire, avec Dieu et en Dieuvii. » Peu après Maître Eckhart cite Maïmonide en appui de sa thèse, laquelle, je le souligne au passage, invalide tant la traduction de la Vulgate que celle de la Septante. « Dans l’être et la compréhension intellectuelle, tout milieu se retire et fait silence. Ceci concorde avec ce passage du Psaume (65,2) : La louange silencieuse est pour Toi, Dieu, d’après la version du texte reçue par Maïmonide, là où nous avons : L’hymne T’est dû, ô Dieu.viii » Ce parti-pris en faveur de Maïmonide, contre les traductions habituelles, s’explique sans doute par le fait que la notion de « silence » occupe une position spéciale dans la pensée de Maître Eckhart. On s’en fait une idée nette en lisant le sermonix qu’il a consacré à un passage du Livre de la Sagesse : « Lorsque toutes choses se tenaient au milieu du silence, alors est descendue d’en haut, du trône royal, et est venue en moi une parole secrètex ». Cet article, on le devine, cherche à mettre en évidence la richesse intrinsèque liée aux difficultés de la traduction, et aux ouvertures qu’elle permet… Il se trouve que, dans une autre traduction du passage que l’on vient juste de citer, on ne trouve ni l’expression « au milieu du silence » ni l’expression « parole secrète », mais respectivement, « un silence paisible » et une « parole toute-puissante, inexorable », jouant un rôle dans « l’extermination » de la terre : « Alors qu’un silence paisible enveloppait toutes choses et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux, ta Parole toute-puissante s’élança du trône royal, guerrier inexorable, au milieu d’une terre vouée à l’exterminationxi. » Tout comme le « silence », l’idée du « secret » joue aussi un rôle important chez Maître Eckhart. Il développe par exemple le thème de la naissance du Verbe divin dans l’âme, lorsque celle-ci se tient « une » dans « le plus secret » de son « intérieur », et en silence. « Il faut donc qu’un silence s’installe [dans le fond de l’âme], une tranquillité, et là, le Père doit s’exprimerxii. » Il faut savoir que « le meilleur, le plus noble auquel un homme puisse parvenir dans cette vie, est : tu dois faire silence et laisse Dieu opérer et parlerxiii. » Eckhart fait, dans ce contexte, référence à un passage du Pseudo-Denys l’Aréopagite traitant de la nature profonde de la Ténèbre divine, et de la lumière que l’on peut y trouver : « C’est dans le Silence en effet qu’on apprend les secrets de cette Ténèbre dont c’est trop peu dire que d’affirmer qu’elle brille de la plus éclatante lumière au sein de la plus noire obscurité, et que, tout en demeurant elle-même parfaitement intangible et parfaitement invisible, elle emplit de splendeurs plus belles que la beauté les intelligences qui savent fermer les yeuxxiv. » Partant de cet éloge de l’inconnaissance absolue, et s’adressant directement à son disciple Timothée, le Pseudo-Denys lui fait ces pressantes recommandations : « Exerce-toi sans cesse aux contemplations mystiques, abandonne les sensations, renonce aux opérations intellectuelles, rejette tout ce qui appartient au sensible et à l’intelligible, dépouille-toi totalement du non-être et de l’être, et élève-toi ainsi, autant que tu le peux jusqu’à t’unir dans l’ignorance avec Celui qui est au-delà de toute essence et de tout savoir. Car c’est en sortant de tout et de toi-même, de façon irrésistible et parfaite que tu t’élèveras dans une pure extase jusqu’au rayon ténébreux de la divine Suressence, ayant tout abandonné et t’étant dépouillé de toutxv. »
J’aime l’idée d’une « pure extase », visant à atteindre le « rayon de Ténèbre » qu’est la Suressence. Partant du « silence », on arrive à la Ténèbre, et à sa lumière.
_____________________________
iלְךָ דֻמִיָּה תְהִלָּה אֱלֹהִים (Ps 65,2)
iiMa traduction de לְךָ דֻמִיָּה תְהִלָּה אֱלֹהִים (Ps 65,2)
iiiPs 65 (64), 2
ivMaïmonide. Le Guide des égarés. Livre I, §59. Trad. de l’arabe par Salomon Munk. Verdier, p. 139
vAugustin. Confessions, Livre IX, cité par Maître Eckhart, Commentaire du Livre de la Sagesse, Ch. 18, §280. Trad. Jean-Claude Lagarrigue et Jean Devriendt. Les Belles Lettres, 2015, p.258
viIntroït de la messe dominicale de l’Octave de Noël.
viiMaître Eckhart, Commentaire du Livre de la Sagesse, Ch. 18, §284. Trad. Jean-Claude Lagarrigue et Jean Devriendt. Les Belles Lettres, 2015, p.260
viiiMaître Eckhart, Commentaire du Livre de la Sagesse, Ch. 18, §285. Trad. Jean-Claude Lagarrigue et Jean Devriendt. Les Belles Lettres, 2015, p.261
ixSermon 101. Meister Eckhart, Die deutschen Werke, 4,1 : Predigten 87-105, Stuttgart, Kohlhammer, 2005, p.334-367
xSg 18,14-15. La traduction française est celle donnée dans Maître Eckhart, Sermons, Traités, Poème. Les Écrits allemands. Traduction Jeanne Ancelet-Hustache et Eric Mangin, Seuil, 2015, p.95
xiSg 18,14-15. Bible de Jérusalem. Cerf, 1996
xiiMaître Eckhart, Sermons, Traités, Poème. Les Écrits allemands. Traduction Jeanne Ancelet-Hustache et Eric Mangin, Seuil, 2015, p.100
xiiiIbid. p.101
xivPseudo-Denys l’Aréopagite. La Théologie mystique. Ch. 1. In Œuvres complètes, Trad. Maurice de Gandillac, Aubier, 1943, p. 177
xvPseudo-Denys l’Aréopagite. La Théologie mystique. In Œuvres complètes, Trad. Maurice de Gandillac, Aubier, 1943, p. 177-178

Toutes les religions se ressemblent au moins sur ce point : leurs rites obéissent à des règles qui n’ont aucun sens. Ce qui importe dans un rituel, c’est ce que l’on fait – et non pas ce que l’on pense, ce que l’on croit ou ce que l’on dit. Le rituel n’a pas de sens intrinsèque, il ne possède en soi ni but ni finalité. Il est à lui-même son propre but. « Dans l’activité rituelle, les règles comptent, mais pas le résultat. Dans une activité ordinaire, c’est le contrairei. » Prenons par exemple, le rituel juif de « la vache rousseii », qui surprenait Salomon lui-même, et qui était, déjà à son époque, considéré comme l’exemple classique d’un commandement divin pour lequel aucune explication ne pouvait être donnée. Il n’est pas inutile d’ailleurs de s’interroger sur le caractère tatillon et quasi obsessionnel de l’Éternel, c’est-à-dire de YHVH, prescrivant lui-même ce rite de consomption de la vache, et prenant la peine d’en détailler les modalités, avec notamment l’obligation faite de brûler la peau, la chair et le sang de la vache rousse « avec sa fiente ». On imagine qu’il fallait nourrir la vache rousse pendant fort longtemps afin d’accumuler assez de fumier pour enfin la consumer sur l’autel avec les flammes produites par ses seules bouses accumulées. Pas très pratique, dans l’urgence. Mais surtout, quel sens donner à tout cela ? Les rabbins qui commentèrent ultérieurement ce « décret de la loi » [ חֻקַּת הַתּוֹרָה , ḥouqqath ha-Thorah, littéralement « ce qui est écrit, gravé, dans la Thorah »] étaient parfaitement conscients de la difficulté et même de l’impossibilité d’en donner quelque explication. Le célèbre Rachi lui-même reconnaît que « Satan et les autres nations se moquent d’Israël en disant : ‘qu’est-ce que ce commandement et quel en est le motif ?’, c’est pour cela qu’il est écrit חֻקַּת , c’est un décret émanant de Moi que tu n’as pas le droit de critiqueriii. » On n’a pas le droit de critiquer le rite même si l’on n’en comprend pas la significationiv. Il est aussi intéressant de comparer ce rite juif mortifère (pour la vache) au respect quasi divin accordé aux vaches (sacrées) dans le cadre de la religion hindoue. Pourquoi, d’un point de vue anthropologique, une opposition aussi nette, aussi radicale, de ces deux religions dans leur rapport à la « vache » ?
Du point de vue anthropologique, qui est celui que j’adopte dans cet article, les rites semblent cependant chargés d’un langage et d’une symbolique propres, mais ce langage et cette symbolique ne véhiculent pourtant pas de sens, à proprement parler. Ils sont essentiellement inexplicables. On pourrait oser une explication minimaliste. Les rites offrent seulement une « structure » permettant de mémoriser et d’enchaîner un certain nombre d’actions imposées pour une raison et une finalité dont on ignore tout, et que l’on n’a pas le droit d’interroger, et encore moins de critiquer. Il peut être intéressant de remarquer que, tout à fait en dehors du cadre humain, les animaux eux-mêmes ont aussi des sortes de « rituels », comme celui de l’« aspersion ». Ce qui est certain, c’est que l’existence des rituels (humains ou animaux) remonte à la nuit des temps, bien avant l’apparition de langages structurés, et a fortiori, de la syntaxe et de la grammaire. De là, l’idée que l’existence même de la syntaxe, l’idée même de structure du langage pourrait avoir originairement émergé de la répétition de rites, d’emblée structurés comme des proto-langages… De cette observation, on pourrait aussi induire que l’absence patente de sens des rites voit son corollaire dans l’absence de sens quant à la raison de telle ou telle règle de syntaxe. La contingence radicale des rites s’est propagée, depuis l’aube de l’humanité, et a envahi l’ensemble des structures associées aux divers langages, ce qui pourrait expliquer aussi leur diversité, et leurs éventuelles et intraduisibles spécificités.
Si le rite juif du sacrifice de la « vache rousse » semble dépourvu de toute explication, nombre des rites associés au Véda semblent en être tout autant dépourvus. L’extrême ritualisation du Yajurveda et du Samaveda est en soi remarquable, et offre des séries innombrables de prescriptions à respecter scrupuleusement, sous peine d’annuler totalement les effets du rite sacrificiel. Dans les chants du Samaveda, par exemple, on trouve une grande variété de sons qui n’ont apparemment aucun sens, aucune signification sémantique, comme de longues répétitions de O, avec leurs modulations prolongées, et se terminant parfois par des M, censées sans doute évoquer la mantra ‘OM’. On peut bien sûr imaginer que ces pures sonorités ne sont pas essentiellement vaines. Elles ont sans doute des effets psycho-actifs. D’ailleurs les rites védiques s’accompagnent d’autres sortes d’effets psycho-actifs, dont certains extrêmement puissants, comme ceux associés à la consommation rituelle du soma, dont on est presque certain qu’elle provoquait des effets psychotropes et même enthéogènes. Or, les effets du chant, de la récitation et de la psalmodie, qui impliquent un contrôle rigoureux du souffle, pouvaient, avec un entraînement suffisant, avoir aussi de tels effets psychotropes. Ces différentes sortes d’effets, effectivement psychotropes ou seulement psychosomatiques, pourraient même inclure ceux qui relèvent de la méditation silencieuse, telle que recommandée par les Upaniṣad et le Bouddhisme. Ainsi les pratiques d’inspiration et d’expiration contrôlées dans les exercices fortement ritualisés de respiration, peuvent aider à expliquer comment l’ingestion d’une substance psychoactive peut aussi devenir un rituel. Dans d’autres articles de ce Blog, j’ai évoqué le fait que de nombreux animaux se plaisent à consommer des plantes psychoactives. De même, on observe chez de nombreuses espèces animales des pratiques qui offrent des caractères très ritualisés. Il me paraît possible de faire un lien entre ces pratiques animales « ritualisées », mais qui n’ont apparemment aucun « sens », et les pratiques humaines fortement ritualisées comme celles que l’on observe dans les grands rites sacrificiels du Véda. Il serait tentant de faire cette hypothèse supplémentaire : l’ingestion de certaines plantes, l’observation obsessionnelle de rites très détaillés et l’obéissance « aveugle » à nombre de prescriptions religieuses possèdent au moins un point commun, à savoir celui de pouvoir engendrer des effets psychoactifs, ce qui est peut-être le but cherché.
Si l’on considère que les animaux sont eux aussi capables de s’imposer des pratiques ritualisées et de consommer régulièrement des substances alcaloïdes et psychoactives, s’ouvre alors une piste de réflexion plus fondamentale sur la structure même de l’univers, sur son harmonie interne et sur sa capacité de produire des résonances. Celles-ci relient en quelque sorte, de multiples et subtiles façons, le monde de la chimie minérale et organique, le règne des fungi, le règne végétal, le règne animal et le monde spirituel spécifique aux humains. L’existence de ces résonances est particulièrement saillante dans le monde animal (non-humain et humain). Sans doute également, ce sont ces résonances qui sont à l’origine du phénomène universel de la « conscience ». Des rites apparemment sans « sens », sans « signification », ont au moins cet immense avantage qu’ils sont capables d’engendrer, en puissance, un peu plus de « conscience » dans ceux qui les suivent à la lettre, et qui, ce faisant, prennent conscience de ce qu’ils font et de ce qui en résulte en eux… Détournant ironiquement la célèbre formule rabelaisienne, je voudrais exprimer le fond de ma pensée ainsi : « Sens sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Cette formule pourrait aussi s’inverser. Si « du sens sans conscience » peut s’avérer potentiellement et symboliquement destructeur, ou parfois créateur, une « conscience sans sens » pourrait n’être pas moins dangereuse pour elle-même et pour les autres. Une « conscience sans sens » se contente d’être, purement et simplement, et à ce titre elle ne se représente elle-même dans aucun devenir, dans aucun avenir. Une conscience qui se contente d’être, sans se représenter quelque sens que ce soit, quant à ce pour quoi elle est, est l’archétype du nihilisme, avec ce que cela implique comme menace pour les autres vivants et pour tout l’écosystème. Comme on le pressent peut-être, cette voie de recherche (la recherche de résonances profondes, structurelles, systémiques, au sein de l’univers) ouvre donc des perspectives inimaginables, par l’amplitude et l’universalité de ses implications, à tous les niveaux, du minéral au végétal et à l’animal, du quantique au cosmique, de l’anthropique au néguentropique…
En conclusion (provisoire), le fait que les rites religieux n’ont aucun sens offre des perspectives stimulantes. Cela ouvre un espace infini de futures combinaisons entre ce qui relève de ce que les matérialistes appellent la « matière » et ce qui relève de l’« idée », au sens que les idéalistes donnent à ce mot.
____________________
iFrits Staal. Rituals and Mantras. Rules without meaning. Motilar Banasidarss Publishers. Delhi,1996, p.8
iiCf. Nb. 19, 1-22. Voici les premiers versets de ce chapitre (Nb. 19, 1-5): « L’Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes: « Ceci est un décret de la loi qu’a prescrit l’Éternel, savoir: Avertis les enfants d’Israël de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n’ait pas encore porté le joug. Vous la remettrez au pontife Eléazar; il la fera conduire hors du camp, et on l’immolera en sa présence. Le pontife Eléazar prendra du sang de l’animal avec le doigt, et il fera, en les dirigeant vers la face de la tente d’assignation, sept aspersions de ce sang. Alors on brûlera la vache sous ses yeux: sa peau, sa chair et son sang, on les brûlera avec sa fiente […] » »
iiiLe Pentateuque avec commentaires de Rachi. Traduit par le Grand Rabbin Joseph Bloch et al. Paris, 1992. Tome IV, Les Nombres, ch. 19, p.151
iv« La critique de Satan et des nations porte sur deux points : 1° Qu’est-ce que ce rite ? Son objet est de rendre purs ceux qui sont impurs, mais il rend impurs ceux qui manient les cendres ! [les cendres de la vache brûlée en sacrifice]. 2° Comment pourrait-il seulement effacer l’impureté causée par un cadavre ? C’est pour prévenir toute critique de ce genre que l’Écriture introduit ce commandement par les mots : ‘C’est une prescription de la Torah !’ C’est un décret promulgué par le Législateur Divin, et comme tout décret de la Torah il doit être observé même si l’on n’est pas capable d’en sonder la signification. » Le Pentateuque avec commentaires de Rachi. Traduit par le Grand Rabbin Joseph Bloch et al. Paris, 1992. Tome IV, Les Nombres, ch. 19, Appendice, p.304

Le Soi — qu’il soit divinisé (à la façon du Véda, sous le nom d’ātmani), ou absolument nié (par le Bouddhaii) — est une idée fort ancienne, et peut-être la plus ancienne qui soit. C’est pourquoi l’on peut ne pas trop s’étonner que, bien après Maître Eckhart, ou même F.W. Schellling, C.G. Jung ait pu dire qu’il était un « équivalentiii » de Dieu. Ce n’était pas là réduire l’idée de Dieu, mais plutôt exalter celle, assez élusive, de ce Soi. Une conséquence de l’« équivalence » ainsi posée était qu’à la divinité pouvait être associée une forme d’« inconscient ». « Le Soi dans sa divinité (c’est-à-dire l’archétype) n’est pas conscient de cette divinité […] Dans l’homme, Dieu se voit de l’« extérieur » et devient ainsi conscient de sa propre formeiv. » En se « voyant de l’extérieur », Dieu se voit aussi, en quelque sorte, de l’« intérieur », en train de se voir de l’extérieur, et prend par là conscience de sa forme spécifique d’inconscience. Autrement dit, après avoir créé la Création, Dieu la voit alors autrement, c’est-à-dire en tant que réalité autre [que l’idée qu’il conçut et énonça « au commencement »]. Il en « découvre » effectivement l’altérité, l’imprévisibilité, la liberté, ainsi que l’intrinsèque multiplicité – il « voit » la pluralité manifeste de créatures subsumées sous son unité. Cette notion d’un Dieu qui « découvre » sa propre création après l’avoir créée, ne doit pas trop surprendre. Elle est implicitement attestée dans la Genèse. Il fallait par exemple que la lumière fût, d’abord, pour que Dieu jugeât, après coup, qu’elle était « bonnev », ou encore, il fallait, d’abord, qu’il créât tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux ou qui volent au moyen d’ailes, pour qu’il considérât, ensuite, que cela était « bienvi ». Cela prouve un certain degré de non-savoir de sa part, ou même une certaine inconscience quant à la nature réelle de son œuvre créée (par contraste avec sa nature idéelle, ou essentielle). Que l’on considère cet autre exemple : Dieu parcourt le jardin d’Éden à la recherche de l’homme et de sa femme, mais ne les trouve pas. Alors « l’Éternel-Dieu appela l’homme, et lui dit: « Où es-tu?vii » » Cette simple question infirme de facto l’hypothèse de son « omniscience ». Passant à la limite, Jung postula même « l’existence d’un être [suprême] qui pour l’essentiel est inconscient. Un tel modèle expliquerait pourquoi Dieu a créé un homme doté de conscience et pourquoi il cherche à atteindre Son but en lui. Sur ce point l’Ancien Testament, le Nouveau Testament et le bouddhisme concordent. Maître Eckhart dit que ‘Dieu n’est pas heureux dans sa divinité. Il lui faut naître en l’homme.’ C’est ce qui s’est passé avec Job : le créateur se voit lui-même à travers les yeux de la conscience humaineviii. » Pour expliquer ces quelques passages de la Genèse, il semble donc que l’on puisse admettre, au moins provisoirement, l’idée d’un Dieu essentiellement inconscient, en tant que principe initial mais toujours inaccompli (au sens de la grammaire hébraïque). Peuvent alors s’ouvrir à la spéculation des horizons imprévus, des perspectives accélérées. On peut entrer dans le langage et dans tous ses non-dits. On peut maintenant renoncer, plus aisément, à l’idée rebattue, et somme toute philosophiquement improductiveix, de « l’omniscience » divine, et l’on peut avancer une hypothèse plus roborative : Dieu a créé l’homme parce qu’il a réellement besoin, en un certain sens, de la conscience humaine, ainsi que des innombrables formes de consciences, lesquelles sont toutes tout autres que la sienne. De même qu’une femme a besoin d’enfanter pour être appelée « mère », le Dieu, malgré son « omnipotence », a besoin de la création pour être reconnu comme « Créateur ». Dialectique éternelle du deus et de l’humus, du divin et de l’humain, de l’être et du devenir, du désir et du don.
Pour fixer les idées, il me vient cette métaphore météorologique : Dieu pourrait être une sorte de nuage infini, une essence immatérielle, gazeuse, sombre, chargée d’une électricité négative et positive, faite de « oui » et de « non », de néant et d’être, ou de mal et de bien, ou encore d’absence et de présence à soix. Mélangeant sans cesse en Lui-même ces masses et ces énergies opposées, l’esprit un, infini et divin, ne saurait pas qui Il est Lui-même, en Lui-même et pour Lui-même, puisqu’Il se dépasserait toujours dans la vie de son inhérent devenir. Ce relatif non-savoir est-il paradoxal, pour un Dieu censé être omniscient ? Il faut concevoir que, dans son unité, son infinité et sa solitude, le Dieu n’a, tant avant la Création qu’« au commencement », aucun point de comparaison avec quelque « autre » que Lui-même. Il roule dans son abyssale profondeur les infinis replis de son infini devenir, il déroule sans cesse les méandres de son infini inconscient. Mais alors, dans ce nuage chargé d’orage en puissance, une étincelle peut soudain surgir, un éclair peut venir traverser l’épaisseur totale de la nuée, et, ce faisant, engendre une première « lumièrexi ». Pour le Dieu qui « voit » cette lumière en son sein, celle-ci est l’équivalent d’une sorte de savoir de Soi qui vient s’ajouter à la sorte de non-savoir qu’il a nécessairement de Lui-même, puisque son infinité, par nature inaccomplie, dépasse en devenir et en puissance la conscience qu’il en a, en acte. Cette lumière est toujours une sorte de « commencement », une lueur de connaissance traversant l’inconscient divin. On pourrait vouloir appeler cette lumière : « Logos », ou « Verbe », ou même « Fils ». Mais ce ne sont-là que de simples métaphores encore, inadaptées au fond, tant les langues humaines affichent leurs manques. Au-delà des images verbales, l’image fondamentale reste invariante : la lumière créée illumine les ténèbres, qui ne la reçoivent que partiellement, elle est comme une prise de « conscience » de l’abîme de l’inconscience. Et, de la conscience de l’inconscient, de la lumière s’unissant à l’abîme, naissent sans fin les mondes.
_________________________
iLe Véda donne aussi à l’Homme le nom du Dieu, Puruṣa, qui est aussi Prajāpati, le « Seigneur des créatures », et que les Upaniṣad nomme le Soi, ātman.
ii“Ne crois surtout pas, Subhuti, que le Tathâgata pense : ‘Je conduirai tous les êtres vivants à la rive de la libération.’ Pourquoi ? Il n’y a aucun être vivant que le Tathâgata conduise jusqu’à l’autre rive. Si le Tathâgata pensait qu’il en existait, il serait encore emprisonné dans l’idée d’un soi, d’un être humain, d’un être vivant ou d’une durée d’existence. Ce que le Tathâgata appelle soi, Subhuti, est fondamentalement dépourvu d’un soi, mais les êtres ordinaires pensent qu’il y a un soi. Ces êtres ordinaires, Subhuti, le Tathâgata ne les considère pas comme des êtres ordinaires. C’est pourquoi il les appelle êtres ordinaires.” Soutra du Diamant.
iii« En ce qui concerne le Soi, je pourrais dire qu’il est un équivalent de Dieu. » C.G. Jung. Lettre au Pr Gebhard Frei. 13 Janvier 1948. Le Divin dans l’Homme. Albin Michel.1999. p.191
ivC.G. Jung. Lettre à Aniela Jaffé. 3 Septembre 1943. Le Divin dans l’Homme. Albin Michel.1999. p.185-186
vGn 1, 3-4
viGn 1, 21
viiGn 3, 9
viiiC.G. Jung. Lettre au Rev Morton Kelsey. 3 Mai 1958. Le Divin dans l’Homme. Albin Michel.1999. p.133
ixC’est une idée philosophiquement improductive, parce que logiquement contradictoire : si Dieu est omniscient, alors le monde est absurde, car Dieu « sait » toute l’étendue du Mal qu’il a créé (עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע « Je fais la paix et je crée le mal » Is. 45, 7), et Il « sait » aussi que le monde est absurde, de ce fait, et par sa faute.
xLa divinité est qui elle est, et nie tout ce qu’elle n’est pas. Il lui reste à devenir ce qu’elle n’est pas encore, et que, sans doute, dans son omniscience toute relative, elle ignore encore, tant sa liberté d’être à venir dépasse sa connaissance momentanée de ce qu’elle est et a été. Après le Néant initial, dont on ne peut rien dire sinon qu’il semble vide, le plérôme divin se présente à la fois comme un Oui, puis comme un Non, entrant successivement en scène, ainsi que la Cosmogonie d’Hésiode le présente: D’abord entre en scène Gaïa, qui est un Oui en puissance, puis vient Éros, qui est un Oui en acte, et enfin Ouranos, qui assène un Non répété. Ouranos est l’archétype divin de la négation et de l’inconscience, confrontée à Gaïa, qui est l’archétype de l’affirmation et de la conscience. Ouranos incarne le Non divin : « En soi, la divinité est toujours le Non à l’adresse de l’être extérieur, mais c’est en se manifestant comme telle qu’elle fait surgir l’être extérieur […] Elle est pour cet être extérieur un Non destructeur, une force éternellement en colère qui ne supporte aucun être qui lui soit extérieur. » (F.-W. Schelling. Les Âges du Monde. Trad. S. Jankélévitch. Aubier, Paris, 1949, p.133) Après le Oui de Gaïa, le Non d’Ouranos. Ce Non, cette colère du Dieu du Ciel, est la divinité tout entière, et exprime son essence même, elle n’en est pas seulement un attribut, un aspect relatif. « Cette force de colère n’est pas une propriété de la divinité, pas plus qu’elle n’en est une puissance ou une partie ; elle est toute la divinité pour autant qu’elle existe en soi et constitue l’Être essentiel. Cet être essentiel est une pointe irrésistible, inapprochable, un feu dans lequel aucune vie n’est possible. » (Ibid. p.133-134)Mais ce Non de la divinité, pour essentiel qu’il soit, ne peut l’empêcher d’être aussi un Oui, à un autre moment. « Elle doit être nécessairement un Non destructeur par rapport à tout être extérieur et elle doit aussi […] être un éternel Oui, un amour qui fortifie, l’être de tous les êtres. » (Ibid.)La divinité, dans son unité et dans sa dualité, est à la fois une volonté qui veut et une volonté qui ne veut pas. Ce qui ne veut pas dire qu’elle est une volonté qui ne veut rien, une volonté du vide, du néant. Elle est une volonté double, et même triple. En termes mythologiques, Ouranos, qui refuse que ses enfants vivent, est le Non destructeur. Gaïa, qui est le siège, le fondement de tous les êtres vivants, est le Oui. Et Éros, l’Esprit de vie, est lui aussi le Oui. La divinité dans son ensemble est un Tout. En tant que plérôme, elle est à la fois le Non et le Oui, et leur union. Le Oui, « cet amour n’est pas une propriété, une partie ou un principe de la divinité, il est la divinité même, totale et indivisible. Mais justement parce que la divinité est un Tout indivisible, qu’elle est l’éternel Oui et l’éternel Non, elle n’est ni l’un ni l’autre, mais l’unité des deux. Il ne s’agit pas ici, à proprement parler, d’une trinité de principes distincts, mais Dieu est, et en tant qu’Un, et justement parce qu’il est Un, il est aussi bien le Oui que le Non et l’unité des deux. » (Ibid.) Dans la présence simultanée, ou alternée, de ce Oui et de ce Non, on peut reconnaître l’action de deux forces fondamentales de l’univers physique et métaphysique, — l’attraction et la répulsion. La différence radicale, existentielle, entre ces deux forces de sens contraires, est la condition première de l’apparition de la conscience. La conscience ne se constitue qu’en résistant à la dissolution qui la menace, du fait des mouvements contradictoires qui l’assaillent. Elle s’élève d’autant plus dans l’échelle de la conscience qu’elle réalise sa liberté d’être comme un Oui, ou comme un Non, ou comme quelque unité supérieure des deux. En effet, si elle était seulement un Oui, ou un Non, la divinité, ou la conscience, devrait adopter tel ou tel mode d’être, puis l’affirmer absolument ou bien le nier absolument. Mais l’affirmation ou la négation absolues sont en contradiction avec un principe bien supérieur, celui de la liberté absolue, le principe de la volonté absolument libre du divin, — ou de la conscience.
xiJn 1,1

Quel est le sens du mot « Sion »? Plusieurs savants et prophètes en Israël ont répondu à cette question, chacun à sa manière. Voici un bref florilège d’opinions à ce sujet.
« Sion » (צִיּוּן Tsiyoun) : selon Eliezer Ben Yehuda, ce mot signifie étymologiquement « pierre tombale » (tombstone) (in A Complete Dictionary of Ancient and Modern Hebrew, Jerusalem, 1950, Tome 11, p.5464).
Ernest Klein adopte une vue plus interrogative: « Sion ou ‘Tsiyon’, d’étymologie incertaine. Certains érudits le font dériver de צוה dans le sens de « ériger » (cp. ציון). D’autres le relient à la racine צִין , apparaissant dans l’arabe ṣāna ( -il a protégé), de sorte que ציון signifierait littéralement « forteresse, citadelle ». Les références de savants font dériver ces mots de la racine צהה ou ציה ; selon eux, le sens originel de צִיּוּן serait ‘colline dénudée’. » (« ‘Sion or Tsiyon’ of uncertain etymology. Some scholars derive it from צוה in the sense ‘to erect’ (cp. ציון). Others connect it with base צִין , appearing in Arab, ṣāna ( -he protected), so that ציון would literally mean ‘fortress, citadel’. Scholars reference derive these words from base צהה or ציה ; according to them the original meaning of צִיּוּן would be ‘bare hill’. » Ernest Klein. A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English. Univ. of Haifa, 1987, p.545)
Le Psalmiste quant à lui, ne livre pas d’interprétation du mot Sion, mais il n’hésite pas à prophétiser, de façon singulièrement optimiste, et universaliste, que Sion appartient à tous les hommes :« De Sion, l’on dira tout homme y est né. » (Ps. 87,5)
Dans un autre psaume, le Psalmiste voit en Sion la source même de la vie, pour l’éternité : « C’est la rosée de l’Hermon, qui descend sur les hauteurs de Sion; là l’Éternel a voulu la bénédiction, la vie à jamais. » (Ps. 133,3)
Alors? Pierre tombale? Forteresse? Colline dénudée? Lieu de naissance de tous les hommes? Source de rosée et de vie à jamais?

En ce temps-là, un Juif, originaire d’une petite bourgade de Galilée, commençait à faire parler de lui. Il avait pour nom Yehoshoua, ce qui signifie en hébreu : « Il sauve », et son diminutif était Yeshoua. Mais, lors de certaines de ses interventions publiques, il préférait se désigner comme étant le « Fils de l’homme » (Ben-Adam), expression assez curieuse, que l’on rencontre cependant à plusieurs reprises dans la Bible hébraïquei. Au commencement de ses pérégrinations, et à l’occasion de son baptême dans le Jourdain, il avait aussi été appelé par la « voix » même de Dieu, d’une autre expression encore, fort tendre : « Mon Fils bien-aimé ! ». Et, peu de temps avant sa mort, il fut appelé de la même manière, lors de la scène de la Transfigurationii. Lorsque Caïphe, le « souverain sacrificateur » du Sanhedrin, cherchant à son encontre des preuves de blasphème, lui avait demandé : « Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu », Yeshoua lui répondit: « Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du cieliii ». Ces paroles sont, pourrait-il sembler, quelque peu étranges et ambiguës : Yeshoua rétorque à Caïphe que c’est lui, Caïphe, qui a dit qu’il était le « Messie » et le « Fils de Dieu », et tout de suite après il se désigne à nouveau comme étant « le Fils de l’homme », ce qui semble impliquer une certaine prudence quant à l’emploi du titre de « Fils de Dieu ». Quoi qu’il en soit, ce sont cependant ces paroles mêmes qui furent jugées blasphématoires et qui permirent à Caïphe et au Sanhedrin de le condamner à mort. Comme si tous les « noms » que l’on vient de citer, Yehoshoua, Yeshoua, « Fils de l’homme », « Fils de Dieu », « Mon Fils bien-aimé », n’épuisaient pas l’essence de son être, il fut interpellé d’une autre manière encore, au moment de son baptême, par Jean le Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieuiv ! ». Cette métaphore ovine peut sembler curieuse de nos jours, mais elle était alors parfaitement claire pour les Juifs. C’était une référence directe à l’agneau que chaque famille juive devait égorger et manger à l’occasion de la Pâque, selon le rite du sacrifice instauré par Moïsev. Ce qui était nouveau et original dans l’apostrophe de Jean, c’est qu’elle qualifiait d’« agneau » (sous-entendu sacrificiel), un homme, Yeshoua, qui allait être reconnu peu après par Dieu comme étant son « Fils », et qui allait être précisément « sacrifié » trois ans plus tard, juste avant la Pâque juive, pour avoir assumé cette double épithète (celle de « Fils » et celle d’« Agneau » de Dieu). La figure de l’« agneau », pour innovante qu’elle pût paraître en tant qu’appliquée à un homme, n’était pourtant pas tout à fait une « première » dans le cadre de l’ancienne religion juive. Le prophète Jérémie, qui avait lui-même rencontré de sérieuses difficultés lors de ses confrontations avec ses propres coreligionnaires, s’était aussi comparé à un « agneau » que l’on mène au sacrifice: « J’étais comme un agneau confiant qu’on conduit à l’abattoirvi ». Un autre prophète, Isaïe, utilisa la même image et alla encore plus loin en appliquant la figure de l’« agneau » au Messie lui-même, le Messie attendu par tous les Juifsvii : « Il a été maltraité, il s’est humilié et n’a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu’on mène à l’abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n’a pas ouvert la boucheviii. » Mais ces adjectifs, « maltraité », « humilié « , « muet », étaient certes inacceptables par les Juifs, qui attendaient un Messie triomphant, glorieux, et régnant sur la fin du monde. Ces deux figures, celle du Messie, mené à l’abattoir comme « une brebis muette », et celle du « Fils bien-aimé » de Dieu mais crucifié par les hommes, sont indéniablement « sacrificielles », mais elles lient surtout, et de façon désormais indénouable, la figure de ce « sacrifice » à l’essence même du « divin ». Dans le contexte du judaïsme du second Temple, reconstruit après le retour de la déportation à Babylone, elles étaient donc des figures éminemment paradoxales, scandaleuses, incompréhensibles, capables de provoquer la violence, absolue, sans limite, des « religieux ». Ce mécanisme de la violence contre une victime qui réunit sur sa tête toutes les haines, a été assez étudié par René Girard pour qu’il soit utile d’y revenir ici. Disons seulement que Girard fut le théoricien de la présence de « boucs émissaires », de victimes sacrificielles, dans les sociétés humaines. Leur fonction centrale est de canaliser le flot de violence mimétique que ces sociétés engendrent inévitablement. En conséquence, Girard n’hésitait pas à voir dans le cas de Yoshoua/Jésus une parfaite illustration de ses théories sur la violence mimétique et sur le besoin inhérent aux sociétés humaines de s’unir et de se conforter aux dépens de victimes dûment choisies (pour leur culpabilité supposée, alors qu’elles sont en vérité totalement innocentes). Girard considéra manifestement que ses théories sur la violence mimétique et la victimisation sacrificielle révélaient en fait l’essence même du sacrifice christique. Sans doute gratifié par sa « découverte » et persuadé de la position de surplomb théorique qu’elle semblait lui octroyer, il se crut en mesure de signaler la singularité « sacrificielle » de la religion chrétienne, seule religion à avoir, selon lui, rendu désormais impossible tout sacrifice humain — ayant été elle-même fondée sur l’auto-sacrifice du « Fils bien-aimé de Dieu », ce qui annulait du coup toute imitation et réplication purement humaine. Il n’avait pas échappé à Girard que la religion chrétienne était entrée dans une période fort difficile, et qu’elle était confrontée à de nombreuses attaques venant de toutes sortes d’horizons. Il voulut mettre ses théories au service de cette cause, tant elles étaient liées, selon lui. Il avait noté par exemple les tentatives de « ceux qui s’efforcent de minimiser l’originalité du Logos chrétien en insistant sur l’origine grecque de cette notion, [alors qu’ils] ne voient pas que la définition johannique [du Logos] n’a rien à voir avec la grecque. Elle incorpore l’idée chrétienne essentielle de l’exclusion, de l’expulsion à celle du Logos, pour définir un Logos émissaire, si j’ose dire, très étranger à la pensée grecqueix ». Notons au passage que voilà encore un nom nouveau pour Yeshoua : Logos, terme grec que l’on peut traduire par « Verbe », « Parole », ou encore « Sagesse ». René Girard, toujours en quête d’indices de la « singularité » de la religion chrétienne, soutint donc que le Logos « émissaire » est « très étranger à la pensée grecque » . Ceci mérite examen… Il se trouve que, bien avant Socrate, Platon, ou Jean l’évangéliste, Héraclite avait déjà considéré le mystère associé au concept de Logos. Il avait insisté sur son étrangeté radicale : « Limites de l’âme, tu ne saurais les trouver en poursuivant ton chemin, si longue que soit toute la route, tant est profond le Logos qu’elle renfermex. » Il avait affirmé qu’il était étranger au champ de la compréhension humaine. « Le Logos, ce qui est, toujours les hommes sont incapables de le comprendre, aussi bien avant de l’entendre qu’après l’avoir entendu pour la première foisxi ». Pourtant, il y avait ce paradoxe : le Logos est à la fois présent dans l’âme humaine et indépendant d’elle : « Il appartient à l’âme un Logos qui s’accroît de lui-mêmexii ». Le Logos grandit de lui-même dans l’âme humaine, mais les hommes l’ignorent, car ce n’est pas le Logos qui se sépare des hommes, ce sont les hommes qui se séparent du Logos. « Quelle que soit l’assiduité avec laquelle ils fréquentent le Logos [qui gouverne toutes choses], ils se séparent de luixiii. » Tous les hommes s’excluent d’eux-mêmes du Logos, qui est pourtant essentiellement commun à tous les hommes : « Bien que le Logos soit commun, la plupart vivent comme avec une pensée en proprexiv. » De plus, entrant quelque peu en matière, et bien avant que soit apparue la notion de « Verbe » dans la théologie chrétienne, Héraclite lie directement le Logos à l’existence de l’Un. C’est le Logos qui révèle son existence et un aspect de son essence (l’identité entre l’Un et Tout) : « Si ce n’est moi, mais le Logos, que vous avez écouté, il est sage de convenir qu’est l’Un‒Toutxv. » Enfin, comment ne pas trouver étrangement prophétique le Fragment 32 d’Héraclite : « L’Un le seul sage ne veut être appelé et veut le nom de Zeusxvi » ? Cela ne rappelle-t-il pas le moment-clé de la scène rapportée plus haut, entre Yeshoua et Caïphe ? Yeshoua ne veut pas être appelé « Fils de Dieu » comme Caïphe le lui suggère. Il se nomme lui-même, encore une fois, « Fils de l’homme », comme si ce nom était aussi un autre « nom de Zeus ».
____________________
iCf. Psaume 8,5 et Daniel 7,13
ii« Et voici qu’une voix venant des cieux disait: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. » (Matthieu 3,17 , Mc 1,11 et Lc 3,22). La même voix [venant des cieux, ou de Dieu] s’est aussi fait entendre lors de la scène de la Transfiguration : « Comme il parlait encore, voici qu’une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que, de la nuée, une voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. Écoutez-le! » (Matthieu 17,5 ainsi que Mc 9,7 et Lc 3,22).
iiiMt 26, 63-64
ivJn 1, 29 et Jn 1, 36
vEx 12, 5-11 : « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an; vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu; on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l’eau; mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l’intérieur. Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin; et, s’il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main; et vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Éternel. »
viJr 11, 9
viiIsaïe voit dans le Messie non une figure triomphale, victorieuse, mais « meurtrie » , « écrasée », « blessée », et par cela même rédemptrice : « Et c’est pour nos péchés qu’il a été meurtri, par nos iniquités qu’il a été écrasé; le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui, et c’est sa blessure qui nous a valu la guérison » (Is. 53,5).
viiiIs 53,7
ixRené Girard. Le sacrifice dévoilé dans les religions bibliques et la religion védique. Éditions de la Bibliothèque nationale de France, 2003. Le passage ici cité se poursuit par une citation de l’Évangile de Jean (Jn 1, 5-11), censée illustrer la différence entre la conception johannique du Logos et celle de Héraclite :
« La lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont point reçue
Il était dans le monde
et le monde fut par lui
et le monde ne l’a pas reconnu.
Il est venu dans son propre bien
et les siens ne l’ont pas accueilli
La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres l’ont rejetée. »
xHéraclite. Fragment 45. Cité par Diogène Laërce, Vies, IX, 7
xiHéraclite. Fragment 91. Cité par Sextus Empiricus. Contre les mathématiciens. VII, 132.
xiiHéraclite. Fragment 2. Cité par Stobée, Florilège III, 1, 180 a
xiiiHéraclite. Fragment 72. Cité par Marc Aurèle. Pensées, IV, 46
xivHéraclite. Fragment 115. Cité par Sextus Empiricus. Contre les mathématiciens. VII, 133
xvHéraclite. Fragment 50. Cité par Hyppolyte, Réfutation de toutes les hérésies, IX, 9 .
xviHéraclite. Fragment 32. Cité par Clément d’Alexandrie. Stromates, V, 116
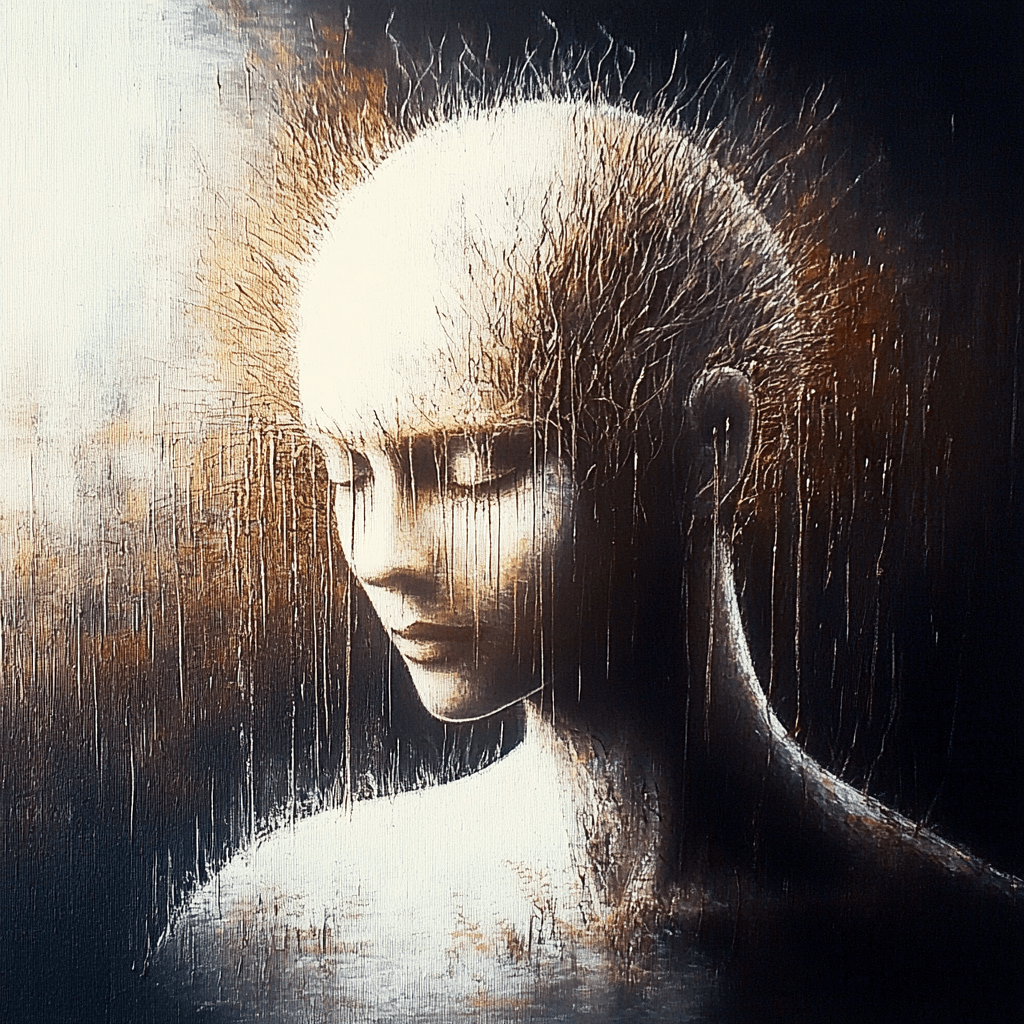
Il y a deux sortes de philosophes. Il y a ceux pour qui l’homme se réalise en se « dépassant » toujours, et ceux pour qui il est essentiellement, et irrémédiablement, déjà « dépassé » — par les antinomies de la raison ou les profondeurs de l’inconscient. Parmi les premiers, Hobbes dit que la vie est une course, et qu’« être dépassé, c’est misèrei », – il faut donc aller toujours le plus en avant, ou bien mourir. Schopenhauer estime qu’il faut « dépasser le soi », dépasser le singulier, l’individuel. Nietzsche affirme que l’homme n’existe que pour être dépassé, afin de devenir qui il est. Dans le camp opposé, pour Kant, par exemple, la raison humaine est toujours « dépassée » par les questions que l’homme se pose. C.G. Jung atteste aussi que la conscience est limitée, « dépassée » de toutes parts par l’inconscient, illimité.
Tous ces points de vue contiennent une part de vérité, sans doute. Mais je pense qu’il faut les « dépasser » à leur tour, eux aussi. Ils peuvent tous être subsumés sous une vérité plus large, plus englobante, qu’il s’agit de débusquer. Certes, d’un côté l’essence de la conscience est de se dépasser sans cesseii. Mais d’un autre côté, l’esprit de l’homme est toujours en retard, il est « dépassé » par son destin. Il est dépassé par son ignorance de lui-même. Quoi qu’il en soit, on ne peut en rester là. Il nous faut nous mettre en mouvement, dépasser le temps des retards, et nous dépasser nous-même, pour enfin dépasser ce dépassement même. Cela prendra du temps, beaucoup de temps, et peut-être même un temps infini — ce qui en soi serait plutôt une bonne nouvelle. Cela serait un signe que l’infini existe en effet, et qu’est envisageable la perspective de l’explorer infiniment — pour le « dépasser » lui aussi, un jour ? Avant d’en arriver là, commençons par une brève revue de quelques philosophes « modernes » impliqués dans la question du « dépassement » — Kant, Schopenhauer, Nietzsche.
Kant, dépassé par le « vide »
La toute première phrase de la préface à la première édition de la Critique de la raison pure (1781) présente la raison humaine comme étant « dépassée » : “La raison humaine a cette destinée singulière […] d’être accaparée de questions qu’elle ne saurait éviter, car elles lui sont imposées par sa nature même, mais auxquelles elle ne peut répondre, parce qu’elles dépassent totalement le pouvoir de la raison humaineiii.” La raison est « dépassée » par des questions « inhumaines », qui placent l’être humain devant les limites de ses capacités. Elle est aussi « dépassée » par les principes mêmes dont elle se sert, qui sont pourtant en accord avec le sens commun. « La raison ne peut jamais dépasser le champ de l’expérience possibleiv ». La raison réalise ses limites lorsqu’elle est envahie par l’obscurité de ces principes qui la dépassent. Kant donne en exemple les « paralogismes » de la raison pure, et fait la liste de ses « antinomies » : Le monde est-il fini ou non ? Existe-t-il ou non du « simple » dans les choses ? La causalité est-elle libre ou nécessaire ? Existe-t-il ou non un être absolument nécessaire ? La « raison pure » est bien incapable de trancher ces antinomies, selon Kant. Elle peut seulement garantir la régulation et l’enchaînement des raisonnements, et fonder l’unité de l’entendementv. Elle favorise « l’usage empirique de la raison, en lui ouvrant de nouvelles voies que l’entendement ne connaît pasvi. » Mais, en dehors de cet usage empirique, et hors des bornes que lui impose la nature, il n’y a que le vide. Le « pouvoir suprême de connaître [ne peut] jamais sortir des limites de la nature, hors desquelles il n’y a plus pour nous qu’un espace videvii. » La raison humaine ne sort jamais des limites de l’expérience ni des frontières de la nature… Vastes frontières, certes, mais prison quand même. Si nous restons enfermés dans ces « frontières de la nature », quid d’une éventuelle « surnature » ? Kant est parfaitement muet à ce sujet. C’est d’ailleurs logique. Puisque la raison est enfermée dans la nature, que pourrait-elle savoir à ce sujet ? Rien, évidemment, sinon le « vide ».
Schopenhauer, dépassé par le « néant »
Schopenhauer entend « dépasser » radicalement le sujet humain. Il veut lui enlever la position centrale qu’il occupe chez les Modernes, depuis Descartes. Son point de départ est le constat de la souffrance (humaine) et la compassion que celle-ci lui inspire. Le fait de ressentir de la compassion lui est une indication que la séparation entre les hommes est illusoire. Par conséquent, la subjectivité de chaque sujet, le principe de la singularité et de l’individuation, perdent leur pertinence. Fidèle à cette intuition première (la primauté de la ressemblance entre les hommes, et de leur solidarité, plutôt que celle de leur séparation et de leur division) Schopenhauer veut éclipser le sujet, le faire passer au second plan, et même l’ « anéantir » entièrement — non bien sûr physiquement, mais en tant que sujet philosophique. La philosophie doit désormais renoncer à l’idée de fonder la subjectivité du sujet. C’est d’ailleurs là un constat que tout un chacun peut faire à son sujet. Chacun se reconnaît être, certes, comme « sujet connaissant », mais doit aussi reconnaître comme étant dans l’impossibilité de se connaître soi-même. Une vértiable connaissance du sujet qui se dit « connaissant » est impossible. Car si le sujet est en mesure de « connaître », en revanche il ne se connaît pas « en tant qu’il connaîtviii ». Il connaît beaucoup de choses, mais il ne se connaît pas lui-même. Sur le fronton du temple de Delphes, l’injonction « connais-toi toi-même » était relativement optimiste : elle laissait croire encore qu’il était possible de se connaître. La philosophie de Schopenhauer est fondée sur l’impossibilité absolue de cette connaissance. Prenant acte de cette limite indépassable, Schopenhauer propose en conséquence de « dépasser » le sujet, si opaque, si inconnaissable. Cette opacité n’est qu’un voile qui couvre un vide. Le principe d’individuation n’est qu’une illusion (māyā), tout comme la séparation entre les êtres. Tout un chacun fait partie intrinsèquement du monde entier. « Ne plus faire la distinction égoïste entre sa personne et celle d’autrui, mais prendre autant part aux souffrances des autres qu’aux siennes propres […] se reconnaître dans tous les êtres, considérer également comme siennes les souffrances infinies de tout ce qui vit, et aura ainsi à s’approprier la douleur du monde tout entierix. » L’idée de l’individu, du particulier, du singulier, est une imposture, une illusion mensongère et pathogène. Persister dans cette illusion conduit fatalement à souffrir et infliger la souffrance. Le bourreau et la victime ne font qu’un. Il faut donc renoncer au vouloir de son moi, ne plus persévérer dans son être, chercher son « anéantissement », prendre conscience de l’unité de tout ce qui est. Schpenhauer semble avoir été largement influencé par le bouddhisme. Il l’admet volontiers. « Et c’est là précisément le Prajna-Paramita des Bouddhistes, l’ “au-delà de toute connaissance”, c’est-à-dire le point où le sujet et l’objet cessent d’êtrex». L’« anéantissement » (que Schopenhauer appelle aussi « faveur du néant ») fait l’objet d’une révélation survenant lors de l’éclipse de la conscience, lors de l’évanouissement de la présence à soi – lors de la libération de soi et du monde. Schopenhauer conclut son livre par cette phrase : « Pour ceux chez qui la volonté s’est convertie et niée, c’est notre monde si réel avec tous ses soleils et avec toutes ses voies lactées qui est – néantxi ».
Nietzsche, dépassé par le « devenir »
Nietzsche croit qu’est possible un homme « surhumain » – mais il méprise ceux qui croient au « supraterrestre ». Contradiction ? Non. Le supraterrestre n’est qu’une fiction empoisonnée. Seule existe la « terre », sur laquelle doivent surgir les « surhumains ». « Je vous enseigne le surhumain. L’homme n’existe que pour être dépassé […] Le surhumain est le sens de la terre […] Ne croyez pas ceux qui vous parlent d’espérance supraterrestre. Sciemment ou non, ce sont des empoisonneursxii. » Nietzsche proclame qu’il « enseigne le surhumain ». Mais cette idée n’est pas de lui. Elle appartient à Zoroastre, auteur des Gâthas, et fondateur d’une religion, le zoroastrisme. On apprend dans les Gâthas que le monde évolue sans cesse ainsi que toutes les consciences, et que celles-ci tendent toutes vers « la Perfection [Haurvatat], au terme de laquelle [elles seront] des créateurs capables d’autocréer de manière éternelle – c’est-à-dire des surhumains ayant accédé à l’immortalitéxiii. » A défaut d’avoir créé l’idée du « surhumain », Nietzsche reconnaît au moins sa dette intellectuelle. « Zarathoustra a plus d’audace que tous les penseurs pris ensemble. – Me comprend-on ?… La morale se dépassant elle-même par souci de vérité, le moraliste se dépassant en son contraire – en moi – , voilà ce que signifie dans ma bouche le nom de Zarathoustraxiv. » La morale se dépasse donc elle-même, et le moraliste aussi. Il n’y a que Zoroastre [Zarathoustra], qui soit indépassable, du moins à première vue. Nietzsche ne cesse de le répéter. « Atteindre son idéal, c’est le dépasser du même coupxv« . « On en vient à aimer son désir et non plus l’objet de ce désirxvi« . « Vivre dans une immense et orgueilleuse sérénité – toujours au-delàxvii« . Toujours au-delà ? Peut-être qu’atteindre l’idéal de Zarathoustra, ce serait le dépasser du même coup ? Après tout, ce prophète n’était jamais qu’un homme. Plus que de l’idéal d’un homme, fût-il prophète, Nietzsche aurait-il besoin d’un dieu ? Ne reconnaît-il pas explicitement Dionysos comme étant son dieu ? « Je fus le dernier, me semble-t-il, à lui avoir offert un sacrifice […] moi le dernier disciple du dieu Dionysos et son dernier initiéxviii ». Sous ses grands airs, je remarque que Nietzsche aime bien se soumettre, en bon « disciple », en « initié », à plus grand que lui. Frappé par la parole de Zarathoustra: « Deviens qui tu esxix ! », il se l’approprie et il la plagie tout en l’augmentant un peu (ce qui, au passage, diminue sa portée ontologique…) : « Deviens ce que tu es, quand tu l’auras apprisxx ». Nietzsche, qui se dit « incomparable », est aussi suffisamment modeste pour reconnaître sa dette vis-à-vis de Zarathoustra : « Quant à nous autres, nous voulons devenir ceux que nous sommes – les hommes nouveaux, les hommes d’une seule foi, les incomparables, ceux qui se donnent leurs lois à eux-mêmes, ceux qui se créent eux-mêmesxxi. » Mais cette loi, qu’il se donne à lui-même pour se créer lui-même, n’est-elle pas une loi déjà empruntée aux Gâthas ? Nietzsche répète qu’il veut se créer « lui-même ». Il veut se dépasser pour « devenir soi-mêmexxii »… Mais qui est ce « lui-même » ? Qu’est-ce que ce « soi-même » ? L’a-t-il jamais appris ? Nous ne le saurons pas. L’a-t-il jamais su lui-même, d’ailleurs ?
Le daimon
Kant a vu un « espace vide », au-delà de la raison. Schopenhauer, pour aller au-delà du moi, aspira au « néant ». Nietzsche voulut se créer « lui-même », mais ne sachant pas qui il « était », sinon qu’il « devenait ». Un problème analogue hante ces philosophes : toujours surgit en eux un manque, un vide, une absence, un néant. Par contraste, Jung, qui n’était pas philosophe mais psychologue, partit de la connaissance décisive qu’existent en lui des choses qui ne font pas partie du « moi », qui se font d’elles-mêmes et qui ont leur vie proprexxiii. « Tous mes écrits me furent imposés de l’intérieur. Ils naquirent sous la pression d’un destin. Ce que j’ai écrit m’a fondu dessus, du dedans de moi-même. J’ai prêté parole à l’esprit qui m’agitaitxxiv ». Cet esprit, il l’appelle d’un mot grec, dont Socrate s’était déjà servi, le daimon. « En moi il y avait un daimon qui, en dernier ressort, a emporté la décision. Il me dominait, me dépassaitxxv ». Le daimon est un autre nom de l’inconscient. « J’ai fait l’expérience vivante que je devais abandonner l’idée de la souveraineté du moi. De fait, notre vie, jour après jour, dépasse de beaucoup les limites de notre conscience, et sans que nous le sachions, la vie de l’inconscient accompagne notre existencexxvi« . L’inconscient est illimité, et par nature, « dépasse » le conscient, qui est limité. L’inconscient est illimité parce qu’il est en devenir incessant. Il ne devient pas ce qu’il est, il est un « devenir ». Seul l’inconscient est vraiment réel. Le moi conscient ne l’est pas, il n’est qu’une « illusion ». « Notre existence inconsciente est l’existence réelle, et notre monde conscient est une espèce d’illusion ou une réalité apparente fabriquée en vue d’un certain butxxvii. » Les rapports du moi limité à l’égard de l’inconscient illimité sont donc franchement inégaux. De cette confrontation entre le limité et l’illimité émergent une série d’évolutions, un changement de l’esprit, une métamorphose de la psychéxxviii, une métanoïaxxix. Le mot ‘inconscient’, qui recouvre l’‘illimité’, convient bien à Jung, qui est psychologue, mais les mots ‘daimon’ ou ‘Dieu’ pourraient tout aussi bien faire l’affaire. « Je préfère le terme d’ ‘inconscient’ en sachant parfaitement que je pourrais aussi bien parler de ‘Dieu’ ou de ‘démon’, si je voulais m’exprimer de façon mythiquexxx. » La psychologie est une science, mais la mythologie, qui ne l’est pas, ne manque pas de profondeurs propres. On aurait tort de la délaisser, en particulier dans une époque scientiste, positiviste et matérialiste. La mythologie, en effet, enseigne l’essence du dépassement. « Seul un être mythique peut dépasser l’hommexxxi« . Cet être mythique ne tire pas sa puissance d’être un dieu ou un démon. Il la tire du fait qu’il révèle la présence d’une puissance divine en nous. « Ce n’est pas ‘Dieu’ qui est un mythe mais le mythe qui est la révélation d’une vie divine dans l’homme. Ce n’est pas nous qui inventons le mythe, c’est lui qui nous parle comme ‘Verbe de Dieu’xxxii. » On en revient donc encore au manque, qui obsédait déjà Kant ou Schopenhauer. Cette fois c’est la psyché, l’âme elle-même qui manque de pouvoir se libérer, de se dépasser. « La psyché ne peut s’élancer au-delà d’elle-même […] Nous ne sommes pas en état de voir par-delà la psyché. Quoi qu’elle exprime sur elle-même, elle ne pourra jamais se dépasser […] Nous sommes désespérément enfermés dans un monde uniquement psychique. Pourtant nous avons assez de motifs pour supposer existant, par-delà ce voile, l’objet absolu mais incompris qui nous conditionne et nous influence.xxxiii » Mais alors, peut-on ‘dépasser’ le monde ‘psychique’ dans lequel nous semblons être enfermés ? Peut-on se libérer de l’inconscient?
Il faut, me semble-t-il, revenir ici à d’autres intuitions, qui ne sont absolument pas « modernes » — la description biblique de la nature de l’homme, par exemple : « Il souffla dans ses narines un souffle de vie [neshma ḥayyim], et l’homme [ha-adam] devint une âme vivante [néphesh ḥayah]xxxiv. » Paul de Tarse, Juif hellénisé, traduit cette expression, néphesh ḥayah [âme vivante], par « esprit vivifiant » (πνεῦμα ζῳοποιοῦνxxxv). La nuance est cruciale. Dans l’hébreu original, l’« âme » [néphesh] est « vivante » [ḥayah]. Dans le grec traduit et réinterprété par Paul, l’« esprit » [πνεῦμα] « fait vivre » [ζῳοποιοῦν]. L’âme est substance « vivante », dans la nature. L’esprit est le principe actif, le principe qui fait vivre la nature, et qui se révèle donc comme ‘surnature’. Ailleurs, Paul emploie une formule qui donne à nouveau à l’esprit le rôle d’un principe de vie : « l’esprit de la penséexxxvi ». L’esprit se définit ici comme l’essence vivante de la pensée. J’en infère que, dans notre moi, dans notre âme ou dans notre inconscient, vit en effet un principe vivant (l’esprit), qui non seulement « vit », mais qui « fait vivre » aussi. Et puisqu’il « fait vivre », c’est qu’il « dépasse » la vie.
____________________
i« Cette course nous devons supposer qu’elle n’a d’autre but, ni d’autre couronne de récompense que le fait de chercher à être le plus en avant […] Considérer ceux qui sont derrière, c’est gloire […] Continuellement être dépassé, c’est misère. Et abandonner la course, c’est mourir. » Thomas Hobbes, Éléments de la loi naturelle et politique, Livre de poche, 2003, p.145
iiCf. Philippe Quéau. L’Exil et l’Extase. Ed. L’Harmattan. 2023
iiiEmmanuel Kant. Critique de la raison pure. Trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud. PUF, 1975, p. 5
ivIbid. p. 484
v« La raison pure ne contient, si nous la comprenons bien, que des principes régulateurs […] mais qui portent au plus haut degré, grâce à l’unité systématique, l’accord de l’usage [empirique de l’entendement] avec lui-même. » Emmanuel Kant. Critique de la raison pure. (« La dialectique transcendantale. But de la dialectique naturelle ») Trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud. PUF, 1975, p. 484
viEmmanuel Kant. Critique de la raison pure. Trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud. PUF, 1975, p. 472-473
viiIbid. p. 484
viii Schopenhauer. De la quadruple racine du principe de raison suffisante (1813), trad. F.-X. Chenet, Paris, Vrin, 1991, § 25, p. 87
ix Schopenhauer. Le Monde comme volonté et représentation, Livre IV, § 68
xApostille à la troisième édition (1859) du Monde comme volonté et représentation.
xi Schopenhauer. Le Monde comme volonté et représentation, Livre IV, § 71
xiiNietzsche. Ainsi parlait Zarathoustra.Prologue 3
xiiiLes Gathas. Le livre sublime de Zarathoustra. Traduit et présenté par Khosro Khazai Pardis, Paris Albin Michel, 2011, p. 97
xivF. Nietzsche. Ecce Homo. « Pourquoi je suis un destin », Gallimard, 1974, p. 145
xvNietzsche, Par-delà le bien et le mal §73
xviNietzsche, Par-delà le bien et le mal §175
xviiNietzsche, Par-delà le bien et le mal §284
xviiiNietzsche, Par-delà le bien et le mal §295
xixNietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, L’Offrande du miel, op.cit., p. 273.
xxPindare, Les Pythiques, 2, 72.
xxiNietzsche, Le Gai savoir, §338.
xxiiNietzsche, Généalogie de la morale
xxiiiC.G. Jung. Ma vie,Gallimard, 1973, p. 293
xxivC.G. Jung. Ma vie,Gallimard, 1973, p.355
xxvC.G. Jung. Ma vie,Gallimard, 1973, p. 560
xxviC.G. Jung. Ma vie,Gallimard, 1973, p. 474
xxviiC.G. Jung. Ma vie,Gallimard, 1973, p. 509
xxviiiC.G. Jung. Ma vie,Gallimard, 1973, p. 335
xxix Ibid. p.515. Le mot métanoïa est composé de la préposition μετά (ce qui dépasse, englobe, met au-dessus) et du verbe νοέω (percevoir, penser), et signifie une ‘métamorphose’ de la pensée. Il désigne une transformation complète de la personne, comparable à celle qui se passe à l’intérieur d’une chrysalide.
xxxC.G. Jung. Ma vie,Gallimard, 1973, p. 528
xxxiC.G. Jung. Ma vie,Gallimard, 1973, p. 26
xxxiiC.G. Jung. Ma vie,Gallimard, 1973, p. 534
xxxiiiC.G. Jung. Ma vie,Gallimard, 1973, p. 550-552
xxxivGn 2,7
xxxv1 Co 15, 44-46
xxxvi« Renouvelez-vous (ἀνανεοῦσθαι δὲ) en l’esprit de votre pensée (τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν), pour revêtir l’Homme Nouveau. » Eph 4,23

La critique des textes n’est pas faite pour ajouter du sens à ce qui en a déjà, ou ce qui est censé suffisamment en avoir. Elle est faite plutôt, me semble-t-il, pour transformer quelque extrait du monde « écrit » en une partie, souvent toute petite, mais parfois plus grande, d’un monde qui n’est pas encore visible. Il s’agit d’une expérience, non pas d’extraction de sens, mais de transformation, et même de pure création d’un sens d’une tout autre nature. Vaste et noble entreprise ! Mais qui n’est pas sans risques de mauvaise appréciation, et même d’erreurs fatales. Il faut cependant tenter sa chance, la vie est trop courte pour se contenter de faire du surplace ontologique. C’est pourquoi je m’autorise [dans ce blog] à attaquer au pic et au marteau n’importe quel roc, n’importe quel texte, sacré ou profane, ancien ou nouveau, non pour lui enlever ou lui ajouter du sens, ni non plus pour mêler un sens nouveau à ce qui n’en a pas vraiment besoin, mais pour me transformer moi-même en ce que je ne suis pas encore, et que j’aspire à devenir. Cette méthode de travail a son intérêt, je crois. C’est pourquoi je me permets de la partager publiquement, pour ce qu’elle vaut, non pas par une sorte de vanité personnelle (qui serait bien risible, vu l’enjeu), mais parce que tout ce qui incite à laisser vivre l’esprit (le mien ou celui de quiconque) doit être mis en commun, je pense. Deux silex esseulés, ou même placés l’un à côté de l’autre, paraissent a priori très statiques, bien mornes, et foncièrement inertes. Mais empoignez-les, cognez-les d’un coup sec l’un contre l’autre, et de ce choc jaillira une neuve étincelle. C’est là une parabole de la critique, telle que je l’entends ici.
Pour mieux me faire entendre, voici un exemple d’application de cette méthode. Je lisais l’autre jour dans un livre traitant de l’immortalité de l’âmei, un court paragraphe qui se présentait comme étant « une preuve ontologique » de cette immortalité : « Dieu a bien pu faire tout sortir du néant; mais ce qui existe ne peut plus être anéanti (nous voyons bien, dans la nature, des changements de formes mais jamais d’anéantissement). Si la vie a pu sortir du néant, à plus forte raison la vie doit-elle sortir de la vieii. »
Je me mis à réfléchir aux théories actuelles en physique des particules. Seraient-elles en accord avec cette idée talmudique que ‘ce qui existe ne peut plus être anéanti’ ? Mes quelques notions de physique étant un peu trop profondément enfouies dans ma mémoire, je cherchai à les rafraîchir et à me remémorer si la matière et l’antimatière ne s’annihilent pas, en fait, l’une l’autre. Après une brève vérification sur Wikipédia, il me fut confirmé que la rencontre d’une particule et de son antiparticule les « annihile » toutes deux, en effet, mais qu’elle émet en revanche une quantité correspondante d’énergie suivant la formule bien connue E=mc2. Cette « annihilation » donne donc naissance à une paire de photons dont l’énergie correspond à celle des « masses » des deux particules de matière et d’antimatière, qui ainsi s’additionnent en s’annihilant… Le verdict est donc net. L’« annihilation » des particules n’est pas un anéantissement. Leur masse semble disparaître, mais réapparaît immédiatement sous forme d’énergie. Le Talmud avait donc raison sur ce point.
Je remarquai ensuite que le paragraphe sur la « preuve ontologique », auquel je faisais allusion ci-dessus, citait une source : Sanhedrin 91a. On était donc invité à consulter ce traité talmudique, intitulé Sanhedrin. Je lus le passage en référence : « L’empereur de Rome dit à Rabban Gamliel : ‘Tu dis que les morts vivront. Ne sont-ils pas poussière ? Et la poussière viendrait-elle à vivre ?’ La fille de l’empereur dit à Rabban Gamliel : ‘Laisse-le. Je vais lui répondre avec une parabole’. Elle lui dit : ‘Il y a deux artisans dans notre cité. L’un façonne des poteries avec de l’eau, et l’autre avec de l’argile. Lequel est le plus habile ? L’empereur répondit : ‘Celui qui les façonne avec de l’eau.’ Sa fille lui dit : ‘S’il peut façonner une poterie avec de l’eau, ne pourra-t-il pas d’autant mieux en façonner à partir d’argile ? De la même manière, si Dieu a été capable de créer le monde à partir de l’eau, il est certainement capable de ressusciter les hommes à partir de leur poussièreiii. »
Je trouvai l’idée de faire des cruches en eau fort poétique. Mettre de l’eau à boire dans un pot formé seulement par de l’eau ! Superbe image… Décidément le Talmud me plaisait bien.
Continuant la lecture, j’appris que l’école de Rabbi Yishmaël avait proposé une autre métaphore, quoique assez proche, quant à la résurrection des morts. Il ne s’agissait plus du potier, mais du souffleur de verre. Par leur souffle, les verriers, eux-mêmes faits de chair et de sang, façonnent des vaisselles de verre. Si le verre se casse, ou est mal formé, les verriers peuvent toujours le refondre au four et le souffler de nouveau. De même, dit le Talmud, les véritables êtres de chair et de sang, dont l’âme est formée d’un souffle divin, peuvent être rendus à la vie, par un autre souffle. CQFD.
Une autre image encore est proposée dans le traité Sanhedrin. Un roi de chair et de sang dit à ses serviteurs : Allez me construire un palais là-bas, où il n’y a ni eau ni argile. Ils y vont et le lui construisent. Mais un peu plus tard, le palais s’écroule. Le roi leur dit alors : Retournez-au travail et construisez le palais dans cet autre endroit, où vous trouverez cette fois de la bonne argile et de l’eau. Ils lui répondirent : Nous en sommes incapables. Le roi se mit en colère et leur dit : Dans un endroit privé d’eau et d’argile, vous avez pu construire un palais. Dans un lieu qui en est pourvu en abondance, vous devriez pouvoir le faire plus facilement encore… De même, conclut le Talmud à partir de cette histoire, l’homme que Dieu a créé à partir de rien, pourrait être ressuscité à partir de sa poussière.
Ces textes talmudiques se présentent comme des paraboles. Le style est elliptique, la logique pas toujours très claire, mais l’intention générale l’est. Ce qui m’importait le plus dans leur lecture, c’étaient les rebondissements, les sauts de sens, les incises, et surtout les références inter-textuelles. Tout semblait toujours ouvert, et notamment à la critique. Les hypertextes sur lesquels je consultai le Talmudiv, renforçaient cette impression de fluidité. En cliquant sur une citation d’Isaïe incluse dans un autre paragraphe du Sanhedrinv, je lus le verset d’Isaïe 25, 8 : « À jamais il anéantira la mort, et ainsi le Dieu éternel fera sécher les larmes sur tout visage, et disparaître de toute la terre l’opprobre de son peuple: c’est l’Éternel qui a parlé. » Puis je cliquai dans le même paragraphe sur un lien menant vers cet autre verset, Isaïe 65, 20 : «Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards qui n’accomplissent leurs jours; car celui qui mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. » Le Talmud présente ces deux versets comme se contredisant expressément l’un l’autre. Le premier parle en effet de l’anéantissement de la mort, le second de l’inévitable « accomplissement des jours » ainsi que d’une mort, « jeune à l’âge de cent ans ».
Ces deux versets se contredisent-ils ? En apparence seulement. La solution du Talmud pour résoudre la contradiction est fort simple. Elle consiste à invoquer l’autorité de la Guemara, selon laquelle le verset 25,8 est seulement réservé aux Juifs, lesquels « vivront éternellement après la résurrectionvi ». Le verset 65, 20 ne s’applique qu’au destin des Goyim, lesquels, « ultimement, mourront, après avoir vécu une vie extrêmement longuevii ».
Ah ! me dis-je, une vraie coupure ontologique, alors ? Les Juifs vivront tous éternellement, et les Goyim mourront tous un jour ? Je n’avais jusqu’alors aucune raison de douter a priori du Talmud, ni d’Isaïe, mais cela valait le coup (silex contre silex!) de vérifier. Je lus donc le verset 25, 7, celui qui précède immédiatement le verset 25, 8 : « Sur cette même montagne, il déchirera le voile qui enveloppe toutes les nations, la couverture qui s’étend sur tous les peuplesviii. » Tiens donc ! Il me parut qu’Isaïe avait une interprétation bien plus généreuse, et même carrément universaliste, que le Talmud. Je lus ensuite le verset 65, 19, précédant immédiatement le verset 65,20 : « Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie; on n’y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Je vis alors que le verset 65, 20, soi-disant réservé aux Goyim, selon le Talmud, s’adressait explicitement, du point de vue d’Isaïe lui-même, au peuple habitant Jérusalem.
Je méditais sur cette discordance, et même cette contradiction, mentale et morale, entre le Talmud, la Guemara, d’une part et Isaïe, d’autre part. J’en vins alors à ressentir de façon subite une profonde sympathie pour ce dernier. Voilà un prophète selon mon cœur, me dis-je à moi-même. Et je sentis dans la profondeur de ce même cœur, du coup, comme une étincelle.
_______________________________
iGidéon Brecher, L’immortalité de l’âme chez les Juifs, Traduction de l’allemand par Isidore Cahen,1857
iiIbid., p. 82
iiiMa traduction, à partir de la version anglaise du Traité Sanhedrin 91a du Talmud de Babylone, dans la version « The William Davidson Talmud (Koren-Steinsaltz) ».
vSanhedrin 91b
viSanhedrin 91b
viiIbid.
viiiIs 25,7

Je crois qu’on est bien plus grand que tout ce que l’on sait, bien plus grand que ce que l’on croit que l’on est, et qu’on est aussi bien plus petit que l’infinité des choses qu’on ignore — ce qui laisse évidemment beaucoup de marge. De marge pour quoi ? Pour l’imagination et pour la spéculation. Peu avant de mourir, M. Pouget parlait par exemple de ce qu’il appelait « son éternité » : « Elle est tout près et j’y vogue à pleines voiles. Quand on est devant la mort, mon pauvre ! Toute la terre tombe. On avance vers des régions tellement nouvellesi ». Guillaume Pouget était un personnage absolument inclassable. Bien que vivant d’une vie obscure, n’ayant presque rien publié, non reconnu et même « cassé » par la hiérarchie de sa congrégation, il avait notamment fasciné des générations de jeunes normaliens, pendant les trois premières décennies du siècle dernier, et ce, jusqu’à sa mort en 1933. Ma référence à l’admiration à lui vouée par ces « jeunes normaliens » donne peut-être une certaine indication de son aura intellectuelle, de l’originalité ses idées, et surtout de la pertinence de ses méthodes de travail, et de l’orientation de ses recherches, dans le contexte troublé de cette époque, traversée, comme on sait, par de profondes transformations sociales, politiques et morales. C’est aussi grâce aux écrits de deux d’entre eux que nous sont parvenus les éléments les plus saillants de sa mémoire. Ils ont publiéii, avec une sorte de piété filiale, les souvenirs de leurs rencontres presque journalières, pendant de nombreuses années, avec Guillaume Pouget. Cet humble érudit a vécu la dernière partie de sa vie, devenu aveugle, ignoré du monde, dans une petite cellule, au 95 de la rue de Sèvres, le siège de la maison-mère des Lazaristes, à Paris. Il était ignoré du monde, en effet, mais pas complètement. Henri Bergson, par exemple, ne le méconnaissait pas, bien qu’il ne pût le rencontrer qu’à la fin de sa vie… « Conquis par le Père Pouget, par tout ce qu’il savait de lui, par tout ce que je lui en avais dit, par les réponses que je lui avais transmises aux questions qu’il se posait, Bergson, qui ne le connaissait pas encore, me disait le 1er juin 1932 : ‘Il faudrait recueillir tout ce qu’il pense et dit’iii. »
J’évoque aujourd’hui le souvenir de ce lazariste hébraïsant, hellénisant et latinisant, fort savant dans les Écritures, dont il connaissait bon nombre par cœur (en hébreu et en grec), pour deux raisons principales. La première est qu’il était un maître, fort supérieur, de la critique (des textes, mais aussi des dogmes). La deuxième est qu’il avait au dernier degré une sorte d’esprit « paysan ». Il était de par son origine, son enfance et sa première éducation, un paysan, savant certes, mais surtout près de la terre, avec le sens de son immanence, sans toutefois accorder beaucoup de poids philosophique à cette immanence mêmeiv. Acharné au travail, versé dans les mathématiques, dans les sciences physiques, comme dans l’art de l’exégèse, il était avant tout éminemment conscient de la réalité et de la singularité des choses, tout en étant sensible à leur impermanence. Loin d’être un « mystique », c’était un esprit réaliste, vaste, acéré, et fort éloigné des apparences et des illusions du monde. Il disait, avec quelque ironie : « Moi qui ne suis pas mystique, à force d’étudier, je le deviendrai un peuv. » Cette ironie distante ne cachait pas une candeur relevant d’un tout autre ordre. Dans ses dernières années, il pouvait dire : « J’ai ma guenillevi dans cette chambre, mais tout le reste s’en va très loin et très haut. Et je vous prie de croire que je ne suis pas retenu par la terre […] Nous avons des attaches avec le monde invisible, nous tenons à Dieu, beaucoup plus que nous le sentons, par les dernières fibres de notre être. Je ne suis jamais que l’extériorisation d’une des idées divinesvii. »
A propos d’idées, l’une des idées majeures que M. Pouget, cette « idée divine » extériorisée, défendait, était l’importance essentielle de « la connaissance du singulier », laquelle s’oppose, dans l’ordre spéculatif, à la connaissance par l’universel. Ainsi, pour prendre un exemple emblématique, les mathématiques sont condamnées à ne jamais rien connaître des êtres concrets, singuliers, puisqu’elles se limitent à étudier les relations qui existent entre les choses, et font abstraction de ce que sont les choses. Les mathématiques, de par leur essence même, ne donnent aucun accès à la représentation de la singularité ineffable des êtres réels. Elles ne saisissent que des « êtres de raison ». Cela les disqualifie donc, du moins pour ceux qui sont attachés avant tout à la recherche des essences et des fins.
Le mystère du singulier, est, sans vouloir jouer sur les mots, le mystère le plus singulier qui soit. L’univers tout entier en donne la première et fondamentale idée, par son existence même, qui est l’exemple d’une immense et cosmique singularité, faite d’une totalité d’innombrables singularités. Le cosmos fait coexister cette totalité d’êtres singuliers, essentiellement distincts et séparés les uns des autres par leurs singularités et leurs spécificités respectives. Certes, tous ces êtres singuliers (des quarks élémentaires aux corps les plus complexes) donnent aussi lieu à des formes de continuités et d’interactions (ils baignent dans des champs, ils échangent des ondes, gravitationnelles, électromagnétiques, etc.). Mais, en essence, tous les êtres sont plus contigus plus que continus. Autrement dit, ils ne sont pas, par leur existence et par leur essence mêmes, nécessaires à l’existence et à l’essence des autres êtres, proches ou éloignés. Ils ne leur sont en effet que relativement contingents. Leur disparition ne changerait rien à l’ordre du monde concret. Mais, et c’est là un point crucial, leur essence et leur existence jouent toujours, je le pense, un rôle certainement essentiel dans un autre ordre, celui de la surnature.
M. Pouget, et c’est là ce qui aujourd’hui me le rend si attachant, donna aussi, à sa manière, unique et subtile, une vie singulière à chacune des singularités qu’il sut trouver dans les Écritures, singularités si précieuses, si absolues, qu’il nous revient, et après nous, aux générations à venir, de n’en laisser perdre aucune dans l’oubli.
_____________________
iCité par Jean Guitton. Portrait de M. Pouget. Gallimard. 1941, p. 261
iiCf. Jacques Chevalier, Père Pouget. Logia. Propos et enseignements. Grasset, 1955, et Jean Guitton, Portrait de M. Pouget. Gallimard, 1941.
iiiJacques Chevalier, Père Pouget. Logia. Propos et enseignements. Grasset. 1955. Avant-propos, p. ix
ivM. Pouget défendait l’idée d’un « Dieu personnel, distinct du monde et dont il est l’auteur total ». Il n’était pas tenté par la philosophie de l’immanence. A ses yeux, Dieu n’est immanent que pas son action, et encore « en ce sens seulement, sens très réel toutefois, qu’il est plus présent à nous-mêmes que nous n’y sommes présents nous-mêmes. » Cité par Jean Guitton, op.cit., p. 161. Cette idée de M. Pouget eut une destin singulier, car elle se trouva reprise expressément dans l’Encyclique Pascendi publiée le 8 septembre 1907 : « Deus agens intime adsit in homine, magis quam ipse sibi homo » (« Dieu est présent, et agissant intimement en l’homme, davantage que l’homme ne l’est à lui-même »).
vJean Guitton. Portrait de M. Pouget. Gallimard. 1941, p. 169
viC’est ainsi qu’il appelait son corps physique, qui n’était pour lui qu’une sorte de vêtement sans grande valeur intrinsèque.

Deux versets de la Genèse rapportent le moment, tout à fait unique, spécial, de la « création » de l’homme. Le premier de ces versets annonce l’intention de Dieu (Élohim) à ce sujet. Mais le verset suivant en décrit la réalisation effective, laquelle se révèle fort différente de ce qui avait été annoncé, et cela sur plusieurs points cruciaux… Qu’on en juge :
Gen. 1, 26 : « Élohim dit : ‘Faisons homme avec notre image, comme notre ressemblance’. »
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ
va-yomer Elohim na ‘asseh adam be-tsalme-nou ki-demouté-nou
Gen 1, 27 : « Élohim créa l’homme avec son image ; avec l’image d’Elohim, il le créa. »
וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ
va-yvra’ Elohim êt-ha-adam be-tsalmou, be-tsêlêm Elohim bara’ oto
Dans le premier verset, Élohim s’exprime à la première personne du pluriel (« Faisons »). Il emploie aussi cette curieuse expression : « faisons homme »… Il ne dit pas : « faisons un homme » ou «faisons l’homme ». Il dit aussi qu’il veut le faire avec l’image des Élohim, considérés ici comme un pluriel (« avec notre image »). De plus, il précise qu’il veut s’appuyer sur une sorte de modèle préexistant (« comme notre ressemblance »). Autrement dit, Élohim « fait homme », non pas à partir de rien, en extrayant « homme » du néant, mais par l’entremise d’une sorte de matière première (qui serait «[leur] image ») et prenant avantage de leur exemple (« notre ressemblance »).
Or, ce qui est vraiment curieux, c’est que, dans le verset suivant, plusieurs changements essentiels, fondamentaux, sont actés par rapport à ce programme initial. J’en ai compté quatre. Chacune de ces différences est absolument cruciale, comme on va le voir. Voici ces quatre changements :
1. Alors qu’il vient de parler à la première personne du pluriel, dans le premier verset, Élohim « crée » — à la troisième personne du singulier — dans le second verset.
2. Au lieu de « [faire] homme » (‘asseh adam) comme annoncé, « il crée l’homme » (va-yvra’ êt-ha-adam) dans le verset suivant.
3. Au lieu de le faire « avec notre image, comme notre ressemblance », il le crée « avec l’image d’Élohim ». Il n’est désormais plus question de la « ressemblance », mot qui n’est plus cité et qui n’est pas donc pas pris en compte pour cette « création »
4. En revanche, il y a une répétition, ou un doublement de l’acte de création. L’énoncé de cette création en deux temps est rendu avec une très subtile nuance. Dans un premier temps, Élohim crée l’homme « avec son image » (be-tsalmou). Puis dans un deuxième temps, il le crée « avec l’image d’ Élohim » (be-tsêlêm Elohim).
Étonnant, non ? Il nous reste à interpréter ces quatre différences, et à en tirer des leçons nouvelles.
1. La question de l’emploi de la première personne du pluriel (« Faisons ») a fait couler des flots d’encre. Mais selon le Zohar, ce pluriel indique que la Déité possède un « côté mâle » et un « côté femelle ». Le « côté mâle » est représenté par YHVH. Le « côté femelle » est représenté par Élohim. « L’Écriture dit : ‘Et Élohim dit : Faisons homme à notre image.’ Elle ne dit pas : ‘Faisons l’homme’ mais : ‘Faisons homme’, afin d’exclure l’ « Homme » d’en haut, lequel est formé du Nom complet. Quand l’Homme d’en haut est complet, l’homme d’ici-bas l’est également. YHVH est le côté mâle, et Élohim est le côté femelle. Aussi, pour faire l’homme à l’image de Dieu, il a fallu le faire mâle et femelle. Yod [la lettre י] désigne le mâle, Hé [la lettre ה] la femelle ; Vav [la lettre ו] sort des deuxi. »
Il y a donc dans ce passage du Zohar, deux assertions, successives et différentes, de l’union en Dieu d’un principe mâle et d’un principe femelle. La première assimile les deux principes, mâle et femelle, à YHVH et Élohim, respectivement. La deuxième assertion associe ces deux principes à la première lettre, Yod, et à la seconde lettre, Hé, du Nom YHVH [ יְהוָה ]. Quant à l’« Homme », il est assimilé pour sa part à la troisième lettre de ce Nom, le Vav [la lettre ו], dont la forme même rappelle la silhouette humaine, ce que les maîtres du Zohar ne se sont pas privés de souligner. L’Homme apparaît donc comme étant l’« enfant » du couple formé par YHVH et Élohim.
Mais qui est réellement cet « Homme d’en haut » ? On en a une première indication, fournie par le prophète Ézéchiel. Dans sa « vision », Ézéchiel vit par-dessus le firmament « une forme de trône, et sur cette forme de trône une forme [demout] comme une apparence d’homme [ki-mar’ah adam], dans les hauteursii ».
Résumons. Selon le verset Gn 1,26, au moment d’envisager la création de l’homme, c’est Élohim qui s’exprime au nom du couple YHVH – Élohim, et qui dit « Faisons homme ». Mais dans le verset Gn 1,27, Élohim, seul, « crée l’homme ». Pourquoi cette absence de YHVH au moment de la création, alors qu’il était implicitement présent lors de la décision de « faire homme » ? On peut penser que YHVH était alors occupé, pour sa part, à créer l’« Homme d’en haut », cet Homme qui est au-dessus de son propre trône (le trône de YHVHiii). Mais ce n’est-là qu’une interprétation. Le mystère s’épaissit.
2. La différence entre « faire homme » et « créer l’homme » est assez frappante pour être soulignée et analysée. Le verbe « faire » (‘asah) implique la présence d’une matière ou d’une substance préalable avec laquelle on « fait » ou on « forme », tout comme un potier « fait » ou « forme » un pot avec de la glaise. Mais le verbe « créer » (bara’) implique une création ex nihilo. La différence entre les verbes « créer », « faire », et « former, façonner » (yatsar) est très notable, et fort instructive. Ainsi, il est écrit : « Tous ceux qui se réclament de mon nom, ceux que j’ai créés, façonnés pour ma gloire, ceux que j’ai faits iv ! ». Le Zohar commente : « L’Écriture se sert des trois termes : « créer » qui désigne le « côté gauche », « former » qui désigne le « côté droit », ainsi qu’il est écrit : « Qui forme la lumière et qui crée les ténèbres ? »v — et « faire », qui désigne le « milieu », ainsi qu’il est écrit : « Qui fait la paix en hautvi ? …» L’Écriture applique donc à l’homme ces trois termes, afin de nous indiquer que l’homme ici-bas représente exactement la Gloire divine d’en haut. Et où l’Écriture applique-t-elle à l’homme les trois termes du monde d’en haut ? Dans le verset suivant : « Qui forme la lumière, qui crée les ténèbres, qui fait la paixvii ? » Voilà les trois mêmes termes employés pour la formation du monde d’en haut, ainsi que pour celui d’ici-basviii. »
La référence faite par le Zohar au verset d’Isaïe 45,7 est en réalité incomplète. Si on le restitue dans son intégralité, on lit : « Je forme la lumière, je crée les ténèbres; je fais la paix et je crée le mal. Moi, YHVH, je fais tout cela. » On voit qu’Isaïe associe le verbe « créer » aux ténèbres et au mal. Il associe le verbe « faire » à la paix et à l’ensemble de la création. On comprend mieux alors la différence qu’il y a entre « faire homme » et « créer l’homme ». « Faire homme » c’est l’assimiler à ces actions de YHVH : « faire la paix » et « faire le monde ». Mais « créer l’homme », c’est le mettre en compagnie des « ténèbres » et du « mal ».
3. On l’a dit, Élohim projetait tout d’abord de « faire homme » — « avec notre image, comme notre ressemblance ». Or, dans le verset suivant, on apprend que l’homme est non pas « fait », mais « créé » — « avec l’image d’Élohim ». Il n’est désormais plus question de « ressemblance », mot qui n’est plus cité et qui n’est pas donc pas pris en compte pour cette « création ». Pourquoi ? L’explication que je propose vient de l’étymologie des deux mots hébreux « image » (tsêlêm) et « ressemblance » (demout). Le mot tsêlêm a pour premier sens « ombre, ténèbres », et comme second sens « idole, image ». Il possède donc plusieurs connotations négatives. Être « créé avec l’image d’Élohim », signifie que l’on est créé, en quelque sorte, avec son « ombre ». En revanche le mot demout est chargé de connotations positives. Sa racine verbale est damah, « ressembler », dont vient aussi le substantif dam, « sang ». Parler de « ressemblance » en hébreu revient donc à suggérer que l’on a le même « sang ». Autant le verset 26 promet à Adam une ressemblance et une parenté de « sang » avec Dieu, autant le verset 27 les lui refusent.
4. Qu’implique la nuance du verset 27, selon laquelle Élohim crée d’abord l’homme « avec son image » (be-tsalmou), puis le crée « avec l’image d’ Élohim » ? Il y a plusieurs possibilités d’interprétation. Ne voulant pas fatiguer le lecteur, je me contenterai d’exposer celle qui me paraît la meilleure. D’abord, le fait qu’il y ait deux temps (ou deux mouvements) de création indique que celle-ci n’est pas statique, elle est toujours en devenir. Élohim revient une deuxième fois sur sa première création. C’est donc qu’il pourrait y revenir, à nouveau, dans le futur. (On en aurait bien besoin, vu l’état du monde). Mais il y plus à en dire… Dans l’expression « avec son image », le pronom possessif son ne se réfère pas, selon moi, à Élohim, mais à Adam. Élohim crée d’abord Adam avec l’image d’Adam, avec cette image pré-éternelle d’Adam qui est son image, c’est-à-dire son idée ou son paradigme. Puis, dans un second temps, Élohim se ravise en quelque sorte, et décide de retoucher cette image en utilisant cette fois l’image d’Élohim lui-même.
Que retenir de tout cela ? Le fait que l’affaire est loin d’être close. La création va continuer, dans l’avenir, n’en doutons pas…. Il reste par exemple, pour « faire homme », à le compléter avec la « ressemblance » d’Élohim, et peut-être même, dans un temps plus lointain encore, avec celle de YHVH.
_______________________
iSepher ha-Zohar II, 178 a. Traduction sur le texte chaldaïque par Jean de Pauly. Maisonneuve et Larose, 1985, Tome IV, p.142
iiEz 1,26
iiiDans ce chapitre, Ezéchiel n’emploie pas le nom Élohim, mais seulement le nom YHVH.
ivIs 43, 7
vIs 45,7
viJob 25,2
viiIs 45,7
viiiSepher ha-Zohar II, 155a. Traduction sur le texte chaldaïque par Jean de Pauly. Maisonneuve et Larose, 1985, Tome IV, p.84

Une tradition talmudiquei nous apprend que tout Psaume commençant par les mots : «Psaume de David » n’est pas inspiré par l’Esprit-Saint. Seuls les Psaumes qui commencent par les mots « De David, un psaume » le sont… Mais le point de vue de cette tradition semble très discutable, à tout le moins. Elle impliquerait, par exemple, que le Psaume 53 n’a pas été inspiré par l’Esprit-Saint puisque son premier verset est : « Psaume de David, lorsqu’il était dans le désert de Yehudah ». Or ce Psaume constitue pourtant l’un des cantiques les plus sublimes qui soient, selon l’opinion du Zoharii. Pourquoi est-il si sublime ? Il l’est parce que son deuxième verset commence par une triple, innovante et directe interpellation de la Divinité, suivie d’un cri d’amour et de désir : « Elohim, mon Dieu, Toi !, je te cherche ! Mon âme a soif de toi, ma chair te désire ! » Ces trois appels successifs, « Elohim », « mon Dieu », « Toi », me semblent, à première vue, évoquer trois degrés croissants d’intimité entre le Psalmiste et Dieu. « Elohim » (אֱלֹהִים , littéralement « Seigneurs ») est le terme courant pour désigner la Divinité dans la tradition élohiste. Le fait même que cette expression prenne la forme grammaticale d’un pluriel, semble traduire une certaine distance de cette pluralité par rapport à la singularité de la personne humaine. La seconde expression, « Mon Dieu » (אֵלִי , Eli), indique, par l’usage de la première personne du possessif, un premier niveau d’appropriation de la Divinité par le Psalmiste, une sorte de possession revendiquée comme personnelle. La troisième expression, « Toi ! » (אַתָּה , Attah) révèle, par l’emploi du tutoiement direct, une intimité plus grande encore.
Cependant, j’ai trouvé dans le Zohar une autre interprétation de cette succession de trois Noms de Dieu. Selon le Zohar, le nom « Elohim » désigne « le Dieu vivant d’en haut ». Le nom « El » désigne « le Dieu dont l’Écriture dit que sa gloire s’étend d’une extrémité du ciel à l’autre ». Et le pronom personnel « Toi » désigne « les Deux [degrés de la Divinité] réunisiii ».
On peut aussi remarquer que ces trois Noms de Dieu, ainsi énoncés à la suite, constituent par leur assemblage scripturaire, une sorte de paradigme d’allure « trinitaire ». Cela, en soi, est assez piquant, quand on connaît les attaques du judaïsme orthodoxe quant au concept de « trinité » développé dans la théologie trinitaire du monothéisme chrétien. Mais ce qui me semble particulièrement intéressant est que ce paradigme « trinitaire » s’applique aussi, toujours selon le Zohar, à la structure même de l’âme humaine. Celle-ci est en effet désignée sous trois noms : ‘Nephech’, « l’esprit vital », ‘Rouaḥ’, « l’esprit intellectuel » et ‘Nechama’, « l’âme » proprement diteiv. Ces trois parties de l’âme forment une unité qui est dite être à l’image de Dieu. « Les trois parties de l’âme sont formées à l’exemple [des Trois] d’en haut, qui ne forment qu’une unité. ‘Nephech’ n’a point de lumière qui lui soit propre ; il a cela de commun avec le corps qu’il ne sert que pour délecter et nourrir celui-ci […] ‘Rouaḥ’ domine et éclaire ‘Nephech’, le second sert de piédestal au premier. ‘Nechama’ domine ‘Rouaḥ’ et l’éclaire de la lumière vivifiante. Voilà comment les trois parties de l’âme se tiennent ensemble à l’exemple d’en hautv. »
Un peu plus loin, le Zohar décrit ce qui se passe lors de la mort, et le sort destiné à ces trois composantes. « Tout ‘Nephech’ ne demeure pas près du corps ; il y en a qui ne trouvent jamais de repos. Ceux qui se séparent du corps dès le moment de la mort ne trouvent point de repos […] Un tel ‘Nephech’ erre constamment dans le monde et ne trouve de repos ni jour ni nuit ; c’est le châtiment le plus terrible de tous. C’est d’un tel ‘Nephech’ que l’Écriture dit : ‘Et cette âme [Nephech] périra devant moi ; je suis le Seigneurvi.’ Que signifie ‘devant moi’ ? — Il ne sera pas attaché à ‘Rouaḥ’ . Lorsqu’il en est détaché, il n’a rien de commun avec le monde d’en haut et n’en a aucune connaissance ; il ressemble à l’esprit vital des animaux. Le ‘Nephech’ qui trouve du repos est accueilli par ‘Idoumiam’ et ses cohortes qui lui ouvrent toutes les portes du paradis et lui font voir la gloire des justes ainsi que la gloire de son propre ‘Rouaḥ’ ; le ‘Nephech’ s’attache alors à son ‘Rouaḥ’ et l’entoure comme un vêtement, et c’est ainsi qu’il apprend les choses de l’autre monde. Et quand ‘Rouaḥ’ monte pour recevoir la couronne de sa ‘Nechama’ d’en haut, ‘Nephech’ s’attache à lui et en reçoit la lumière, comme la lune reflète celle du soleil. Pendant que ‘Rouaḥ’ s’attache à sa ‘Nechama’, celle-ci s’attache à la ‘Fin de la Pensée’ qui constitue le mystère du ‘Nephech’ d’en haut. Celui-ci s’attache au ‘Rouaḥ’ d’en haut, et celui-ci s’attache à la ‘Nechama’ d’en haut, et celle-ci enfin s’attache à l’infinivii. »
Que retenir de ces fascinantes digressions ? Il me semble que la piste de recherche la plus prometteuse est d’analyser l’anagogie implicite entre la structure trinitaire de l’âme et la structure, elle aussi trinitaire, des Noms de Dieu telle que révélée dans le psaume 53. On voit que ‘Nephech’, l’esprit vital, peut être alors associé à Elohim ; ‘Rouaḥ’, l’esprit intellectuel peut être assimilé à El ; et ‘Nechama’ peut correspondre au Nom réduit au simple pronom Toi. On en induit que ‘Nephech’ participe de la Vie, laquelle est l’essence d’Elohim, que ‘Rouaḥ’ participe de l’Esprit, nommé El, et que de la ‘Nechama’ seule, sourd la source la plus intime de la personne. La ‘Nechama’ est l’essence même du Moi. Et c’est le Moi, seul, non la Vie ou l’Esprit, qui est en capacité d’interpeller Dieu même et de s’adresser à lui, en lui disant : ‘Attah !’… Toi !
______________________
iTalmud, tr. Pessaḥim, fol. 117 b et Zohar I , fol. 39b
iiZohar II, 140a
iiiIbid.
ivCf. Zohar II, 141b
vZohar II, 142a. Trad. Jean de Pauly, 1985, p.49
viLévit. 17,10
viiZohar II, 142b. Trad. Jean de Pauly, 1985, p.51

Toute religion se base, en dernière analyse, sur des mots, publiquement prononcés, et surtout sur des noms. Ces mots et ces noms varient bien sûr, suivant les langues, les cultures, les civilisations, mais ils se rapportent toujours à « quelque chose » qui, en réalité, n’a aucun mot pour être dite. De cela, il ressort d’intrinsèques contradictions, de multiples jeux de langage, des commentaires sans fin, et beaucoup de confusion pour les esprits qui voudraient y voir plus clair, mais souvent en vain.
A titre d’exemple je partirai d’un verset de l’Exode où sont prononcés à la suite, plusieurs noms du Dieu censé être « Un », sans qu’une claire explication ne soit donnée de ce fait que l’unité divine se nomme (elle-même) de si différentes façons : « Elohim parla à Moïse, et lui dit : Je suis YHVHi. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme El Shaddaï, mais je ne me suis pas fait connaître à eux sous mon nom de YHVHii. »
Dieu lui-même s’adresse à Moïse (il lui « parle », il lui « dit ») sous le nom YHVH. Mais, pour que le mystère soit bien souligné, Dieu précise qu’il s’est « fait connaître » d’Abraham, Isaac et Jacob sous un autre nom, El Shaddaï. Voilà donc trois noms du Dieu Un qui sont énoncés en deux versets : Elohim (אֱלֹהִים), YHVH (יְהוָה) et El Shaddaï (אֵל שַׁדָּי). Ces trois noms en sont en réalité quatre puisque El Shaddaï représente le nom El (אֵל) associé au nom Shaddaï (שַׁדָּי). Une première interprétation de cette diversité des noms de Dieu pourrait être qu’ils correspondent à divers aspects de son essence, ou bien à divers degrés d’interprétation de cette essence. Pour l’apprécier, une première analyse sémantique est nécessaire. Elohim est le pluriel du mot El (« Seigneur »). YHVH est un nom essentiellement mystérieux, révélé pour la première fois à Moïse, mais pas aux premiers patriarches. El Shaddaï signifie mot-à-mot : « Seigneur Tout-Puissant ». Autrement dit, ces noms divers du « Dieu » invitent à méditer sur la complexité de son essence unique, en l’illustrant par certaines de ses facettes, éminemment plurielles…
Les commentaires sur ce verset ont été innombrablesiii. Mais je voudrais me concentrer sur celui de Rabbi Abba, qui est cité dans le Zohariv. Il donne en effet une fort curieuse interprétation du Nom le plus mystérieux qui soit, YHVH… Dans son explication, Rabbi Abba commence par évoquer un verset d’Isaïe : « Mettez votre confiance dans YHVH pour toujours; car, en Yah YHVH, est un roc éternelv ». L’affaire se complique donc d’emblée avec l’ajout de cet autre nom divin : Yah YHVH !… Yah (יָהּ) est un fort ancien nom de la Divinité, qui était déjà utilisé à Akkad et qui semble remonter sans doute à la civilisation de Sumer. Les deux lettres de Yah (YH), il importe de le noter, sont aussi les deux premières lettres du Tétragramme YHVH. Mais ces détails ne semblent pas importer pour Rabbi Abba. Il se concentre essentiellement sur l’expression « pour toujours » que j’ai employée pour traduire (approximativement) l’hébreu ‘adéi-‘ad (עֲדֵי-עַד), et qui signifie mot-à-mot « jusqu’à (‘adéi-) l’éternité (‘ad) ». C’est le même mot (‘ad), mais qui est employé d’abord comme préposition adverbiale, puis comme substantif. Rabbi Abba explique : « Tous les hommes doivent se fortifier dans le Saint, béni soit-il, et y mettre leur confiance. Mais que signifient les mots ‘adéi-‘ad ? ‘Ad est la désignation de ce degré céleste où l’on se fortifie, ainsi qu’il est écrit : ‘Il dévorera la proie (‘ad) le matin’. C’est le degré qui forme le trait d’union entre tous les autres degrés et qui est l’objet de désir de tout le monde ; c’est de ‘ad qu’on ne doit jamais se séparer, ainsi que cela a déjà été dit : ‘… Jusque (‘Ad) au désir des collines éternellesvi’ Qui sont les collines éternelles ? Ce sont les deux Mères, constituant le Principe femelle et symbolisées par l’année jubilaire et l’année sabbatique ; ce sont elles que l’Écriture appelle les ‘collines éternelles’ (‘olam). Le mot désigne chacune des deux mères, ainsi qu’il est écrit : ‘Que le Seigneur, le Dieu d’Israël soit béni d’un monde (‘olam) à l’autre monde (‘olam)vii.’ Les deux Mères soupirent après ‘Ad; la Mère symbolisée par le וָ [du Tétragramme יְהוָה] et par l’année jubilaire soupire après ‘Ad dans le désir de Lui tresser des couronnes, d’attirer sur Lui les bénédictions et de verser sur Lui les eaux douces de la Source […] La mère symbolisée par le 2e ה [du Tétragramme יְהוָה] et par l’année sabbatique soupire après ‘Ad dans le but d’être bénie par Lui et d’être éclairée par Sa lumière. En vérité, tel est le sens des mots : « ‘Ad est le désir des collines éternelles ». C’est pourquoi l’Écriture dit : ‘Mettez votre confiance dans le Seigneur jusqu’à ‘Ad [symbolisé par le 1er ה du Tétragramme יְהוָה] ; car au-dessus de cet ‘Ad tout est caché et mystérieuxviii. »
On comprend donc, selon cette interprétation de Rabbi Abba, que le Tétragramme יְהוָה s’analyse comme étant formé d’abord d’un Principe, éminemment caché et mystérieux, le יְ initial de יְהוָה, puis par une « Mère d’En-Haut », symbolisée par le premier 1er ה du Tétragramme יְהוָה, qui représente l’Éternité, puis par une Mère symbolisée par le vav וָ du Tétragramme, qui fait « le trait d’union » entre ce monde-ci et le monde d’En-Haut, et enfin par une Mère symbolisée par le 2e ה du Tétragramme, qui représente la « Mère d’en-bas », Ma, la « communauté d’Israël ».
Tout cela est un peu compliqué, certes, mais somme toute assez logique. Un Père et trois Mères, pourrait-on dire en résumé. Il en ressort surtout que le Tétragramme affiche publiquement, en quelque sorte, une partie de son propre mystère. Il en ressort également que le Principe suprême, qui reste caché, mystérieux, est visiblement accompagné de trois « épouses », qui sont les trois Mères, celle d’En-Haut, la Mère trait-d’union, et la Mère d’en-bas. Ce Principe suprême, ce degré mystérieux entre tous, nous en apprenons aussi le nom : c’est Yah YHVH.
Compliqué, non ?
Mais réjouissons-nous d’avoir un peu percé le mystère !
Allélou Yah !
________________
iEx 6, 2 : וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים, אֶל-מֹשֶׁה; וַיֹּאמֶר אֵלָיו, אֲנִי יְהוָה.
iiEx 6, 3 : וָאֵרָא, אֶל-אַבְרָהָם אֶל-יִצְחָק וְאֶל-יַעֲקֹב–בְּאֵל שַׁדָּי; וּשְׁמִי יְהוָה, לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם.
iiiPar exemple, Rachi (Rabbi Chlomo ben Itzhak HaTzarfati), le célèbre commentateur qui vécut au 11e siècle à Troyes en Champagne, fit pour sa part ce commentaire des versets 2 et 3 du chapitre 6 de l’Exode : «ELOHIM PARLA à MOÏSE. Il lui fait son procès, pour s’être exprimé en termes durs lorsqu’il Lui avait dit : Pourquoi as-Tu fait du mal à ce peuple ? ET IL LUI DIT : JE SUIS L’ÉTERNEL [YHVH]. On peut me faire confiance. Je récompense bien ceux qui « marchent devant Moi ». Et ce n’est pas pour rien que Je t’ai envoyé, mais c’est pour accomplir les paroles que j’ai dites aux premiers patriarches. Nous trouvons cette expression expliquée de cette manière dans beaucoup de textes : JE SUIS L’ÉTERNEL [YHVH], on peut se fier à Moi pour punir, lorsqu’il s’agit de sanction. Ainsi : Tu profanerais le Nom de l’Éternel [YHVH] ton Dieu, Je suis l’Éternel (Lev. 19,12). Et lorsqu’il est question de l’accomplissement des commandements de Dieu. Ainsi : Vous observerez Mes commandements et vous les accomplirez, Je suis l’Éternel (Lev. 22,31), on peut Me faire confiance pour récompenser. JE SUIS APPARU aux patriarches EN EL-SHADDAÏ. Je leur ai fait des promesses, à chaque promesse, Je leur disais, Je suis le Dieu Tout-Puissant. – ET SOUS MON NOM : L’ÉTERNEL [YHVH], JE N’AI PAS ÉTÉ CONNU. Je n’ai pas été reconnu d’eux dans Mon attribut de vérité, en raison duquel Mon Nom est appelé L’ÉTERNEL [YHVH], c’est-à-dire fidèle à donner vérité à Mes paroles. Car Je leur ai fait des promesses, et Je ne les ai pas encore réalisées. » Par son commentaire, Rachi éclaircit certaines questions, mais ces éclaircissements consistent surtout à ajouter d’autres noms encore, ou plutôt d’autres attributs au Dieu Un : Il est aussi, apprenons-nous, le Dieu qui « punit », Celui qui « récompense », le Dieu de « vérité », qui est « fidèle » à Ses paroles et finit toujours par les accomplir.
ivZohar. II, 22a. Section Va-Era. Traduction Jean de Pauly. Ed. Maisonneuve et Larose, 1985. Tome III, p.111 sq.
vIs 26,4 : בִּטְחוּ בַיהוָה, עֲדֵי-עַד: כִּי בְּיָהּ יְהוָה, צוּר עוֹלָמִים.
viGn 49,26
viiPs 106,48 : מִן-הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם min ha-‘olam vé-’ad ha-‘olam. On pourrait traduire aussi : « d’une éternité à une (autre) éternité », le mot ‘olam pouvant avoir ces deux sens : « monde » ou « éternité ».
viiiZohar. II, 22a. Section Va-Era. Traduction Jean de Pauly. Ed. Maisonneuve et Larose, 1985. Tome III, p.111-112

De nos jours, comme de tout temps d’ailleurs, la véritable bataille, la bataille essentielle, reste celle de l’esprit. Loin de se limiter aux seuls conflits armés, elle fait aujourd’hui rage, sous nos yeux. Elle va durer longtemps encore. Il faut en prendre son parti, et réaliser que l’on ne peut rester spectateur. L’on se doit aussi de prendre parti. Avant de décider lequel, examinons les forces en présence. Notons que, dans toute guerre, c’est un avantage indéniable d’avoir YHVH de son côté. YHVH combat, et il écrase les ennemis, il les dépossède même de leurs terres et les donne à ceux qui Le servent. « Vous avez vu tout ce que YHVH votre Dieu a fait à cause de vous à toutes ces populations ; c’est YHVH votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, j’ai tiré au sort pour vous, comme héritage pour vos tribus, ces populations qui restent, et toutes les populations que j’ai exterminées depuis le Jourdain jusqu’à la Grande mer à l’occident. YHVH votre Dieu les chassera lui-même devant vous, il les dépossédera devant vous et vous prendrez possession de leur pays, comme vous l’a dit YHVH votre Dieui. » Mais ce Dieu, si fort, capable d’un tel déploiement de puissance, pose aussi certaines conditions, extrêmement sévères, à ceux-là mêmes qui Le servent, ou qui prétendent le faire, dans tel combat ou telle guerre. Pour illustrer cette ancienne leçon, j’aimerais évoquer l’histoire de l’infortunée ville de Jéricho, que Josué voua jadis à l’anathème.
Josué, ou plus précisément Yehoshu‘a (יְהוֹשֻׁעַ), est un nom hébreu qui signifie littéralement ‘Il sauve’. Ce nom est parfois orthographié ‘Josué’, et parfois ‘Jésus’, en français, pour différencier divers personnages bibliques. Le premier de ces Yehoshu‘a était le successeur de Moïse. « Yehoshu‘a, fils de Nûn, était rempli de l’esprit de sagesseii, car Moïse lui avait imposé les mainsiii. » Ce détail importe. Le texte du Deutéronome ajoute immédiatement après l’annonce de cet adoubement, une sorte de restriction, qui peut valoir d’avertissement pour les générations futures : « Il ne s’est plus levé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que YHVH connaissait face à faceiv. » A la fin de sa vie, Yehoshu‘a donna ses derniers conseils quant à la conduite à tenir au milieu des populations étrangères qu’il s’agissait de dominer. « Montrez-vous donc très forts pour garder et accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi de Moïse sans vous en écarter ni à droite ni à gauchev, sans vous mêler à ces populationsvi qui subsistent encore à côté de vousvii. » Mais l’important est de savoir que YHVH est toujours là pour combattre, et faire le travail, et même s’il est un peu sale. « YHVH a dépossédé devant vous des populations grandes et fortes, et personne n’a pu, jusqu’à présent, vous tenir tête. Un seul d’entre vous pouvait en poursuivre mille, car YHVH votre Dieu combattait lui-même pour vous, comme il vous l’avait ditviii. » Mais attention, que cela soit bien entendu : pas de mélange, pas de mariage avec ces populations. « Mais s’il vous arrive de vous détourner et de vous lier au restant de ces populations qui subsistent encore à côté de vous, de contracter mariage avec elles, de vous mêler à elles et elles à vous, alors sachez bien que YHVH votre Dieu cessera de déposséder devant vous ces populations (« ces goyimix ») : elles seront pour vous un filet, un piège, des épines dans vos flancs et des chardons devant vos yeux, jusqu’à ce que vous ayez disparu de ce bon sol que vous a donné YHVH votre Dieux. » Le peuple est dûment prévenu, s’il se rapproche de ces « populations », YHVH cessera de « déposséder » ces dernières de leurs bonnes terres… Yehoshu‘a ajouta encore ce dernier avertissement : « S’il ne vous paraît pas bon de servir YHVH, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir. » Le peuple répondit : « Loin de nous d’abandonner YHVH pour servir d’autres dieuxxi ! » Mais Yehoshu‘a n’était pas convaincu par une telle allégeance, qui lui semblait vide, purement verbale. Il dit d’ailleurs au peuple : « Vous ne pouvez pas servir YHVH car il est un Dieu saint, Luixii, il est un Dieu jaloux, Luixiii, qui ne tolérera pas vos transgressions ni vos péchésxiv. »
« Il est un Dieu saint, Lui ». Sous-entendu, vous le peuple, vous n’êtes certes pas des saints. Or tout est lié, en matière de sainteté, et en matière d’anathème, tout le monde se trouve lié par la terrible loi du hérêm. Il suffit d’un seul « non saint » pour que le peuple ne le soit plus dans son ensemble et que tous subissent alors les conséquences de l’anathème. Or c’est exactement ce qui se passa quand l’anathème fut prononcé sur la ville de Jéricho. On va voir comment la violation de l’anathème par Akân, de la tribu de Juda, fit que « la colère de YHVH s’enflamma contre les Israélitesxv ». Avant de lancer l’assaut final contre Jéricho, Yehoshu‘a l’avait en effet vouée à l’anathème. « La ville sera dévouée par anathème à YHVH, avec tout ce qui s’y trouve […] Mais vous prenez bien garde à l’anathème, de peur que, poussés par la convoitise, vous ne preniez quelque chose de ce qui est anathème, car ce serait rendre anathème le camp d’Israël et lui porter malheur.xvi »
Mot étrange, terrible, effroyable, que celui d’anathème.
Une ville vouée à l’anathème, en hébreu hérêm (חֵרֶם), subit un sort radical : les hommes, les femmes, les enfants et les animaux y sont tous mis à mort, et tous les objets précieux, l’or, l’argent et le bronze sont livrés au trésor du sanctuaire de Jérusalem. En français, le mot anathème signifie : « objet détruit ou victime immolée, offerts en expiation à une divinité ; objet de malédiction » et, par métonymie « acte par lequel un être est frappé de malédiction ». Il vient du grec ἀνάθημα, mot dont le sens littéral est « ce qu’on place par-dessus, ce qu’on offre en outre ». En hébreu, le mot חֵרֶם, ḥérêm, signifie « filetxvii ; destructionxviii ; chose consacréexix ». La racine en est le verbe ḥaram « se défendre la jouissance d’une chose en la sacrifiant ; consacrer, sacrifier ; détruire, extirper ». Ses acceptions mêlent intimement destruction et consécration.
Or, à Jéricho, Akân de la tribu de Juda prit des objets qui tombaient sous l’anathème. Sur le moment cela passa inaperçu. Mais bientôt après, l’armée conduite par Yehoshu‘a échoua à prendre la ville d’Aï, près de Bet-Avèn, et subit des pertes. Yehoshu‘a déchira ses vêtements, se prosterna face contre terre devant l’arche de YHVH, et se lamenta. YHVH lui dit : « Relève-toi ! Pourquoi rester ainsi prosterné ? Israël a péché, il a violé l’alliance que je lui avais imposée : Oui ! On a pris de ce qui était anathème, et même on l’a dérobé et même on l’a dissimulé, et même on l’a mis dans ses bagages. Eh bien, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis parce qu’ils sont devenus anathèmes. Si vous ne faites pas disparaître du milieu de vous l’objet de l’anathème, je ne serai plus avec vous. Lève-toi, sanctifie le peuple et tu diras : Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle YHVH, le Dieu d’Israël : L’anathème est au milieu de toi, Israël ; tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis jusqu’à ce que vous ayez écarté l’anathème du milieu de vousxx. » L’affaire se termina fort mal pour Akân. Après avoir été découvert, il fut mis à mort ainsi que toute sa famille, sur l’ordre de Yehoshu‘a.
Un autre cas célèbre d’anathème vaut d’être rapporté. Il s’agit de Balthazarxxi, le dernier roi de Babylone, qui donna un grand festin pour ses vassaux, où il fit servir du vin. Ayant goûté ce vin, il se fit apporter les vases d’or et d’argent que son père Nabuchodonosor avait autrefois pris au sanctuaire de Jérusalem, pour y faire boire ses seigneurs, ses concubines et ses chanteuses. Tout le monde but dans ces vases, et fit louange « aux dieux d’or et d’argent, de bronze et de fer, de bois et de pierrexxii ». Cette profanation à peine commise, apparurent des doigts de main humaine qui se mirent à écrire quelques mots sur le mur du palais royal. Le roi se troubla. Il manda en criant devins, chaldéens et exorcistes. Mais nul ne sut lire l’inscription. La reine lui conseilla de faire appel à Daniel, surnommé Baltassar par le roi Nabuchodonosor. Daniel déchiffra alors les mots, écrits en hébreu, Mené, Mené, Teqel, et Parsin. Et il en donna l’interprétation suivante : « Mené : Dieu a mesuré ton royaume et l’a livré. Teqel : tu as été pesé dans la balance et ton poids se trouve en défaut. Parsin : ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Persesxxiii. » Beau joueur, Balthazar récompensa Baltassar (Daniel) pour son interprétation. Mais cette nuit-là, Balthazar fut assassiné. Il ne fait jamais bon profaner les objets consacrés, les objets voués à l’anathème.
Maintenant appliquons ces leçons antiques à la situation actuelle. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, YHVH ait décidé de combattre ou d’aider à combattre une guerre de « radhyation » contre un peuple particulier. Imaginons que YHVH exige en contrepartie que le peuple ainsi victime de l’ire divine soit voué en anathème, ou plutôt en ḥérêm. Mais alors, quel terrible malheur, et un malheur à double tranchant, tant pour le peuple qui est attaqué que pour celui qui l’attaque ! L’anathème lie, littéralement pour l’éternité, tout ce qui appartient au peuple attaqué et voué à l’anathème, toutes ses possessions, ses richesses, ses terres. Le ḥérêm oblige par conséquent le peuple attaquant, en l’occurrence Israël, à les respecter comme appartenant au sanctuaire de YHVH. Ah, quelle situation inextricable ! Quel sérieux, très sérieux et très sévère caveat… Toutes les vies, humaines et animales, de ce peuple, seront certes réputées pouvoir être sacrifiées à YHVH dans cette guerre « sacrée ». Mais toutes les richesses de ce peuple, et en particulier ses maisons (non encore détruites) et ses terres (même brûlées) devront être versées comme propriété inaliénable au trésor du Temple de YHVH. Attention, rien ne doit manquer. Yehoshu‘a nous a déjà prévenus. Si la moindre parcelle de terrain, ou la moindre maison, était, en violation de l’anathème, appropriée par un membre de la tribu de Juda ou de quelque autre tribu, alors le ḥérêm serait au milieu de toi, Israël.
_________________
iJos 23, 3-5
iiרוּחַ חָכְמָה « Ruaḥ ḥokhmah »
iiiDt 34,9
ivDt 34, 10
v[J’imagine donc que tant l’extrême droite que l’extrême gauche sont également bannies].
vi[C’est là une injonction fort claire, mais qui me paraît relever de l’apartheid, me semble-t-il].
viiJos 23, 6-7
viiiJos 23, 9-10
ixJos 23, 13 « déposséder les goyim הַגּוֹיִם «
xJos 23, 12-13
xiJos 24, 15-16
xii« Elohim qadoshim, hu’ » אֱלֹהִים קְדֹשִׁים, הוּא
xiii«El qanna, hu’ » אֵל-קַנּוֹא הוּא
xivJos 24, 19
xvJos 7,1
xviJos 6,17
xvii« Il l’attire dans son filet » ; Hab. 1,15. « Le coeur de la femme est un rets (rempli de séduction » Eccl. 7,26
xviii« Il n’y aura plus de destruction » Zach. 14,11
xix« Tout ce que l’on consacre en anathème en Israël » Nb 18,14. « Chaque objet consacré que l’homme dévouera à l’Éternel » Lv. 27,28
xxJos 7, 10-13
xxiLe nom babylonien Bel-shar-uçur signifie « [le dieu] Bel protège le roi ».
xxiiDn 5, 4
xxiiiDn 5, 25

L’ancienne religion juive, dès son origine, privilégia l’oblation du sang, le sacrifice au Dieu d’un animal : un taureau, une génisse, un bouc, une chèvre, un agneau, ou encore une colombe, par ordre (décroissant) de coût, et donc d’importance des prières ainsi tarifées et monnayées. Selon l’égyptologue Jan Assmann, comme pour d’autres anthropologues, le sacrifice d’ovins ou de bovins a été initialement conçu par Moïse comme une façon de se démarquer radicalement de l’antique religion égyptienne. Celle-ci considérait en effet le Taureau (Sérapis) comme un avatar divin. On conçoit que le judaïsme, dans sa haine des « idoles » égyptiennes, ait pu vouloir sciemment ordonner de sacrifier le « taureau » et d’autres bovidés, qui en incarnaient la quintessence. Leur sang coule alors en abondance sur l’autel du Dieu, mais ce sang est fondamentalement « impur » (l’idée resta ancrée dans l’esprit des peuples : « Qu’un sang impur abreuve nos sillons ! »). Le sang, comme les chairs mortes, se corrompt à l’air et il emplit alors le Temple de puanteurs vite insupportables. Il faut le laver à grande eau, ou bien brûler la chair avec son sang sur la braise, pour en faire un « holocauste » (littéralement une « consumation totale »).
Bien avant le temps d’Abraham ou de Moïse, et beaucoup plus loin vers l’Orient, dans le bassin de l’Indus, la religion plus ancienne du Véda était organisée quotidiennement autour du sacrifice du lait de la vache, – et non de son sang. Autre civilisation, autre sensibilité, autre vision du monde – et du divin.
Par un contraste frappant avec la religion juive qui célébrait l’holocauste du bovidé ou de l’ovidé, et en une différence notable, aussi, avec les cultes à mystère et le mithraïsme de l’Empire romain, qui prônaient le sacrifice du taureau, la religion védique a toujours considéré la vache comme étant éminemment « sacrée », ce qu’elle est aujourd’hui encore pour l’hindouisme.
Dans la tradition du Véda, la vache joue un rôle unique dans le cycle cosmique de la vie. La lumière du soleil inonde la terre, elle fait pousser l’herbe qui nourrit la vache, laquelle produit le lait. Ce lait tire en dernière analyse son origine des forces cosmiques. Dans le sacrifice, il est utilisé sous la forme du « beurre clarifié », liquide, inflammable, et produit d’une fermentation. Ce « beurre clarifié » entre dans la composition du Sôma, auquel on ajoute d’autres sucs végétaux, eux aussi susceptibles de fermenter.
La fermentation est un phénomène universel, qui frappa les Anciens depuis les temps les plus reculés. La fermentation de la pâte résultant du mélange de l’eau et de la farine, la fermentation du houblon, de l’orge ou du jus de la vigne, ont excité leur sens du mystère, leur intuition que des puissances invisibles étaient à l’oeuvre. D’où venait cette vie invisible, s’agitant en silence, mais non en vain, pour finalement donner aux hommes le pain, la nourriture la plus essentielle, et le vin ou la bière, ces boissons super-essentielles, car analogues aux ambroisies divines ?
Le Sôma védique, mêlé de beurre clarifié et de plusieurs sucs végétaux, résulte donc de multiples fermentations. Mais le fait essentiel est que sa consommation va induire une nouvelle fermentation, celle de l’esprit et de l’âme des hommes… Le Sôma, d’origine cosmique (par le biais de l’énergie solaire), d’origine terrestre (par son lien avec le végétal et l’animal) et d’origine humaine (par la médiation du rituel sacrificiel et surtout par la transformation de l’esprit du sacrifiant), va permettre un retour à l’Origine, primordiale, de toutes ces origines. Sous les espèces de la flamme, de la fumée et de l’odeur, mais aussi sous la forme de l’extase, au sein du brasier de l’âme, cet incendie psychique nourri d’une puissance proprement psychotrope, le Sôma met le ‘feu’ à l’âme de l’homme, complétant ainsi le grand cycle cosmique du divin, l’ayant lié en son lieu à l’humain.
Dans ce cycle du Sôma, la fermentation joue un rôle crucial, elle est au coeur du mystère. Le mot français « ferment » permet d’en soulever les premiers voiles. Il vient du latin fermentum, « levain ; levure ». Ce mot dérive lui-même du verbe ferveoi, dont la racine proto-indo-européenne est *bhreuii-, « bouillir, faire des bulles, mousser, brûler ». Cette proto-racine est à l’origine de la racine sanskrite bhur भुर् qui a donné plusieurs mots : bhurnih « violent, passionné »; bhurati « trembler, battre, remuer », bhūrṇi «excité, impétueux, sauvage, en colère », jarbhurīti « mouvement rapide ». La racine sanskrite bhur a aussi donné les mots grecs phrear « source, citerne », et phurô « mouiller, tremper ; mêler ; pétrir », au passif : « être brouillé, confondu, se brouiller, se confondre » et au figuré « se troubler ». Elle a également donné le latin fervere « bouillir, mousser », le grec thrace brytos « liqueur fermentée à base d’orge »; le russe bruja « courant »; l’ancien irlandais bruth « chaleur »; l’ancien anglais breowan « brasser », beorma « levure »; l’ancien haut allemand brato « viande rôtie » mais aussi brot, et braupa « pain au levain ».
Sur le plan biologique, on sait maintenant que les « ferments » se composent d’êtres microscopiques vivant et se développant au sein de certaines matières organiques dont ils provoquent la transformation moléculaire. Mais, on le voit, dans de nombreuses langues, on trouve associé à la notion de fermentation un riche arc de divers sens, qui vont du physique et du chimique au mental et au psychique… Le mot « ferment » a ainsi pris en français, au sens figuré, le sens de « ce qui fait naître ou entretient un sentiment ou un étatiii ». Il est notable par exemple, que le « levain » (ce ferment qui fait « lever » la pâte) est à la base de nombreuses métaphores évangéliques:
« Sur ces entrefaites, les gens s’étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l’hypocrisieiv. »
« Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d’Hérodev. »
« C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâtevi? »
Le « levain » évangélique n’était, en somme, qu’une reprise de la métaphore première d’un levain bien plus originaire, le Sôma.
Le Véda consacre au culte du Sôma, qui est « l’âme primordiale du sacrifice »vii, une importante liturgie, dont les détails sont conservés dans les 114 hymnes du 9e Mandala . Le Sôma est le nom d’un Dieu immortel, invincible, généreux, pur, qui, « tel l’oiseau, vole vers le vase du sacrifice »viii, puis qui s’élève vers le Ciel, irrésistible, et permet aux hommes de « jouir de la vue du Soleil » ou, dans une autre traductionix, leur donne une « portion de Soleil »x. Sôma est aussi appelé Pavamāna, « maître du monde »xi, il est « éclatant parmi les autres Dieux »xii. « Il féconde la Nuit et l’Aurore »xiii. « Il enfante la lumière et dissipe les ténèbres »xiv. Il est « le père des Prières, le père du Ciel et de la Terre, le père d’Agni, du Soleil, d’Indra et de Vichnou ».xv Sôma est également appelé Prajāpati, le « Père de toutes les créatures »xvi. Il est le « Seigneur de la Parole »xvii, le « maître de la Prière »xviii, le « Seigneur de l’esprit »xix. Il est le « Prudent Sôma« , le « Sage Sôma, versé par la main du Sage, [qui] répand la joie dans la demeure chérie d’Agni »xx. Mais il est aussi « l’auteur de l’ivresse »xxi. Au Dieu Sôma, on peut répéter ce refrain lancinant: « Dans l’ivresse que tu causes, tu donnes tout »xxii. Et Sôma « révèle au chantre le nom secret des Dieux »xxiii. Sôma réalise l’union du ‘divin’ au ‘divin’ par l’intermédiaire du ‘divin’ : « Ô Sôma, unis-toi à toi par toi. » Sôma s’unit aux Dieux: « Sage et brillant, Sôma enfante la Prière, il s’unit à Ayou, il s’unit à Indra »xxiv.
Les métaphores érotiques de cette ‘union’ abondent. Sôma, liquide, ‘se donne’ au Sôma qui va prendre flamme ; enflammé, Sôma ‘se donne’ au Feu. De la Flamme sacrée on dit: « Épouse fortunée, elle accueille avec un doux murmure Sôma, son époux. Leur union se consomme avec éclat et magnificence. »xxv Les épousailles de la liqueur somatique et du feu ardent représentent l’union divine du divin avec le divin. La métaphore de l’amour brûlant et celle, très explicite, de l’union consommée, sont aussi des images du Divin engendrant le Divin. Sôma, « en murmurant se répand dans le vase, où il dépose son lait antique, et il engendre les Dieux. »xxvi Il « s’unit avec tendresse comme un nourrisson s’attache à sa mère. De même que l’époux accourt vers son épouse, il vient dans la coupe et se confond dans le vase avec [le lait] des Vaches » xxvii.
Dans plusieurs passages du Rig Véda, le mot yoni, योनि , désigne le creuset de pierre en forme de sexe féminin, qui reçoit la liqueur du sôma en flammes, et ce mot porte une multiplicité d’images et d’allusions. Le sens premier de yoni est: « matrice, utérus, vagin, vulve ». Le dictionnaire sanskrit de Monier-Williams donne plusieurs autres sens dérivés: « place de naissance, source, origine, fontaine », « réceptacle, siège, résidence, maison, foyer, antre, nid, étable » et « famille, race, caste, état », ‘graine, grain ». Par sa position essentielle dans le processus matériel du sacrifice, le yoni joue à la fois la matrice et le berceau du Divin, permettant sa conception, son engendrement et sa naissance. « Ô Feu, mis en mouvement par la pensée, toi qui crépites dans la matrice (yoni), tu pénètres le vent au moyen de la Loi (Dharma) »xxviii, dans la traduction qu’en donne G. Dumézilxxix. M. Langlois traduit ce même verset (RV, IX, 25, 2) en donnant à yoni le sens plus neutre de ‘foyer’: « Ô (Dieu) pur, placé par la Prière auprès du foyer, fais entendre ton murmure; remplis ton office et honore Vâyou. »xxx
Le Divin védique naît mystiquement, non d’une matrice vierge, mais d’un yoni baigné de liqueur divine, et enflammé de flammes brûlantes. Mais le yoni n’est pas seulement la matrice d’où naît le Dieu, il est aussi son Ciel, sa résidence éternelle : « Ce Dieu resplendit tout en haut, dans le yoni, Lui, l’Éternel, le destructeur, le délice des Dieux »xxxi
Les très nombreuses images associées au Sôma diffractent la compréhension de son sens profond. Le Véda voit la libation du Sôma comme une « mer ».xxxii Cette mer en flammes « crépite », et le feu « hennit comme un cheval ». « Ce Dieu, allumé, devient un char, devient un don ; il se manifeste en crépitant. »xxxiii Il s’agit de galoper vers le divin, toujours plus avant, toujours plus haut. « En allant en avant, ceci a atteint les sommets des deux Brillants (Dieux), et le Rajas (Dieu) qui est tout en haut. »xxxiv « Ceci coule dans le Ciel, libéré, à travers les ténèbres, allumé aux oblations généreuses. Ce Dieu versé pour les Dieux, par une génération antérieure, d’or, coule dans ce qui l’enflamme. »xxxv Le « crépitement » de Sôma en flamme figure le mouvement de la pensée, qui en est le synonyme. « Ô vous deux, l’Ardent et le Sôma, vous êtes les maîtres du soleil, les maîtres des vaches ; puissants, vous faites croître les ‘crépitantes’ [les pensées] ».xxxvi Le Dieu est éternel et destructeur, il est or et lumière, il est doux et savoureux. « Ils te poussent, toi l’Or, dont la saveur est très douce, dans les eaux, par les pierres, – ô Lumière, libation du Feu. » (Ibid. XXX, 5)
Il est Lumière née de la lumière. Il est Feu né du feu…
Les flammes du Sôma « parlent ». Elles sont la demeure de la divine Parole (Vāc)xxxvii.
Sôma naît et vit dans les chants, les prières, les paroles, les murmures des hommes, mais aussi dans les crépitements du feu, et dans les mugissements de la Vache xxxviii .»
Feux, Flammes, Souffles, Pensées, Paroles, Cris, Vents, visent tous à rejoindre l’unique Essence…
Sang ou Sôma ? Il nous faut, aujourd’hui encore, choisir la meilleure voie vers le divin.
________________
iFerveō ou ferueō « bouillir, bouillonner ; être brûlant ; écumer, fermenter ; s’agiter fiévreusement ». De l’indo-européen commun *bh(e)rū̆- ,« être bouillant, sauvage », qui donne aussi defrutum (« moût fermenté, vin raisiné »), le grec ancien βρῦτος, brýtos (« liqueur fermentée »), le sanscrit bhurváṇiḥ (« indomptable, bouillant »), le latin brisa (« marc de raisin ») est probablement un emprunt au celte où \bh\ fait \b\ alors que le latin a \f\ : birviñ (« bouillir ») en breton.
ii*bhreu– également *bhreuə-, *bhreəu-, racine indo-européenne signifiant « bouillir, faire des bulles, pétiller, brûler », avec des dérivés se référant à la cuisine et à la brasserie. Il forme tout ou partie des mots de diverses langues européennes : barm; barmy; bourn « petit ruisseau »; braise; bratwurst; brawn; brawny; braze « exposer à l’action du feu »; brazier; Brazil; bread; breed; brew; broth; broil « se quereller, se battre »; brood; effervesce; effervescence; effervescent; embroil; ferment; fervent; fervid; fervor; imbroglio.
iiiSelon le CNRTL, qui donne les exemples suivants ;
-À la regarder il lui venait des comparaisons qu’il n’osait formuler tant il redoutait qu’elles ne parussent exagérées et niaises. Pour cela et pour d’autres ferments d’enthousiasme qui le travaillaient, il devait se contraindre, par peur du ridicule, à une surveillance pénible sur lui-même. — (Maurice Leblanc, Voici des ailes, 1898, réédition Éditions François Bourin, collection Libretto, 1999, page 31)
-Cependant le ferment qui a produit l’insurrection dans le Nord existe également dans le Sud : l’exaspération créée par la rapacité des Glaoua qui règnent aujourd’hui en maîtres incontestés sur le Maroc méridional. — (Frédéric Weisgerber, Au seuil du Maroc Moderne, Inxstitut des Hautes Études Marocaines, Rabat : Les éditions de la porte, 1947, page 248)
-Pour chaque être humain qui croise ta route, tu peux être un ferment de liberté. — (Jean Proulx, Grandir en humanité, Fides, 2018, pages 72-73) -Le sang des martyrs était le ferment de l’Évangile. — (Après Jésus. L’invention du christianisme, sous la direction de Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim, Albin Michel, 2020, page 289)
ivLuc 12,1
vMarc 8,15
vi1 Co 5,6
viiIbid. IX, Hymne II, 10
viiiIbid. IX, Hymne III, 1
ixCelle de Ralph T.H. Griffith, disponible sur Wikisource
xIbid. IX, Hymne IV, 5
xiIbid. IX, Hymne V, 1
xiiIbid. IX, Hymne V, 5
xiiiIbid. IX, Hymne V, 6
xivRig Véda, Section VII, Lecture 7ème, Hymne VIII. Trad. M. Langlois, Ed. Firmin-Didot, 1851, Tome 4ème, p.121
xvRig Véda, Section VII, Lecture 4ème, Hymne VI, 5. Trad. M. Langlois, Ed. Firmin-Didot, 1851, Tome 4ème, p.89
xviPrajapati est l’Un, primordial, auto-créé, mentionné par le Nasadiya Sukta : « Au commencement, il n’y avait ni Être ni Non-Être, ni ciel, ni terre, ni rien qui soit au-dessus et en dessous. Qu’est-ce qui existait ? Pour qui ? Y avait-il de l’eau ? La mort, l’immortalité ? La nuit, le jour ? Quelles que soient les choses qui existaient, il y avait l’Un, l’Un primordial auto-créé, autosuffisant, par sa propre chaleur, ignorant de lui-même jusqu’à ce qu’il désire se connaître lui-même. Ce désir est la première graine de conscience, disent les présages. Liant le Non-Être avec l’Être. Qu’est-ce qui était au-dessus et qu’est-ce qui était en bas ? La graine ou la terre ? Qui sait ? Qui sait réellement ? Même les dieux vinrent plus tard. Peut-être que seuls les êtres originels savent. Peut-être que non. » (Cité à l’article Prajapati de Wikipédia)
xviiIbid. IX, Hymne XXVI, 4 dans la traduction de Ralph T.H. Griffith.
xviiiIbid., IX, Hymne XXVI, 4 dans la traduction de M. Langlois.
xixIbid. IX, Hymne XXVIII, 1 dans la traduction de Ralph T.H. Griffith.
xxIbid. IX, Hymne XVII, 8
xxiIbid. IX, Hymne XII, 3
xxiiIbid. IX, Hymne XVIII,1-7
xxiiiRig Véda, Section VII, Lecture 4ème, Hymne V, 2. Trad. M. Langlois, Ed. Firmin-Didot, 1851, Tome 4ème, p.87
xxivRig Véda. IX,XXV, 5
xxvRig Véda, Section VII, Lecture 7ème, Hymne XIV. Trad. M. Langlois, Ed. Firmin-Didot, 1851, Tome 4ème, p.190
xxviRig Véda, Section VI, Lecture 8ème, Hymne XXX, 4. Trad. M. Langlois, Ed. Firmin-Didot, 1851, Tome 3ème, p.472
xxviiRig Véda, Section VII, Lecture 4ème, Hymne III, 2. Trad. M. Langlois, Ed. Firmin-Didot, 1851, Tome 4ème, p.85
xxviiiRig Véda. IX,XXV, 2. La translittération du texte sanskrit donne: « pa/vamaana dhiyaa/ hito\ .abhi/ yo/niM ka/nikradat dha/rmaNaa vaayu/m aa/ visha ». Ralph T.H. Griffith traduit ici yoni par ‘dwelling place’ (résidence, foyer): » O Pavamana, sent by song, roaring about thy dwelling-place, Pass into Vayu as Law bids. » On retrouve le mot yoni au dernier verset de cet hymne (RV, IX,XXV,6), traduit par Ralph T.H. Griffith par ‘place’: « Flow, best exhilarator, Sage, flow to the filter in a stream, To seat thee in the place of song. » M. Langlois, dans ce verset, traduit yoni par ‘foyer’: « Ô (Dieu) sage, qui donnes la joie, viens avec ta rosée dans le vase, et assieds-toi au foyer qu’occupe l’Illustre (Agni) ». (Translittération de RV, IX,XXV,6: aa/ pavasva madintama pavi/traM dhaa/rayaa kave arka/sya yo/nim aasa/dam )
xxixin Les dieux souverains des Indo-Européens. 1977
xxxRig Véda, Section VI, Lecture 8ème, Hymne XIII, 2. Trad. M. Langlois, Ed. Firmin-Didot, 1851, Tome 3ème, p.455
xxxiRig Véda. IX,XXVIII, 3. Ralph T.H. Griffith traduit ce verset: « He shines in beauty there, this God Immortal in his dwelling-place ».
xxxiiIbid. IX, Hymne XXIX, 3
xxxiiiRig Véda. IX, III, 5
xxxivRig Véda. IX,XXII, 5
xxxvRig Véda. IX,III, 8-9
xxxviRig Véda. IX,XIX,2
xxxvii « La Parole a parlé ainsi : « C’est moi qui porte l’excitant Sôma, moi qui porte Tvaṣtar et Pūṣan, Bhaga. C’est moi qui confère richesses à qui fait libation, à qui invoque [les Dieux], à qui sacrifie, à qui presse le Sôma. C’est moi, de moi-même, qui prononce ce qui est goûté des dieux et des hommes. celui que j’aime, celui-là, quel qu’il soit, je le fais fort, je le fais Brahman, je le fais Voyant, je le fais Très-Sage. C’est moi qui enfante le père sur la tête de ce monde, ma matrice est dans les eaux, dans l’océan. De là, je m’étends à tous les mondes et le ciel, là-bas, je le touche du sommet de ma tête. Je souffle comme le vent, embrassant tous les mondes, plus loin que le ciel, plus loin que la terre: telle je me trouve être en grandeur. » Rig Véda. X,XII, 2-8 (A.V. 4.30). Cité par G. Dumézil, in Les dieux souverains des Indo-Européens. 1977
xxxviii« Les Vaches mugissent. Le [Dieu] Brillant part avec son murmure. Les grandes mères du sacrifice, enfantées par les Rites pieux ont répondu à ce bruit. Elles parent le nourrisson du Ciel » Rig Véda, Section VI, Lecture 8ème, Hymne XXI, 3-5. Trad. M. Langlois, Ed. Firmin-Didot, 1851, Tome 3ème, p. 463

Sites brutaux!
Oh! votre haleine,
Sueur humaine,
Cris des métaux!
(Paul Verlaine. Romances sans paroles.)
[Explication: On ne peut vraiment pas représenter ni l’horreur brute, ni le désespoir nu, ni la douleur incandescente, ni la descente déshumanisée du monde « dé-civilisé » dans l’infamie absolue. On ne peut que tenter de représenter, par des métaphores et par des métonymies, par évocation et par allusion, cette impossibilité même. Les guerres d’aujourd’hui sont irreprésentables, en essence, dans leur cruauté, leur stupidité, leurs mensonges, et leurs viols impunis de l’esprit. Ceux qui les ont sciemment provoquées, ceux qui les ont justifiées par leur veulerie, et ceux qui les ont encouragées par leur passivité active, seront – un jour – torturés dans les sous-sols de l’Enfer et les geôles de la Géhenne. Parole de ZIWI.]
[Nota Bene: ZIWI est le nom d’un Dieu dont on aurait décalé les lettres vers la droite extrême. Comprenne qui pourra.]

Dans le Crépuscule des idoles, Nietzsche posa cette question : « Que dire ? L’homme n’est-il qu’une méprise de Dieu ? Ou bien Dieu – une méprise de l’hommei ? » Heidegger, qui rapporta l’aphorisme, ajouta une troisième option : « Ou bien les deux seraient-ils une mé-prise de l’estreii ». C’était peut-être là une façon assez désinvolte de botter « Dieu » en touche, en mettant l’« estre » à sa place, ou plutôt en position de surplomb par rapport « aux deux » [l’Homme et Dieu]. La date de rédaction (en automne 1932) n’est pas non plus sans importance: Hitler s’apprêtait à prendre le pouvoir, et Heidegger était déjà membre du parti nazi. L’« estre », d’ailleurs, qu’est-ce que c’est, philosophiquement parlant ? Dans l’original allemand, on lit : Seyn. Heidegger a choisi de changer la graphie du verbe Sein (« être ») en Seyn pour signifier, par le réemploi de cette ancienne orthographe, sa volonté d’une nouvelle orientation philosophique. Il pensait ainsi effacer la question de la différence ontologique entre l’être de l’étant et l’être tout court, pour la remplacer directement par une nouvelle question, celle de l’estre, censé symboliser le fondement de la vérité qui restait à éclaircir. Mis à part ce jeu de mot Sein/Seyn, rendu en français par une astuce de traduction (l’emploi d’un s pour l’accent circonflexe), quelle valeur sémantique attacher à l’estre ? L’estre est en réalité le « métal », qu’il faut fondre « en un seul magma », pour asseoir la Terre et fonder le nouveau mondeiii…
L’idée philosophique de méprise ou de mé-prise invite, me semble-t-il, à penser d’abord celle de la prise. Dans le contexte de la relation entre le Dieu créateur et sa création, la notion de prise est d’emblée fort prégnante, et cela, dans tous les sens du terme. Les mystiques, qui, en cette matière, ont peut-être quelque longueurs d’avance, vont fort loin en ce sens. Ils sont pris, c’est-à-dire, ravis, transportés, emportésiv. Mais cette prise est-elle bien réelle ? Ou n’est-elle que symbolique, ou encore imaginaire ? Ne peut-elle donner lieu, précisément, à une méprise, ou même une fausse prise, une mé-prise, comme le laissent entendre Nietzsche et Heidegger, partageant une même sorte de distanciation et d’ironie ?
Pour ma part, j’aimerais moduler l’idée de prise, à l’aide d’autres préfixes : dé-prise, re-prise, sur-prise, entre-prise. Ces substantifs sont associés à des verbes qui indiquent un mouvement, une direction de l’action ou du sentiment : entre-prendre, dé-prendre, re-prendre, sur-prendre. On pourrait ajouter les verbes ap-prendre et com-prendre, qui évoquent aussi un mouvement, celui de cueillir, ramasser, regrouper.
Notre Temps, si vide, à la fois de pensée et d’être, préfère simplement « prendre » plutôt que de tenter de « comprendre », ou de chercher à « apprendre » (à penser et à être). C’est un temps, où l’important est la prise. Peu importe le risque de méprise ou de mé-prise. On relègue désormais ces nuances aux deux penseurs allemands déjà cités, et plus ou moins discrédités, d’ailleurs. Pour le « moderne », une prise est toujours bonne à prendre.
Face à cette modernité avaleuse, avide, attrape-tout, le philosophe, ou l’anthropologue, ou le poète , ou le théologien, peut se sentir en droit de reposer, à nouveau, la question de l’être ou de l’estre, ou de l’aître, et cela sur le mode apophatique. Si prendre, prendre le plus possible, est l’ordre du jour, ne faut-il pas envisager plutôt de déprendre, de se dé-prendre pour se sur-prendre ?
Dieu, on le sait, est un Dieu jaloux. El qanna’ (Ex. 34,14). S’il est jaloux, c’est que les tourments de l’amour ne lui sont pas inconnus. La question que Nietzsche posait, sans d’ailleurs y répondre, et que Heidegger reprenait laborieusement, pourrait être alors reformulée ainsi : Dieu s’est-il dépris de l’être humain ? Dépris après s’en être épris, et s’en éloignant, comme un amant déçu ?
Vu l’actualité, les tueries, le sang, la haine, tout cela au nom de ce « Dieu jaloux », je crois que je pourrais comprendre un autre Dieu, qui se déprendrait de l’Homme.
__________________
iNietzsche. Crépuscule des idoles ou Comment philosopher à coups de marteau (« Maximes et traits », n° 7). Galliamrd, 1974, p.14
iiMartin Heidegger. Réflexions VI. Cahiers noirs (1931-1938).Traduit de l’allemand par François Fédier. Gallimard, 2018, § 63, p. 461. Le traducteur signale que Nietzsche emploie ici le mot Fehlgriff, alors que Heidegger emploie le mot Mißgriff. Griff se traduit par « prise ». Fédier ajoute : « Fehlgriff est la prise qui lâche la proie pour l’ombre. Mißgriff accentue l’idée du manquement, au point qu’il faut presque entendre « mé-prise » comme disant l’échec de la tentative qui entendait se saisir de l’estre. »
iiiEn automne 1932, Heidegger écrit : « Nous sommes à l’aube d’un temps au sein duquel toutes les autorités et organisations, tous les élans et toutes les mesures vont être fondus en un seul magma ; et là, ce qui importe surtout, c’est que nous mettions en œuvre le vrai feu original et rendions fluide dans l’existence à venir le vrai métal idoine pour la refonte. Ce feu, c’est la ‘vérité’ en sa fervescence d’origine et l’incandescence alerte, avide et clarifiante du questionnement. Le métal, et la fermeté d’assise de la Terre, c’est l’estre. » Martin Heidegger. Réflexions III. Cahiers noirs (1931-1938).Traduit de l’allemand par François Fédier. Gallimard, 2018, § 163, p. 189
ivThérèse d’Avila explique que dans le ravissement, « vous vous trouvez saisi par un mouvement d’une force et d’une impétuosité inouïes. Vous voyez, vous sentez s’élever cette nuée ou, si vous voulez, cet aigle puissant vous emporter sur ses ailes […] De fait, on est emporté malgré soi. » (Vie, 20)

Du dégoût à en vomir. De la rage à en arracher la bouche, devant l’impuissance affaissée, la désertion de la raison, l’assèchement de la sagesse, l’effacement de la « loi » (mais, en revanche, le quintuple décuplement du talion), l’implosion de l’humanité, l’explosion de l’inhumain. L’humain réduit à bien moins que l’animal, rabaissé au caniveau d’une minérale inhumanité. Maintenant et encore – seulement du sang, de la mort, de la haine. Des vies massacrées par les missiles, traînées à répétition dans la boue sanglante des chars, dans l’orgie aveugle des drones, et l’assassinat par l’IA. Par-dessus le marché, l’effroyable destruction de toutes les valeurs. Des idées plurimillénaires froidement déchiquetées devant tous les yeux. Et surtout, cette haine à l’état pur, cette haine vive, qui va continuer de vivre, de prospérer, de propager ses futurs, de les asservir sans fin à son ordre au front bas, sans perspectives autres que des morts multipliées, de la mort toujours infligée, du sang en flaques coagulées et des haines neuves. Le cynisme le plus vorace, l’arrogance la plus impitoyable. Le mépris pour l’« autre » jusqu’à l’os, et jusqu’à ses cendres. La violence satisfaite d’elle-même, sûre de son « droit » (il n’y a plus de gauche depuis longtemps). Ce droit – un Droit divin, une Loi, disent-ils. Le droit de faire hurler la haine en l’humain. L’impunité absolue, dans les concerts mous, feutrés, suivistes, des lâchetés achetées. De quelque côté que l’on se tourne – l’humain avili. À nouveau avili. Ils n’ont rien vu, ils n’ont rien compris ? Ils ne savent pas ce qu’ils font ? Des profondeurs, je crie.

Si Dieu est « un », le monde est naturellement multiple. D’où Babel – et, surtout, l’abysse inéluctable entre le réel et le langage. Pour qui philosophe un tant soit peu, il apparaît vite que les « singularités » et les « dualismes » que l’on rencontre dans les langues humaines et leurs grammaires, ne suffisent pas à rendre compte de l’essence de la réalité. Plus riches et plus complexes, sans doute, les triades et les quaternions semblent un peu mieux à même de saisir (structurellement) quelques-unes des réalités immanentes (ou même transcendantales) que le singulier ou la dualité ignorent. On mesure l’importance du « quatre », par exemple, lorsque l’on considère les points de vue axiaux que les grammaires humaines emploient presque universellement. Ces quatre axes sont représentés par les trois pronoms personnels, « je, tu, lui », liste complétée par le pronom démonstratif « cela », qui précisément n’est pas personnel, mais impersonnel. Il est d’autres pronoms, bien sûr, comme « nous, vous, il, elle, eux ou elles ». Mais on peut arguer que ce ne sont là que des variantes des trois ‘personnes’ fondamentales. Il y a toujours, en somme, le point de vue du ‘sujet’ (je ou moi), celui de l’ ‘autre’, qu’il soit présent (tu ou toi) ou absent (lui) et enfin celui de l’objet absolu (cela).
Ceci ne représente qu’un premier niveau d’analyse. Se multiplient ensuite d’autres points de vue encore, lorsque ces pronoms se mettent en relation, se lient, se tiennent à distance ou se nient. Martin Buber a développé une sensibilité particulière à propos des accouplements de mots. « Les bases du langage ne sont pas des mots isolés, ce sont des couples de mots. L’une de ces bases du langage, c’est le couple Je-Tu. L’autre est le couple Je-Cela, dans lequel on peut aussi remplacer Cela par Il ou Elle, sans que le sens en soit modifié. Donc le Je de l’homme est double, lui aussi. Car le Je du couple verbal Je-Tu est autre que celui du couple verbal Je-Celai ».
On peut volontiers admettre que les mots fondent leur(s) sens par le biais de l’ensemble de leurs interactions, effectives ou présupposées. « Dire Tu, c’est dire en même temps le Je du couple verbal Je-Tu. Dire Cela, c’est dire en même temps le Je du couple verbal Je-Celaii. » Mais, d’emblée, les nuances se dessinent, les dérives s’amorcent, des cassures de sens s’opèrent. Buber lui-même fait immédiatement remarquer les césures profondes, ontologiques, qui sont en quelque sorte inhérentes à la règle qu’il vient d’émettre, et qui viennent de l’immense distance entre le personnel et l’impersonnel. « Le mot-principe Je-Tu ne peut être prononcé que par l’être entier. Le mot-principe Je-Cela ne peut jamais être prononcé par l’être entieriii. » Dès lors, les questions fusent. De possibles généralisations se profilent. Qu’est-ce que l’« être entier » ? Pourquoi se limiter à des couples, et ne pas étendre les conjonctions et autres agglutinations de pronoms à des triades, ou à des quaternions ? En son temps, YHVH, n’a-t-il pas prononcé une triade verbale pour se définir lui-même ? Parmi les plus étranges des noms divins dont le Dieu unique s’est servi pour se nommer Lui-même, il y a l’expression triadique « Moi, Moi, Lui », d’abord rapportée par Moïseiv, puis reprise plusieurs fois par Isaïev. « Moi, Moi, Lui », soit en hébreu: אֲנִי אֲנִי הוּא ani ani hu’. Ces trois pronoms sont immédiatement suivis d’une réaffirmation de la solitude de Dieu : וְאֵין אֱלֹהִים, עִמָּדִי v’éin elohim ‘imadi : « Et il n’y a pas de dieux (elohim) avec moi ».
Si l’on suit cette piste, et si l’on généralise les possibles intrications des pronoms entre eux, on devrait concevoir que l’expression Je-Cela citée par Buber se trouve en quelque sorte transcendée par l’expression Moi-Moi-Lui que YHVH emploie. Dès lors, d’autres portes s’ouvrent pour d’autres combinaisons encore, dans des mises en abyme successives.
Par exemple, le Moi de YHVH peut-il d’une manière ou d’une autre résonner avec le Je de Buber ?
A cette question pleine d’embûches, Rûmî répond sans hésiter, et de la manière la plus positive qui soit. Il reprend l’exclamation divine, telle que rapportée par Moïse, mais pour y introduire son propre Je dans l’équation ;
« Tu es cette lumière qui à Moïse proclama :
Je suis Dieu, je suis Dieu, moi je suis Dieu !
J’ai dit : Soleil de Tabrîz, qui es-tu ? Il dit :
Je suis vous, je suis vous, moi je suis vousvi ! »
Trois siècles avant Rûmî, Husayn ibn Mansûr al-Hallâj, arrivant à la mosquée d’al-Mansûr, avait prononcé, devant son ami Shiblî, la formule qui devait être la cause de son martyre : Ana’l Haqq, «Je suis la Vérité ». Or, il n’y a de vérité que Dieu. On pouvait donc aussi entendre : « Mon je, c’est Dieu ». Hallâj ajouta immédiatement ces vers, qui s’adressait à ce Dieu en le tutoyant : «Yâ sirra sirri… ô secret de mon âme, Toi qui Te fais si ténu que Tu échappes à la prise de toute imagination pour tout être… »
Ceux qui condamnèrent Hallâj et le mirent en croix après d’atroces tortures, virent dans ces mots un blasphème. Pour Louis Massignon, qui lui consacra une puissante étude, Hallâj était dans le droit fil de ce qu’autorise, dans ses principes mêmes, la grammaire arabe : « L’arabe, langue sémitique, langue de la révélation, est prédisposée à concevoir, à la 1re personne, sous l’influence de l’Esprit, le verbe mental […] La phrase cruciale de son expérience, Anâ’l-Haqq, ‘Je suis la Vérité’ ou ‘mon Je c’est Lui’ n’est pas une formule moniste de métaphysicien, c’est une ‘clameur de justicevii’ criée en pleine luciditéviii ».
Le mystique réalise-t-il un pas vers l’union divine en articulant la formule que Dieu emploie, parlant de Lui à la 1re personne ? Dire : « mon Je, c’est la Vérité », revient-il à dire : « mon Je, c’est Lui » ou même, par une extension condensée, intriquée et cryptique : « Je c’est Moi » ?
S’invitant dans ce débat, Ibn ‘Arabi exclut absolument cet usage du Je. Pour désigner Dieu par un pronom grammatical, il recommande l’usage exclusif du terme huwa, « Il, Lui » (huwa est en arabe l’équivalent de hu’ en hébreu). Ibn ‘Arabi refuse absolument l’emploi du Je, du Moi, dans ce contexte. « Huwa est le nom exclusif de l’Essence absolue, le nom de la monéïté (aḥadîya)ix. » Quant au Tu, son usage est aussi fortement déconseillé quand on s’adresse à Dieu. « Le terme anta (« Tu, Toi ») est d’un usage plein de pièges, pose un voile plus épais ; il s’oppose au huwa, il souligne dans le dialogue l’antithèse des deux personnes, sans définir de qui des deux il s’agit. C’est pourquoi l’employer n’est licite que pour ceux qui savent abstraire (tanzîh, hors du khayât, imaginative)x. »
Pour ce qui est de l’emploi du terme anâ (« Je, Moi »), Ibn ‘Arabi s’attaque frontalement à Hallâj et Bistâmî : « Quelques-uns, inconscients de la dignité du huwa et de la distinction à faire entre l’essence en tant que modalisée en formes et l’essence absolue, ont pensé que le « Je » (anâ) était le plus noble des symboles aptes à traduire l’unification mystique (ittiḥād), sans se rendre compte que cette unification est a priori impossible. Quand tu dis « je », l’idée ainsi transmise à Celui à Qui tu veux t’unir, c’est « toi, qui as dit ‘Je’ », c’est une expression venant de toi, non pas toi. Quant à cette idée en elle-même, tu l’as conçue, ou bien avec ton anânîya (l’ipséité « mienne » de ta forme créée), ou bien avec la Sienne ; d’où dilemme : ou bien c’est toi seul, ou bien tu n’existes plus, et dans les deux cas, il n’y a pas d’unification. […] S’adresser à anâ (« Moi ») en l’invoquant, est de la déraison ; prier Dieu en L’appelant « Je » attire Sa réponse : « ton statut est contradictoire » ; et si c’est ton anâniya que tu invoques, c’est à elle de te répondre, par toi. – Et si Tu te répondais, à Toi, par moi ? – Je ne Me manifesterai jamais à toi par mon « Je », privilège exclusif de la monéïtéxi. »
Sans préjuger s’il fut ou non entendu du Divin, Hallâj n’avait aucune chance de se faire entendre des hommes qui le condamnèrent. C’est pourquoi il mourut martyr à Bagdad en 922.
Et pourtant, il fallait bien qu’avec son cri, il répondît à son exigence intérieure. Il fallait qu’il articulât les paroles les plus fidèles possibles à sa vision, quels que fussent les risques encourus.
« Ton esprit s’est emmêlé à mon esprit, tout ainsi
Que se mélange le vin avec l’eau pure,
Aussi, qu’une chose Te touche, elle me touche,
Voici que ‘Toi’, c’est ‘moi’, en tout !
[…]
Je suis devenu Celui que j’aime, et Celui que j’aime est devenu moi !
Nous sommes deux esprits, fondus en un corps.
Aussi, me voir, c’est Le voir
Et Le voir, c’est nous voir.
[…]
Je t’appelle… non, c’est Toi qui m’appelles à Toi !
Comment aurais-je dit ‘c’est Toi !’ -– si Tu ne m’avais dit ‘c’est Moi !’xii ? »
Hallâj savait qu’il était un néant, mais par la voie de ce savoir, et par la voix de ce néant même, sa voix, il advenait au Tout, il se conjoignait à l’Unité, il se faisait fusion (divine).
« Est-ce Toi ? Est-ce moi ? Cela ferait une autre Essence au-dedans de l’Essence…
Loin de Toi, loin de Toi d’affirmer ‘deux’ !
Il y a une Ipséité tienne, en mon néant désormais, pour toujours,
C’est le Tout, par-devant toute chose, équivoque au double visage…
Ah ! Où est Ton essence, hors de moi, pour que j’y voie clair…
Mais déjà mon essence est bue, consumée, au point qu’il n’y a plus de lieu…
Où retrouver cette touche qui Te témoignait, ô mon Espoir,
Au fond du cœur, ou bien au fond de l’œil ?
Entre moi et Toi, un ‘c’est moi !’ me tourmente…
Ah ! Enlève, de grâce, ce ‘c’est moi !’ d’entre nous deuxxiii ! »
Bien avant le judaïsme ou l’islam, il importe de rappeler que le Véda avait exploré des chemins, analogues en un sens, mais aussi franchement originaux. Dans une célèbre upaniṣad, la genèse du Je (primordial, originaire) est décrite ainsi : « Au commencement, cet [univers] était le seul Soi (ātman) ayant forme d’Homme. Il regarda tout autour et il ne vit rien d’autre que son Soi. Il dit en tout premier : ‘Je suis Lui’ (so’ham asmi). De là, le nom ‘JE’ (aham) vient à êtrexiv. » Mais quel était donc ce Soi, si seul, si originaire, et comment le caractériser plus avant en langues huamaines ? D’abord, on peut dire que le Soi est seul, certes, mais qu’il est aussi « eux » : « Ce Soi (ātman) est fait d’eux : il est fait de parole, il est fait de mental, il est fait de soufflexv. » Le Soi est aussi fait de tous les mondes dont la parole, le mental et le souffle sont la substance. « Ils sont aussi les trois mondes : ce monde-ci est parole, l’espace intermédiaire est mental, ce monde au-delà est soufflexvi. » Le Soi est enfin fait des Dieux, des Anciens et des Humains : « Dieux, ancêtres et humains, ils sont aussi : les Dieux sont la parole, les ancêtres sont le mental, les humains sont le soufflexvii. »
Rappelons enfin, brièvement, les quatre « grandes paroles » (Mahāvakya), qui se fondent sur des pronoms, personnels ou non, etsur ce mot qui les rassemble, le brahman :
Aham brahma-asmi
JE suis le brahmanxviii.
Tat tvam asi
TU es celaxix.
Ayam ātmābrahma
Cet ātman (ce « SOI ») est le brahmanxx.
Prjanānam brahma
La sagesse est le brahmanxxi.
Concluons par une synthèse ramassée, en attendant de futurs développements : le moi, le tu et le lui ne s’opposent pas à l’essence de l’Un. Ils la nourrissent au contraire, la transcendent, l’intriquent et l’irradientxxii.
_________
iMartin Buber. Je et Tu. Traduit de l’allemand par G. Bianquis. Aubier, 1969, p.19
iiIbid. p. 20
iiiIbid. p. 20
ivDt 32,39
vIs 43,10 ; Is 43,25 ; Is 51,12 ; Is 52,6
viJalâloddîne Rûmî. Soleil du Réel. Traduction du persan par Christian Jambet. Ed. Imprimerie nationale, 1999, p. 209
viiCf. Qur’an. 50,42 : ‘Sayḥata bil-ḥaqq’, mot à mot : «Un cri en vérité »
viiiLouis Massignon. La Passion de Husayn ibn Mansûr Hallâj, Tome II. Tel-Gallimard, 1975, p.65
ixLouis Massignon. La Passion de Husayn ibn Mansûr Hallâj, Tome II. Tel-Gallimard, 1975, p.65
xLouis Massignon. La Passion de Husayn ibn Mansûr Hallâj, Tome II. Tel-Gallimard, 1975, p.66
xiLouis Massignon. La Passion de Husayn ibn Mansûr Hallâj, Tome II. Tel-Gallimard, 1975, p.67
xiiLouis Massignon. La Passion de Husayn ibn Mansûr Hallâj, Tome III. Tel-Gallimard, 1975, p.49-50
xiiiLouis Massignon. La Passion de Husayn ibn Mansûr Hallâj, Tome III. Tel-Gallimard, 1975, p.55
xivBṛhadāraṇyaka-upaniṣad (BAU) 1,4,1. Traduction Alyette Degrâces
xvBAU 1.5.3
xviBAU 1.5.4
xviiBAU 1.5.6
xviiiBU 1,4,16
xixCU 6,8,7
xxMU 2
xxiAiU 5,3
xxiiBien que je ne partage pas son goût pour certains néologisme comme celui de « tuité », je voudrais ici prendre en appui cette phrase de Kristeva : « Égoïté, tuité, ipséité, tout cela ce sont des points de vue qui surajoutent à l’essence éternelle de l’Unique. » Julia Kristeva. Thérèse mon amour. Récit. Fayard. 2008, p.55

Le Lévitique :
« Aime ton prochain comme toi-même : moi, je suis YHVHi. »
Le Bouddha (Śakyamuni) :
« Que personne n’aime qui que ce soit. Ceux qui n’aiment rien et ne haïssent rien n’ont pas d’entravesii. » « Celui qui est libéré de l’amour ne connaît ni le chagrin ni la peuriii. »
Jésus :
« Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieuxiv. »
De ces trois philosophies de l’amour (et de la haine), laquelle est la plus utopique et la plus révolutionnaire ? La réponse me paraît aussi évidente que mille soleils.
Laquelle est la plus impraticable, la plus éloignée du sens commun et la plus irrationnelle ? Idem.
Laquelle porte peut-être en elle le germe d’une transformation absolue du monde ? Idem.
En comparaison, et par contraste, les deux autres philosophies semblent réalistes, pratiques, terre-à-terre, chacune à sa manière. L’une se fonde sur un pessimisme et un nihilisme sans concession. Elle vise l’extinction de la souffrance individuelle et la fin de tous les désirs. De dieu, il n’y en a pas. D’âme, non plus, il n’y en a pas. Il n’y a que du vide. Quant à l’autre, elle prône l’amour tribal du semblable et du proche, l’amitié redondante et pléonastique pour l’ami, l’amant ou le voisin (le mot רֵעַ signifie « ami, prochain, amant ») – ainsi qu’une bonne dose de haine implacable pour l’ennemi. .
Quant au Dieu, il est qui il est, mais il est surtout apparemment hors champ. Il n’est ni l’ami ni l’ennemi, il est le Tout Autre, il est l’ineffablement transcendant. Certes, il a sans doute choisi son camp, ce camp qui est le sien. Mais qui dira quel est ce camp, en réalité ? On peut seulement penser qu’à la fin des temps ce Dieu ineffable et « Tout Autre » reconnaîtra peut-être les « siens ». En attendant, les « autres » auront le loisir de philosopher sur la relation que celui qui est dit « Tout Autre » entretient avec ceux qui n’aiment que ceux qui sont les « mêmes », ceux qui se ressemblent et qui aiment se ressembler.
D’un point de vue que l’on pourrait qualifier de ‘méta-philosophique’, on devrait chercher laquelle de ces différentes visions du monde a quelque chance d’ouvrir une voie viable au lointain avenir, si l’avenir reste encore à l’ordre du jour (ce dont je doute) : la vision basée sur l’entre-soi tribal, schizophrène, mimétique et haineux ? Ou celle se fondant sur un nihilisme pessimiste, détaché, matérialiste et athée ? Ou bien celle proclamant qu’est désormais venu le temps des utopies contre-nature ? Ou bien aucune d’entre elles ? Il reste peut-être en effet d’autre voies que l’on n’imagine pas. Se pourrait-il que la philosophie et la métaphysique soient extrêmement loin d’avoir atteint la fin de leur histoire ? Se pourrait-il que la pensée humaine soit dans les babillages de l’enfance ? Se pourrait-il, par exemple, qu’une autre vision, dont nous n’avons aucune idée, mais dont la nécessité se fait déjà sentir, se fera bientôt une loi de se révéler elle-même, par elle-même, et cela pour quelque autre fin, dont nous n’avons, là non plus, aucune idée ?
_____________
iLv 19,18
iiDhammapada, 211
iiiDhammapada, 215
ivMt 5, 43-45

La notion de lieu, éminemment concrète, chargée de vie et d’expérience, se distingue radicalement de celle d’espace, beaucoup plus abstraite, désincarnée. Trois articles de ce Blog y seront consacrés, avec l’étude successive et comparative du mot hébreu maqôm, du mot sanskrit loka et du mot grec topos.
Le mot « lieu » se dit מָקוֹם (maqôm) en hébreu. Ce mot est composé du préfixe ma– (qui s’emploie génériquement pour désigner l’idée de lieu), et de la racine verbale qoum (קוּם), « se lever, s’élever, naître, venir ; se tenir, résister, subsister, rester, persévérer, s’accomplir ». Littéralement, donc, maqôm signifie un lieu où quelque chose se lève, s’élève, se tient, vient (ou naît). Riche profondeur sémantique… C’est pourquoi, quand YHVH dit à Moïse : « Voici un lieu auprès de moi : tu te tiendras sur le rocheri », les questions surgissent nombreuses à l’esprit du chercheur…
Selon Maïmonideii, le mot maqôm s’applique à des « lieux », particuliers ou communs, mais s’utilise aussi métaphoriquement pour désigner le rang d’une personne ou le degré de son perfectionnement. On dit que telle personne est en tel « lieu » (maqôm), c’est-à-dire qu’elle est arrivée à tel niveau. Par exemple : « Il remplissait la place (maqôm) de ses pères en science ou en piété », ou encore : « La discussion reste à la même place », autrement dit au même degré de développement. Le verset : « Que la gloire de l’Éternel soit louée en son lieuiii » s’entend en ce sens, à savoir, selon le rang élevé que la Divinité occupe dans l’univers. Mais l’interprétation de ce verset demande d’y regarder de plus près. Elle ne se satisfait pas seulement de l’aspect métaphorique associé au « rang » divin. On peut en effet penser que le « lieu » de la gloire divine est aussi, en quelque sorte, sa « demeure » même. C’est d’ailleurs le sens du mot chekhina, qui signifie la « présence » de Dieu, et dont la racine verbale (chakhana) signifie « demeurer, séjourner ». Dans le contexte du verset cité, le prophète Ézéchiel ne reste précisément pas dans ce « lieu », ni n’y « demeure » : il est aussitôt « emporté » par l’esprit (« Et l’esprit m’emportaiv »), avant même de se rendre compte qu’il était dans le lieu de la gloire divine. Deux versets plus loin, cette formulation est répétée, avec l’ajout de l’idée d’ascension « Et l’esprit m’éleva en l’air et m’emportav »).
Maïmonide relie explicitement cette curieuse expérience d’ Ézéchiel avec un passage de l’Exode, rapportant la rencontre de l’Éternel avec Moïse : « Voici un lieu (maqôm) auprès de moivi ». Il souligne qu’il faut en percevoir le double sens (métaphorique et littéral), « c’est-à-dire un degré de spéculation, de pénétration au moyen de l’esprit, et non de pénétration au moyen de l’œil, en ayant égard en même temps à l’endroit de la montagne auquel il est fait allusion et où avait lieu l’isolement de Moïse pour obtenir la perfectionvii. » Le lieu qui est « auprès » de l’Éternel est désigné comme étant le rocher (tsour) sur lequel Moïse est invité à se tenir (natsav). « YHVH dit: « Voici un lieu auprès de moi : tu te tiendras sur le rocher ». Mais ce lieu privilégié (qui est « sur » le rocher) est provisoire. Moïse devra le quitter quand la gloire de YHVH passera. Alors il se cachera « dans » la fente ou le creux (niqrat) du rocher. Plus exactement, c’est YHVH qui le cachera dans ce creux, et qui, dans une volonté de protection redoublée, couvrira Moïse de sa main : « Puis, quand passera ma gloire, je te cacherai dans la cavité du roc et je t’abriterai de ma main (kaf) jusqu’à ce que je sois passéviii. »
On voit que la notion de « lieu » se trouve ici déclinée d’une triple manière. Il y a premièrement un lieu « sur » le rocher, où la Gloire de YHVH va bientôt passer et où Moïse se tiendra un instant, ensuite, il y a le lieu creux qui se trouve « dans » le rocher, où Moïse se cachera, et il y a encore un autre « creux », au sens métaphorique, celui de la main même de YHVH – laquelle offre le « creux » de sa paume (kaf), qui « abritera » Moïse, et s’interposera en quelque sorte entre la Gloire de YHVH et le creux du roc. Dans un article de ce Blog sur la métaphysique du « creux » ou du kaf, j’explique que le mot כֵּף kéf, similaire à kaf, à la vocalisation près, et de même provenance étymologique, signifie également ‘rocher, roc’, ce qui implique une proximité sémantique entre l’idée du ‘creux’ et celle de ‘rocher’. Certes, le ‘rocher’ dans le creux duquel Moïse est placé par Dieu (en Ex 33,22) n’est pas désigné par le mot kéf, mais par le mot tsour. Cependant, le simple fait que les mots kaf (‘creux’) et kéf (‘rocher’) aient la même racine verbale kafaf, « être recourbé, être creux », attire l’attention sur le fait que certains rochers peuvent d’autant mieux offrir un refuge ou une protection qu’ils offrent des anfractuosités creuses, et s’ouvrent comme des cavernes ou des grottes. La notion de « creux » n’évoque pas seulement une sorte de lieu, mais s’ouvre vers d’autres acceptions, beaucoup plus métaphysiques, comme celle de « pardon », et comme le laisse entendre l’idée de « couvrir » les fautes… Lorsque Dieu « couvre » Moïse de son propre kaf, s’expriment là, d’une part l’idée littérale de protection et d’abri, mais aussi, de façon sans doute plus subliminale, l’idée figurée de « couvrir » (kafar) les faiblesses de Moïse, ou ses péchés, afin de l’en purifier, afin qu’il soit admis à voir Dieu, ne serait-ce que « par-derrière ». Le verset suivant nous renseigne en effet sur ce qui se passe après le passage de la Gloire divine. « Alors je retirerai mon kaf, et tu me verras par-derrière, mais ma face ne peut être vueix. »
De ceci, il ressort que la notion de maqôm en hébreu n’est pas simplement « locale » ou « statique ». D’une part, elle cumule plusieurs couches de sens, à la fois littérales et figuratives, qui nouent ensemble, étroitement, plusieurs états du lieu : le lieu est aussi ce qui est « sur », « dans » et « par-derrière » le lieu en question, à savoir, ici, le rocher. D’autre part, l’idée de maqôm conjoint des idées franchement opposées, et même contradictoires : le lieu permet la manifestation (de la gloire) et il permet dans le même temps l’effacement, le recouvrement, l’enfouissement. Ceux-ci dénotent la nécessité de se « cacher », dans une recherche de protection, mais connotent aussi une possible recherche de miséricorde divine. La notion de maqôm introduit une dynamique du creusement, de l’approfondissement, d’ordre spirituel.
La géométrie du maqôm est en essence multidimensionnelle, fractale, et elle s’avère capable d’intriquer effectivement la sphère humaine et la sphère divine.
Voir aussi Le creux de Dieu ou la métaphysique du kaf.
_______________________
i וַיֹּאמֶר יְהוָה, הִנֵּה מָקוֹם אִתִּי; וְנִצַּבְתָּ, עַל-הַצּוּר. Ex 33,21
iiMoïse Maïmonide. Le Guide des égarés. Traduit de l’arabe par Salomon Munk. Verdier, 1979. p.40-41
iiiEz. 3, 12 : בָּרוּךְ כְּבוֹד-יְהוָה, מִמְּקוֹמוֹ . Barukh kevod-YHVH mi-mqômou
ivEz. 3, 12 : וַתִּשָּׂאֵנִי רוּחַ va-tissa’ni. « Et l’esprit m’emporta, et j’entendis derrière moi le bruit d’un grand tumulte : « Bénie soit la gloire de l’Éternel en son lieu! » »
vEz. 3,14 : וְרוּחַ נְשָׂאַתְנִי, וַתִּקָּחֵנִי Vé-rouaḥ nessa’at-ni va-tiqqaḥ-ni. « Et l’esprit m’éleva en l’air et m’emporta ». Le verbe nasa’ signifie « élever, emporter » aux sens littéral et figuré. Le verbe laqaḥ signifie « prendre », avec une grande variété de nuances.
viEx. 33,21
viiMoïse Maïmonide. Le Guide des égarés. Traduit de l’arabe par Salomon Munk. Verdier, 1979. p.41
viiiEx. 33,22
ixEx. 33,23
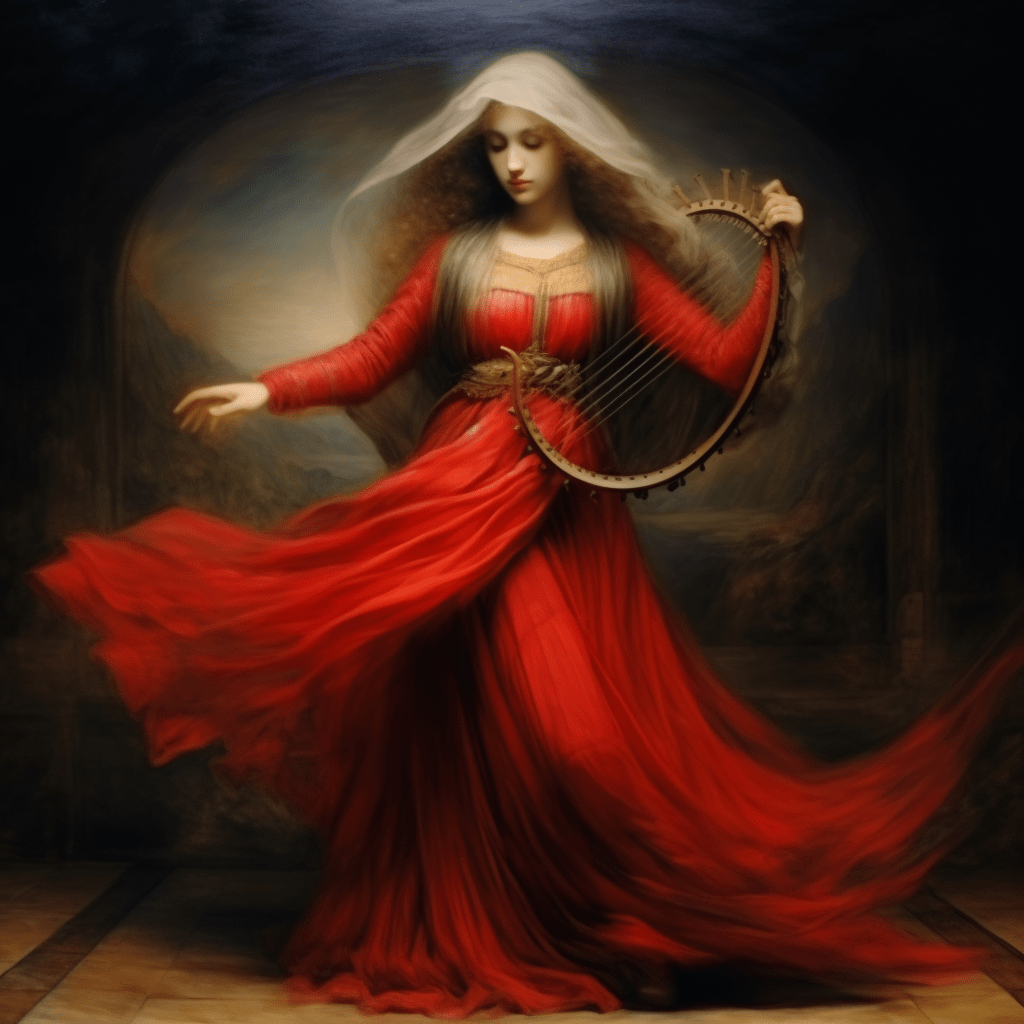
Jephté traversa le Galaad et Manassé. Il voulait faire la guerre aux Ammonites, et remporter une victoire totale. Animé de l’esprit de l’Éternel, il fit un vœu : »Si tu livres en mon pouvoir les enfants d’Ammon, la première créature qui sortira de ma maison au-devant de moi, quand je reviendrai vainqueur des enfants d’Ammon, sera vouée à l’Éternel, et je l’offrirai en holocauste. » Jephté marcha alors sur les Ammonites pour les combattre, et l’Éternel les livra en sa main. Vainqueur, il rentra dans sa maison à Miçpé. Il vit alors sa fille venir à sa rencontre, en dansant au son des tambourins. C’était son unique enfant; en dehors d’elle, il n’avait ni fils, ni fille. Dès qu’il la vit, il déchira ses vêtements et s’écria : « Ah ! ma fille, tu m’accables !, c’est toi qui fais mon malheur ! Je me suis engagé, moi, devant l’Éternel, je ne puis m’en dédire. » Elle lui répondit : « Mon père, tu t’es engagé devant Dieu, fais-moi ce qu’a promis ta bouche, maintenant que l’Éternel t’a vengé de tes ennemis, les Ammonites. Seulement, ajouta-t-elle, qu’on m’accorde cette faveur, de me laisser deux mois de répit, afin que j’aille, retirée sur les montagnes, pleurer avec mes amies sur ma virginité. » « Va », dit-il. Et il la laissa libre pour deux mois ; et elle s’en alla avec ses compagnes sur les monts, où elle pleura sa virginité. Au bout de deux mois, elle revint chez son père, qui accomplit à son égard le vœu qu’il avait prononcé. Elle n’avait jamais connu d’homme. Et cela devint une coutume en Israël : d’année en année, quatre jours de suite, les filles israélites se réunissaient pour pleurer la mémoire de la fille de Jephté le Galaaditei.
Que nous apprend ce récit du Livre des Juges ? Le général en campagne fait tout pour obtenir la victoire sur l’ennemi, y compris des vœux imprudents. Tout cela se termine par le sacrifice de sa propre fille, qui l’avait accueillie joyeusement et en dansant, et qui, par cela même avait créé la condition de son égorgement, sur l’autel de l’holocauste. Son père ne manqua pas d’honorer son vœu sanglant. Il trouva même le moyen de faire reposer sur sa fille la responsabilité de sa mort (« Ah ! ma fille, tu m’accables !, c’est toi qui fais mon malheur !)…
Aucun lien, bien sûr, avec des événements contemporains. Mais ceux qui, dans quelque guerre actuelle ou à venir, accueilleront la victoire finale avec joie et en dansant, qui sait de quels terribles vœux, ils devront ensuite payer le prix ?
__________
iD’après Jg 11, 29-40

La plupart des humains se considèrent comme destinés à retourner à la poussière et au néant. Comment les en blâmer ? N’en sont-ils pas originairement issus ? La mort, qui vient toujours les rejoindre à grands pas, ne les condamne-t-elle pas à disparaître sans retour de la surface de la terre ? Tout porte à croire que les hommes ne sont jamais qu’humus, que leur existence est en effet éphémère, que leur âme, si elle existe, n’est qu’une sorte de vent, une espèce de souffle. Ceux d’entre eux qui sont matérialistes doutent absolument de l’existence de tout ce qui n’est pas matière, et bien entendu, ils nient toute réalité au divin. Ils en rient même. Ils en voient trop l’absurdité, l’incohérence, l’inanité. La matière, dont on sait maintenant qu’elle n’est qu’une sorte de vide, leur paraît tangible et cela leur suffit.
Quant à ceux qui croient un tant soit peu qu’existe ‘quelque chose’, que croient-ils réellement ? Selon les époques et les modes, ils disent croire en un monde des esprits, un royaume des morts, un univers celé des idées et des intelligibles, un abîme du mystère, un système des sphères, un commencement d’avant les origines, un fond abyssal de l’être, un au-delà des ciels. Mais de tout cela, ils s’en sentent cependant séparés, et à tout le moins infiniment éloignés, à l’exception d’une poignée de chamanes, de cabalistes ou de visionnaires. Les hommes n’ont certes pas l’idée que leur propre nature ait au fond un véritable rapport avec la divinité. Comment s’en douteraient-ils seulement ? Ils ne savent presque rien de ce que cette nature tient en réserve, ils ne se connaissent déjà pas eux-mêmes. Ils n’ont jamais eu l’idée de tourner leur regard vers l’essence de leur être. La profondeur de leur nature, la capacité de leur esprit, la puissance de leur intelligence, la splendeur de leur âme, leur restent fondamentalement cachées. « Comment cela se fait-ce ? – me demanderez-vous. Si l’homme est aussi divin que vous le dites, comment n’est-il pas davantage conscient ce qu’il est ? Qu’est-ce qu’une divinité faite de poussière, et condamnée à retourner à la poussière ? Qu’est-ce qu’une divinité qui s’ignore tellement elle-même qu’elle ne croit même pas à elle-même ? »
En général, les hommes pensent peu à qui ils sont réellement. Ils pensent encore moins à l’essence de ce qu’ils sont. La vie leur prend tout leur temps, et il faut bien vivre avant d’en venir un jour à mourir. Ils se tournent quotidiennement vers la brume des images, le brouillard des sens, ils optent sans hésiter pour des représentations fallacieuses qui leur facilitent la vie, des théories creuses qui l’embellissent en apparence. Ils se satisfont trop facilement de quelques pépites découvertes (l’art, la science, les techniques), et les plus exigeants d’entre eux se contentent trop vite des éclats de quelques perles (qu’ils nomment avec fatuité « perles de sagesse »)…
Rares les hommes qui méditent sans cesse sur la mort, comme le conseille Platon. « De deux choses l’une : ou bien d’aucune manière il ne nous est possible d’acquérir la connaissance, ou bien ce l’est pour nous une fois trépassési. » Platon dit en somme que le moyen de s’approcher le plus près de la connaissance, c’est d’avoir le moins possible commerce avec le corps. Passant à la limite, on peut en déduire que seule la mort est le royaume de la vraie connaissance. C’est là qu’on peut espérer la trouver, cette connaissance véritable. Sereinement, et même joyeusement, Socrate a fait d’ailleurs part de cet « immense espoir » à ses amis affligés, peu avant de boire la ciguë. Sur quoi cet espoir repose-t-il ? Il s’appuie sur une idée folle : « Nous sommes des êtres divins », dit Socrate. Qu’est-ce qui justifie une telle assertion ? Un homme de la Renaissance italienne livre cette explication, dans le genre néo-platonicien : « Précisément parce que, privés momentanément de notre demeure et de notre patrie céleste, c’est-à-dire aussi longtemps que nous sommes sur la terre les suppléants de Dieu, nous sommes sans cesse tourmentés par le désir de cette patrie céleste, et que nul plaisir terrestre ne peut consoler dans le présent exil l’intelligence humaine désireuse d’une condition meilleureii. » Cet espoir immense, fou, déraisonnable, se base assez paradoxalement sur la seule activité de la raison. Marsile Ficin l’explique : « L’espoir de l’immortalité résulte d’un élan de la raison, puisque l’âme espère non seulement sans le concours des sens, mais malgré leur opposition. C’est pourquoi je ne trouve rien de plus admirable que cette espérance, parce que, tout en vivant sans cesse parmi des êtres éphémères, nous ne cessons pas d’espéreriii. » Cette idée « folle » a cependant été partagée au long des âges par des sages de haut vol et des philosophes sortant de l’ordinaire: Zoroastre, Hermès Trismégiste, Orphée, Pythagore, Platon… Ils ont fait école. Leurs élèves, Xénocrate, Arcésilas, Carnéade, Ammonius, Plotin, Proclus, ont repris le flambeau, pendant quelques siècles. Mais aujourd’hui, les gazettes et les journaux télévisés ne traitent plus guère de ce qui fut matière à tant de réflexion. Que reste-t-il de ce passé qui semble avoir passé. Des livres peu lus? De cette ère de croyances, témoignent encore, cependant, et souvent fort malencontreusement, les éructations et les anathèmes, pleins de haine, de fondamentalistes « religieux ». De ceux-là, il vaut mieux surtout ne jamais les approcher. et s’efforcer de les fuir absolument.
Si l’on reste sur le plan philosophique, l’argument de Socrate paraît avoir une certaine portée. Selon lui, il n’y a que deux hypothèses à considérer: soit la connaissance n’est pas possible du tout, soit elle n’est possible qu’après la mort.
Un prophète hébreu a parlé jadis de la mort. C’est assez rare pour être noté. La Bible hébraïque ne traite pour ainsi dire jamais de ce qui se passe après la mort. Ce prophète, Daniel, a dit de sa voix de voyant: « Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l’opprobre, pour l’horreur éternelle. Les savants brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre, brilleront comme les étoiles pour toute l’éternité iv. »
La prophétie de Daniel a une certaine saveur gnostique, avec sa référence aux « savants », aux « doctes ». Mais ce n’est pas d’un savoir cognitif dont il est ici question. Il s’agit essentiellement de savoir ce qu’est la justice, et comment on peut l’enseigner à « un grand nombre ». Apparemment, les humains de nos jours ne semblent guère s’y connaître en matière de justice. Il suffit de suivre l’actualité et d’observer le déferlement des injustices les plus criantes dans le monde. Aucune force, politique ou morale, ne paraît aujourd’hui capable de « rendre » la justice dans ce bas monde, semble-t-il. Il est vrai que la justice est d’une essence moins humaine que divine. Mais quand les dieux sont morts, la justice doit-elle aussi agoniser? Y a-t-il aujourd’hui un lieu dans le monde où règne la justice ? Je ne sais. Mais à l’évidence, il y a des lieux où la plus effroyable injustice se donne libre cours. Dans l’indifférence divine? La justice des hommes n’est que cendres et poussière. Elle porte la mort en elle. Et nous voulons la vie.
______________
iPlaton, Phédon, 66 e
iiMarsile Ficin, Théologie Platonicienne,Livre XVI
iiiIbid.
ivDan 12,3

D’après la Bible juive le monde a été créé il y a environ 6 000 ans. Selon les cosmologistes contemporains, le Big Bang remonte à 14 milliards d’années. Mais ce Big Bang lui-même n’est pas nécessairement l’instant originel. Rien n’existant sans cause, il faut bien s’interroger sur ce qui a rendu possible cet événement. L’origine réelle de l’Univers pourrait donc être bien plus ancienne. En théorie du moins, on pourrait remonter par conséquent bien plus avant encore, à la recherche d’une « origine » toujours plus élusive. La mythologie chinoise évoque des périodes de temps bien plus longues que ce que la cosmologie moderne propose. Dans La pérégrination vers l’Ouest, un ancien roman chinois, d’inspiration bouddhique, le récit de la création du monde commence par une première montagne qui se forme « au moment où le pur se séparait du turbide ». Cette montagne, appelée le mont des Fleurs et des Fruits, « domine un vaste océan ». Elle est « le pilier du ciel où se rencontrent mille rivières » et elle constitue « l’axe immuable de la terre à travers dix mille kalpa ». Elle est couverte de bambous et abonde en fruits (des pêches). « Le pêcher des immortels ne cesse de former des fruits, les bambous longs retiennent les nuages. » Qu’est-ce qu’un kalpa ? La signification de ce mot sanskrit, utilisé pour définir des durées extrêmement longues, ne peut être appréhendée que métaphoriquement. Soit un cube de 40 km de côté, rempli à ras bord de graines de moutarde. On retire de ce cube une graine une fois par siècle. Quand le cube est vide, on est encore loin d’avoir épuisé la durée du kalpa. Autre image : soit un gros rocher. On l’effleure une fois par siècle d’un rapide coup de chiffon. Quelques particules s’envolent alors. Lorsqu’il ne restera plus rien du rocher, alors on n’est pas encore au bout du kalpa.
Depuis combien de temps, donc, l’univers existe-t-il ? Depuis 6000 ans ? Depuis 14 milliards d’années ? Depuis 10 000 kalpa ? On peut faire l’hypothèse, assez raisonnable, que l’idée même de temporalité n’est pas très assurée, au-delà d’un certain horizon conceptuel. De même que l’espace est « courbe », le temps est « courbe » lui aussi. La théorie de la relativité générale d’Einstein a établi que les objets de l’univers ont une tendance à se mouvoir vers les régions où le temps s’écoule relativement plus lentement. Le cosmologiste Brian Greene formule la chose ainsi : « En un sens, tous les objets veulent vieillir aussi lentement que possible. » C’est une conséquence de la « courbure » du temps. Cette tendance potentielle est analogue au fait que les objets « tombent » lorsqu’ils sont soumis à un champ de pesanteur. Autrement dit, lorsque des objets de l’Univers se rapprochent de certaines des singularités de l’espace-temps que l’on peut qualifier d’« originaires », alors le temps ralentit toujours davantage son propre cours. Si on extrapole ce résultat, la notion même de temps perd tout son sens. À cette aune, même une durée de dix mille kalpa ne pourrait rendre compte d’un temps infiniment distendu.
Rapportées à la vie humaine, ces durées de temps peuvent être assimilées à une sorte d’infini, sans que ce mot ait nécessairement une connotation métaphysique. Des durées extrêmement longues peuvent paraître objectivement infinies, quoique en réalité finies. La différence laisse seulement apparaître la question réellement métaphysique de l’origine même du temps. On en déduira aussi que le temps n’a aucune sorte d’objectivité « scientifique », et qu’on ne peut certes pas le représenter selon la façon habituelle, comme une simple droite le long de laquelle s’égrèneraient linéairement les milliards d’années. Il reste certain qu’à l’échelle des kalpa, la durée d’une vie humaine n’est qu’une sorte de femto-seconde, ultra-fugace, un quasi-néant, et la durée totale de l’existence du genre Homo Sapiens n’est elle-même guère plus longue qu’un battement de cœur. A vrai dire toutes ces métaphores n’ont guère de sens. Ou alors, elles impliquent nécessairement qu’il nous faut changer complètement de regard sur ce qu’est l’essence du temps. La principale conséquence de ceci est essentiellement métaphysique. Les récits inouïs qui pourraient, en théorie, se déployer dans la profondeur des temps, les infinies narrations auxquels ils pourraient donner lieu, ne sont épuisés par aucune vision unique. Autrement dit, l’infini des temps possède sa propre architecture. Des philosophes aux propensions mystiques, tels Plotin ou Pascal, ont formulé d’admirables représentations du temps. Mais on peut inférer des considérations précédentes que toute formulation comportant des mots comme « origine » ou « infini » ne serait elle-même qu’un grain de moutarde emportée dans la tempête des temps. Toute théorie métaphysique ne couvre elle-même qu’une ère infiniment infime. Et cet énoncé même l’est aussi… Il nous faut donc une autre « approche » du temps. Il faut considérer, de loin, les infinis paysages de l’infini, et l’infinité de tous les points de vue sur tous les angles de vue possibles dans ces paysages. Parmi cette infinité d’infinis, certains méritent le détour, et même quelque arrêt sur l’image, quelque pause méditative, elle-même source, peut-être, d’une nouvelle série infinie de considérations. Il faut désormais prendre conscience que nous sommes tous embarqués – et quand je dis « nous », j’entends ce « nous » à l’échelle de tous les univers possibles et concevables – il faut prendre conscience que nous sommes embarqués dans un infini voyage. Un voyage sensible et conceptuel, et un voyage sans âge, ou plutôt un voyage qui les comprend tous, ces âges et ces ères, un voyage qui les dépasse et les transcende.

Sur la question de l’Un, on trouve de par le monde, à travers les époques, de bien multiples opinions. L’Un, apparemment, ne se laisse pas dire tout uniment, ni saisir de façon univoque. Contradiction ? Ou bien incitation à la recherche ? Il y a quelque chose de stimulant à observer la tension entre l’idée de l’Un, en tant que telle, et les innombrables manières dont elle se laisse décliner. Notons aussi que, d’emblée, l’idée de l’existence de l’Un revient à poser une deuxième idée, celle de l’Être. En effet si l’Un est, cela revient à dire que l’Un participe de l’Être. L’Un n’est donc pas seulement et purement « un », puisqu’il se définit aussi comme un « être un ». Cela implique que de son unité essentielle dérive une certaine dualité, celle de l’un et de l’être. La compacité de l’Un se fissure dès lors, pour se faire créatrice, pour engendrer de l’Autre. L’Un, dès l’origine, se voit ajouter l’Être, pour « être » en effet, mais au prix de n’être plus seulement « un » alors, puisque l’Un doit être aussi, pour être Un. Avec cette première fissure, la pensée peut maintenant continuer de s’ouvrir et de penser. Par exemple, s’il y a de l’Être avec l’Un, et si l’Être est, lui aussi, alors peut-on aller jusqu’à penser que le non-Être n’est pas ? On sait qu’il existe certaines écoles de pensée (grecques, mais aussi bouddhistes) qui n’hésitent pas à proclamer l’existence du non-Être, et l’illusion de l’Être. Quant aux tenants de la théologie négative, comme le Pseudo-Denys l’aréopagite, ils expriment un doute radical quant à la possibilité même d’utiliser des concepts comme l’un ou l’être pour définir cette ‘Cause transcendante’ qui échappe absolument à tout raisonnement, à tout discours. « On ne peut la saisir intelligiblement ; elle n’est ni science, ni vérité, ni royauté, ni sagesse, ni un, ni unité, ni déité, ni bien, ni esprit au sens où nous pouvons l’entendre ; ni filiation, ni paternité, ni rien de ce qui est accessible à notre connaissance, ni à la connaissance d’aucun être, mais rien non plus de ce qui appartient à l’être ; que personne ne la connaît telle qu’elle est, mais qu’elle-même ne connaît personne en tant qu’êtrei. »
Mais on peut aussi décider de mettre entre parenthèses ces objections, et admettre (au moins provisoirement) que l’Être est, ce qui permet de concevoir (au moins en principe) que l’Un peut donc être, lui aussi. On tire de l’idée de l’Un une deuxième idée, celle de l’Être. Au cœur même de l’Un, il y a, au moins conceptuellement, du Deux : l’Un et l’Être. Certes, les Vieux Croyants diront que cet Un et cet Être sont bien le même. Sans doute. Mais enfin, il reste que ce sont bien là deux concepts distincts, n’est-ce pas ? Et de là s’ouvrent d’autres questions, que l’on vient d’effleurer. Si l’Être est, est-ce que le non-Être est, ou bien n’est-il pas ? Idem pour l’Un et le non-Un… Et si le non-Un est, qu’est-ce sinon le multiple ? La pensée qui se met à penser, ne peut longtemps se suffire de l’Un, ou de l’Être. Elle demande à se multiplier elle-même, à se développer, à bourgeonner, à vivre sa vie, à se dépasser… Même si l’on reconnaît que l’Un est, a été et sera toujours Un, peut-on penser que l’Un laissera un peu de place à l’Autre ? Être ou Autre, that is the question. Une question, mais pas la seule. Une autre question surgit en effet immédiatement. Pourquoi l’Un n’est-il pas resté seulement Un ? Pourquoi un Commencement est-il advenu, interrompant l’éternelle unicité de l’Un ? Pourquoi, en ce Commencement, a-t-il été créé de l’Autre que l’Un, et donc du non-Un ? Pourquoi, en dehors de l’Un, cette émergence, cette existence effective du Multiple, du Divers, du non-Un, dont le Cosmos tout entier, mais aussi la multiplicité du Vivant sont partie prenante. Comme on voit, les possibilités d’autres discours sur l’Un prolifèrent sans mesure, dès que s’ouvrent les perspectives du non-Un.
Mais pour sa part, et peut-être par besoin de simplification, le philosophe Alain Badiou a déterminé l’existence de seulement quatre discours possibles sur la question de l’Un. Pourquoi quatre ? Comme on vient de voir, on pourrait d’emblée en énumérer bien davantage, tant l’Un a créé du multiple, du divers, du varié, du nombreux, et même de l’innombrable, pendant tous les éons et les kalpas du passé, sans parler de ceux de l’avenir. Il est vrai que Badiou a décidé de se concentrer sur un assez petit espace géographique, en gros la Grèce et le Levant, et pendant une période de temps spécifique – le 1er siècle de notre ère. Il recense donc dans cette étroite fenêtre spatio-temporelle quatre discours sur l’Un : le discours du Juif, le discours du Grec, le discours chrétien, et enfin un quatrième discours, « qu’on pourrait appeler mystiqueii », comme il dit.
Qu’est-ce que le discours du Juif ? C’est, dit Badiou, celui du prophète, celui qui met en scène les « signes ». C’est « un discours de l’exception, car le signe prophétique, le miracle, l’élection, désignent la transcendance comme au-delà de la totalité naturelleiii ».
Qui incarne le discours du Grec ? C’est le « sage », le « philosophe », celui qui lie l’être au logos, et le logos au cosmos, « l’ordre fixe du monde ». Le logos est un « discours cosmique » qui dispose le sujet dans « la raison d’une totalité naturelleiv », pose Badiou.
Il ne faut pas se le cacher, ces deux positions, celle du Juif et celle du Grec, s’opposent nettement, du moins en apparence. « Le discours grec argue de l’ordre cosmique pour s’y ajuster, tandis que le discours juif argue de l’exception à cet ordre pour faire signe de la transcendance divinev . » Mais en réalité, ce sont « les deux faces d’une même figure de maîtrise ». Et c’est en cela que réside « l’idée profonde » de Paul, ajoute Badiou. « Aux yeux du juif Paul, la faiblesse du discours juif est que sa logique du signe exceptionnel ne vaut que pour la totalité cosmique grecque. Le Juif est en exception du Grec. Il en résulte premièrement qu’aucun des deux discours ne peut être universel, puisque chacun suppose la persistance de l’autre. Et deuxièmement, que les deux discours ont en commun de supposer que nous est donnée dans l’univers la clé du salut, soit par la maîtrise directe de la totalité (sagesse grecque), soit par la maîtrise de la tradition littérale et du déchiffrement des signes (ritualisme et prophétisme juifs)vi. »
Si l’on suit Badiou, on en conclut que ni le discours grec, ni le discours juif ne sont « universels ». L’un n’est dévolu qu’aux « sages », et l’autre n’est réservé qu’aux « élus ». Par contraste, argumente Badiou, le projet de Paul est de « montrer qu’une logique universelle du salut ne peut s’accommoder d’aucune loi, ni celle qui lie la pensée au cosmos, ni celle qui règle les effets d’une exceptionnelle élection. Il est impossible que le point de départ soit le Tout, mais tout aussi impossible qu’il soit une exception au Tout. Ni la totalité ni le signe ne peuvent convenir. Il faut partir de l’événement comme tel, lequel est a-cosmique et illégal, ne s’intégrant à aucune totalité et n’étant signe de rienvii. »
Paul considère seulement cet unique événement, improbable, inouï, incroyable, jamais vu, mais qui a bien eu lieu, dans l’Histoire. C’est un événement qui a pris une place unique dans l’histoire du monde, un événement qui n’a aucun rapport avec la Loi, et qui n’a non plus aucun rapport avec la sagesse. Il a introduit dans le monde quelque chose d’absolument et radicalement nouveau. Paul voit qu’il a renversé toutes les traditions, pluriséculaires, et même millénaires. Et Paul sait qu’il lui faut maintenant parler au nom de Celui qui est capable de tout détruire, de tout anéantir. « Aussi est-il écrit : ‘Je détruirai la sagesse des sages, et j’anéantirai l’intelligence des intelligents.’ Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur du siècle ? […] Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sontviii. » On ne peut nier que ces paroles incisives soient proprement révolutionnaires. L’ordre établi, l’ordre de la Loi comme l’ordre cosmique, n’aime pas être remis en cause. Paul sait que ces paroles sont « scandaleuses » pour les Juifs, et « folles » pour les Grecs. Qu’importe ! Elles sont surtout radicalement « nouvelles ».
Après les trois discours, celui du Juif, celui du Grec et celui du chrétien, il y a encore un autre discours, celui du « mystique ». Mais de celui-ci, on peut à peine parler, tant il est allusif, voilé. Paul l’évoque d’une manière brève, lapidaire, pour en souligner le caractère indicible : « Je connais un homme […] qui entendit des paroles ineffables qu’il n’est pas permis à un homme d’exprimerix. » Lui-même, qui en sait plus long qu’il n’en dit, ne peut révéler tout ce qui serait à entendre, mais que l’on ne peut entendre. Il serait inaudible. L’ineffable se conjoint intimement ici à l’inaudiblex.
À la question de l’Un, on vient de voir que deux discours sur quatre nient son lien avec l’« universel » et choisissent de ne s’adresser qu’aux « élus » ou aux « sages ». Le troisième discours revendique sans doute l’« universel », mais pour aussitôt être rejeté par ceux qui le considèrent comme un « scandale » ou une « folie », ce qui en diminue en quelque sorte l’universalité. Quant au quatrième discours on a vu qu’on ne peut rien en dire, au sens propre, puisqu’il relève précisément de l’ineffable. En somme, on voit à tout le moins qu’aucun des quatre discours sur la question de l’Un ne l’ont résolue unanimement.
Il y a sans doute bien d’autres pensées pensables, et d’autre réponses encore à la question de l’Un, que celles que Badiou a choisi de sélectionner. On pourrait même imaginer, dans l’idéal, qu’il existe un point de vue spécial qui conjoigne les quatre propositions précitées, selon une sagesse qui ne serait ni juive, ni grecque, ni chrétienne, ni mystique, mais beaucoup plus profonde encore. Cette sagesse-là, si elle existait, pourrait représenter une image plus juste du point de vue de l’Un même.
Jadis, les prêtres égyptiens employaient pour leurs cérémonies sacrées un parfum appelé Kyphi. Il était composé de seize substances : miel, vin, raisins secs, souchet, résine, myrrhe, bois de rose, séséli, lentisque, bitume, jonc odorant, patience, petit et grand genévrier, cardamone, calamexi. Le Kyphi, à l’arôme unique et complexe, se compose de multiples essences, et l’on pourrait oser dire que son parfum est une métaphore de l’Un.
Baudelaire n’a-t-il chanté l’ivresse issue de la puissance de
« Ce grain d’encens qui remplit une église,
Ou d’un sachet le musc invétéré » ?
Résonnent aussi, plus anciennes, les paroles qui ont chanté jadis,
« Le nard et le safran,
le roseau odorant et le cinnamome,
avec tous les arbres à encens ;
la myrrhe et l’aloès,
avec les plus fins arômesxii. »
Exquises et multiples, ces senteurs, ces flagrances, ces essences s’unissent en une seule huile (שֶׁמֶן shemen). Celle-ci s’épanchant figure le Nom unique (שֵׁם shem)xiii.
_____________________
iPseudo-Denys l’Aréopagite. La Théologie mystique. Ch. V, 1048 A. Trad. Maurice de Gandillac. Aubier, 1943, p. 183.
iiAlain Badiou. Saint Paul. La fondation de l’universalisme. PUF, 2015
iiiIbid.
ivIbid.
vIbid.
viIbid.
viiIbid.
viii1 Cor. 1, 17sq.
ix2 Cor. 12, 1-6
xL’idée de l’ineffable inaudible n’était pas en soi entièrement nouvelle. Plutarque a rapporté par exemple qu’il y avait en Crète une statue de Zeus qui le représentait sans oreilles, et il en livrait cette explication : « Il ne sied point en effet au souverain Seigneur de toutes choses d’apprendre quoi que ce soit d’aucun homme ». Mais Paul était un rabbin versé dans les Écritures. Il savait qu’Abraham, Moïse ou Job avait eu la possibilité de se faire entendre de Celui qui avait manifestement des oreilles pour entendre leurs prières ou leurs plaintes…
xi D’autres recettes de ce parfum ont été données par Galien, Dioscoride, et d’autres encore dans des textes trouvés dans les temples d’Edfou ou celui de Philae.
xiiCt 4,14
xiiiCt 1,3

Pour le comparatiste, il apparaît que les monothéismes, malgré qu’ils en aient, ont aussi des tendances panthéistes. Ils mettent volontiers en scène des représentations plurielles du divin. On trouve par exemple, dans les textes sacrés du judaïsme, des « anges », dont on ne distingue pas clairement, comme lors de leur apparition dans les plaines de Mamré, s’ils sont de simples messagers de Dieu, distincts de Lui, ou s’ils représentent divers aspects de Son essence même. On multiplie dans ces mêmes textes les « noms de Dieu », dont on trouve plus d’une dizaine de variations dans la Torah. Comment expliquer un Dieu essentiellement « un », dont la pure unicité s’accommode si aisément d’une multiplicité de ses « noms » ? De même, dans le christianisme, des théologiens arborant des tendances néo-platoniciennes aiment à considérer les nombreuses « émanations » de l’essence du Dieu « un ». Quant au concept de Trinité, qui donne lieu à de nombreuses incompréhensions de la part des autres monothéismes, se mêle-t-il à l’idée de l’Un, pour mieux en glorifier l’essence même, et la transcender – ou pour en compliquer et obscurcir la notion?
Réciproquement, les religions censées être polythéistes, à commencer par la védique ou l’hindouiste, mais aussi la religion de l’Égypte ancienne ou encore les religions grecques et romaines, possèdent généralement une réelle intuition de l’Un. Elles portent haut le sentiment d’une Divinité suprême, et en cela « unique », dont l’essence est suréminente, et bien au-delà des autres « dieux ». Ceux-ci ont d’ailleurs été considérés, par exemple dans les Mystères, comme autant d’avatars de la Divinité, des symboles de ses attributs, des images de son intelligence ou de sa sagesse, de sa puissance ou de sa justice.
L’Hymne de Cléanthe à Zeus, écrit au 3ème siècle avant J.-C., me semble parfaitement illustrer les relations possibles entre un panthéisme de façade et un monothéisme immanent, sous-jacent. Aucun adorateur du Dieu des monothéismes ne pourra nier, me semble-t-il, que le Dieu de Cléanthe ne possède une essentielle ressemblance avec le « Zeus », le « Jupiter », le « Roi suprême de l’univers », appelé « Père » par ceux qui le louent :
« Salut à toi, ô le plus glorieux des immortels, être qu’on adore sous mille noms, Jupiter éternellement puissant ; à toi, maître de la nature ; à toi, qui gouvernes avec loi toutes choses ! C’est le devoir de tout mortel de t’adresser sa prière ; car c’est de toi que nous sommes nés, et c’est toi qui nous as doués du don de la parole, seuls entre tous les êtres qui vivent et rampent sur la terre. À toi donc mes louanges, à toi l’éternel hommage de mes chants ! Ce monde immense qui roule autour de la terre conforme à ton gré ses mouvements, et obéit sans murmure à tes ordres… Roi suprême de l’univers, ton empire s’étend sur toutes choses. Rien sur la terre, Dieu bienfaisant, rien ne s’accomplit sans toi, rien dans le ciel éthéré et divin, rien dans la mer ; hormis les crimes que commettent les méchants par leur folie… Jupiter, auteur de tous les biens, Dieu que cachent les sombres nuages, maître du tonnerre, retire les hommes de leur funeste ignorance ; dissipe les ténèbres de leur âme, ô notre père, et donne-leur de comprendre la pensée qui te sert à gouverner le monde avec justice. Alors nous te rendrons en hommages le prix de tes bienfaits, célébrant sans cesse tes œuvres ; car il n’est pas de plus noble prérogative, et pour les mortels et pour les dieux, que de chanter éternellement, par de dignes accents, la loi commune de tous les êtresi. »
La démarche comparatiste invite à considérer les analogies et les ressemblances. Plutôt que de se cantonner à ressasser les chiasmes et les différences, elle encourage à chercher des synthèses supérieures, à explorer des voies de compréhension plus larges, plus universelles. À tout le moins, une opposition irréconciliable entre le monothéisme, d’une part, et les polythéismes ou les panthéismes, d’autre part, ne lui paraît pas si pertinente, ni adéquate à la progression dans la compréhension d’un mystère, qui dépasse l’intelligence humaine.
La démarche comparatiste permet de rapprocher les cultures, de comprendre leurs liens cachés, profonds, et de révéler par là même l’existence de constantes anthropologiques. Le fait religieux est l’un des phénomènes les plus anciens qui soit apparu avec Homo Sapiens, sur cette Terre. Et ce fait a pris de multiples formes. Il serait vain de vouloir ramener cette miroitante diversité à des idées (trop) simples, et arbitrairement exclusives. Il vaut la peine de rechercher patiemment les points communs entre des religions qui ont traversé les millénaires. D’autres niveaux de compréhension apparaissent alors.
Il y a des religions qui continuent de vivre aujourd’hui, et qui témoignent encore (un peu) de ce qu’elles furent jadis, sans toutefois indiquer toujours clairement ce qu’elles pourraient être appelées à devenir, dans les prochains chapitres de l’histoire (que nous espérons longue) de l’espèce humaine. Il y a aussi des religions fort anciennes, maintenant disparues, mais qui continuent de vivre virtuellement, du moins si on fait l’effort de recréer par la pensée, par l’imagination, la nature essentielle de leurs intuitions, la beauté sombre de leurs cultes, et si on voit en elles, pour les magnifier, des symboles de passions et de pulsions humaines, peut-être oubliées, mais immanentes, et sans doute toujours à l’œuvre dans la psyché humaine. Sous d’autres formes, sous d’autres noms, elles ne cesseront de vivre, dans une éternité qui dépasse l’humain, et le divin lui-même.
_______________
iHymne de Cléanthe. Traduction d’ Alfred Fouillée

À midi, dans les plaines de Mamré, « trois hommes » rencontrent Abrahami. Ensuite, seulement « deux anges » rencontrent Loth le soir même, à Sodomeii. Pourquoi trois hommes à midi, puis deux anges le soir? Philon d’Alexandrie livre cette interprétation, métaphysique et allégorique : « Alors que trois étaient apparus pourquoi l’Écriture dit-elle ‘Les deux anges vinrent à Sodome le soir’. Trois apparaissent à Abraham et à midi, mais à Loth, deux et le soir. L’Écriture fait connaître la différence au sens profond qu’il y a entre l’être parfait et celui qui progresse, à savoir le parfait a l’impression d’une triade, nature pleine, continue, à qui il ne manque rien, sans vide, entièrement pleine, mais celui-là a l’impression d’une dyade qui a séparation, coupure et vide. L’un a accueilli le Père qui est au milieu et est servi par les deux premières puissances, tandis que l’autre a accueilli les puissances servantes sans le Père, car il était trop faible pour voir et comprendre celui du milieu, roi des puissances. L’un est illuminé d’une lumière très éclatante, lumière de midi et sans ombre, tandis que l’autre l’est d’une lumière changeante, aux limites de la nuit et du jour, car le soir a reçu en partage d’être un espace intermédiaire : ce n’est ni la fin du jour, ni le commencement de la nuitiii. » Selon Philon, les trois anges représentent Dieu [le Père], se tenant au milieu, et « servi par les deux premières Puissances ». Cette interprétation est un peu gênante, à l’évidence, du point de vue d’un strict monothéisme. En revanche, elle n’est pas incompatible avec une interprétation trinitaire, telle que celle que le christianisme devait proposer un peu plus tard. Philon est né en 25 av. J.-C., et il vivait à Alexandrie, alors en plein bouillonnement d’idées, notamment néo-pythagoriciennes et néo-platoniciennes, et bénéficiant d’influences venues de Chaldée ou de Perse.
Plus de mille ans après Philon d’Alexandrie, le célèbre Rachi, de Troyes en Champagne, fournit une explication très différente de ce même passage. Rachi commente ainsi le verset 2 du chapitre 18 : « ET VOICI TROIS HOMMES. Dieu envoya des anges à forme humaine. Un pour annoncer la bonne nouvelle concernant Sara. Un pour détruire Sodome. Un pour guérir Abraham. Car un même messager n’accomplit pas deux missions à la fois. » Quant au verset 1 du chapitre 19, Rachi note ; « LES DEUX. Un pour détruire Sodome et un pour sauver Loth. C’était ce dernier qui était venu guérir Abraham. Le troisième qui était venu pour annoncer à Sara la naissance de son fils, une fois sa mission remplie, s’en est allé. – LES ANGES. Plus haut (Gn 18,2) on les appelle DES HOMMES. Lorsque la Che’hina était avec eux, on les appelle des hommes. Autre explication : précédemment, auprès d’Abraham dont la force était grande et qui était habitué aux anges autant qu’aux hommes, on les appelle des hommes. Tandis qu’auprès de Loth on les appelle des anges. »
Il y a un point commun entre Philon et Rachi; ils s’accordent sur le fait qu’Abraham était « parfait », « fort », et que Loth était « faible ». Ils en déduisent tous les deux que voir la Che’hina entre deux « hommes » est un signe de force, mais que voir seulement des anges, donc sans la présence de la Che’hina, est en revanche un signe de faiblesse.
D’autres questions s’ensuivent. Pourquoi est-ce que l’ange qui avait annoncé la prochaine naissance d’un fils à Abraham et Sara, s’en est-il allé sa mission accomplie, laissant ses deux compagnons, deux autres « anges », continuer vers Sodome et Gomorrhe? Autre question : pourquoi l’ange qui était en fait spécifiquement chargé de détruire Sodome et Gomorrhe était-il présent lors de la rencontre de Mamré, alors qu’il ne s’agissait que d’annoncer à Abraham la naissance à avenir d’Isaac, et également, selon Rachi, de compléter la guérison d’Abraham?
On pourrait arguer qu’il était là, avec ses compagnons, pour écouter les arguments d’Abraham en faveur des habitants des deux villes, menacées d’extermination imminente. Lorsqu’Abraham présente sa longue plaidoirieiv pour intercéder en faveur des habitants de Sodome et Gomorrhe, on peut présumer qu’il s’adresse précisément à cet ange – l’ange exterminateur. Or, à cet ange-ci, le texte de la Genèse donne le nom de l’Éternel, ce nom imprononçable, יְהוָה ,YHVH (lors de ses échanges verbaux avec Abraham).
Il y a dans ces chapitres de la Genèse, une véritable complication, une dense obscurité, difficile à éclaircir. D’un côté, il y a « trois hommes », chargés respectivement de trois missions bien différentes (l’annonce de la naissance d’un fils à Abraham, la guérison prochaine d’Abraham et l’extermination de la population de deux villes). De plus, ces « trois hommes », ou plutôt ces « trois anges », on comprend progressivement qu’ils représentent en réalité l’Éternel, יְהוָה (YHVH), ainsi nommé dans le texte. L’Éternel s’y exprime, à plusieurs reprises, à la 1re personne du singulier, et sans ambiguïté. Adonaï, le Seigneur, l’Éternel, YHVH « dit » (וַיֹּאמֶר יְהוָה). Les « trois hommes » prennent successivement la parole. Le premier annonce la naissance d’un fils à Abraham et Sara. Le second se parle à lui-même, soliloquant en quelque sorte en aparté (« L’Éternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais fairev? »). Quant au troisième, il débat de la prochaine extermination de Sodome et Gomorrhe avec Abraham, qui tente de l’en dissuader. Puis le Seigneur (YHVH) « s’en allavi » (וַיֵּלֶךְ יְהוָה, va-yélêkh Adonaï), lorsqu’il eut fini de parler avec Abraham. Et tout de suite après, c’est-à-dire au verset suivant, il est écrit : « Les deux anges arrivèrent à Sodome le soirvii ».
Résumons. Dieu était bien « présent », en tant que Ché’hina, « au milieu » des trois hommes en visite chez Abraham, à Mamré. Il était « présent » tout au long de la route jusqu’aux portes de Sodome. Arrivé là, et après avoir encore parlé avec Abraham, il s’en va, et il ne reste plus que « deux anges ». L’un a pour tâche de détruire Sodome et Gomorrhe et d’exterminer leurs populations, l’autre est là pour sauver Loth et sa famille. Dieu s’en est allé juste avant que l’extermination ne commence.
Dans ce chapitre 18 de la Genèse, des paroles sont échangées entre Dieu, Abraham, et même Sara (qui semble quelque peu rabrouée par Dieu : וַיֹּאמֶר לֹא, כִּי צָחָקְתְּ , « Il dit : ‘Non, tu as ri’viii »). Les dialogues sont brefs, incisifs. Mais il y a aussi toute une riche gestuelle, un ballet de mouvements. Abraham court, se prosterne, entre en hâte (dans sa tente), se tient debout, s’avance, marche pour accompagner ses hôtes… Alors qu’il était assis à l’entrée de sa tente, Abraham lève les yeux : « Il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui ; dès qu’il les vit, il courut de l’entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terreix. » Mais comment se fait-il qu’Abraham courre vers des hommes qui se tenaient déjà près de lui ? Il y a sans doute là un sens caché. Lequel ? Abraham voit trois hommes « debout », mais lui est « assis ». Ils sont « près de lui », mais Abraham est assez loin d’eux. Il faut d’abord qu’il se lève, pour se mettre à leur niveau, et qu’il se mette à courir, pour se rapprocher d’eux, autant que ceux-ci se sont déjà approchés de lui. Tout ceci est à comprendre au niveau spirituel, et même métaphysique. Ensuite, Abraham « se hâte vers la tentex », puis « il courut au troupeauxi ». Lorsqu’ils mangeaient, « il se tenait deboutxii ». Après cela, « s’étant levés, les hommes partirent de là et arrivèrent en vue de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduirexiii. » Suit une sorte de soliloque de l’Éternel. Enfin, le groupe repart, YHVH restant avec Abraham : « Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. YHVH se tenait encore devant Abrahamxiv. » Devant Sodome même, un long échange a encore lieu entre Dieu et Abraham, lequel tente d’intercéder en faveur des habitants de la ville, au nom des quelques « justes » qui sont en son sein. Puis Dieu s’en va. Et Abraham retourne chez luixv. Tout de suite après les deux anges entrent dans Sodome pour leur mission de mort et d’exterminationxvi.
En quelques lignes, on voit Abraham assis, puis il court à plusieurs reprises, vers les hommes, vers sa tente, vers le troupeau, vers sa tente à nouveau, puis il se tient debout, puis il marche vers Sodome, s’arrête, repart, arrive devant Sodome, discute avec Dieu, voit Dieu s’en aller, et s’en retourne chez lui. Comment expliquer tous ces mouvements chez un vieil homme, fort âgé assurément, venant de plus d’être circoncis, et se remettant avec peine de cette douloureuse opération? La simple description de ces mouvements du corps physique ne paraît pas suffisante. Ils traduisent sans doute l’extrême agitation intérieure d’Abraham. A mon avis, une clé décisive de compréhension se trouve au verset 18, 3, quand Abraham dit : « Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteurxvii. »
אַל-נָא תַעֲבֹר. « Ne passe pas ! » Le verbe employé, עבר, ‘abar, « passer, aller au-delà » est le verbe qui est aussi la racine du mot « hébreu » en hébreu, mot qui signifie étymologiquement « celui qui passe, qui traverse, qui va au-delà ». Voilà donc un Hébreu éminent, Abraham, un « passeur » s’il en est, et qui s’adresse à Dieu pour lui dire de « ne pas passer »… Abraham s’agite et court beaucoup, afin que Dieu « ne passe pas » – qu’il s’arrête chez lui.
Qu’en conclure ? D’abord, il faut noter, dans ce texte crucial, que le divin peut prendre successivement trois figures, celle de l’Un (YHVH), celle du Trois (« les trois hommes ») et la figure du Deux (« les deux anges »).
Ensuite, ce texte nous apprend que les mouvements du corps sont des métaphores des mouvements de l’âme, et que dans ces mouvements, l’homme n’est jamais seul. Trois hommes plus Abraham font quatre. Avec Sara, ils sont cinq. Mais quand Dieu et Abraham se parlent ils sont deux. Leurs attitudes, leurs positions, leurs mouvements doivent être coordonnés, conjoints, comme dans une danse. D’un côté, Abraham se lève, court, se prosterne, marche, etc., et de l’autre, Dieu reste présent, il « ne passe pas ».
___________
iGen 18, 2
iiGen 19, 1
iiiPhilon le Juif (Philo Judaeus), ou Philon d’Alexandrie. Quaestiones et solutiones in Genesim, Livre IV, 30
ivGen 18, 23-33
vGen 18,17
viGen 18,33
viiGen 19,1
viiiGen 18,15
ixGen 18,2
xGen 18,6
xiGen 18,7
xiiGen 18,8
xiiiGen 18,16
xivGen 18,22
xvGen 18, 33
xviGen 19,1
xviiGen 18,3
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.