
L’homme qui, par quelque grâce incompréhensible, atteindrait une entière conscience de l’état actuel du monde, qui posséderait une vision véridique du temps présent, se sentirait paradoxalement fort seul, extrêmement isolé ; il ne trouverait personne avec qui parler ou penser. Il se sentirait étrangement exclu des hordes et des tribus, écarté des peuples, coupé des masses et rejeté des nations. Si, par-dessus le marché, il possédait aussi quelque fibre prophétique, s’il pressentait l’avenir proche ou lointain, par morceaux ou en totalité, il serait bien plus esseulé encore, il se sentirait alors si prisonnier de ce savoir, qu’il en deviendrait étranger à lui-même, projeté dans un ailleurs, et littéralement aliéné. Dans un tel état de lucidité, supposée surhumaine, et dans la solitude qui l’accompagnerait, il serait amené à douter de ses pensées les plus intimes, les plus spontanées, à questionner ses déductions les plus serrées, les mieux étayées, et à sonder la sûreté même de sa raison. Rien d’étonnant à cela : les hommes vraiment « conscients » ont toujours été, à toutes les époques, dans tous les mondes, absolument et initialement solitaires. C’est l’une des conditions de leur vision, le prix de leur anticipation. Chaque pas vers une conscience plus incisive, plus aiguë, les éloigne davantage de l’inconscience commune, les libère d’une participation purement animale, collective, mimétique, avec la foule. Le cas échéant, s’ils ont quelque tendance mystique, ils se détachent même de leur fusion avec le Tout, parce qu’ils voient bien que le Tout lui-même reste toujours enceint d’un devenir encore impensé, encore impensable. Chaque pas en avant pour l’homme qui recherche une plus pleine conscience le détache toujours un peu plus de l’inconscience quasi utérine dans laquelle la masse des hommes s’agite et s’ébroue. Mais dans son avancée, que voit-il enfin en pleine conscience ? Il voit ce qui vient, ce qui, encore caché, meut les temps neufs. Seul l’homme vraiment « conscient » est donc essentiellement « moderne » ‒ au sens pré-moderne que ce terme avait jadis, en bas-latini. Lui seul voit précisément ce que donne à voir en son fond le temps présent. Il voit tout ce qui manque d’évidence à ce temps-ci, tout ce qui s’en absente, tout ce qui a disparu, et aussi tout ce qui n’est pas advenu, tout ce qui est en gésine, en puissance, et qui pourrait bien ne jamais advenir, si les conditions n’étaient pas remplies. Lui seul, l’homme vraiment « moderne », possède une conscience qui se déploie au-dessus de son époque, survole le passé et se propose de planer vers l’avenir. Lui seul réalise en son for intérieur que les modes de vie, tant anciens qu’actuels, le lassent, l’indiffèrent ou l’exaspèrent. Les valeurs et les aspirations des mondes passés comme celles du monde présent ne l’intéressent plus que d’un point de vue historique, elles lui paraissent « démodées ». En lui-même (et non pas dans le monde), il cherche un indice de temps à venir, de temps qui seraient plus adéquats à son désir. Ainsi, il devient anhistorique, au sens ontologique. Il voit que l’histoire du monde et l’histoire personnelle de son être se découplent, se détachent, se séparent, se dés-intriquent sous tous rapports. Il veut maintenant se détourner de toutes les réalités affadies, imbéciles et cruelles de cette histoire-là, l’histoire présente de ce monde-ci. Il sent même sa propre essence se détacher de l’Histoire avec un H. Il désire maintenant s’éloigner de la masse des hommes qui vivent sans pourquoi, dans l’étroitesse de leurs traditions, dans la brièveté de leurs vues, dans l’hypocrisie de leurs croyances. Il sait qu’il n’est pleinement lui-même que lorsqu’il ne vit ni dans le passé, ni dans le présent. Il est parvenu au bord extérieur de ce monde-ci, il en voit la flagrante finitude, l’irréalité même. Il est fatigué d’observer ses turpitudes, le mouvement de la tourbe, l’apparat des tyrans, ces homoncules dominateurs, vulgaires et assassins. Il a laissé derrière lui tout le passé, le passé dépassé et le passé trépassé. Il a cessé de prendre à cœur l’énormité des menaces mortifères qui pèsent sur l’avenir. Coincé seul sur la vire glissante, verglacée, du moi, il considère les lignes ‒ au fond du néant, il le sait, tout peut soudain s’abîmer. Il peut aussi en suivre d’autres, à nouveau, vers le haut, pour s’élever vers des sommets invisibles, selon la justesse de la prise et la force du bras. « Quel moment romantique et grandiose !», se dit-il, in petto, non sans une amère ironie. Cela frôle le pathos malvenu ou le ridicule assumé, pense-t-il encore. Rien n’est plus banal que de croire posséder une « grande conscience », reconnaît-il en lui-même, quand on est immobile dans la paroi du réel. Enfermé dans sa solide solitude, qui d’autre que lui-même peut lui garantir la vérité de l’analyse, la pertinence du jugement, la fermeté du projet, la certitude du cap ? Personne. Tout le porte à subodorer qu’un homme qui se croirait doté d’une « grande conscience » est en réalité inconscient de sa grande inconscience. C’est là un résultat général. Une multitude de personnes sans réel relief, mais pleines d’elles-mêmes, croient vivre d’une vie très « moderne », affirmative, occupée, sans distance. Elles sautent dans tous les trains qui passent, les omnibus comme les TGV, sans s’inquiéter de leurs incertaines ou terminales destinations.
En revanche, un homme vraiment « moderne », au sens métaphysique, serait l’homme qui n’habiterait ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans quelque avenir indéfinissable, mais qui verrait la nécessité de transcender tous ces « modes » de l’être, pour s’en affranchir enfin. L’homme vraiment « moderne » serait sans « mode », parce qu’il voudrait transcender tous les modes, et toutes les modes. Les transcender ? Pour les remplacer par quoi ? Par une raison hyper-critique ? Par une foi post-mosaïque et post-messianique ? Par une philosophie, qui ne serait pas faite de mille plateaux, ou de mille collines, mais striée de dix mille abîmes, illuminée de cent mille étoiles, irriguée de millions d’hyphes et baignée de milliards de cieux.
Les yeux lents des masses clignent sans distinguer de clarté : une nuit inintelligible les noie d’ombres, les confond d’illusions, les embrouille de spectres. Il n’y a rien à y faire, les foules n’y voient goutte : et, à toute époque, les hommes les plus réellement « modernes » leur suscitent lazzi et dérision. Ils leur apparaissent d’emblée suspects et sont aussitôt jugés coupables ‒ comme Socrate et Jésus jadis, et comme, demain, tous ceux qui diront la vérité. Être anhistorique est un péché prométhéen, contre les dieux et contre les hommes. En se voulant anhistorique, l’homme moderne devient un pécheur métaphysique, un bouc émissaire, qu’il faut rouer de coups, et tuer, parce qu’il révèle des vérités inacceptables pour l’inconscience publique. Accéder à un niveau de conscience plus élevé pèse un fardeau, demande un sursaut, exige un salto. Seul l’homme qui a dépassé tous les stades de conscience appartenant au passé, et qui a amplement rempli les devoirs assignés par le monde actuel, peut en toute connaissance, désirer s’en détacher, s’en éloigner. Désormais libre du passé et du présent, il pourra, s’il le veut assez, tenter d’atteindre un autre niveau de conscience, une conscience à venir.
Beaucoup de gens se croient sincèrement « modernes », mais ils ne connaissent pas l’acception proprement métaphysique du mot. Il est plus facile de trouver un homme métaphysiquement « moderne » parmi ceux qui se sont formés « à l’ancienne ». Ceux-là sont mus par la nostalgie, non de ce qui a été, mais de ce qui aurait pu être. Ils veulent réparer ce qu’ils considèrent être une rupture inévitable avec la tradition, en mettant, peut-être plus que nécessaire, quelque accent sur le passé. S’il existe, comme le pense Jung, une loi de la conservation de l’énergie (spirituelle), on dira que toute qualité a son revers et que rien de bon ne peut apparaître dans le monde sans produire simultanément un mal correspondant (‒ et réciproquement). Le passé doit donc consentir à laisser venir à lui l’avenir, pour en être dépassé, quoi qu’il en coûte. Les comptes s’équilibreront un jour, au plan métaphysique, peut-on espérer. Ceci rend illusoire l’euphorie qui peut nous envahir, si l’on croit que le temps présent joue un rôle crucial dans l’évolution future de l’humanité et du monde. C’est un sentiment bizarre et contradictoire que « nous » ‒ ces nains juchés sur les épaules de géants disparus ‒ nous sommes en ce moment même l’aboutissement provisoire de toute l’histoire de l’humanité, l’accomplissement éphémère de générations innombrables. Au mieux, ce devrait être seulement l’occasion de reconnaître humblement notre pauvreté mentale et morale : nous incarnons surtout, sans le savoir, la déception des espoirs et des attentes de la somme totale des âges anciens. Pensez qu’après deux mille ans d’idéalisme chrétien, l’on a observé dans les douze dernières décennies, non pas le retour glorieux du Messie et l’avènement de l’amour universel, mais deux guerres mondiales entre nations (dont principalement les soi-disant chrétiennes), des génocides, des tueries de masse, des crimes répétés contre l’humanité, et puis, à nouveau, de sanglantes guerres de décolonisation et de néo-colonisation. Quelles catastrophes itératives et réduplicatives, sans cesse, sur la terre comme au ciel ! L’humanité actuelle, en un sens, toujours « culmine » dans l’horreur, hier comme aujourd’hui ; mais demain elle sera peut-être dépassée, sur ce point. L’humanité actuelle résulte d’un développement s’étalant sur quelques dizaines de millénaires, autant dire une minute, à l’échelle cosmologique. Malgré quelques réussites éclatantes, elle a aussi été à l’origine des plus grandes déceptions, comparées aux espoirs que l’on pouvait en attendre, à l’aube des temps. L’homme, dit « moderne », s’il est assez lucide, a une conscience larvée de cet état des choses. Il a vu à quel point la science, la technologie, la politique, la société, peuvent être bénéfiques, et il a aussi vu à quel point elles peuvent se révéler catastrophiques, lorsqu’elles sont prises d’assaut et dominées par des intérêts spécieux, spéciaux et spécifiques, mais certes ni généreux, ni généraux, ni génériques. Il a également vu comment les gouvernements les mieux intentionnés, en temps de paix, ont en réalité si maladroitement préparé la guerre (Si vis pacem para bellum !). Il a vu aussi qu’en matière d’idéaux, ni l’Église chrétienne, ni les autres confessions monothéistes, ni la religion laïque de la fraternité humaine, ni la démocratie sociale, ni l’« ordre international », ni même la solidarité égoïste bien comprise des intérêts capitalistes et économiques, n’ont résisté à l’épreuve impitoyable de la réalité. Aujourd’hui, après tant de guerres, provoquées ou évitables, déterminées ou hasardeuses, nous entendons de nouveau, la ritournelle des mêmes phrases creuses, des mêmes slogans vides, déversés sur des peuples asservis, assommés, abouliques, amorphes, apathiques. Comment, dans ce contexte, ne pas craindre l’imminence d’autres catastrophes ? Peut-on garder sa foi en « l’avenir » ?
L’humanité « moderne » se divise en deux parties. La première, idéaliste, continue de croire ; elle est peuplée de gens qui ont foi en une foi ‒ leur foi, naturellement, pas celle des autres, qu’ils méprisent. Et il y a l’autre partie, celle des matérialistes, qui abhorrent la foi, les religions et les spiritualités ‒ ces illusions, ces fictions, ces chimères. Ils ne veulent voir que ce qu’ils voient, ils ne veulent savoir que ce qu’ils savent, ici et maintenant. Rien de ce qui reste caché depuis la fondation du monde ne les concerne. Leur seule lumière clignote dans les ombres de leur raison.
A cette première partition, on pourrait en ajouter d’autres : il y aurait une partie « consciente » de l’humanité et une autre « inconsciente », ou encore, l’une serait « suractive » et l’autre « passive », etc. Se pose alors une question centrale, pour la compréhension de la dynamique mondiale : comment évoluent les rapports entre ces différentes parties (idéalistes/matérialiste, conscients/inconscient, actifs/passifs) sur le court et le long terme ? Peut-on dégager une loi générale ? A ce sujet, une loi psychologique « invariablement valable », a été proposée par Jung, il y a un siècle. Si quelque chose d’important est dévalorisé ou refoulé dans la vie consciente, il se produit une compensation correspondante dans l’inconscient. Jung y voit une analogie avec la conservation de l’énergie dans le monde physique. D’ailleurs, les processus psychiques ont également un aspect quantitatif et énergétique. Aucune valeur psychique ne peut donc totalement disparaître sans être remplacée par une autre d’intensité équivalente, mais topiquement déplacée. C’est une règle fondamentale qui se vérifie à maintes reprises dans la pratique quotidienne, et qui ne faillit jamais. On peut donc tenter de la généraliser. Cette loi psychologique, étant « invariablement valable », doit pouvoir s’appliquer à l’échelle mondiale, et régir les rapports entre les idéalistes et les matérialiste, les croyants et les athées, le actifs et les passifs. Tout ce qui est dévalorisé et refoulé chez les uns, doit ressurgir avec d’autant plus de force chez les autres. Tout comme, pour un sujet isolé, peut surgir soudainement de l’obscurité une lumière nouvelle, inattendue, inespérée, aux pires moments, de même il en peut aller ainsi dans la vie psychique des peuples, ou même, dans celle de l’humanité tout entière. Voici un exemple : alors que la Révolution française battait son plein, des foules surexcitées affluèrent vers Notre-Dame de Paris, bien décidées à la vandalisation. Mais elles finirent par y célébrer une « Fête de la Raison » en 1793. On peut supputer que des forces sombres et innommables étaient alors manifestement à l’œuvre, emportant par leur puissance les esprits individuels et les âmes isolées. Mais, pour l’observateur des temps longs, il est possible de remarquer que d’autres forces, blessées mais vigoureuses, moins clairement identifiables mais obscurément ressenties, étaient aussi à l’œuvre, un peu plus de deux siècles plus tard, lorsqu’il fallût reconstruire la cathédrale incendiée. Il est vrai que la grande question, délibérément entretenue par Macron, fut alors : faut-il la rebâtir à l’identique ? Ou, faut-il peut-être la rebâtir autrement, par caprice politico-architectural, dans un style néo-bobo?
Les forces et les puissances ne manquent pas, en tout temps, pour qui veut les voir. Au temps de la Révolution, d’autres forces que révolutionnaires agissaient sans doute sur l’esprit de l’orientaliste français Abraham Hyacynthe Anquetil-Duperron (1731-1805). Et pourtant, révolutionnaire, il ne le fut pas moins, à sa manière. En cette époque de Lumières athées, il partit vers un Orient lointain (en Inde, en l’occurrence). A la recherche des sources du zoroastrisme, il se trouva en capacité de ramener en France le texte de l’Avesta ainsi que cinquante Upaniṣad. Ce faisant, il révéla soudainement à la psyché occidentale des voix spirituelles inédites, et jusqu’alors insoupçonnablesii. Cette irruption-révélation, imprévisible et inconcevable, des textes sacrés du Véda et de l’Avesta, appartenant à des religions antérieures de plusieurs millénaires aux révélations juives et chrétiennes, ne correspondait en rien à « l’esprit du temps » (tant celui de la France des Lumières que celui de la France révolutionnaire), mais elle se révéla fondamentalement fécondante et transformante. L’importance du choc intellectuel subi, restreint initialement à quelques cercles lettrés, s’amplifia bientôt dans l’Europe entière, à travers les voix discordantes mais sincères de Schopenhauer et de Nietzsche. Ainsi Anquetil-Duperron, à lui seul, et réel révolutionnaire en cela, introduisit une part de l’esprit de l’Orient en Occident. Et les conséquences lointaines de cette fécondation des esprits échappe encore à l’analyse. D’autant que, spirituellement, deux siècles plus tard, le monde occidental semble en situation de plus en plus précaire, voire désespérée. Le danger encouru est d’autant plus menaçant que nous nous aveuglons encore quant à la nature de « l’esprit » (européen), et quant à la gravité de son affaiblissement sous nos latitudes.
L’homme occidental paraît de nos jours vivre dans un épais brouillard intellectuel, dans un nuage de fumées opiacées, traversé d’exhalaisons de haschisch. Dans une sorte d’inconscience ou de cécité subie, il se plaît à rester impunément environné d’îles de cash et de paradis fiscaux, au milieu d’océans de misère. Il brûle en son sang et son cerveau toutes sortes de drogues ; et son être se dissout dans les fumées éphémères. Il fut un temps où la puissance impériale britannique imposa par la guerre la consommation de l’opium en Chine. Aujourd’hui, la Chine exporte ses molécules de fentanyl dans le monde. D’un point de vue anthropologique, comment la Chine considère-t-elle aujourd’hui l’Europe ou l’Amérique ? A-t-elle du respect ou de l’admiration pour leurs éventuels accomplissements techniques ou culturels ? Ou est-elle animée d’un ancien désir de revanche, s’appuyant sur le souvenir des humiliations passées et des millénaires d’antériorité civilisationnelle ? Et l’Inde ou l’Afrique, que pensent-elles de l’« Occident » ? Et que pensent tous ceux, de par le monde, dont le sang a été versé, dont les terres ont été volées, dont les âmes ont été brisées, dont les cultures ont été anéanties ? Jung a rapporté ces paroles d’un de ses amis amérindiens, un chef Pueblo : « Nous ne comprenons pas les blancs. Ils veulent toujours quelque chose, ils sont toujours agités, toujours à la recherche de quelque chose. Qu’est-ce que c’est ? Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas les comprendre. Ils ont des nez si fins, des lèvres si minces et si cruelles, toutes ces lignes sur leurs visages. Nous pensons qu’ils sont tous fous. » Je pense, pour ma part, que la folie ne rode et ne maraude pas seulement chez « les hommes blancs », mais chez tous les hommes qui se croient « modernes ». Si nous nous targuons d’être pessimistes, nous verrons dans cette folie rampante (ou galopante) un symptôme certain de décadence, dont on peut attendre les pires conséquences, les désordres les plus dévastateurs. Si nous sommes d’un tempérament optimiste, on pourrait voir dans ces vents mentaux le signe annonciateur d’une « réorientation » civilisationnelle, politique et spirituelle, d’un changement d’immense portée, qui pourrait balayer le monde, de l’ouest à l’est, du sud au nord, avec la puissance d’un typhon de niveau 12. Pour prendre une autre métaphore, non pas météorologique mais géologique, la « grande transformation » qui est en cours prend aussi la forme d’une tectonique souterraine, mettant en mouvement des forces matérielles et psychiques, irrationnelles et incalculables, et transformant, en même temps, inégalitairement et violemment, la vie matérielle et psychique de tous les peuples.
Pour les prisonniers de l’ancienne idée d’une « antithèse » radicale entre l’esprit et la matière, cette instabilité explosive et simultanée des deux plans, spirituel et matériel, doit sembler une contradiction inassimilable. Mais si nous acceptons de nous réconcilier avec cette autre vérité mystérieuse, selon laquelle l’esprit et la matière participent d’une même substance, une et subtile, alors nous pouvons comprendre l’étendue de l’effort nécessaire pour transcender le niveau actuel de la conscience, à l’échelle mondiale. Mais, a dit le poète : « Là où est le danger, croît aussi ce qui sauveiii ».
Pendant que le monde entier s’agite en tous sens, sans orientation apparente, sans but clair, et sur un rythme toujours plus rapide, nous pressentons que, par une sorte de compensation, croissent en chacun de nous d’autres sortes d’énergies et une volonté de résistance. Cette volonté, encore latente, se nourrit de centration celée, de mouvance lovée, de faim de paix, de soif de silence. Une appétence de vie sage, un désir de joyeuse prudence se frayent lentement un chemin en nous vers le jour, comme une aube pâle annonce un matin. La loi de invariablement variable de la compensation explique la montée de notre résistance, l’augmentation des tensions cachées, le durcissement des contradictions entre la réalité objective et le sentiment subjectif. Mais peut-être que cette loi n’existe pas, en fait ? Peut-être qu’il s’agit là d’une course opposant simplement, mais à mort, un monde où règnent avec éclat la puissance, l’argent, l’arrogance et le mépris, et un autre monde, où survivent difficilement l’impuissance, la pauvreté, l’humilité, l’amitié et l’attention ? Ou peut-être est-ce le symptôme d’un effort de l’esprit pour se libérer du carcan des lois de la nature, et pour lancer vers le ciel un péan de grâce, d’espoir et de victoire ? Ce sont là des questions auxquelles seule la nouvelle histoire, celle d’après l’aube, répondra ‒ peut-être.
_____________________________________
iLe mot « moderne » a été emprunté au bas latin modernus, «récent, actuel», lequel dérive de l’adverbe modo «seulement, naguère, peu après». Dans un enthousiasme sémantique et sémiotique, on pourrait donc imaginer que « moderne » signifie aussi ce qui n’est que « seulement » ce qu’il est, et donc qu’est « moderne » tout ce qui n’est pas ce qu’il pourrait être en principe. On pourrait aussi avancer que « moderne » signifie seulement ce qui était « naguère », mais qui « n’est plus », ou encore, ce qui pourrait advenir « peu après », c’est-à-dire dans un avenir proche, lequel serait naturellement loin de présenter quelque garantie quant à sa pérennité à long terme…
iiAnquetil-Duperron était alors, ce faisant, absolument « moderne »… Et les Philosophes des « Lumières » révélèrent quant à eux leur vraie nature, « anti-moderne » et déjà dépassée, en rejetant avec violence les textes ainsi mis au jour. « La déconvenue du parti des Philosophes fut grande : là où ils attendaient une philosophie utile à leurs desseins, ils découvraient un texte liturgique et dévot. Voltaire s’emporta disant que « l’abominable fatras que l’on attribue à ce Zoroastre » ne pouvait être qu’un faux. » (Selon l’article de l’Encyc. Universalis consacré à Anquetil-Duperron).
iii« Wo aber Gefahr ist, wâchst das Rettende auch. » Friedrich Hölderlin. Patmos.

















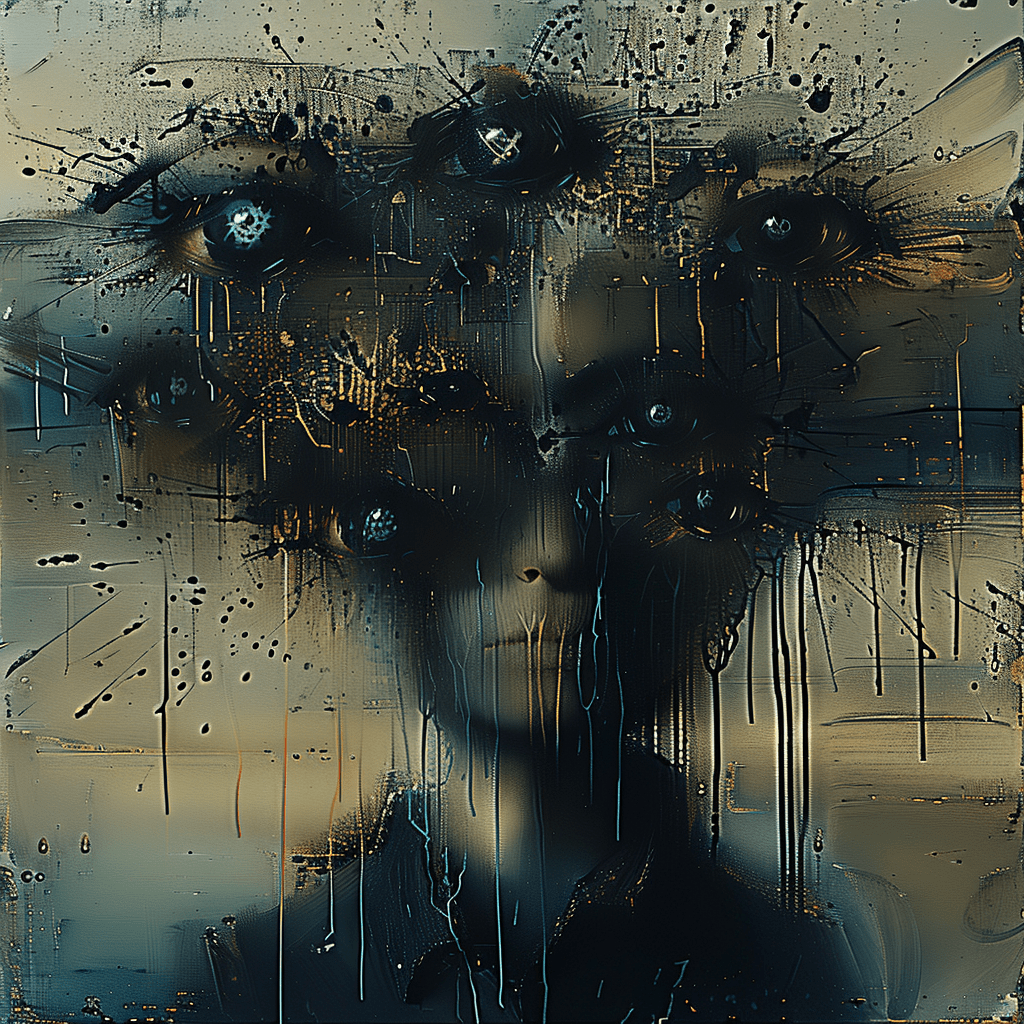












Vous devez être connecté pour poster un commentaire.