
Ne lisez surtout pas ce qui va suivre, vous, les esprits forts ; ne perdez pas votre temps. Ce ne sont là que des sornettes, des divagations, des fables, des fantasmagories, et au pire, des fraudes. Juives ou chrétiennes. Que valent aujourd’hui, en notre époque matérialiste et positiviste, ce que rapportèrent jadis, en des temps si différents du nôtre, mais en un sens similaires, des prophètes d’Israël, puis des Juifs en deuil, rassemblés cinquante jours après la mort de leur rabbin, ou encore des visionnaires judéo-grecs ? Songes creux, idées folles, hallucinations collectives, délires absurdes, transport des cerveaux, racontars d’attardés, fake news ?
Qu’on en juge.
Un prophète juif reçut en l’an 740 av. J.-C., à l’âge de 25 ansi, une vision dont il rendit compte ainsi :« Je vis le Seigneur [Adonaï] assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins [seraphim] se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six ailes [knaphim], deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour volerii […] L’un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise [ritspah] qu’il avait prise avec des pincettes [be–melqaḥayim] sur l’autel. Il m’en frappaiii la boucheiv. »
Ce qui est curieux, dans cette affaire, c’est que le seraphim, dont le nom signifie « brûlantv », ait eu peur de se brûler la main, et que, pour saisir la braise, il ait eu besoin d’instruments, les melqaḥayim, qui désignent soit des « pincettes » pour tenir les charbons ardents, soit des « mouchettes » pour éteindre les bougies des chandeliers. On en déduit que la braise était si brûlante que même un « brûlant » eut peur de se « brûler » en la saisissant.
Un autre prophète juif, grand prêtre et grand visionnaire, exerça son office parmi les exilés à Babylone, entre 593 et 571. Il vit et il entendit ceci (entre autres) : « Et je vis comme l’éclat du vermeilvi, quelque chose comme du feu [éch] auprès de lui, tout autour, depuis ce qui paraissait être ses reins et au dessus ; et, depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessous, je vis quelque chose comme du feu [éch] et une lueur [nogah] tout autour ; l’aspect de cette lueur, tout autour, était comme l’aspect de l’arc [qêchêt] qui apparaît dans les nuages, les jours de pluie. C’était quelque chose qui ressemblait [demout] à la gloire de Yahvé [kévod-YHVH]. Je regardai, et je tombai la face contre terre ; et j’entendis la voix de quelqu’un qui me parlaitvii. »
Me frappe ici le fait que les « reins » séparent le « haut » du « bas ». Dans le « haut », Ezéchiel n’y voit que du « feu », si j’ose dire. Dans le « bas », il voit du « feu » mais aussi une « lueur ». Pourquoi cette différence ? Parce que, sans doute, plus on monte, moins on voit de lumière, et plus on brûle.
Voici maintenant un texte qui rapporte ce qui arriva lors d’une assemblée d’une centaine de Juifs, réunis pour le cinquantième jourviii suivant la mort de leur rabbin, il y a environ deux mille ans.
« Tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu’on eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’euxix. »
Dans la vision d’Isaïe, la braise frappe la bouche du prophète. A la Pentecôte, le « feu » prend la forme d’une langue, et se pose sur les têtes des apôtres. Curieuse différence, non ?
Je termine avec un visionnaire, originaire de Patmos, et vivant à l’époque de Néron : « Je tombai en extase, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix clamer, comme une trompette : ‘Ce que tu vois écris-le dans un livre’ […] Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait ; et m’étant retourné je vis sept candélabres d’or, et, au milieu des candélabres, comme un Fils d’hommex. » Cette vision de Jean de Patmos inaugure un récit fameux, plus connu sous le nom d’Apocalypse. Ce mot grec n’a pas a priori de signification « apocalyptique », puis qu’il signifie simplement « révélation ». Il reste à son sujet une réelle ambiguïté. Est-ce la révélation qui est en soi « apocalyptique » (au sens catastrophique du mot), ou bien est-ce l’Apocalypse qui, par-delà ce qu’elle implique de terrifiant, se fait aussi « révélation », au sens fort ?
Dans ces quatre exemples, on a affaire à des phénomènes indubitablement paranormaux. Quelle crédibilité leur accorder ? Chacun choisira son camp. Je voudrais pour ma part attaquer le problème sous un autre angle, plus expérimental, et qui n’a pas perdu son actualité, celui de la nature profonde de l’extase ‒ laquelle ouvre d’autre pistes encore, qui ne relèvent pas de la prophétie, mais plutôt d’une sorte de philosophie de l’initiation, ou d’une phénoménologie des marches.
Voici ce que je peux en dire. L’initié, dans sa transe extatique, s’approche de l’étroite frontière entre la vie et la mort. Il s’avance dans ces marches, ce territoire où le temps semble fait d’espaces et de formes, qui s’étendent ou se dissolvent à volonté. L’entrée dans la chambre de la mort, la camera della morte, ne lui est pas refusée, mais il en voit l’inanité, et tout le temps perdu s’il succombait à la tentation d’y entrer en tant que « vivant ». Au moment crucial, une idée le frôle : impalpable, magnétique, analogique, poétique, et radicalement viscérale, fœtale même. Ce qui se donne à voir dans l’approche de la frontière, je n’en dirai rien ici. Ce n’est pas le lieu, ni le moment. Je veux seulement affirmer que le fait d’y être allé et d’en être revenu (expérience qui est donnée à peu d’entre nous, pour des raisons que j’ignore) permet de penser que la frontière existe en effet, et qu’on peut la franchir, dans les deux sens. Depuis des temps immémoriaux, ce constat a été fait, sous toutes les latitudes, dans toutes les cultures. Les pratiques universelles des chamanismes, tout comme les anciens Mystères des Pyramides, d’Éleusis, ou de Samothrace, en présentent des témoignages. Mais aujourd’hui, alors que l’humanité tombe à nouveau dans une sorte de folie, et dans un temps où le « politique » montre ses effroyables limites, et où les religions font partie du problème plus que de la solution, dans un temps où l’argent, l’hubris et l’égoïsme prennent tout le pouvoir, il faut le répéter ‒ ce constat constant-là. Ce monde n’est qu’une immense salle d’attente, bondée, et s’ouvrant sur des myriades de corridors. Le sens de la sortie est indiqué, clairement univoque. La vie doit se nourrir de la mort, comme la mort ne cesse de se nourrir de la vie. Il est temps de relire Isaïe, Ézéchiel et Jean de Patmos. Ce qu’ils ont vu, il nous sera donné aussi de le voir. Autant se préparer le mieux possible à cette « grande vision » à venir. Elle sera aussi un « grand oral » (pour prendre une métaphore de concours) ou encore une séance de « debriefing », si l’on interprète le passage des hommes ici-bas, comme étant une mission sur le terrain, à visée « préparatoire ».
Préparatoire à quoi ? Préparatoire à d’autres missions peut-être, lesquelles seront, sans doute, déterminées selon des désirs et des puissances dont nous n’avons aujourd’hui pas la moindre idée, et cependant, parfois, quelque intuition dirimante.
__________________________________________
iEn l’an 740, année de la mort du roi Ozias.
iiIs 6,1-2
iiiLe texte emploie le mot yagga‘, du verbe naga‘, « toucher ; frapper ».
ivIs 6,6-7
vDu verbe saraph, « brûler, mettre le feu ».
viLe texte emploie le mot חַשְׁמַל, hachmal, « métal composé d’or et d’airain » ou encore « ambre ». Selon d’autres, ce mot signifie « lumière, rayon ».
viiEz 1,27-28
viiiLors d’une réunion correspondant à la fête juive des chavouot (les « semaines »), sept semaines après la Pâque juive, et connue sous le nom de « Pentecôte » chez les Chrétiens (du grec, πεντηκοστὴ ἡμέρα, pentêkostề hêméra, les « cinquante » [jours]).
ixAc 2,2
xAp 1,10

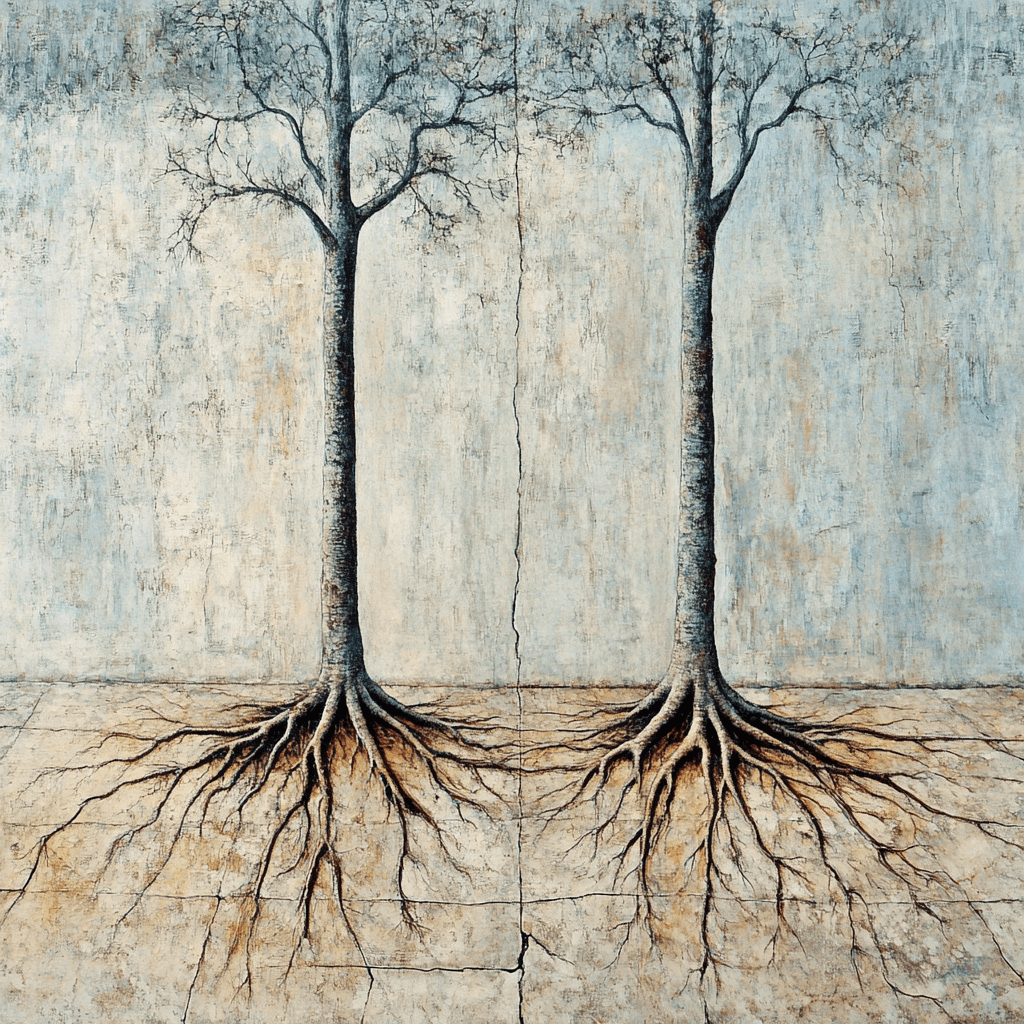


















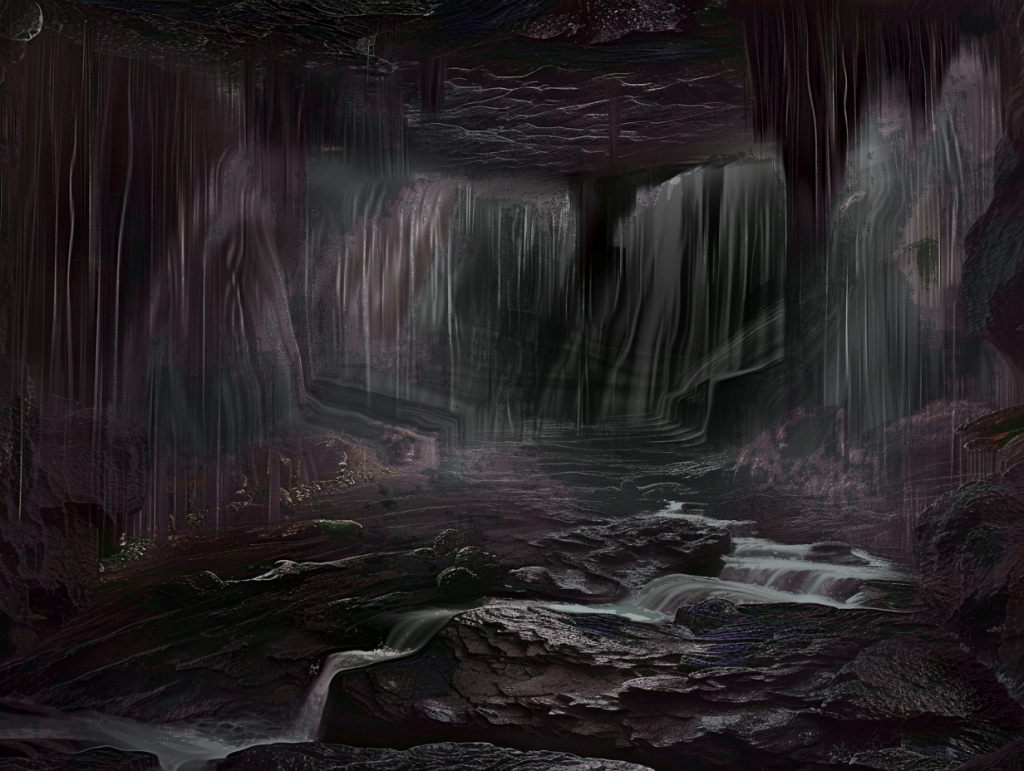









Vous devez être connecté pour poster un commentaire.