
« L’attraction des consciences » ©Philippe Quéau (Art Κέω) 2024
La doctrine philosophique de l’hylozoïsme soutient que la matière est capable, par nature, de produire spontanément la vie : la vie « sourd » de la matière, par elle-même. L’existence de toutes les formes de vie suppose la présence immanente de ce principe d’engendrement, de cette « source » interne qui anime toutes choses, en tout, toujours, partout. Le matérialisme défend lui aussi un tel principe d’immanence. Il nie a priori toute hypothèse d’« esprits » existant indépendamment au sein de la matière, et bien sûr, toute idée d’« âmes » qui « animeraient » la vie végétale ou animale. Pour les matérialistes, l’esprit n’existe pas en tant que tel, il n’est qu’un épiphénomène résultant des assimilations, émanations et « digestions » de la matière. En revanche, selon la doctrine idéaliste de Kant, un monde réellement immatériel existe, au-delà ou parallèlement au monde des « phénomènes ». Immensément vaste, le monde immatériel comprend toutes les intelligences créées, les êtres raisonnables, mais aussi les « consciences » sensibles (les consciences de tous les animaux), et enfin tous les « principes de vie », quels qu’ils puissent être, et qui se trouvent répandus partout dans la nature, par exemple dans les végétaux. Parmi les « intelligences créées », quelques-unes sont liées à la matière. Nous, les humains, nous le savons, car nous l’expérimentons en nous-mêmes. En nous, une « intelligence créée » est alliée à notre corps, et de cette alliance résulte notre « personne ». Mais il existe bien d’autres « intelligences créées » qui, quant à elles, ne sont pas liées à la matière. Elles peuvent rester isolées, ou bien se lier à d’autres esprits, ou encore elles peuvent s’associer plus ou moins étroitement à d’autres entités, qui ont un statut intermédiaire entre la matière et l’esprit. Toutes ces natures immatérielles (les intelligences, les consciences, les principes) exercent leur influence dans le monde corporel, selon des voies et moyens qui restent incompris. Parmi elles, il y a tous les êtres dits « raisonnables », qu’ils soient présents sur la terre ou ailleurs dans l’univers, ou même dans l’au-delà. Du fait même qu’ils font usage de leur raison, les êtres « raisonnables » n’ont pas vocation à rester séparés de la matière. La raison désigne en effet un principe immanent, ordonnateur et régulateur, dont les êtres raisonnables (c’est-à-dire les êtres en qui la raison est immanente) se servent pour animer l’étoffe (irrationnelle) de la matière et pour la constituer comme entité « vivante ». Cependant, on peut aussi supputer que les êtres raisonnables sont capables d’entretenir des échanges ou des communications avec d’autres intelligences créées, et cela en accord avec leurs natures respectives. Ces communications entre divers êtres raisonnables, ou diverses intelligences (immatérielles), ne sont pas limitées par les corps, ni par les contraintes habituelles de la vie matérielle. Elles les transcendent. Elles ne s’affaiblissent pas non plus avec l’éloignement dans l’espace ou dans le temps, et elles ne disparaissent pas lorsque la mort survient. Selon ces vues, l’âme humaine, qui représent un cas spécifique de nature immatérielle et raisonnable, devrait donc être regardée comme déjà liée, dans cette vie-ci, à ces deux mondes — le monde immatériel et le monde corporel. Une âme singulière est liée avec un corps particulier, ce qui en fait un être absolument unique, une personne. L’âme (de la personne) perçoit nettement l’influence matérielle du monde corporel. Mais comme elle fait aussi partie du monde des esprits, elle ressent également les influences des natures immatérielles, et peut percevoir, dans certains cas, leurs immatérielles effluves. Lorsque survient la mort, aussitôt que sa liaison avec le corps a cessé, l’âme continue d’être en communauté impalpable, immatérielle, avec les natures spirituelles. Et, sans doute, étant enfin séparée du corps, elle devrait être alors mieux en mesure de se faire une plus claire intuition de sa propre nature, et de la révéler, de façon appropriée, à sa conscience intérieurei. D’un autre côté, il est probable que d’autres natures spirituelles, celles qui ne sont pas « incarnées » en des corps, ne peuvent avoir immédiatement conscience des impressions sensibles qui sont propres au monde corporel, parce qu’elles ne sont liées d’aucune manière à la matière. N’ayant pas de corps propre, elles ne peuvent avoir conscience de l’univers matériel ni le percevoir, manquant des organes nécessaires. Mais on ne peut exclure l’hypothèse qu’elles puissent exercer une influence subtile sur les âmes des hommes, du fait de leur nature spirituelle. Les âmes et les natures spirituelles peuvent même entretenir, avant la mort, un commerce réciproque et bien réel, capable de progresser et de s’enrichir. Cependant, les images et les représentations formées par des esprits qui dépendent encore du monde corporel, ne peuvent pas être communiquées aux êtres qui sont purement spirituels. Réciproquement, les conceptions et les notions de ces derniers, qui sont des représentations intuitives correspondant à l’univers immatériel, ne peuvent pas passer en tant que telles dans la claire conscience des humains. Ajoutons que les idées et les représentations des êtres purement spirituels et des âmes humaines ne sont sans doute pas de même espèce, et sont donc très difficilement transmissibles et partageables en tant que telles, sans avoir été traduites, ou adaptées, au préalableii. Parmi les idées ou les représentations qui peuvent radicalement mettre l’esprit humain en mouvement, stimuler un désir aigu de métamorphose, et entamer la transformation de l’âme, les plus puissantes d’entre elles peuvent paraître tout à fait inouïes, inexplicables, et même parfaitement capables de « submerger » ou de « noyer » le sujet qui les ressent. D’où viennent ces idées et ces représentations ? Comme Platon l’a indiqué, elles pourraient venir d’un monde immatériel, celui des Muses, ces inspiratrices réputées venir illuminer les créateurs ou les chercheurs, secourir les esprits désarmés, et emplir les âmes inoccupées. En tant que phénomènes, elles pourraient aussi émerger spontanément du plus profond inconscient, du Soi. Les philosophes, les poètes, les mystiques, ont pu observer, au long des millénaires, que les plus élevées d’entre elles n’ont, semble-t-il, aucun rapport avec l’utilité personnelle ou avec les besoins immédiats, pratiques, individuels, des hommes qui les reçoivent. Mais peut-être ont-elles quelque utilité pour d’autres que ces derniers, répondant (selon des voies qui nous échappent) à des besoins lointains, soit pratiques soit théoriques, mais peut-être vitaux, et qui pourraient embrasser l’univers tout entier, et l’entièreté des mondes ? Qui sait ? Les idées les plus excellentissimes pourraient d’ailleurs être en mesure de se transporter à nouveau, sortant de la sphère de conscience assignée à une personne particulière, et, par une sorte de contagion, de contamination, s’étendant vers l’extérieur, bien plus loin, et au-delà de ce que l’on peut imaginer. Elles pourraient en théorie aller si loin, qu’elles toucheraient au passage une infinité d’autres êtres raisonnables qu’elles affecteraient à leur tour, par leur puissance singulière, tant nouménale que numineuse. Il y aurait donc deux types de forces spirituelles, pourrait-on gloser, les unes « centripètes », où l’intérêt personnel dominerait absolument, et les autres « centrifuges », qui se révéleraient lorsque l’âme est en quelque sorte poussée hors d’elle-même et attirée vers l’Autre iii. Les lignes de force et d’influence que nos esprits sont capables de recevoir ou de concevoir ne convergent donc pas simplement en chacun de nous, pour s’y cantonner, et s’y arrêter. Ces forces peuvent se mouvoir puissamment, et librement, hors de nous, hors de notre propre for intime, et parfois malgré nous, – pour atteindre d’autres personnes, d’autres esprits. Conjecturons qu’elles peuvent même aller caresser les confins, et tutoyer l’infini. De là, je déduis que des impulsions irrésistibles peuvent emporter l’homme fort loin de son intérêt immédiat, y compris jusqu’à la métanoïa, ou au sacrifice. La forte loi de la justice immanente, et la loi peut-être moins prégnante de la générosité et de la bienfaisance, ne manquent pas de se déployer dans la nature humaine, suivant les circonstances, selon la nature propre de telle personne, la tessiture spécifique de tel esprit, et la révélation d’aspirations profondes, soudainement mobilisées. On pourrait alors découvrir que dans les volontés et les mobiles apparemment les plus intimes, telle personne se trouve en fait dépendre aussi de l’action de lois universelles, sans même en avoir seulement conscience. Il en résulterait logiquement la possibilité d’une unité et d’une communion générales dans l’univers de toutes les natures pensantes, de tous les êtres obéissant à des lois spirituelles, et, par cette fusion, préparant la venue de nouveaux degrés de métamorphose.
On appelle « gravitation » la tendance de tous les corps matériels à se rapprocher. Isaac Newton a fameusement établi que cette gravitation résulte d’une activité universelle de la matière, à laquelle il donna le nom d’« attraction ». Je voudrais me servir de ce concept d’attraction comme d’une métaphore. Je me représente en effet le phénomène des pensées et des idées s’immisçant dans les natures pensantes, puis se révélant partageables, communicables, comme résultant d’une force universelle, une « attraction » par laquelle les natures spirituelles s’influencent mutuellement. Je propose de nommer cette puissance spirituelle, la « loi de l’attraction universelle des consciences ». Poussant cette métaphore un peu plus loin, j’en déduis aussi que la force du sentiment moral pourrait bien n’être dès lors qu’une sorte de dépendance ressentie par la volonté individuelle à l’égard de la volonté générale, et une conséquence des échanges d’actions et de réactions universelles, dont le monde immatériel se sert pour tendre à sa manière à l’unitéiv. L’âme humaine, dans cette vie, occupe toute sa place parmi les substances spirituelles de l’univers, de même que, d’après les lois de l’attraction universelle, les matières répandues dans l’immensité de l’espace ne cessent de se lier par des liens d’attraction mutuelle. Les particules élémentaires elles-mêmes, loin de rester confinées dans leur étroite granularité, emplissent l’univers entier de leurs potentiels quantiques de champ.
Transformons l’analogie en anagogie. Quand les liens de l’âme et du corps sont rompus par la mort, on peut supputer qu’une autre vie (spirituelle) dans un « autre » monde pourrait être la conséquence naturelle des innombrables liaisons, à la fois matérielles et spirituelles déjà entretenues dans cette vie-ci. Le présent et l’avenir seraient donc formés comme d’une seule pièce, et composeraient un tout continu, tant dans l’ordre de la nature que dans l’ordre de l’espritv. S’il en est ainsi du monde spirituel et du rôle qu’y joue notre esprit, il n’est plus étonnant que la communion universelle des esprits soit en réalité un phénomène « normal », et bien plus répandu qu’on ne l’admet en général. L’extraordinaire, en fait, réside bien plus dans l’absolue singularité des phénomènes psychiques touchant telle ou telle personne particulière, toute âme absolument individuée, et donc unique. C’est cette unique individuation qui représente le plus grand mystère, et non pas celui de l’universelle profusion des « esprits », tant à l’échelle cosmique, qu’au-delà de ses confins.
__________________
iCf. Kant. Rêves d’un homme qui voit des esprits, – expliqués par des rêves de la métaphysique. (1766). Trad. J. Tissot. Ed. Ladrange, Paris, 1863, p.21
iiIbid. p.22
iiiIbid. p.23
ivIbid. p.23-24
vIbid. p.26











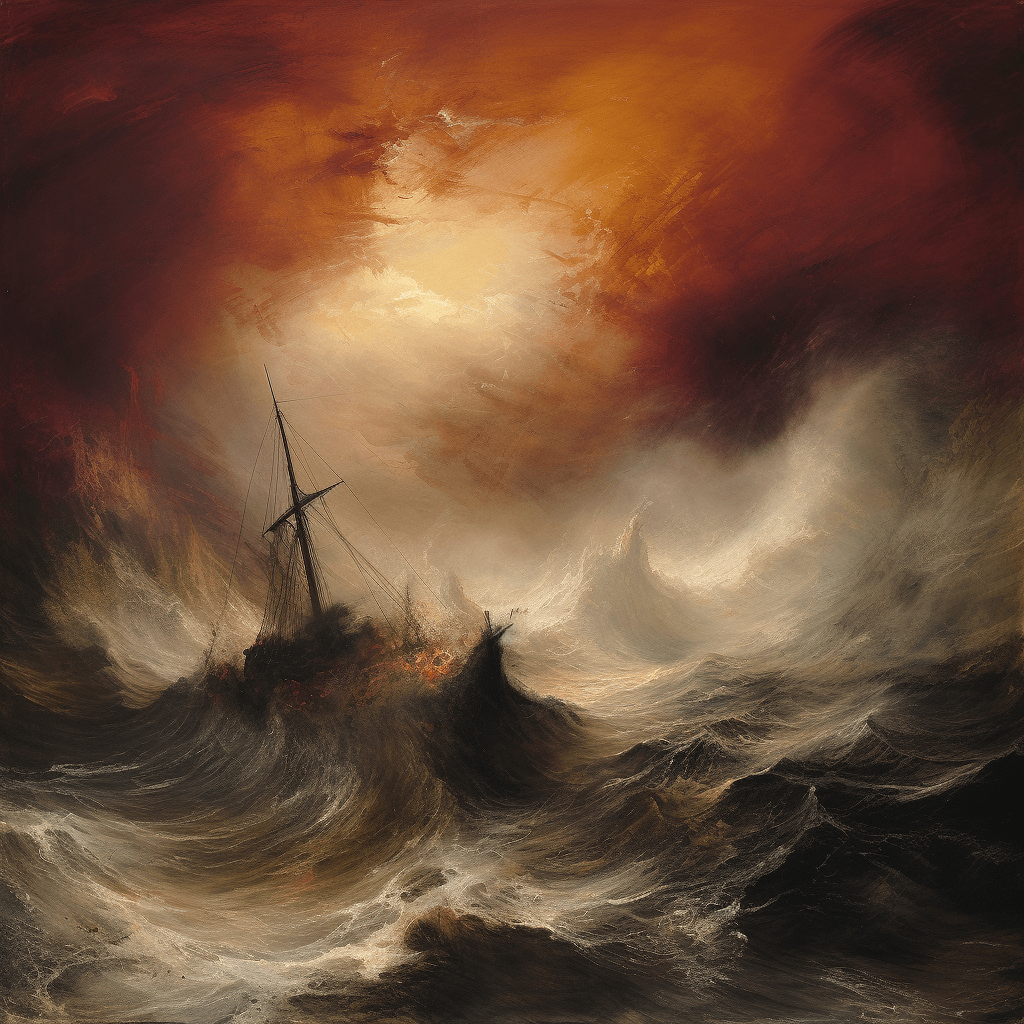



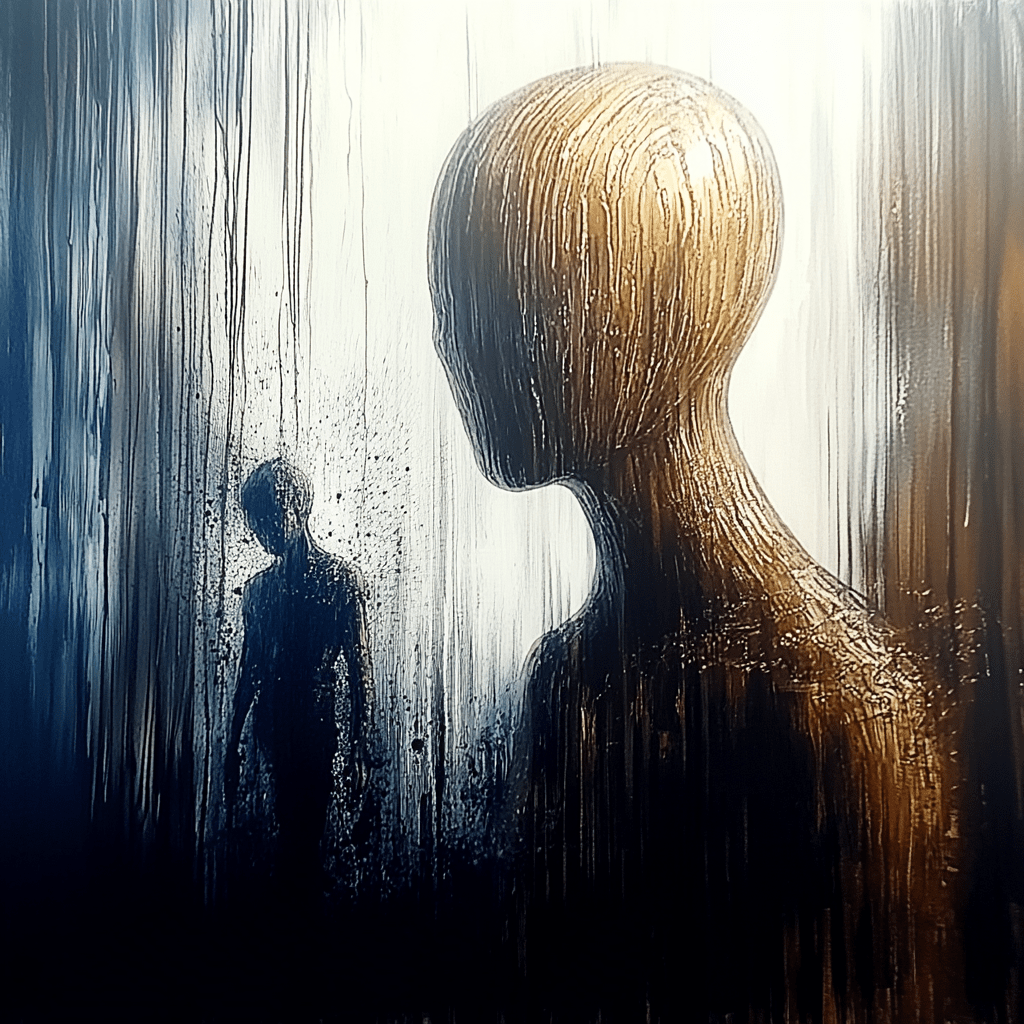





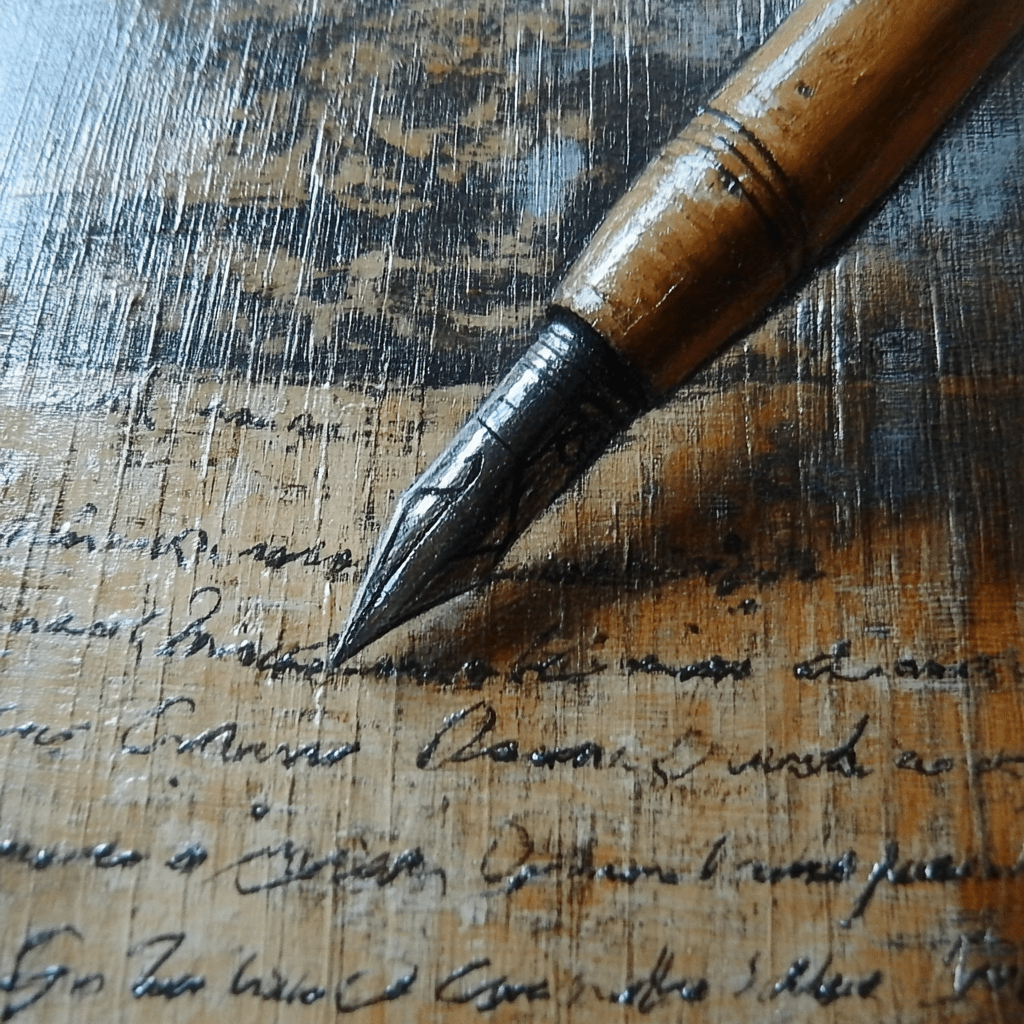

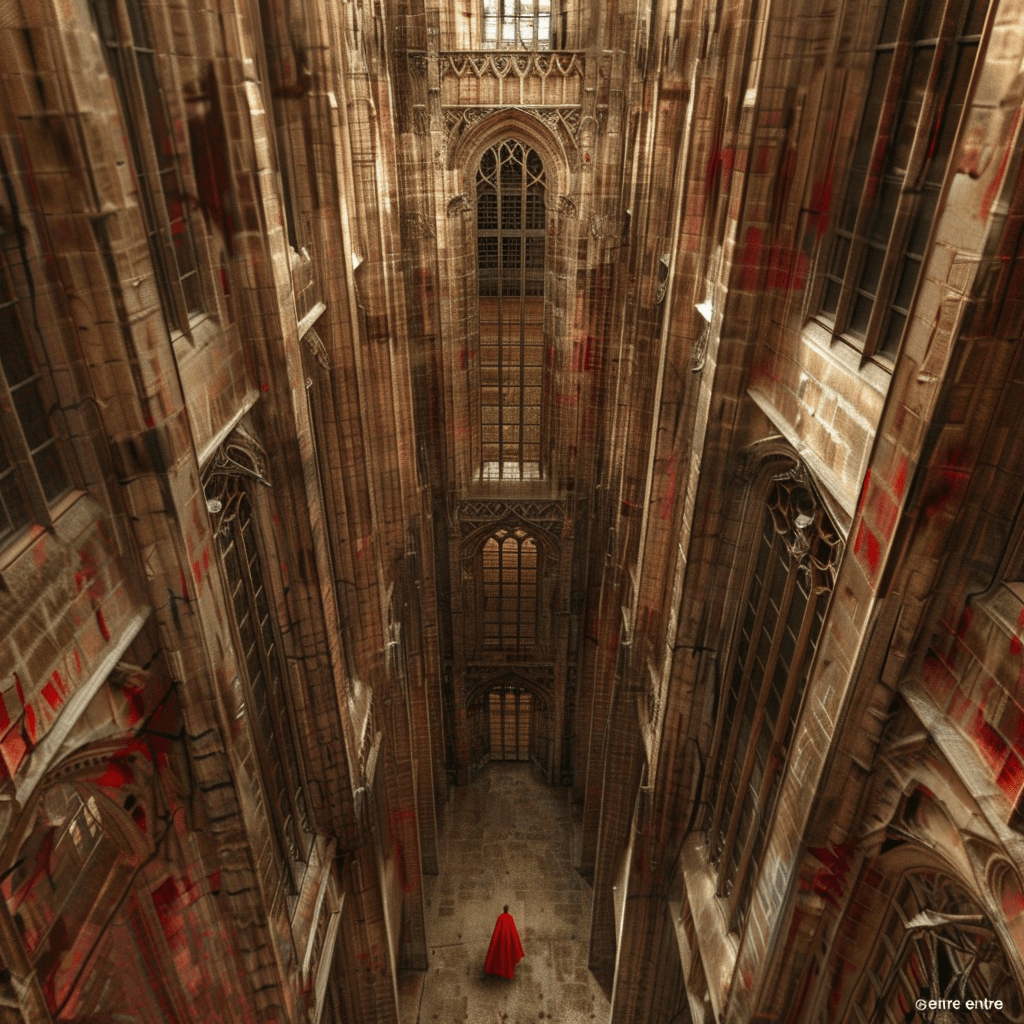






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.