
« L’Éros divin est extatique », dit Denys : ekstatikos ho theios érosi. En Dieu, l’Éros est « extatique », parce qu’il engendre l’extase. Il l’engendre en qui ? En Lui-même ? En ceux qui L’aiment ? En tous ? L’emploi du mot grec éros est ici chargé d’allusions parfaitement assumées. Que Dieu soit « amour » (éros) n’était certes pas, au 6e siècle de notre ère, une idée inconnue en théologie. Mais que Dieu soit capable d’« extase » et que cette « extase » divine puisse être dite d’essence « érotique », parce qu’essentiellement « amoureuse », et même « passionnelle », cela n’allait pas forcément de soi. Il va de soi, naturellement, que tous ces mots ‒ amour, extase, éros, passion ‒ doivent être pris au sens le plus élevé que l’on puisse concevoir, et non dans un sens charnel. Cependant, ils restent colorés par cette acception, qui est la seule expérimentée par la majorité des humains. Denys lui-même s’est résolu à discuter de la nuance entre le mot éros (« amour, passion ») et le mot agapè (« amitié, affection »). Il a jugé que ces termes peuvent tous deux s’appliquer dans le contexte divin, même si le premier terme lui semble le meilleur. « Il a même paru à certains de nos auteurs sacrés que ‘désir amoureux’ (éros) est un terme plus digne de Dieu qu’ ‘amour charitableii’ (agapè). Car le divin Ignace a écrit : ‘C’est l’objet de mon désir amoureux qu’ils ont mis en croix’. Et dans les livres préparatoires aux Écritures, tu trouveras cette parole appliquée à la Sagesse de Dieu : ‘J’ai désiré sa beautéiii’. Il ne faut donc pas que ce vocabulaire érotique nous effarouche, ni que les raisonneurs viennent nous en faire un épouvantailiv. » Mais le terme agapè a ses mérites aussi, et selon l’analyse de Thomas d’Aquin, sur laquelle je reviendrai, c’est l’agapè qui, en fait, produit l’extase réellement authentique.
Quoi qu’il en soit, puisque Dieu est Un, l’Éros divin, ou l’Agapè, ne sont pas seulement « en Lui », mais doivent constituer sa substance ou son essence mêmes, pour autant qu’on puisse utiliser de tels termes, ne serait-ce que métaphoriquement. En effet, on pourrait arguer que la substance ou l’essence de ce Dieu est précisément de n’en avoir point, puisqu’il est au-dessus de toute essence et qu’il est au-dessus de l’être – si l’on admet que c’est Lui qui a créé les essences particulières et l’être en général. Or, le fait que l’amour se révèle proprement « extatique » dans ce Dieu-Éros, implique que ce même Dieu puisse littéralement « sortir » (extatiquement) de Lui-même, en tant que substance, et apparaître en quelque sorte comme phénomène. Cette remarque est loin d’être anodine. Comme une source infiniment abondante, comme un dépassement continuel de la puissance divine par elle-même, Éros jaillit en Dieu, et Éros rejaillit aussi, extatiquement, hors de Dieu. Éros éclabousse toute sa création, et se répand sur le monde. Panspermie cosmique… On pourrait en déduire qu’au moins en principe, l’extase amoureuse a valeur de paradigme universel. Certes, la notion d’extase ne doit se prendre que relativement à la capacité de chaque être singulier à ‘sortir de soi’, et à assumer la portée de cette ‘sortie’. Ce qui importe surtout, c’est l’idée même d’extase, dans toute sa potentielle universalité. Elle s’applique à Dieu Lui-même, mais aussi à l’ensemble des créatures.
Après avoir assimilé l’amour à l’extase (en Dieu lui-même), Denys l’Aréopagite affirme aussi, à propos des créatures (humaines) : « Grâce à lui [l’ Éros], les amoureux ne s’appartiennent plus; ils appartiennent à ceux qu’ils aimentv ». L’idée de ‘la sortie hors de soi’, qui est dénotée par le mot ‘extase’, a donc une portée absolument générale. Elle se vérifie par l’exemple des puissances les plus élevées, lorsqu’elles s’exercent en faveur des puissances inférieures (en descendant vers elles), ou lorsque des êtres de rang égal consentent à s’unir entre eux, ou encore lorsque des êtres de rang inférieur en appellent aux êtres du plus haut rang, et se tournent vers eux. Denys cite comme emblématique l’exemple de Paul, « possédé par l’amour divin et prenant part à sa puissance extatique », et disant alors : « Je ne vis plus, c’est le Christ qui vit en moivi». Cette phrase révélatrice peut s’interpréter comme une confirmation que Paul est en effet « sorti de soi » pour se laisser pénétrer par Dieu, pour ne plus vivre de sa vie propre, mais pour vivre de la vie du divin même.
Prenant conscience de la puissance du paradigme de la « sortie de soi », et de l’« extase », Denys va aller beaucoup plus loin. Il « ose », selon ses propres termes, affirmer que « ce Dieu lui-même, qui est cause universelle et dont l’amoureux désir, à la fois beau et bon, s’étend à la totalité des êtres par la surabondance de son amoureuse bonté, sort aussi de lui-même lorsqu’il exerce ses Providences à l’égard de tous les êtresvii ». Ce Dieu est donc « extatique », au sens littéral, parce qu’« il sort de lui-même » lorsqu’il « condescend » à créer tous les êtres et à en prendre soin, « grâce à cette puissance extatique, sur-essentielle et indivisible qui lui appartientviii ». On peut alors dire que son « désir amoureux » s’étend, grâce à son « extase », à tous les êtres.
Me viennent alors à l’esprit ces questions : pourquoi ce Dieu, si puissant, si élevé, si infini, aimerait-Il d’une telle passion des multitudes d’êtres, si infimes, si proches du néant ? Et comment Denys peut-il affirmer de telles choses au sujet de l’« extase » et de l’« amour » divins ? Sur quelles bases peut-il « oser » faire de telles assertions ? Quant à la première question, on peut supputer que la création même de l’univers et des créatures qui le peuplent fait partie intrinsèque de l’extase propre au divin et en constitue l’une de ses conséquences. En effet, comment ce Dieu n’aimerait-il pas (d’un amour réellement divin) l’existence même de sa propre extase (qui ne peut être que d’essence divine), ainsi que toutes ses conséquences créatives (engendrement, filiation, spiration) ? Pour prendre une comparaison, l’homme lui-même n’aime-t-il pas, en puissance, tout ce qui en découle, et tout ce qui peut être engendré à partir de ses propres extases ? Quant à la deuxième question (sur quelles bases peut-on théoriser l’extase divine ?), on peut s’appuyer sur quelques textes canoniques, au caractère inspiré, dont on peut penser qu’ils ouvrent des pistes roboratives, heuristiques. Certains textes bibliques évoquent par exemple l’ardeur « jalouse » de Dieu à l’égard de sa création. Dans l’Exode, ces mots sont mis dans la « bouche » de Dieu: «Moi, YHVH ton Dieu, je suis un Dieu jalouxix. » L’emploi du mot « jaloux » (en hébreu : qanna‘), est une indication de l’intensité de son désir amoureux. Il est aussi « jaloux » parce qu’Il convertit en « ardeur jalouse », de façon communicative donc, le désir amoureux de ceux qui se tournent vers Lui, pour L’écouter, de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur forcex. Si ce Dieu manifeste un amour aussi « jaloux », c’est parce qu’il semble avoir conscience que les êtres créés qu’il « aime » (à sa façon divine) sont réellement dignes de cette ardeur amoureuse, pour des raisons qui nous échappent à vrai dire complètement, et contrairement à toute apparence de bon sens (vu l’insignifiance et même le néant de ces créatures); cette dignité des créatures, de toutes les créatures, aux yeux du Dieu « jaloux » n’est pas moindre, d’ailleurs, que la dignité apparemment plus élevée des êtres qui tendent volontairement vers Lui. De ce Dieu-là, on peut donc penser qu’Il est (en soi) absolument Éros, « Amour », mais aussi qu’Il tend à aller « hors de Lui » (pour reprendre dans son sens propre la formulation de Denys qui dit qu’Il est « extatique », – c’est-à-dire qu’Il est essentiellement « Extase »). Ce Dieu est donc à la fois « un » et tourné vers l’ « autre ». Il est « un » et il est désir d’amour de cet Autre qu’Il n’est pas, ou pas encore. Il est à la fois « un » – comme sujet extatique de Son amour, et Il est aussi Celui qui se donne à l’Autre comme objet d’amour – un amour qui reste à consommer, comme on dit, dans l’infini des temps. C’est donc l’amour qui essentiellement meut l’essence divine, et en cette essence, Dieu meut aussi tout ce qu’Il aime. De l’amour, Il est la cause essentielle, universelle ; Il en est le créateur et l’engendreur – le Père en quelque sorte, mais aussi, la Mère. Il est donc l’Amant ‒ et l’Amante. Cela fait beaucoup de monde pour un Dieu un… Mais qu’importe, il faut ne voir ici que l’Idée, qui est une : Il est la puissance créatrice et amoureuse qui se meut ; Il est le Séducteur (et la Séductrice), ou plutôt la Séduction divinisée qui entraîne le monde avec Elle, et qu’Elle désire attirer à Elle. Celle-ci est le mouvement même du désir qui se meut, en soi, pour soi et hors de soi, et qui, ainsi, poursuit ses propres fins. Le Dieu ne cesse de progresser sans fin dans Son extase (ek-stasis), mais sans jamais cesser d’être qui Il est en soi.
On dira : « Tout ceci est bel et bon. Mais alors, pourquoi le Mal existe-t-il, si Dieu est amour, et qu’Il baigne Tout de son amour ? » Question archi-rebattue, depuis des millénaires. Elle a aussi été abordée avec quelque profondeur par Denys dans son Traité des Noms divinsxi, et abondamment commentée par Thomas d’Aquin. Je ne la traiterai pas ici, et je me contenterai d’une brève remarque. Le Mal « existe » en un sens, et peut faire beaucoup de mal dans le monde, il cause d’innombrables souffrances, comme on le voit aujourd’hui, de par le monde ; malgré tout, on peut aussi penser (philosophiquement) que le Mal n’existe pas en soi. Le Mal « existe » en un sens, certes, mais pas il n’existe pas en soi, car il n’a pas d’essence, ou plutôt il n’est pas un essence. Le Mal n’a d’ailleurs pour existence réelle que celle que certains êtres veulent et peuvent lui donner, et que d’autres êtres doivent en conséquence subir à leurs dépens. Mais, à la fin des fins, il est possible de penser que le Mal lui-même disparaîtra (en quelque sorte à la fin des Temps), non sans avoir contribué, contre toute raison, et fort paradoxalement, au Bon, au Bien et à l’Amour (divins). Pourquoi un tel dispositif, d’ampleur cosmique et même métaphysique ? Voilà ce qu’en dit Denys : « Pour tout résumer, le bien procède d’une cause unique et totale, le mal d’une multiplicité de défaillances partielles. Dieu connaît le mal en tant qu’il est bon, et en lui les causes du mal sont des puissances productrices de bienxii. »
Revenons à l’extase divine. En vue d’appuyer certaines de ses assertions quelque peu ébouriffantes, Denys cite les Hymnes érotiques de Hiérothée. Lorsqu’il emploie l’expression de « désir amoureux » (éros) en parlant de Dieu, mais aussi lorsque ce désir est éprouvé par des intelligences, des âmes ou diverses natures, Hiérothée affirme qu’il faut comprendre cette notion comme étant « une puissance d’unification et de connexion, qui pousse les êtres supérieurs à exercer leur providence à l’égard des inférieurs, ceux de rang égal à entretenir de mutuelles relations, ceux qui sont en bas de l’échelle à se tourner vers ceux qui ont plus de force et qui se situent au dessus d’euxxiii ». Selon Hiérothée, donc, de l’Amour qui est dans l’Un, et de l’« Extase » qui en émane, dépendent toute une série de désirs amoureux à travers tous les temps et tous les mondes. Conceptuellement, il est possible de ramener tous ces désirs amoureux à l’Amour qui les contient tous en son unité. « Ramenons toutes ces puissances à l’unité et disons qu’il n’existe qu’une Puissance simple, productrice d’union et de cohésion, qui est le principe spontané de son propre mouvement, et qui du Bien jusqu’au dernier des êtres, puis de nouveau de cet être même jusqu’au Bien, parcourt sa révolution cyclique à travers tous les échelons, à partir de soi, à travers soi et jusqu’à soi, sans que cesse jamais, identique à soi-même, cette révolution sur soi-mêmexiv. » Tout se résume donc à un concept d’union et de cohésion, en accord avec l’idée du Dieu Un.
Par contraste, dans la partie du Commentaire du Traité des Noms divins qu’il consacre aux passages que nous venons d’évoquer, Thomas d’Aquin fait état d’une différence fondamentale quant à la manière dont, chez l’homme, les puissances ‘cognitives’ et les puissances ‘appétitives’ interagissent avec leurs objets pour s’y ‘unir’. Pour les premières (les puissances ‘cognitives’), le sujet qui veut connaître tend à faire ‘sien’ ce qu’il veut connaître. Connaître quelque chose, revient à se l’incorporer, à se l’assimiler. Alors, ce qui est ‘connu’ existe désormais, en quelque sorte, dans le sujet (qui ‘connaît’). En revanche, pour les secondes (les puissances ‘appétitives’), le sujet tend naturellement à aller vers la chose qu’il désire, il veut sortir de lui-même, se projeter à l’extérieur de lui-même, vers cet autre qu’il désire, afin de s’en approcher autant que possible, espérant enfin y pénétrer, s’y mêler et s’y fusionner. Dans les deux cas, il y a ‘union’, mais c’est la direction du mouvement d’union qui diffère.
Thomas d’Aquin souligne aussi la différence de nature entre agapè et éros (en latin, dilectio et amor), c’est-à-dire entre amitié/affection et amour/passion. Il distingue « les deux manières dont l’amour tend vers son objet. La première, comme vers un bien substantiel, ce qui se produit lorsque nous aimons une réalité de telle sorte que nous lui voulons du bien, comme quand nous aimons un homme en lui voulant du bien ; la deuxième, lorsque l’amour tend vers une chose comme vers un bien accidentel, par exemple nous aimons la vertu non pas certes pour cette raison que nous voulons qu’elle soit bonne, mais plutôt pour que grâce à elle nous soyons bons. La première sorte d’amour, certains la nomment amour d’amitié [agapè] tandis qu’ils réservent pour la seconde le nom d’amour de concupiscence, de convoitise [éros]xv. »
Dans l’amour/passion, c’est-à-dire dans l’amour de concupiscence, on n’aime pas une personne réellement pour elle-même, et seulement pour elle-même, mais on « l’aime » surtout pour ce qu’elle peut donner d’elle-même, ce qu’elle offre de plaisir ou de jouissance. Le désir de l’amant est excité par l’être aimé, mais à cause de cette excitation même, de ce désir de jouissance, de cette volonté d’obtenir satisfaction, le désir, une fois qu’il a été satisfait, s’efface ; alors la volonté repue s’évanouit dans le sommeil, et la conscience revient à elle-même. La personne ‘désirée’ (plutôt qu’aimée) ne l’était que comme un moyen (pour l’amant), et non comme une fin en soi (une fin pour elle-même). Thomas d’Aquin en conclut : « C’est pourquoi une telle sorte d’amour, à cause de la finalité visée par cet amour, ne place pas l’amant en dehors de lui-mêmexvi. » Il n’y a donc pas, dans l’amour/passion, de véritable « extase » (au sens propre de ce mot, qui dénote, redisons-le, la « sortie en dehors de soi-même »).
En revanche, lorsqu’on aime quelqu’un d’un amour d’amitié, on est porté vers cette personne sans arrière-pensée, sans mouvement d’égoïsme, sans chercher a priori notre intérêt. On lui veut seulement du bien, simplement pour elle-même, pour ce qu’elle est, et cela de façon désintéressée. Loin de nous, alors, l’idée de lier cette amitié à quelque avantage que l’on pourrait en tirer, en quelque sorte par-dessus le marché. La personne ainsi aimée n’est pas instrumentalisée. Elle est considérée seulement en elle-même et pour elle-même, et non pour la satisfaction du désir ‘égoïste’ de l’amant. Thomas d’Aquin affirme : « C’est cette dernière sorte d’amour qui produit l’extase car c’est elle qui place l’amant en-dehors de lui-mêmexvii. » Et en tant que l’amant est placé en dehors de lui-même, c’est alors qu’il connaît à proprement parler, l’« extase ».
Le plus intéressant, c’est que l’on peut généraliser cette analyse et l’appliquer à l’Être divin et à la manière dont l’amour se manifeste en Lui ou autour de Lui. Ainsi, « l’amour divin » peut s’entendre de deux façons : premièrement, on peut le comprendre comme l’amour par lequel Dieu est aimé. C’est ainsi que l’on peut expliquer la phrase de Denys selon laquelle l’amour divin produit, ou « fait » l’extasexviii. Cet amour place l’amant (humain) « hors de lui », c’est-à-dire qu’il sort de lui-même pour être extatiquement lié à Dieu. On peut interpréter cette extase comme une façon pour l’amant de ne plus exister pour lui-même, et de se perdre dans les réalités divines. Il ne reste rien en lui qui ne soit désormais lié à Dieu. Deuxièmement, « l’amour divin » peut aussi s’entendre comme l’amour qui est en Dieu, puis qui en émane, qui vient de Lui, et qui est donc dans le monde, et dans tous les autres êtres, par quelque immanence. Alors là, il y a cette audace (du propre aveu de Denys), qui consiste à « affirmer hardiment comme une vérité » que cette extase d’amour (divin) s’opère donc aussi en Dieu. Dieu « s’extasie » hors de Lui-même quand Il condescend à octroyer sa Providence à ses créatures (par exemple en leur donnant, selon les cas, et à proportions variées, l’être, la vie, et l’intelligence). Dieu, qui est la cause de toute chose, « sort de Lui-même » en tant qu’Il pourvoit aux besoins de tout ce qui existe. Il agit ainsi par bonté et par amour, peut-on conjecturer. Et, d’une certaine manière, comme le souligne Thomas d’Aquin dans son Commentaire, en reprenant les termes mêmes du Pseudo-Denys l’Aréopagite : « Il se prolonge et s’abandonne dans l’existence de tous les êtres, selon une certaine extasexix. » Il faut donc prendre ici le mot ‘extase’ comme signifiant littéralement: Dieu « sort de Lui-même » et « Il s’abandonne ». Ajoutons que cette « sortie » et cet « abandon » restent toujours conformes à l’essence (divine). Dieu demeure au-dessus et séparé de tout ce vers quoi « Il sort », et en quoi « Il s’abandonne ». « Il comble toutes les choses sans que sa puissance s’anéantisse dans aucune d’elles. C’est ce que Denys ajoute, certes pour montrer que par le mot ‘s’abandonne’, il ne faut pas comprendre que Dieu soit diminué, mais seulement qu’il se communique aux créatures qui participent de sa bontéxx. »
L’Extase est un paradigme essentiellement divin, que toutes les sortes d’extases humaines (érotiques, amoureuses, mystiques, etc.) ne font sans doute que mimer. Toutefois, les « extatiques » n’abandonnent jamais l’espoir d’y participer à leur mesure.
___________________________
iἜστι δὲ καὶ ἐκστατικὸς ὁ θεῖος ἔρως. Le mot ἔρως, éros, a le sens de « passion, amour ; désir violent », selon le dictionnaire Bailly. Mais c’est aussi le nom du Dieu Éros, qui, selon Hésiode, est « le plus beau d’entre les Dieux Immortels », et le premier Dieu à être venu « avant toutes choses », en compagnie de Chaos et de Gaïa. Éros est aussi le Dieu qui « rompt les forces, et qui dompte l’intelligence et la sagesse de tous les Dieux et de tous les hommes dans leur poitrine » (Hésiode, Théogonie). Sa force est donc supérieure à toute intelligence et toute sagesse, fussent-elles divines… Maurice de Gandillac traduit ici éros par « désir amoureux » : « Mais en Dieu le désir amoureux est extatique ». Pseudo-Denys l’Aréopagite. Traité des noms divins. Ch. 4 § 13. Aubier, Paris, 1941, p. 107.
iiMaurice de Gandillac traduit ἀγάπη, agapè par ‘amour charitable’, qui en est l’acception chrétienne. Le mot agapè est tiré du verbe ἀγαπάω, agapaô, que l’on trouve chez Homère, et qui signifie « accueillir avec amitié, traiter avec affection ; aimer, chérir ». Dans la Septante et le Nouveau Testament, il se dit de l’amour de Dieu pour l’homme et de l’homme pour Dieu.
iiiSag. 8,2
ivPseudo-Denys l’Aréopagite. Traité des noms divins. Ch. 4 § 12. Traduction Maurice de Gandillac. Aubier, Paris, 1941, p. 106
vPseudo-Denys l’Aréopagite. Traité des noms divins. Ch. 4 § 13. Traduction Maurice de Gandillac, Aubier, Paris, 1941, p. 107
viGal. 2,20
viiPseudo-Denys l’Aréopagite. Traité des noms divins. Ch. 4 § 13. Traduction Maurice de Gandillac, Aubier, Paris, 1941, p. 107. Mots soulignés par moi.
viiiIbid. p.108
ixEx 20,4. « YHVH Êlohéi-kha, Êl-qanna ». יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, אֵל קַנָּא
xCf. Dt 6,4
xiCf. Pseudo-Denys l’Aréopagite. Traité des noms divins. Ch. 4 §§ 19 à 34. Traduction Maurice de Gandillac, Aubier, Paris, 1941, pp. 111-126
xiiPseudo-Denys l’Aréopagite. Traité des noms divins. Ch. 4 § 30. Traduction Maurice de Gandillac, Aubier, Paris, 1941, p.123
xiiiExtrait des Hymnes érotiques de Hiérothée, cités par le Pseudo-Denys l’Aréopagite. Traité des noms divins. Ch. 4, §15. Traduction Maurice de Gandillac, Aubier, Paris, 1941, p.109
xivExtrait des Hymnes érotiques de Hiérothée, cités par le Pseudo-Denys l’Aréopagite. Traité des noms divins. Ch. 4, §17. Traduction Maurice de Gandillac, Aubier, Paris, 1941, p.110
xvThomas d’Aquin. Commentaire du Traité des Noms divins. Ch. 4. Leçon 10
xviIbid.
xviiIbid.
xviiiDans sa version latine, la phrase par laquelle Denys commence le §13 du chapitre 4 de son Traité des Noms divins est : « Est autem et faciens extasim divinus amor. » A la différence de l’original grec, déjà discuté (le théios éros y est qualifié par l’adjectif ekstatikos), la version latine, sur laquelle porte le commentaire de Thomas d’Aquin, contient le mot faciens : l’amour divin est donc dit « faisant l’extase » (faciens extasim).
xixThomas d’Aquin. Commentaire du Traité des Noms divins. Ch. 4. Leçon 10
xxIbid.






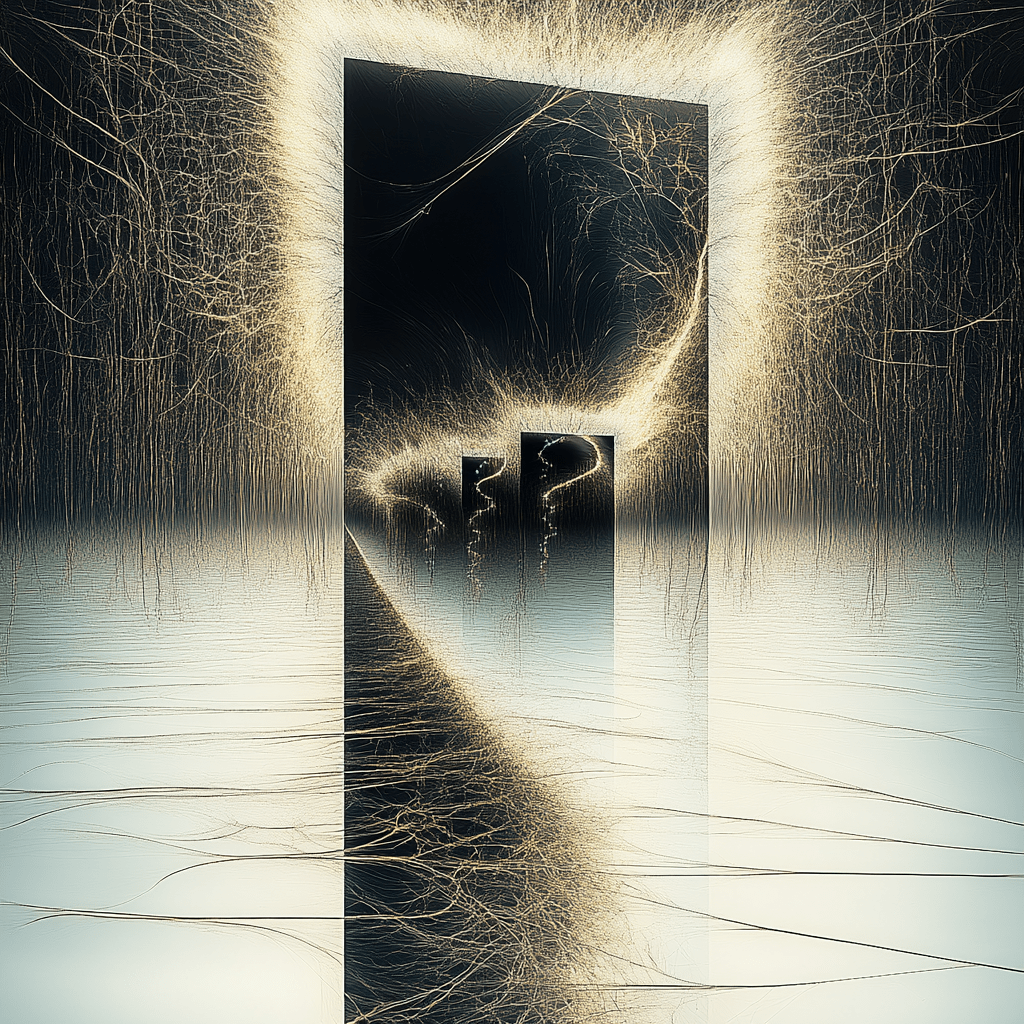











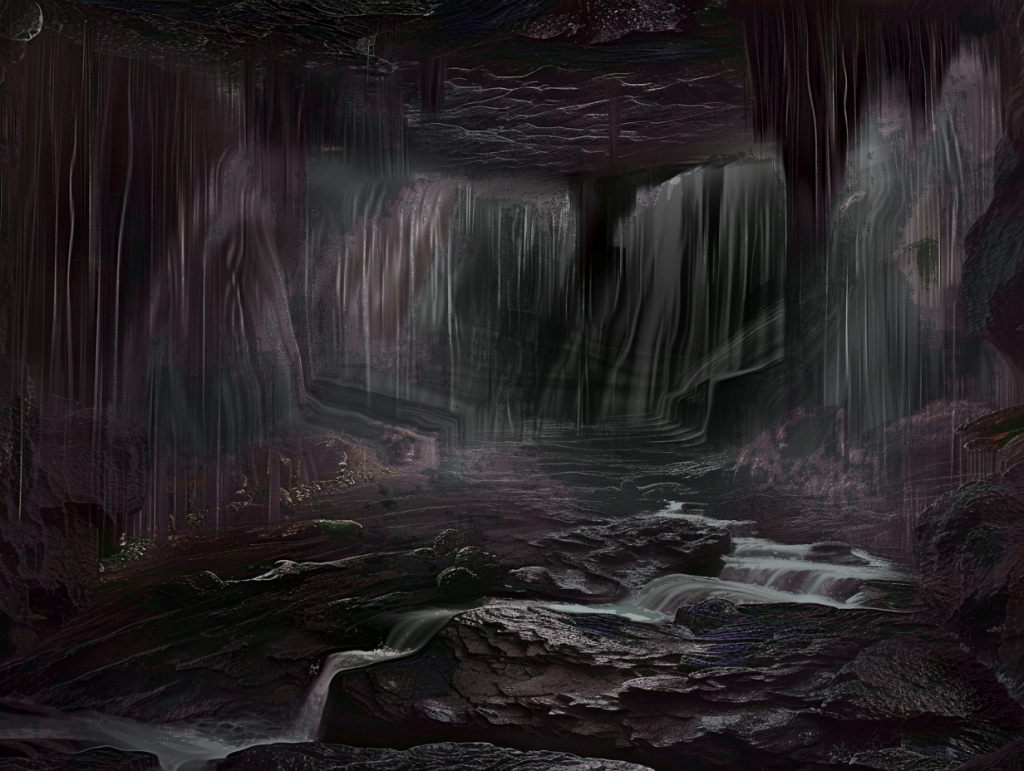











Vous devez être connecté pour poster un commentaire.