
Mis à part un fameux théorème, Pythagore a laissé à la postérité l’idée que les âmes sont immortelles. Mais, pour Cicéron, c’est en réalité Phérécyde de Syrosi, le précepteur de Pythagore, qui fut le premier philosophe à avoir affirmé que l’âme des hommes est éternelle. Il avait notamment écrit, à propos d’un héros mort : « Son âme fût tantôt dans l’Hadès et tantôt au contraire, dans les lieux au-dessus de la terre »ii. En fait, l’idée était rien moins que nouvelle. Elle était répandue depuis bien longtemps dans de nombreuses cultures et diverses religions, sous toutes les latitudes. Phérécyde de Syros vivait au 6e siècle avant J.-C., mais, plus de trois millénaires auparavant, les rituels funéraires de l’ancienne Égypte étaient déjà basés sur la croyance en l’éternité de l’âme, et les textes qui nous sont parvenus attestaient même de sa vocation à être « divinisée », c’est-à-dire réellement transformée en « Osiris N. », la lettre N. symbolisant l’anonymat, et pouvant désigner tout un chacun. Promesse à tous d’une divinisation (presque) assurée ! Rien de moins calviniste ! Plus anciennement encore, de nombreuses pratiques chamaniques, de par le vaste monde, attestaient aussi que les « peuples premiers » savaient bien que, dans certaines conditions, les âmes humaines peuvent voyager au-delà du monde des vivants, pour explorer le monde des morts, échanger avec ceux-ci, avant de revenir ici-bas.
Ni Pythagore, ni Phérécyde, n’avaient donc guère innové. Mais pouvait-on au moins supposer qu’ils avaient eu, personnellement, une expérience de première main, quant à l’éternité de leur propre âme et à ses capacités de migration ou d’extase ? Ou alors ne faisaient-ils en somme que répéter des histoires venues d’ailleurs, d’un Orient plus proche qu’extrême, et fertile en production de « mystères » ?
La Suidas affirme que Phérécyde avait subi l’influence des cultes secrets de la Phénicie. Bien d’autres Grecs tombèrent pour leur part sous le charme des rites chaldéens, comme le rapporte Diodore de Sicile, ou bien sous ceux de l’Éthiopie, décrits par Diogène Laërce. D’autres encore furent fascinés par la profondeur des traditions antiques de l’Égypte, ainsi que le narre Hérodote avec force détails. Bien des peuples ont cultivé des religions à « mystères ». Les Mages de la Perse affectionnaient les grottes obscures pour leurs célébrations sacrées. Plus proches de nous, les croyances des Druides ont été décrites par César, dans sa Guerre des Gaules. « Une croyance que [les Druides] cherchent surtout à établir, c’est que les âmes ne périssent point, et qu’après la mort, elles passent d’un corps dans un autre, croyance qui leur paraît singulièrement propre à inspirer le courage, en éloignant la crainte de la mortiii. » Pour Timagène et Valère-Maxime également, les Druides affirmaient que « les âmes sont immortellesiv ». Diodore, pour sa part, fait le lien entre cette doctrine des Druides et ce que professait Pythagore, lequel pensait qu’après la mort, au bout de quelque temps, l’âme s’enveloppe d’un nouveau corpsv. Jamblique n’hésita pas à y voir un avantage guerrier : comme les Gaulois pensaient que l’âme ne meurt pas, ils enseignaient à leurs fils qu’il ne fallait donc pas craindre le péril du combatvi.
L’idée de l’immortalité de l’âme a donc une longue histoire, de profondes racines. C’est elle, précisément, qui semble fonder et justifier la pratique transnationale, pluriculturelle, et plusieurs fois millénaire, des « Mystères ». Benjamin Constant lui a consacré une partie de son livre, De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements. « Les mystères d’Éleusis furent apportés par Eumolpe, d’Égypte ou de Thrace. Ceux de Samothrace qui servirent de modèle à presque tous ceux de la Grèce furent fondés par une amazone égyptienne (Diodore de Sicile 3.55). Les filles de Danaüs établirent les Thesmophories (Hérodote 2,171 ; 4,172) et les Dionysiaques furent enseignées aux Grecs par des Phéniciens (Hérodote 2,49) ou des Lydiens (Euripide, Les Bacchantes, 460-490). Les mystères d’Adonis pénétrèrent de l’Assyrie par l’île de Chypre dans le Péloponnèse. La danse des femmes athéniennes aux Thesmophories n’était pas une danse grecque (Pollux, Onomast. 4) et le nom des rites Sabariens nous reporte en Phrygievii. »
Constant note que les noms de Cérès et Proserpine dans la langue des Cabires sont identiques à ceux de la Reine des enfers et de sa fille, en Inde. Le nom de Cérés dérive de Axieros et Asyoruca, et celui de Proserpine vient de Axiocersa et Asyotursha. Il cite Creutzer, lequel affirme, dans ses Mithriaques (III,486), que les formules avec lesquelles on consacrait les initiés grecs (« Konx, Om, Pax ») se trouvent être en réalité des mots sanskrits. Konx (κονξ) vient de Kansha (l’objet du désir), Om est le célèbre monosyllabe védique, et Pax (παξ) vient de Pasha (la Fortune). D’autres similitudes encore valent d’être soulignées, comme le rôle de la représentation (stylisée) des organes sexuels dans le culte védique et dans les cultes grecs. Constant indique que les Pélasges à Samothrace adoraient le phallus, comme le rapporte Hérodoteviii, et qu’aux Thesmophories on mettait en scène une représentation du ctéisix. Les Canéphores Dionysiaques, jeunes filles vierges choisies parmi les meilleures familles, portaient sur la tête, dans des corbeilles, le phallus sacré qu’on approchait des lèvres des candidats à l’initiationx. « Ce fut par les mystères Lernéens qui se célébraient en Argolide en l’honneur de Bacchus, que s’introduisit l’usage de planter des phallus sur les tombeauxxi », symboles de la puissance génétique, mais aussi de l’immortalité de l’âme et de la métempsycose. Cicéron parle de l’infamie des mystères Sabariensxii, Ovide et Juvénal décrivent les cérémonies obscènes des fêtes d’Adonisxiii. Tertullien condamne : « Ce que les mystères d’Eleusis ont de plus saint, ce qui est soigneusement caché, ce qu’on n’est admis à connaître que fort tard, c’est le simulacre du Phallusxiv. »
Eusèbe de Césarée s’intéresse aussi à ces orgies antiques, et ne cachant pas son indignation, il cite Clément d’Alexandrie, source bien informée : « Veux-tu voir les orgies des Corybantes ? Tu n’y verras qu’assassinats, tombeaux, lamentations des prêtres, les parties naturelles de Bacchus égorgé, portées dans une caisse et présentées à l’adoration. Mais ne t’étonne pas si les Toscans barbares ont un culte si honteux. Que dirai-je des Athéniens et des autres Grecs, dans leurs mystères de Déméterxv ? »
Les deux sexes s’affublent publiquement dans les cultes sacrés des Dioscures à Samothrace et de Bacchus dans les Dionysies. C’est une « fête de la chair crue », dont l’interprétation peut varier sensiblement. On peut décider de n’y voir qu’une simple allusion aux vendanges vinicoles : le corps déchiré de Bacchus figure celui du raisin arraché de la vigne et écrasé sous le pressoir. Cérès est la Terre, les Titans sont les vendangeurs, Rhéa rassemblent les membres du Dieu mis en pièces, qui s’incarne dans le vin composé du jus des grappes. Mais on peut aussi renverser entièrement la métaphore, et y lire le profond message d’une théophanie de la mort et du sacrifice du Dieu, de son corps démembré et partagé en communion, dans une étrange préfiguration de la mort du Christ, puis de la communion de sa chair et son sang par ses fidèles, aujourd’hui encore, au moment crucial de la messe. Toujours par une sorte de préfiguration païenne des croyances chrétiennes, avec plus d’un demi-millénaire d’avance, on assiste à la mort et à la résurrection du Dieu : Attys, Adonis, Bacchus et Cadmille meurent et ressuscitent, à l’exemple d’Osiris et de Zagréus, avatar du Dionysos mystique. On voit par là que les religions à mystères des Grecs doivent presque tout à des cultes bien plus anciens, venus d’Égypte, de Phénicie, de Chaldée, de Mésopotamie, et de plus loin vers l’orient encore.
Il en ressort une question qui n’est pas sans mérite, me semble-t-il: dans quelle mesure le culte chrétien, qui parut quelques sept ou huit siècles plus tard, fut-il influencé par ces anciens cultes païens révérant un Dieu mort en sacrifice pour les hommes, et dont le corps et le sang sont partagés en communion par eux ? « Le Logos comme fils de Dieu et médiateur est bien clairement désigné dans tous les mystères. » affirme à cet égard Benjamin Constant.xvi
Les cérémonies d’initiation comportaient de nombreux degrés. Les initiés aux petits mystères restaient cantonnés aux vestibules des temples : ils étaient appelés μύσται, les « mystes ». Seuls les initiés aux grands mystères (ἐπόπται, les « époptes », nom qui s’appliqua par la suite aux « évêques » chrétiens) pouvaient entrer dans le sanctuaire. Mais quelle était l’essence de cette initiation ? Quel était le grand secret des grands initiés ? Qu’est-ce qui justifiait de supporter stoïquement quatre-vingt degrés d’épreuves (faim, fouet, séjour dans la fange, dans l’eau glacée, et autres supplices…) pour être initié, par exemple, aux mystères de Mithra ? Avant de tenter de répondre, il importe de noter que tous les systèmes d’initiation avaient un point commun : ils étaient profondément subversifs, ils ruinaient les bases de l’ordre établi, des religions publiques, faisant proliférer des dieux trop nombreux, trop visibles. Une part de cette révélation dernière, qu’il fallait se battre si longtemps pour découvrir, était l’idée de l’inexistence même de toute la foule des dieux populaires, les dieux décrits par Hésiode ou Homère, ces dieux innombrables couvrant les péristyles des villes, et dont le culte était encouragé (et financés) par ceux qui gouvernaient la plèbe. Une partie de l’initiation, enseignée à un très petit nombre d’élus seulement, consistait en l’affirmation du néant de tous les dieux adorés par le peuple. « Le secret ne résidait ni dans les traditions, ni dans les fables, ni dans les allégories, ni dans les opinions, ni dans la substitution d’une doctrine plus pure : toutes ces choses étaient connues. Ce qu’il y avait de secret n’était point donc les choses qu’on révélait, c’était que ces choses fussent ainsi révélées, qu’elles le fussent comme dogmes et pratiques d’une religion occulte, qu’elles le fussent progressivementxvii. »
L’initiation était donc, bien avant l’heure des Lumières modernes, une mise en condition, un entraînement de l’esprit, une ascèse de l’âme, un exercice au doute radical, une mise absolue en abîme. C’était une révélation de l’inanité de toute révélation. Il n’y avait plus, au bout de ce long parcours, d’autres doctrines établies que l’absence de toute doctrine, qu’une négation absolue de toutes les affirmations connues, celles dont on abreuvait le peuple inéduqué. Il n’avait plus de dogmes, mais seulement des signes de reconnaissance, des symboles, des mots de ralliement qui permettaient aux initiés de partager allusivement le sentiment de leur élection à pénétrer les fins dernières. Mais celles-ci, quelles étaient-elles ? S’il fallait se libérer de tous les dieux connus et de tous les dogmes, que restait-il à croire ?
Il fallait croire, par exemple, que les hommes vont au ciel, et que les Dieux sont allés sur la terre. Cicéron en témoigne, dans un échange avec un initié : « En un mot, et pour éviter un plus long détail, n’est-ce pas les hommes qui ont peuplé le ciel? Si je fouillais dans l’antiquité, et que je prisse à tâche d’approfondir les histoires des Grecs, nous trouverions que ceux même d’entre les Dieux, à qui l’on donne le premier rang, ont vécu sur la terre, avant que d’aller au ciel. Informez-vous quels sont ceux de ces Dieux, dont les tombeaux se montrent en Grèce. Puisque vous êtes initié aux mystères, rappelez-vous en les traditionsxviii. » Cicéron nous encourage à reconnaître que le plus grand des mystères est celui de notre âme, et que le sanctuaire le plus sacré n’est donc pas si inaccessible, puisqu’il est si proche, quoique enfoui au plus profond de notre intimité, au centre de notre âme même. « Et véritablement il n’y a rien de si grand, que de voir avec les yeux de l’âme, l’âme elle-même. Aussi est-ce là le sens de l’oracle, qui veut que chacun se connaisse. Sans doute qu’Apollon n’a point prétendu par là nous dire de connaître notre corps, notre taille, notre figure. Car qui dit nous, ne dit pas notre corps; et quand je parle à vous, ce n’est pas à votre corps que je parle. Quand donc l’oracle nous dit: Connais-toi, il entend, Connais ton âme. Votre corps n’est, pour ainsi dire, que le vaisseau, que le domicile de votre âmexix. »
Cicéron, dans le sommet de son art, reste modeste. Il sait qu’il doit tout ce qu’il croit à Platon. Cela se résume à quelques phrases incisives, à la logique précise, chirurgicale : « L’âme sent qu’elle se meut : elle sent que ce n’est pas dépendamment d’une cause étrangère, mais que c’est par elle-même, et par sa propre vertu; il ne peut jamais arriver qu’elle se manque à elle-même, la voilà donc immortelle. Auriez-vous quelque objection à me faire là-contrexx ? »
Si l’on trouve le raisonnement elliptique, on peut en lire la version plus élaborée, telle que développée par Platon dans le Phèdre , et citée par Cicéron dans ses Tusculanes : «Un être qui se meut toujours, existera toujours. Mais celui qui donne le mouvement à un autre, et qui le reçoit lui-même d’un autre, cesse nécessairement d’exister, lorsqu’il perd son mouvement. Il n’y a donc que l’être mû par sa propre vertu, qui ne perde jamais son mouvement, parce qu’il ne se manque jamais à lui-même. Et de plus il est pour toutes les autres choses qui ont du mouvement, la source et le principe du mouvement qu’elles ont. Or, qui dit principe, dit ce qui n’a point d’origine. Car c’est du principe que tout vient, et le principe ne saurait venir de nulle autre chose. Il ne serait pas principe, s’il venait d’ailleurs. Et n’ayant point d’origine, il n’aura par conséquent point de fin. Car il ne pourrait, étant détruit, ni être lui-même reproduit par un autre principe, ni en produire un autre, puisqu’un principe ne suppose rien d’antérieur. Ainsi le principe du mouvement est dans l’être mû par sa propre vertu. Principe qui ne saurait être ni produit ni détruit. Autrement il faut que le ciel et la terre soient bouleversés, et, qu’ils tombent dans un éternel repos, sans pouvoir jamais recouvrer une force, qui, comme auparavant, les fasse mouvoir. Il est donc évident, que ce qui se meut par sa propre vertu, existera toujours. Et peut-on nier que la faculté de se mouvoir ainsi ne soit un attribut de l’âme? Car tout ce qui n’est mû que par une cause étrangère, est inanimé. Mais ce qui est animé, est mû par sa propre vertu, par son action intérieure. Telle est la nature de l’âme, telle est sa propriété. Donc l’âme étant, de tout ce qui existe, la seule chose qui se meuve toujours elle-même, concluons de là qu’elle n’est point née, et qu’elle ne mourra jamaisxxi. » Est-on satisfait ? Veut-on en savoir davantage ? Nous sommes encore loin des Dieux – ou peut-être beaucoup plus proches qu’on ne le suppose. C’est Euripide qui osa la formule la plus audacieuse en cette matière : « Immortalité, sagesse, intelligence, mémoire. Puisque notre âme rassemble ces perfections, elle est par conséquent divine, comme je le dis. Ou même elle est un Dieu, comme Euripide a osé le direxxii. »
L’âme est une sorte de soleil, dont l’éclat ne se dévoile que dans la mort. Les dernières paroles de Socrate, quelques instants avant de boire la ciguë, furent : « Toute la vie des philosophes est une continuelle méditation de la mort ». C’était son chant du cygne. Le cygne est un animal consacré à Apollon, parce qu’il semble tenir de ce Dieu la connaissance de ce qui doit advenir après la mort. C’est pourquoi les cygnes meurent avec volupté, en chantant. Socrate prit le temps, juste avant de mourir, de rappeler cette métaphore à ses disciples assemblés. Il chanta lui-même alors un chant philosophique, inoubliable. Il affronta sa mort imminente, avec le sourire du sage: « Quand on regarde trop fixement le soleil couchant, on en vient à ne voir plus. Et de même, quand notre âme se regarde, son intelligence vient quelquefois à s’émousser; en sorte que nos pensées se brouillent. On ne sait plus à quoi se fixer, on retombe d’un doute dans un autre, et nos raisonnements ont aussi peu de consistance qu’un navire battu par les flotsxxiii. »
Ce doute même, cet aveuglement ultime, quand on s’apprête à franchir la barrière de la mort, vient seulement de la trop grande force du soleil de l’âme, que les yeux faibles de l’esprit ne peuvent supporter.
C’est pourquoi il faut apprendre sans cesse à détacher son esprit du corps, pour apprendre à mourir. Tout au long de la vie, il faut s’entraîner à se séparer du corps par la puissance de l’âme, et s’accoutumer ainsi à mourir. Par ce moyen, notre vie tient déjà d’une vie céleste. Et quand nos chaînes se briseront, nous serons plus aptes à prendre notre véritable essor.
____________
i« À ce qu’attestent les documents écrits, Phérécyde de Syros a été le premier à avoir dit que les âmes des hommes sont éternelles. » Cicéron, Tusculanes, I, 16, 38. Phérécyde de Syros est aussi connu pour avoir été le précepteur de Pythagore, qui était son neveu.
iiPhérécyde de Syros, fragment B 22, trad. G. Colli, La sagesse grecque, t. 2, p. 103 : scholies d’Apollonios de Rhodes, I, 643-648.
iiiJules César. La Guerre des Gaules, VI, 14, 5
ivAmmien XV, 19. Valère-Maxime II, 6, 10. Cité par Albert Bayet, in Totémisme, religion et morale en Gaule. Annuaire de l’École pratique des hautes études, 1923, p.6
vV, 28. Cité Ibid. p. 7
viJamblique, Vie de Pythagore, XXX
viiBenjamin Constant. De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements. 1831. Livre 13, ch.12
viiiHérodote, Histoire 2,51 : « Les Hellènes tiennent donc des Égyptiens ces rites usités parmi eux, ainsi que plusieurs autres dont je parlerai dans la suite ; mais ce n’est point d’après ces peuples qu’ils donnent aux statues de Mercure une attitude indécente. Les Athéniens ont pris les premiers cet usage des Pélasges ; le reste de la Grèce a suivi leur exemple. Les Pélasges demeuraient en effet dans le même canton que les Athéniens, qui, dès ce temps-là, étaient au nombre des Hellènes ; et c’est pour cela qu’ils commencèrent alors à être réputés Hellènes eux-mêmes. Quiconque est initié dans les mystères des Cabires, que célèbrent les Samothraces, comprend ce que je dis ; car ces Pélasges qui vinrent demeurer avec les Athéniens habitaient auparavant la Samothrace, et c’est d’eux que les peuples de cette île ont pris leurs mystères. Les Athéniens sont donc les premiers d’entre les Hellènes qui aient appris des Pélasges à faire des statues de Mercure dans l’état que nous venons de représenter. Les Pélasges en donnent une raison sacrée, que l’on trouve expliquée dans les mystères de Samothrace. » Trad. Pierre-Henri Larcher. Paris, Lefèvre et Charpentier 1842.
ixCf. Théodoret, Serm. 7 et 12. Le ctéis est un mot grec qui signifie littéralement « peigne à dents » mais qui désigne aussi de façon figurée le pubis de la femme, et signifie également « coupe, calice ».
xThéodoret, Therapeut. Disput. 1, cité par B. Constant in op.cit. Livre 13, ch.2
xiB. Constant in op.cit. Livre 13, ch.2
xiiCicéron, De Nat. Deo III,13
xiiiOvide, De Art. Amand. I, 75. Juvénal Sat. VI. In op.cit
xivTertullien. Ad. Valent.
xvCité par B. Constant in op.cit. Livre 13, ch.2
xviB. Constant in op.cit. Livre 13, ch.6
xviiB. Constant in op.cit. Livre 13, ch.8
xviiiCicéron. Tusculanes I, 12-13
xixCicéron. Tusculanes I, 22
xxCicéron. Tusculanes I, 23
xxiCicéron. Tusculanes I, 23
xxiiCicéron. Tusculanes I, 26
xxiiiCicéron. Tusculanes I, 30








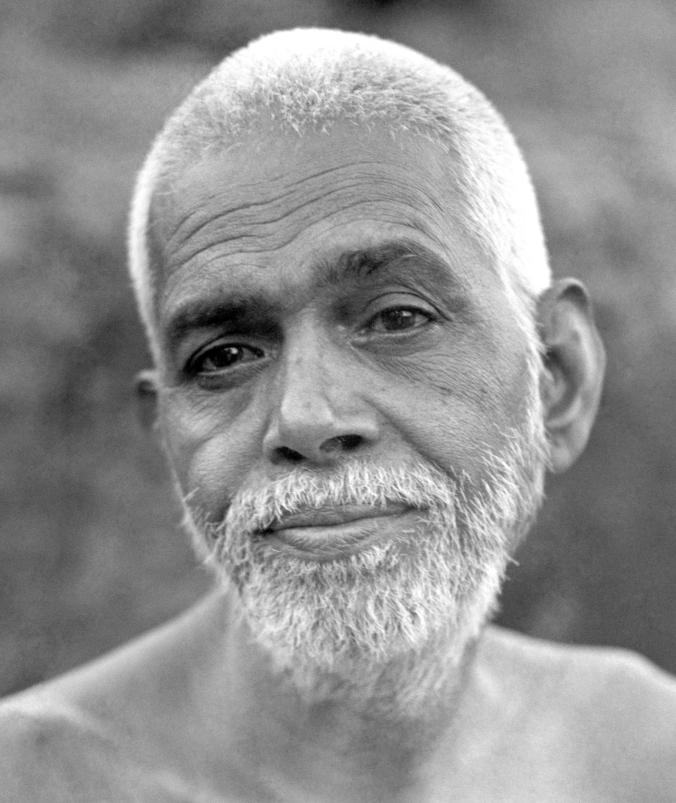



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.