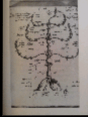En français, le mot « printemps » (du latin primus, premier, et tempus, temps) évoque, comme dans de nombreuses langues, le renouveau, l’efflorescence, le bourgeonnement de la vie. Mais en arabe, l’étymologie de رَبيع ( rabi`, printemps) vient des contraintes du désert. Le verbe رَبَعَ , raba`a, a pour premier sens « se désaltérer, venir à l’eau le quatrième jour » et s’appliquait aux chameaux qui, après avoir marché quatre jours et trois nuits sans boire, avaient enfin accès à l’eau.
Cette belle image donne au « printemps arabe » le goût de l’eau pour les assoiffés. Elle montre aussi que les connotations associées au « printemps » sont assez différentes selon les latitudes.
Cette remarque peut se généraliser, et même devenir une méthode de comparaison, et d’éclairement réciproque. A titre d’illustration, je voudrais proposer l’analyse de quelques mots, utilisés en terre d’Islam et en chrétienté (raison, foi, libre arbitre, prédestination, individu, communauté, religion, loi, occident, orient) et soupeser leurs différences d’acceptions.
1. La raison et la foi (عَقْل, `aql et إِيمان , imân)
La raison (`aql )et la foi (imân) entretiennent dans le christianisme comme en Islam des rapports de tension qu’il est intéressant de comparer.
Le mot `aql vient de la racine عَقَلَ, `aqala,dont le premier sens est « lier, attacher, retenir dans les liens » (et en particulier « attacher le pied du chameau »). D’où les sens dérivés « consacrer quelque chose aux usages pieux », « resserrer », « saisir quelque chose », puis « comprendre ». La racine de imân est أَمَنَ , amana, avec pour premier sens « jouir de la sécurité, être en sûreté, se mettre sous la protection de quelqu’un »2. Dans les deux cas, on voit l’importance des références à une culture matérielle, liée aux conditions de vie dans le désert.
Le mot raison vient du latin ratio, issu du verbe ancien reor, ratus, « compter, calculer ». Son sens premier est « compte, matière de comptes, affaires ». Dans le latin classique, ratio était souvent joint au mot res, la chose, en un effet délibéré d’allitération. Mais on employait aussi ratio dans la langue de la rhétorique et de la philosophie parce qu’il traduisait le grec logos, et importait en latin son double sens de « compte » et de « raison ». Quant au mot foi, il vient du latin fides, « foi, croyance ». C’est le substantif qui est associé au verbe credo, « croire ». Le verbe credo et le substantif fides étaient à l’origine des termes religieux, mais ils ont pris dans le latin ancien des sens profanes, du fait de la disparition de la vieille culture indo-européenne, et l’influence grandissante d’une culture méditerranéenne plus matérialiste. Ces deux mots ne reprirent leur sens religieux qu’avec l’avènement du christianisme3.
Etymologiquement, en arabe comme en français, raison et foi appartiennent manifestement à deux sphères d’activité très différentes, sans lien entre elles.
Cette coupure se traduit aussi sur le plan conceptuel. En Islam, la dualité de la raison et de la foi, du savoir et du croire, et l’idée de la « double vérité », furent au cœur du débat entre les Mu`tazilites (apparus au 8ème siècle) et les Ash`arites (apparus au 9ème siècle). Les Mu`tazilites reconnaissaient la valeur de la raison (`aql) dans la défense de la religion, elle était même le critère (mizan) de la Loi, partant d’une volonté de défendre la foi et de la justifier contre l’invasion de la science grecque et la libre pensée qui en résultait. Mais, les Ash`arites furent heurtés par le rôle excessif donné à la raison par les Mu`tazilites. Cela revenait à supprimer la part de mystère (ghaïb) dans la religion, totalement inaccessible à la raison. Là où les Mu`tazilites estiment que le Coran parle par métaphores, Ash`ari prônait une acception littérale. Par exemple, le musulman doit croire que Dieu a réellement des mains, un visage, mais « sans se demander comment » (bi-lâ kayfa).
Pour Henry Corbin, ce débat traduisait un « rapport d’opposition insoluble » entre raison et foi, entre loi et philosophie. Pour y échapper, il proposait d’y substituer l’analyse du rapport entre l’Islam ésotérique et l’Islam exotérique et littéraliste. Il pensait que c’est dans la place donnée à l’Islam ésotérique que l’on pouvait reconnaître le sort et le rôle de la philosophie en Islam.
Louis Gardet proposa quant à lui de confronter non pas `aql à imân, mais falsafa (qu’il traduit par « philosophie hellénistique de l’Islam ») à char`, (Loi révélée). La falsafa avait surgi dans la Baghdâd `abbâside au 3ème siècle de l’hégire avec la traduction des grecs : Aristote, Platon, Plotin, et donna deux pôles : la falsafa orientale et la falsafa maghrébine, la première plutôt platonicienne et néo-platonicienne, la seconde plutôt aristotélicienne. Ces deux groupes de falsafa se distinguent géographiquement et historiquement: le groupe oriental autour de Baghdâd (du 9ème siècle au 11ème siècle) avec El-Kindî, El-Fârâbî, Ibn Sînâ ; et le groupe maghrébin en Andalus (au 12ème siècle), avec Ibn Bajja, Ibn Tufayl (Abubacer), Ibn Rushd (Averroès).
Alors que Baghdad était imprégné d’influences shi`ites, le mâlikisme sunnite maghrébin se repliait sur les traditions et se refusait à l’ijtihâd. Malgré l’éclat de la dynastie almohade, qui régnait à Marrakech et à Cordoue, les ouvrages d’Ibn Rushd furent d’ailleurs brûlés de son vivant, et ce Cordouan termina sa vie en exil. Louis Gardet estime qu’Ibn Sinâ a marqué profondément la pensée musulmane, mais que l’œuvre philosophique d’Ibn Rushd resta, jusqu’à nos jours, fort peu connue en Islam. Il en conclut que les falâsifa (les philosophes arabes) doivent être considérés en fait « comme des philosophes d’inspiration essentiellement hellénistique, d’expression arabe ou persane, et d’influence musulmane ». Il en tire cette « conséquence fort grave pour l’histoire de la pensée musulmane » : la philosophie dans le monde musulman se constitua dès l’origine en marge, en dehors des sciences religieuses.
A partir du11ème siècle, on assista à une offensive en règle contre les falâsifa menée par Shahrastani surnommé « le tombeur des falâsifa », Isfahâni et surtout Abu Hamid Ghazzali avec son grand livre contre les philosophes (Tahâfut al-falâsifa) (L’Incohérence des falâsifa) auquel Ibn Rushd répondra un siècle plus tard par son Tahâfut al-tahâfut (Incohérence de l’incohérence), ainsi que par son Discours décisif, (Fasl al-Maqâl), où il fait un vibrant plaidoyer pour la raison : « Je veux dire que la philosophie est la compagne de la Révélation (chari’a) et sa soeur de lait. »
أعْني أنَّ الحِكْمَةَ هِيَ صَاحِبَةُ الشَّريعَةِ وَ الأُخْتُ الرَّضِيعَةُ
« [Dieu] a attiré l’attention de l’élite sur la nécessité de l’examen rationnel de la source de la Révélation (chari’a). »
وَ نَبَّهَ الخَواصَّ على وُجوبِ النظَرِ التَّامِّ في أصلِ الشَريعَةِ
Mais Ibn Rushd ne fut pas entendu. A partir du 12ème siècle, on constate que la philosophie perd progressivement de son influence dans le monde musulman, au profit de la mystique.
Pour sa part, le christianisme a montré au long des siècles une gamme comparable d’opinions sur la question du rapport entre raison et foi, mais avec un calendrier différent. Dès les premières années du christianisme, S. Paul affirma que la foi chrétienne était « scandale pour les juifs, folie pour les grecs » (1 Co 1,23), et insaisissable à la raison. En revanche, S. Anselme disait que lorsqu’on a la foi, c’était négligence que de ne pas se convaincre aussi par la pensée du contenu de cette foi. S. Thomas d’Aquin s’employa à prouver au 13ème siècle la compatibilité de la foi et de la raison. En revanche, un peu plus tard, les Franciscains Duns Scot, Guillaume d’Occam et tous les théologiens nominalistes furent beaucoup plus critiques et sceptiques quant aux possibilités de la raison vis-à-vis de la liberté absolue de Dieu : « On ne doit pas chercher la raison de ce dont il n’y a pas de raison » (Duns Scot).
La question s’envenima avec la Réforme, au 16ème siècle. Sola Fide, « la foi seule » (sous-entendu : sans la raison), fut l’un des slogans clé de Luther. La raison doit s’avouer irrémédiablement vaincue devant le mystère de Dieu. En cette matière, la raison non seulement ne sert de rien, mais elle est un handicap. Luther l’appelait la « fiancée de Satan » et la traitait de « prostituée ». Pour Spinoza aussi, entre la foi et la philosophie il n’y a nul commerce possible. « Le but de la philosophie est uniquement la vérité; celui de la Foi, uniquement l’obéissance et la piété. » En conséquence, la théologie ne doit pas être la servante de la Raison, ni la Raison celle de la théologie. « L’une et l’autre ont leur royaume propre : la Raison celui de la vérité et de la sagesse, la Théologie, celui de la piété et de l’obéissance. »4
Le pape Jean-Paul II est revenu sur ce problème dans l’encyclique Fides et ratio (Foi et raison) publiée en 1998, pour réaffirmer la position thomiste : « La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité.»
Dans ce rapide survol, on peut constater que sur de longues périodes de temps, les penseurs chrétiens et musulmans se sont divisés de manière analogue sur ce sujet. On ne peut manquer de relever les proximités de pensée entre les mu`tazilites, l’averroïsme et le thomisme, d’une part, ou entre les ash`arites et les nominalistes chrétiens d’autre part. La similarité des débats semble révéler la présence de clivages structuraux, propres à l’esprit humain, et relativement indépendants des cultures ou des religions spécifiques.
2. Le libre arbitre et la prédestination (قَدَرً qadar et جَبْر jabr)
La question du libre arbitre et de la prédestination a divisé l’Islam tout autant que la chrétienté, et là encore, de façon analogue. En arabe, les mots qadar et jabr ont permis de nommer respectivement la secte de ceux qui admettent le libre arbitre humain, les qadariya (القدرية), et celle de ceux qui prônent la prédestination absolue, les jabariya (الجبرية).
Le mot قَدَرً qadar signifie « volonté divine, providence, arrêts de Dieu, destin ». Mais c’est sans doute à cause de son sens dérivé, « pouvoir, faculté », que ce mot a pu être associé au pouvoir de l’homme et à la liberté humaine.
Quant au mot جَبْر jabr , qui est utilisé pour les défenseurs de la prédestination, il a pour premier sens « réunion de plusieurs parties en un seul corps », « action de ramener les parties au tout » (d’où le mot « algèbre »). C’est seulement par dérivation que ce mot veut dire « exclusion du libre arbitre ». A noter que la racine de jabr est le verbe jabara, « panser, bander et remettre (un os cassé) ; assister quelqu’un », et par dérivation « forcer, contraindre quelqu’un à quelque chose »5.
On trouve dans le Coran des versets en faveur du libre arbitre et d’autres en faveur de la prédestination. Selon les uns, l’homme est responsable de ses actes. « Tout bien qui t’arrive vient de Dieu, tout mal qui t’arrive vient de toi. » (4, 79) « En ce jour, chaque âme sera récompensée de ce qu’elle a acquis » (40,17). Les réprouvés sont ceux « qui refusent l’aide divine » (107, 7).
Selon les autres, rien ne peut conditionner la volonté de Dieu. Les élus sont les « choisis de Dieu ». « Il accorde sa faveur (fadl) à qui il veut » (3, 73). « Quiconque voudra, prendra un chemin vers son Seigneur, — vous ne le voudrez qu’autant que Dieu voudra. » ( 76, 29-30). « Nous avons placé sur leur cœur des enveloppes pour qu’ils ne comprennent pas, et Nous avons mis une fissure dans leur oreille. » (18, 57)
Affirmations contrastées et complémentaires de la responsabilité de l’homme et de l’absolue Toute Puissance divine.
La puissance du décret divin doit-elle être comprise comme la négation de la liberté de la créature raisonnable ? A cette question, seuls les Mu`tazilites répondent en affirmant la liberté de la créature. Selon Gardet, ce sont des textes de hadith intégrés par Bukhârî dans son chapitre du Qadar qui ont servi de base aux écoles mu`tazilites pour assurer que l’homme est « créateur de ses actes ».
En revanche, les Ash`arites nient absolument le libre arbitre. Tout est écrit, tout est prédestiné (maktûb, maqdûr). Ash`ari refuse à l’homme la qudra, le « pouvoir » de ses œuvres, mais lui concède le kasb, le « profit » qu’il peut en tirer.
Mais historiquement, ce sont les écoles théologiques musulmanes qui optèrent pour le Décret divin aux dépens de l’acte libre et de la responsabilité humaine qui finirent par s’imposer.
Cette discussion n’était d’ailleurs pas seulement philosophique ou religieuse, elle avait aussi une forte dimension politique. Car le problème du libre arbitre est lié à celui de la responsabilité, et en particulier à la question de la responsabilité politique.
Deux positions extrêmes se sont affrontées, notamment lors des luttes contre les Omeyades : celle des Khârijites qui déclaraient infidèle, et donc exclu de la Communauté musulmane, le coupable d’un péché grave, et celle des Murji’ites qui remettaient (irjâ’) à Dieu seul le soin de décider du statut de foi ou de non-foi. La position des Khârijites mettait directement en cause `Uthman et menaçait par là les Omeyyades. La thèse des Murji’ites leur était en revanche favorable.
Autrement dit, le problème philosophico-religieux du libre arbitre avait aussi une portée politique: l’affirmation du libre arbitre revenait à rendre les khalifes directement responsables du mal résultant de leurs actes. On retrouve plus tard ce même débat politico-religieux sous les `Abbasides entre les Mu`tazilites et les H’anbalites.
La palette de positions sur la question du libre arbitre est donc complète.
Les Murji’ites « remettent à Dieu » la question du statut effectif de la foi du croyant.
Les Qadarites, partisans du qadar humain, affirment le libre arbitre absolu de l’homme, qui est « créateur » de ses actes. Ils furent aussi les plus opposés au régime omeyyade.
Les Jabarites, liés aux traditionnistes stricts, mettent l’accent sur la Toute-Puissance absolue de Dieu (jabar), sans qu’aucune autodétermination puisse être reconnue à l’homme.
Quant à Ibn Rushd s’il est pour le libre arbitre6, il n’emploie pas le mot qadar, sans doute trop connoté religieusement. Il préfère utiliser le mot الإختيار ikhtiyâr, « choix, option, libre arbitre, alternative, préférence », dont la racine est خارَ , khara, « obtenir quelque chose de bon, préférer, choisir », qui a donné l’adjectif خَيْر, khaïr, « bien, bon » et le verbe اخْتارَ ikhtâra, « choisir, décider de son plein gré ».
Il est frappant de constater qu’entre le libre arbitre et la prédestination, entre la foi et les œuvres, on retrouve un spectre comparable d’opinions en chrétienté.
Dès le début du christianisme, les positions s’affrontent. Paul: «ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par la foi» (Galates, 2, 16)
A quoi répond Jacques: « Il en est ainsi de la foi: si elle n’a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. » (2.17-18 et 26)
Cette polémique, jamais éteinte, fut aussi traduite dans le schisme de la Réforme. Sola gratia, la « grâce seule » (sous-entendu « sans le libre-arbitre »), est l’une des idées fondamentales de Luther. Selon lui, la grâce est donnée par Dieu à certaines âmes « prédestinées », qui sont « élues » sans aucun mérite de leur part. Les autres âmes sont condamnées de toute éternité à la déchéance, quoi qu’elles fassent.
En réaction, le Concile de Trente souligna la coopération et la responsabilité de l’hommepour seconder l’œuvre de Dieu. L’homme doit lutter sans cesse, et progresser dans la foi par ses œuvres.
Il est facile d’apercevoir des analogies entre les positions des jabarites et des Réformés d’une part, et entre celles des qadarites, des averroïstes et des théologiens de la Contre-réforme, d’autre part.
Par ailleurs, de même que l’opposition au libre arbitre en Islam traduisait à l’époque des Omeyyades un soutien politique à leur khalifat, de même les idées de Luther contre le libre-arbitre furent utilisées politiquement par les princes allemands pour nier l’autorité du pape et de Charles-Quint.
3. Individu et communauté
La dualité individu/communauté peut se traduire dans l’Islam par l’opposition entre la responsabilité individuelle dans la recherche de la vérité (qu’on pourrait traduire par l’ijtihâd, l’effort sur soi-même, ou le ra’y , le point de vue personnel) et l’adhésion au consensus communautaire (ijmâ`).
Durant les deux ou trois premiers siècles de l’hégire on pratiqua l’ijtihâd absolu (mutlaq). Une fois les écoles constituées, l’ijtihâd devint relatif. Plus tard il s’effaça devant la simple acceptation passive (taqlîd) des règles d’école. En Islam sunnite, seuls les tout premiers juristes méritent le titre de mujtahid, celui qui pratique l’ijtihad. L’Islam shî`ite au contraire maintient ouvert l’effort personnel, et continua d’appeler mujtahid tout docteur de la loi.
Ibn Rushd dans le Fasl al-maqâl en appelle aussi à la liberté الأختيار ikhtiyâr de l’examen rationnel (النَّظَر التَّامّ) dont la seule limite serait un avis contraire rendu par ijmâ`, un consensus unanime de tous les docteurs en Islam – ce qui sur le plan pratique est évidemment difficile à obtenir, et qui revient de fait à garantir la liberté de la recherche. Les réformistes contemporains réclament quant à eux une « réouverture des portes de la recherche personnelle » (abwâb al-ijtihâd).
Pour sa part, et dès son origine, le christianisme a affirmé l’importance de l’Eglise, et de la communauté des croyants. Mais le schisme de la Réforme changea la donne en relativisant la médiation du clergé et en libérant la réflexion personnelle sur le contenu de la foi. Sola Scriptura (« seules les Ecritures », sous-entendu « sans la médiation de l’Eglise ») résume la position de Luther à ce sujet. Seuls les textes canoniques sont les sources infaillibles de la foi et de la pratique religieuse. Il n’y a pas de place pour une médiation institutionnelle entre le croyant et le texte. Aucune autorité (prêtre, pape ou concile) n’est reconnue; l’interprétation libre, individuelle des textes est laissée entièrement ouverte.
En Islam, comme dans le christianisme, on observe là encore une polarisation analogue entre deux attitudes fondamentales, l’une qui consacre les droits de la raison et de la recherche personnelle, ainsi que la liberté de l’homme de se déterminer par lui-même, et l’autre qui ne cesse de marteler l’importance de la tradition et de la communauté, garants contre le risque des schismes et du sectarisme.
4. Religion et Politique, Dîn wa Dawla.
En Islam, la personnalité du Prophète dut incarner d’emblée une responsabilité religieuse et politique. L’Islam voit de manière intégrée la religion et l’Etat, Dîn wa Dawla. Le mot دِين, dîn, « coutume, habitude, manière d’agir, voie, chemin, croyance, religion, obéissance, calcul, supputation », vient de la racine دَانَ , dâna, dont le premier sens est « être débiteur, s’endetter, emprunter », puis « forcer, contraindre, obliger à quelque chose ». De nombreux autres sens dérivés incluent « se soumettre, obéir, servir » et enfin « avoir de la religion, professer une croyance, surtout l’islamisme »7. Quant à دَوْلَة, dawla, « période, changement, vicissitude, pouvoir, empire, royaume, état », ce mot vient de دَالَ, dâla, « tourner, être en rotation continuelle, chercher à tourner son adversaire, être lâche et pendant (se dit du ventre), marcher en se dandinant avec jactance, faire succéder des changements les uns aux autres »8. Tout un programme.
Pour sa part, le christianisme à son origine s’était placé en dehors de la question du pouvoir temporel, comme l’affirme l’Evangile : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » ou « Mon royaume n’est pas de ce monde ». C’est seulement après la conversion de l’empereur Constantin en l’an 312, qui ouvrit la voie à la christianisation de l’empire romain, que se posa la question des rapports entre le pouvoir et la religion. Les querelles autour du césaro-papisme, le rôle des princes allemands dans la Réforme protestante, la création de l’Eglise d’Angleterre par Henry VIII illustrent la diversité des positions possibles.
En France la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat ne date que de 1905. Mais deux décennies plus tard, en Allemagne, un Carl Schmitt pouvait continuer d’affirmer qu’il n’y a pas d’opposition réelle entre la religion et l’Etat, et que les soubassements de l’Etat sont toujours d’origine théologique. Pour lui, l’Etat de droit moderne, qui découle du rationalisme de l’Aufklärung, a voulu imposer la règle inflexible de la loi, et a cherché à éradiquer l’exception sous toutes ses formes, en privilégiant l’impersonnel sur le personnel, le général sur l’individuel. Ceci équivaut selon Schmitt à un parti théologique radical, qui vise à récuser la possibilité de l’intervention directe du souverain dans l’ordre juridique existant. Et Schmitt ne cache pas sa sympathie pour le parti théologique inverse, en appelant à privilégier politiquement l’« exception » et la « décision », contre la « règle » ou la « loi ». Ce qui le conduisit d’ailleurs à soutenir le nazisme, et son homme « d’exception », le Führer.
Ce dualisme structural de la règle et de l’exception se retrouve dans de nombreux domaines. J’aimerais citer à cet égard la fameuse opposition entre l’école de grammairien de Basra et celle de Koufa, au 9ème siècle. La première insistait sur la systématisation de la règle, la seconde sur les exceptions et les irrégularités. Comparé au système rigoureux de l’école de Basra, celui des grammairiens de Koufa est une somme de décisions particulières, prononcées devant chaque cas, car chaque cas paraît un cas d’espèce. A Koufa, on avait le goût de la diversité justifiant l’individuel, l’exceptionnel, la forme unique, l’anomalie, au dépens des lois générales. En revanche à Basra, les règles de la grammaire devaient refléter la régularité supposée des lois de la pensée, de la nature et de la vie.
Plusieurs siècles auparavant, les grammairiens grecs d’Alexandrie et ceux de Pergame s’opposèrent aussi en une lutte entre « analogistes » et « anomalistes », et plusieurs siècles plus tard, la dialectique du général et de l’exception anima la fameuse querelle scolastique des universaux qui opposa les « réalistes » et les « nominalistes ».
On peut enfin remarquer que les dualismes raison/foi et libre arbitre/prédestination ou communauté/individu s’articulent autour du schème plus fondamental relation/séparation qui équivaut au schème règle/exception. Ces schèmes renvoient en fait à la dualité de l’intelligence et de la volonté, ou au dualisme du « logos » et du « nomos » — c’est-à-dire, ce qui dans l’esprit humain s’attache à « lier » et ce qui vise à « séparer ».
5. La règle et l’exception.
Pour signifier la « loi » civile, l’arabe utiliser les mots نامُوس namouss (loi) et قَانُون qanoun (règle, type, principe) qui sont en fait de simples transcriptions des mots grecs νόμος, nomos et κανών, kanon. Nomos signifiait originairement en grec « division de territoire, pâturage, pacage » et par dérivation « usage, coutume, loi », et kanon avait pour premier sens « baguette droite, règle ». Il a été emprunté par le latin administratif pour signifier l’ « impôt », et par la langue de l’Eglise pour signifier la « règle », le « canon »9.
Pour dire la « loi » divine, l’arabe utilise شرِيعَة chari’a. Ce mot vient de la racine شَرَعَdont le premier sens est « ôter la peau d’un animal tué en commençant par une incision entre les jambes », d’où les sens dérivés : « entamer, commencer une affaire, entrer en matière ; entrer dans l’eau ; diriger une lance contre quelqu’un » puis « rendre clair, évident ; établir, faire une loi ». A la forme II, ce verbe signifie : « frayer un chemin ; faire entrer dans l’eau, amener ses bestiaux à un endroit commode pour qu’ils puissent boire à la rivière»10.
Le mot chari’a permet plusieurs glissements métaphoriques à partir de l’idée de commencement, d’entame, ou d’incision. De là, l’idée d’entrée dans l’eau, puis de la route à suivre pour aller à la rivière, du tracé de la route, pour enfin aboutir à l’idée d’établissement d’une loi, d’un code.
Notons qu’en hébreu, l’équivalent de la chari’a est la torah, « loi », qui vient de la racine יָרָה yarah, qui signifie « jeter, lancer, tirer » et, en sens dérivé, « jeter les fondements, poser, ériger ». Les racines des mots torah et chari’a ont donc en commun l’idée d’un geste initial, « incisif » (comme un coup de lance).
Le mot sunna (usage, habitude, loi, tradition) désigne la coutume normative. La racine de sunna est le verbe سَنَّ, sanna, qui veut dire « former, figurer une chose, percer d’un coup de lance, mener, faire marcher devant soi, élever un troupeau, séparer, distinguer, suivre la route », et de là : « suivre telle règle, observer tel usage, puis établir une loi, prescrire un usage ».11 Dans le droit islamique, il désigne le comportement du prophète. Sunna désigne aussi l’« habitude » d’Allah, qui peut équivaloir aux « lois » de la nature. Ce n’est que tardivement que ce mot fut approprié par les « Sunnites », s’autoproclamant « gens de la sunna ».12
Quant à l’« exception », elle se dit en arabe : اِسْتِثْناء, istithnâ’, de la racine ثَنَى, thana, « plier, recourber, tourner (à droite ou à gauche), doubler, répéter, être le deuxième », et qui donne aussi أَثْناء, athnâ’, « second ».
Cette racine peut être rapprochée phonétiquement et sémantiquement de l’hébreu שֵׁנִי , sheniy, « second, autre », שֵׁנָא , shenâa, « se changer, être changé » , שָׁנָה , shânah, « faire une seconde fois, répéter ; changer, différer », ou encore de שֵׁנָה , shenâh, « sommeil, rêve, songe ». Le glissement de sens entre « second », « répétition », « changement » et « rêve » est utilisé délibérément dans plusieurs versets bibliques, comme par exemple : « Il se rendormit et eut un deuxième songe » (Gen. 41, 5).
La « loi » est associée en hébreu et en arabe à l’idée d’un coup incisif. L’idée duale d’« exception » est associée en arabe au pli, à la courbe, au virage, qui connotent le changement et l’altérité. En hébreu, la même racine conduit à évoquer un « deuxième monde », celui des songes.
6. L’Occident, l’Orient et l’exil.
En langue arabe, le mot « Occident » peut se traduire littéralement par le mot مَغْرِب , maghrib ou « Maghreb ». Ce mot désigne aussi le Maroc. Il est composé du préfixe ma- qui veut dire le lieu, l’endroit, et de la racine غرب, gharaba, dont le sens premier est: « s’en aller, s’éloigner, émigrer, partir, ou se coucher (soleil) », et de façon dérivée, « être long à venir ou à faire quelque chose » mais aussi « être dans l’allégresse, être étrange ». Ainsi le mot غَرْب , gharb, signifie à la fois le couchant, l’ouest, l’occident, mais aussi la fougue, l’impétuosité, la jeunesse. L’adjectif غَريب , gharib, offre une belle polysémie: « bizarre, étrange, inouï, inimaginable, extraordinaire, étranger, rare »…
L’une des significations de gharib appartient au vocabulaire mystique. Il signifie l’« exotérique », par opposition à l’« ésotérique » associé à l’ « Orient ». Le philosophe Ibn Bâjja (Avempace), né à Saragosse à la fin du 11ème siècle, écrivit le Régime du solitaire (Tadbîr al-mutawahhid), dans lequel il utilise le mot gharîb pour désigner des hommes qui sont devenus des étrangers dans leur famille et dans leur société, par allusion à Fârâbî et aux mystiques soufis.
A propos de l’interprétation du Coran (ta’wil), Corbin pousse cette idée plus loin : « Sous l’idée de l’exegesis transparaît celle d’un exode, d’une « sortie d’Egypte », qui est un exode hors de la métaphore et de la servitude de la lettre, hors de l’exil et de l’Occident de l’apparence exotérique vers l’Orient de l’idée originelle et cachée. »
Sohravardi, surnommé le « shaykh al-ishrâq », (l’Ancien de l’Orient), qui fait partie des Ishraqîyûn ou « orientaux », a écrit un Récit de l’exil occidental (Qissat al-ghorbat al-gharbîya). On note le jeu de mot sur ghorbat (exil) et gharbîya (occidental), basés sur la même racine gharb. Dans ce texte, l’« Occident » est une métaphore de l’ « exil », et s’oppose à l’ « Orient des Lumières ». La « théosophie orientale » y est présentée comme amenant le gnostique à prendre conscience de son « exil occidental ». L’initiation doit viser à reconduire le mystique à son origine, à son « Orient ».
Si l’on détache les mots Occident et Orient de toute connotation géographique, on voit que le rêve de cette gnose est que tout homme puisse se faire « occidental », c’est-à-dire « étranger », « exilé » dans sa propre famille et dans sa société, pour mieux devenir « oriental », pour « s’exiler » par l’esprit vers l’ « Orient » de la Lumière. Autrement dit, pour le mystique, l’exil est une règle, en vue d’atteindre l’Exception, qui est aussil’Unique. On trouve d’ailleurs dans le Coran un verset qui se réfère aux « Occidents » et aux « Orients », dans une forme plurielle qui ne peut que renvoyer à une interprétation absolument autre que géographique : « Allah est le Seigneur des Orients et des Occidents » (70,49).
Partage (et 'agitprop' ...) :