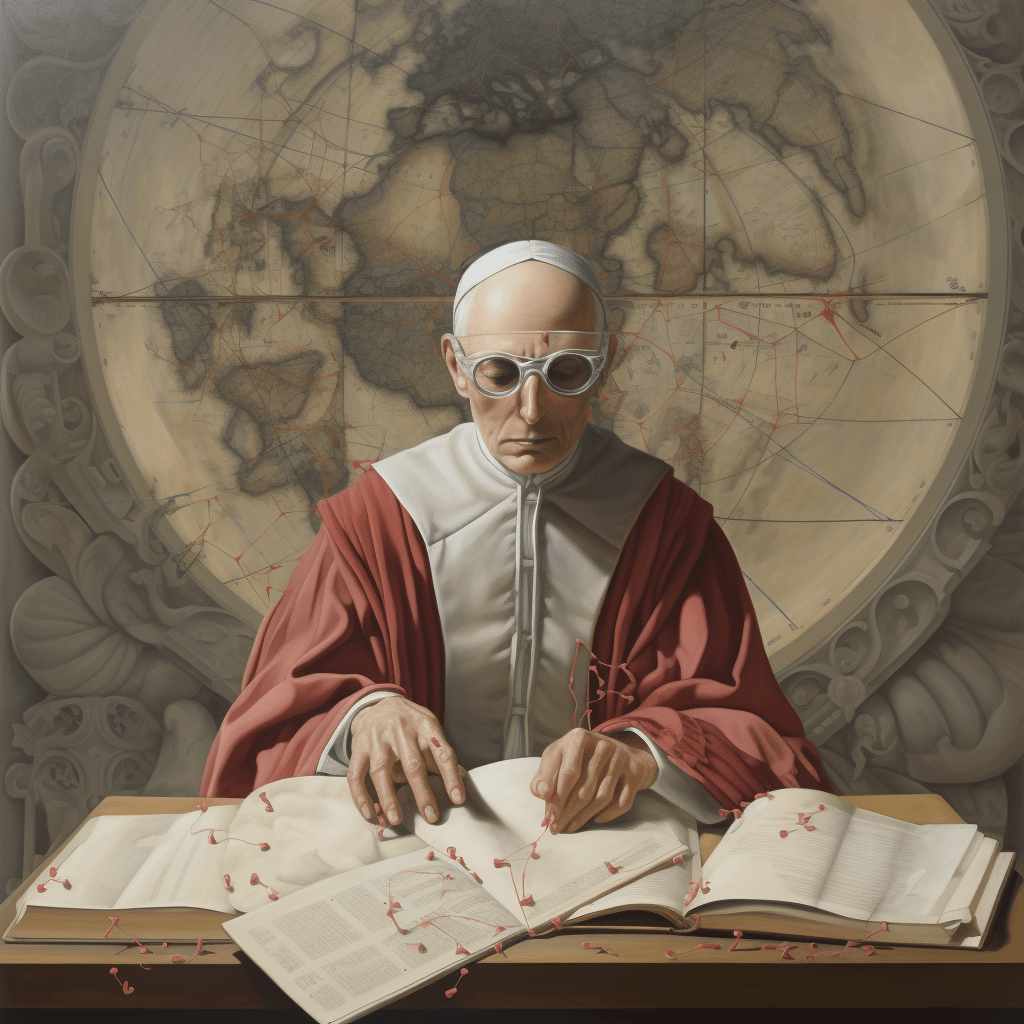
À première vue, la conscience semble être constituée de tout ce qu’elle a conservé de vivant dans sa mémoire, les plaisirs, les peurs, les souffrances, les espoirs, les désirs, les croyances, et toutes les pensées présentes ou passées dont elle s’irrigue et se nourrit. Mais si tous ces souvenirs disparaissent, que devient-elle ? Qu’arrive-t-il à la conscience si elle se trouve soudainement vidée de tout contenu (conscient) ? Cette perte peut être relative, en cas de choc, de trauma ou de coma, ou totale, lors de la mort. Quand le cerveau meurt, que reste-t-il de ce monceau de morceaux de vie qui, auparavant, formait sa substance même ? Le contenu de la mémoire ne se dissout-il pas irrémédiablement, au fur et à mesure que les cellules du cerveau disparaissent ?
Des traditions variées, dans différentes cultures, sous toutes les latitudes et à toutes les époques de l’histoire humaine, attestent cependant que la conscience ne se résume pas au contenu mémorisé biologiquement dans les cellules du cerveau. La conscience semble en effet être en capacité de dépassement de ces limites biologiques. En d’autres termes, la conscience possède en puissance une profondeur propre, une essence intime, qui ne serait sans doute pas sans rapport avec ce que Freud ou Jung appelaient l’Inconscient. Cette conscience abyssale pourrait être interprétée comme une sorte de « conscience inconsciente », c’est-à-dire une conscience qui serait intermédiaire entre la conscience et l’Inconscient. Cette conscience intermédiaire se tiendrait en permanence (et métaphoriquement) ‘au-dessus’ ou ‘à côté’ de la conscience habituelle, mais sans jamais en être séparée, et se confondant même avec elle, la plupart du temps. On pourrait aussi l’appeler une méta-conscience, pour la distinguer conceptuellement de la conscience courante, sans toutefois vouloir a priori l’en distinguer formellement. La méta-conscience serait capable, cependant, de se détacher de la conscience habituelle, dans certains cas, par exemple lors de la phase du sommeil profond, ou bien pendant un coma ou une perte de connaissance, ou encore lors d’expériences faites aux limites de la conscience (dans les NDE ou EMI, les extases, les expériences mystiques…). La méta-conscience se distinguerait de la conscience habituelle en tant qu’elle serait, quant à elle, sans mémoire, sans pensée, sans désir et hors du temps, mais vigilante, et toujours présente au sein de la conscience. La présence de la méta-conscience pourrait être qualifiée de subliminale, c’est-à-dire qu’elle resterait en dessous des limites de la perception consciente, du moins quand la conscience habituelle serait pour sa part en éveil. En revanche, pendant d’autres états de conscience, comme l’état de rêve, de sommeil profond ou l’état dit turīyai, elle serait sans doute plus prégnante, affirmant son existence propre, et prenant la direction du soi. L’hypothèse de l’existence d’une méta-conscience, qui serait comme la conscience de la conscience, sa ‘fine pointe’, n’est pas gratuite. Elle repose, comme je l’ai dit, sur des témoignages innombrables émanant de toutes les traditions et de toutes les cultures. Mais ce qu’il est intéressant de considérer, ce sont les conséquences de cette hypothèse, et voir où elle mène.
On sait assez que la pensée (la pensée ‘consciente’) est fondamentalement limitée, malgré toutes les prouesses dont elle est capable (comme l’attestent dans l’histoire humaine, le développement des philosophies, des sciences, des arts, ainsi que toutes les réussites du genre Homo Sapiens dans son adaptation à la vie sur terre). Tous les savoirs que la pensée produit elle-même, ou qu’elle élabore à partir de l’expérience, sont donc, eux aussi, fondamentalement bornés. On conçoit que la conscience, en tant qu’elle est tissée de pensée et de mémoire, est, elle aussi, a priori relativement réduite, restreinte, cantonnée, enfermée. Il y a assurément dans le monde une infinité de choses que la conscience ne pourra jamais connaître, et dont elle ne soupçonnera même pas l’existence. On peut certes imaginer qu’elle rêverait de les connaître, ces choses infiniment inconnaissables, et qu’elle pourrait faire un effort spécial pour s’en approcher, si elle pouvait seulement supputer leur probabilité d’existence. Mais la conscience vit généralement sa vie consciente sans se préoccuper de tout ce dont elle n’a pas conscience, et encore moins de tout ce dont elle ignore absolument la probabilité d’existence. La conscience vit habituellement dans une certaine clarté, une lumière qui lui appartient en propre, mais qui l’enveloppe par là-même d’un profond brouillard, l’isolant et l’éloignant de tout ce qu’elle ne connaît pas et qu’elle ne pourra jamais connaître, en lui enlevant toute motivation pour le percer. Or, parmi les myriades de choses dont elle ignore tout, à commencer par le fait même qu’elles puissent exister, on peut supputer qu’il y en a qui sont parmi les plus fondatrices, les plus essentielles, les plus magnifiques, les plus étonnantes qui soient. On peut l’inférer de l’épaisseur même des mystères qui environnent de tout temps l’intelligence humaine, et qui semblent être là depuis la fondation du monde, formant la substance des grandes antinomies de la raison pureii. Il y a sans aucun doute un immense intérêt prospectif, pour la réflexion philosophique, de jauger la cohérence des prémisses que ces mystères impliquent, et aussi d’évaluer les conséquences de la « liberté au sens cosmologiqueiii » qu’ils dénotent. En effet, s’ils existent vraiment, quel infini dommage pour la conscience que de se voir inutilement privée de ces trésors ineffables, invisibles et inconcevables !
Ce sont là, à tout le moins, des hypothèses qui valent d’être posées, et méditées. Il est nécessaire et profitable d’échanger des idées sur ces questions fondamentales. Malgré les risques, les difficultés, il est utile et stimulant de les poser, particulièrement dans un monde qui va mal, qui titube, qui vacille sur ses bases, au point que l’avenir même de l’humanité semble aujourd’hui menacé. La corruption intellectuelle, morale et matérielle, gangrène le monde. Les esprits s’assèchent et rapetissent. Il y a peu de raisons d’avoir confiance dans un avenir qui se profile déjà, sous de sombres auspices. Inutile de rappeler la litanie des problèmes mondiaux. L’Occident perd à grande vitesse ce qui lui restait de crédibilité idéologique, politique, morale – et juridique, pour avoir trop longtemps voulu impunément tromper le reste du monde avec son hypocrisie et ses doubles standards, et pour avoir constamment renié dans la pratique ses idéaux (supposés). Quant au Sud, incorrectement dit « global », il n’a certes pas fini de souffrir de ses propres manques. Encore quelques dixièmes de degrés de réchauffement climatique, et la marmite humaine va réellement bouillir.
La question de l’évolution de la conscience (à l’échelle de l’humanité entière) n’est pas un luxe théorique, un passe-temps pour intellectuels oisifs. C’est en réalité la question essentielle, le principal enjeu du champ de bataille mondial, où s’affrontent déjà les forces qui définiront les prochains siècles, et orienteront l’humanité vers le pire, ou le meilleur ou même vers de nouvelles formes de médiocrité. Observons, pour commencer, que plus la conscience semble accumuler des savoirs, plus elle prend conscience qu’elle en sait de moins en moins. Elle découvre qu’elle ignore de plus en plus de choses au fur et à mesure qu’elle avance dans le domaine des connaissances. Il y a en effet, pour la conscience qui avance, cette constante prise de conscience qu’elle est entourée de toujours plus d’inconnu. Elle conçoit même, de plus en plus clairement, que cet inconnu pourrait se révéler être sans fin. J’admets que l’existence d’un infini inconnu ne peut être ni assurée ni démentie, on ne peut que la supposer, ou la conjecturer. Mais on peut aussi raisonner par l’absurde. Si l’on affirmait que le savoir a une ‘fin’, et que la connaissance sera un jour ‘complète’, alors il paraît évident que cette hypothétique assertion serait d’emblée positivement indémontrable, et, surtout, logiquement contradictoire. Elle contredirait en effet, notamment, les théorèmes d’incomplétude de Gödel, qui sont, quant à eux, logiquement démontrésiv…
L’infini inconnu, s’il existe, doit posséder un grand nombre, et même une infinité de dimensions. Cet infini, cette non-connaissance illimitée, dont on conçoit la crédible possibilité, ne peuvent pas être saisis par la pensée, laquelle est, par nature, intrinsèquement limitée, divisée, comme on l’a dit. Nous avons cette nette conscience des limites de la conscience, parce que nous avons aussi conscience des limites de notre conscience individuelle. Mais, si nous avions conscience de participer à la constitution d’une conscience totale, universelle, cosmique, nous aurions peut-être, alors, moins conscience de nos limites propres, et peut-être imaginerions nous que ces limites objectives sont aussi objectivement dépassables par la conscience cosmique, totale, toujours en genèse, et visant vraisemblablement à atteindre quelque transcendance lointaine, mais non hors de portée. L’humanité, on le sait, est constituée de plusieurs milliards d’individus, lesquels n’ont pas tous une claire conscience que « tout est un », et que leur conscience individuelle n’est en réalité qu’une simple goutte noyée dans l’océan total. La conscience océanique est certes ‘une’, d’un certain point de vue, mais chacune des gouttes qui la composent, chacun des embruns projetés par les vagues de conscience, tous se croient vraiment singuliers. Ils le sont sans doute, mais cette singularité est aussi ce qui contribue de façon décisive à la nature de la conscience totale. Celle-ci forme un tout indissociable, et pourtant elle est constituée de ces myriades de singularités qui continuent de croire en leur unique spécificité. Ces singularités ne voient cependant pas que, d’un point de vue plus élevé, elles représentent le chatoiement vivant, le murmure bruissant de la conscience totale. Leur multitude même invite à penser que leur ensemble, leur totalité, a vocation à se développer infiniment. Mais la pensée n’est pas bien équipée pour penser lucidement à de telles choses. Elle peut certes essayer de les concevoir, mais ces conceptions restent toujours en un sens abstraites. Elles sont pensables, mais elle ne sont pas vécues, ni charnellement, ni spirituellement. Malgré tout, il peut arriver que des conceptions issues de la pensée puissent être vécues, exceptionnellement, sur un mode mystique ou extatique, et donc d’une manière fort éloignée de la réalité habituelle. La pensée peut penser des singularités concrètes ou bien des généralités abstraites, mais elle ne peut guère saisir la totalité du pensable, puisqu’elle n’en représente elle-même qu’une infime partie. La pensée est bien incapable de se penser elle-même, en tant qu’elle est par avance perdue dans l’infinie totalité. Elle ignore cette perte même, cet égarement ontologique. Elle préfère toujours croire qu’elle est au moins présente à elle-même. Mais est-ce assez de penser cela ? Y a-t-il quoi que ce soit d’autre au-delà de la pensée ? Il ne s’agit pas ici de faire allusion à quelque Déité, ou à des entités transcendantes, ou encore à de tout autres êtres métaphysiques qui auraient leur propre mode d’existence. Il s’agit bien de rester ici sur le plan humain, et sur le plan des créatures. Je demande s’il existe, dans ce plan, des activités de l’esprit et de l’intelligence qui ne seraient pas de l’ordre de la pensée, mais qui se situeraient bien au-dessus d’elle (comme un indicible mouvement noétique, une nouvelle et inattendue conception, une soudaine intuition ou encore un désir fulgurant, foudroyant…). Je suis absolument certain que l’esprit existe, et qu’il vit, en tant que tel, indépendamment du cerveau. Ce dernier n’est qu’un instrument passager au service de l’esprit, un moyen de s’incarner dans ce corps, et d’entrer en contact avec la réalité de ce monde. Le cerveau biologique, dont le développement est, on le sait, épigénétique, vit essentiellement dans l’héritage de son passé et il se reconfigure sans cesse dans son présent. Mais il n’a aucun moyen de se connecter avec son lointain avenir, puisqu’il est matériellement limité à ce qu’il est, présentement, ainsi qu’à ce qu’il a été. L’esprit, quant à lui, n’est pas une substance biologique, il est immatériel et, de ce fait, il est essentiellement libre. Il est certainement non contraint ou limité par le cerveau. En revanche, comme le cerveau est conditionné par sa constitution biologique, par ses réseaux de cellules et de neurones, par ses hormones, sa relation à l’esprit est naturellement limitée. Le cerveau naît, vit et meurt dans le temps. L’esprit est indépendant du temps : il vit dans son propre espace, mais il n’a pas de rapport avec le tempsv. Il demeure en dehors du temps. Le temps, en revanche, fait partie des principales représentations du cerveau, et réciproquement, le cerveau se coule entièrement dans le mouvement du temps. La pensée (du cerveau) considère aussi l’espace, elle peut inventer différentes représentations de l’espace, diverses sortes d’espaces. Mais ces sortes d’espace n’ont rien à voir avec l’espace propre de l’esprit. L’esprit, d’ailleurs, est davantage un ‘lieu’ qu’un ‘espace’. Je renonce à faire ici un développement sur ces notions, dont rendent compte les mots makom en hébreu, topos en grec, locus en latin, et les mots sanskrits ākāśa, « espace, air, ciel », dont la racine vient de kāśa, « apparition, visibilité » et diś, « direction, sens, lieu », et qui nous mènent, c’est le cas de le dire, vers d’autres directions, et d’autres sens. Je reporte cela à un autre blog. Ce qui est sûr, c’est que la nuance entre espace et lieu importe beaucoup. Dans un espace nu, abstrait, tout reste à faire a priori. En revanche, dans un lieu, on peut d’emblée s’y installer, y habiter, y résider, puis s’y refonder, s’y sourcer ou s’y ressourcer. Dans l’immanence du lieu, dans son secret, l’esprit peut montrer sa puissance, sa transcendance. Restant dans son lieu propre, il peut aussi se révéler au cerveau, dans certaines occasions, par exemple lors d’une perception étincelante, une illumination, une extase, une vision, une révélation. Toutes ces expériences de l’esprit, ces expériences aux limites, sont en réalité hors du temps, elles ne sont pas des produits de la mémoire, ni de simples intuitions, ni le résultat de désirs, ou la concrétisation d’espoirs. Elles sont seulement des faits – bruts, instantanés, irrémédiables, inoubliables, indicibles, ineffables, éternels. Elles n’ont strictement rien à voir avec les schémas linéaires du temps et de la pensée. Elles appartiennent à la nature même de l’esprit, et sont la meilleure preuve de son existence propre, indépendante. L’esprit n’est donc pas une simple production du cerveau. C’est le contraire, en fait. Le cerveau est en partie une production de l’esprit. L’esprit peut agir directement sur la matière même du cerveau (les cellules, les neurones, les synapses, les hormones, etc.). Cette matière est, par essence, limitée, et la pensée est aussi, par essence, limitée. C’est pourquoi la pensée ne peut pas produire un changement en elle-même et par elle-même. En revanche, la pure énergie de l’esprit est capable de pénétrer et de moduler l’énergie limitée de la matière, et, par conséquent, de corriger certaines des limitations du cerveau.
On peut aussi affirmer que le cerveau est fondamentalement, structurellement, « ouvert », et tout à fait disposé à devenir un instrument docile de l’esprit, le moment venu – mais seulement quand il n’est plus occupé de lui-même, quand il n’est plus centré sur son propre fonctionnement. On peut se demander si le cerveau ne serait pas une sorte d’émetteur-récepteur radio qui pourrait émettre des signaux spécifiques, et en recevoir. Mais, faute d’entraînement, il aurait beaucoup de mal à capter distinctement des signaux d’une autre nature (une nature non cervicale, et non humaine) qui viendraient d’ailleursvi. Pourquoi une telle dissymétrie ? On peut seulement observer que le cerveau fonctionne assez correctement, mais dans une zone vraiment réduite, comme dans un réseau wifi de portée limitée. Quand le cerveau veut s’ouvrir à l’esprit, il faut impérativement qu’il commence par se taire. L’esprit a un besoin essentiel, vital, de ce silence. Le contact entre le cerveau et l’esprit ne peut s’établir que dans le silence. Dans ce silence, et si le contact a bien eu lieu, alors l’esprit peut venir et agir. Comment entendre cette action ? Il faut l’entendre dans le sens où le cerveau peut être intimement transformé par l’esprit, comme une fleur butinée peut être fécondée par une abeille. Tant qu’une personne se pense comme un être simplement séparé, elle n’a aucune chance d’établir un contact avec l’esprit. L’esprit vit, on l’a dit, dans son propre lieu et dans le silence. Il vit dans un lieu inconcevable pour la pensée. Dans ce lieu, que fait l’esprit ? Il médite. Sa méditation constitue une sorte de vie intérieure, essentiellement inconsciente. Elle n’a donc rien à voir avec un processus conscient, ou avec une pensée qui serait occupée de raisonnements, de logique ou de grammaire. Sa méditation est une lente éclosion, hors du temps, et elle a besoin dune ’attention permanente, vigilante. Elle ne cherche pas à advenir à la conscience, elle cherche à se fondre toujours plus profondément dans l’inconscient, où elle sait qu’elle a sa source. Le contrôle conscient de la pensée reste donc fort loin de ce que la méditation cherche, et qui se veut un total abandon à la liberté de ce qu’elle ignore, mais qu’elle devine.
L’effort ne sert pas la qualité de l’attention. La véritable attention requiert en revanche que l’ego s’efface, se retire, se cache, disparaisse à ses propres yeux. Là où il y a pensée, pesée, jugement, mesure, projet, sujet, objet, devenir, il n’y a pas de méditation. L’attention est la substance même de l’esprit. Elle constitue son lieu propre, et ce lieu est sans limites. Seul l’esprit peut pleinement habiter ce lieu qui n’a pas de limites. Dans cette illimitation, l’esprit possède un tropisme vers l’universel. Mais ce mot (universel) pose problème. Il y a un risque à associer à l’esprit l’idée d’universel. Ce risque vient des mécanismes mêmes du cerveau, et des structures induites par le langage humain et les grammaires qui le formatent. Le risque est que l’on en vienne à inférer l’existence de ce que certaines traditions appellent « l’Esprit » (avec sa forme de transcendance), à partir du concept d’esprit (dont la nature est d’abord immanente avant d’être possiblement transcendante). Parler de l’Esprit par un E majuscule, le fait entrer dans la longue litanie des traditions, et lui donne alors la consistance d’une idée, respectable sans doute, mais qui n’est qu’une idée, seulement une idée. Ce qui est véritablement important est d’entrer en contact avec cela (que l’esprit incarne et révèle), et non avec une idée (à savoir quelque idée de ce que l’esprit pourrait être ou n’être pas). On peut entrer en contact avec cela, seulement si l’ego se tait. Alors, viennent la beauté, le silence, l’au-delà du temps et de la mémoire. Viennent émotion et compassion. Et, de la compassion, l’esprit fait naître l’intelligence, laquelle peut agir dans le monde réel, par l’intermédiaire du cerveau. L’observateur (le moi, et son cerveau) devient, à sa propre surprise, l’observé, quand il réalise effectivement cela, quand il se résout enfin à éliminer tout conflit entre ce qu’il était et ce qu’il est appelé à observer, avant d’être invité à le devenir. Le cerveau n’est plus séparé de l’esprit, et tout conflit disparaît. Le cerveau cesse de lutter contre ce qu’il ignore depuis toujours, et le moi acquiert une énergie sans mesure. Il se connaît enfin dans son ignorance absolue. Il se connaît dans un apprentissage permanent de soi-même. Il ne se connaît plus par son passé, mais par ce qu’il pressent être son avenir. Se connaître, se pénétrer soi-même, se comprendre soi-même, est une chose très subtile, très complexe – mais formidablement, éminemment vivante. Veiller sur ce qui arrive, ce qui sourd en soi, est une merveille absolue.
____________________
iTurīya (तुरीय)1 est un terme sanskrit qui signifie le quatrième état de conscience au-delà de ceux de veille, rêve et sommeil. Dans les différents courants de philosophie monastique hindoue, Turīya est un état de conscience pure. Il s’agit d’un quatrième état de conscience qui sous-tend et qui transcende les trois états de la conscience commune : l’état de veille, l’état de rêve, et le sommeil sans rêve (Wikipédia).
iiCf. Emmanuel Kant. Critique de la raison pure.
iiiLe déterminisme des phénomènes dans la nature peut coexister avec la « liberté pratique » des noumènes, indépendants des phénomènes. Cette liberté pratique est qualifiée par Kant de « libre arbitre ». Mais Kant pose également l’existence d’une autre liberté, la « liberté au sens cosmologique », qui est la faculté de commencer des séries de causes naturelles. La création même du monde ou du cosmos est l’expression de cette liberté cosmologique, qui s’exerce hors du temps naturel. Elle n’emprunte rien à l’expérience et elle ne peut être reproduite dans aucune expérience (humaine). Cf. Philippe Quéau . La liberté du choix.
ivKurt Gödel a établi en 1931 ses théorèmes d’incomplétude, lesquels prouvent, avec les moyens de la logique mathématique, qu’aucune théorie cohérente (au sens de la logique mathématique) ne peut démontrer sa cohérence avec ses propres principes.
vJiddu Krishnamurti et David Bohm. Le temps aboli. Presses du Châtelet, 2019, p.461
viCf. Jiddu Krishnamurti et David Bohm. Le temps aboli. Presses du Châtelet, 2019, p.455

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.