
Quel « véritable » but proposer aujourd’hui aux êtres humains — à part, bien sûr, le fait de survivre et de ne pas trop s’entretuer ? Quel « véritable » projet donner à l’homo, si improprement nommé sapiens ? Quelle « véritable » fin présenter à l’homme dit « moderne » et précisément soumis sans relâche à toutes sortes de « modes » successives, saisi par le vertige de leur évolution accélérée, et finalement submergé par les incohérences d’un monde absurde, dysfonctionnel, dépourvu de sens et de direction ? Vers quelle « vérité » — du sens de la vie et de l’évolution — faire tendre son intelligence et sa volonté ? Le fait d’employer les mots « vérité » et « véritable » exige naturellement que l’on sache ce qu’ils signifient réellement. Il faut donc reposer cette ancienne question : « Qu’est-ce que la vérité ? », jadis posée au rabbin galiléen qui avait affirmé être venu « pour rendre témoignage à la véritéi ». Cette question ne reçut, alors, pas de réponse. Est-on plus avancé aujourd’hui ? Le mot vérité est, en vérité, un mot fort noble, mais notoirement usé, démonétisé, et désormais presque vidé de sens. Il vient du latin veritās qui, originairement, appartenait au vocabulaire philosophique et théologique, ainsi qu’en témoigne la formule : Veritās est adaequatio rei et intellectus, citée par Thomas d’Aquinii. La vérité est ainsi présentée comme résultant de la « conformité » (adaequatio) des choses avec l’intellect. Comment cela est-il possible ? Les choses, étant créées, doivent « correspondre » à leur conception idéale par l’intellectus divinus (l’esprit divin). L’intellectus humanus (l’intellect humain) étant lui aussi une chose créée, doit être également « conforme » à l’idée que s’en est fait cet intellectus divinus. Et, par transitivité, en quelque sorte, l’intellect humain doit encore pouvoir se « conformer » aux idées correspondant aux autres choses créées… La vérité en tant que veritās signifie qu’est possible une certaine « conformité » et « concordance » de la pensée humaine avec les idées correspondant aux choses créées. Cette concordance est basée sur l’harmonie (supposément) pré-établie du plan divin… Les choses créées et l’intelligence (humaine) bénéficieraient donc, selon cette vue théologique, d’une certaine « conformité » a priori entre elles, puisqu’elles sont toutes, de par leur statut de choses créées, « conformes » aux idées du plan divin. De ceci l’on déduit qu’un homme qui pense est supposé atteindre, par sa pensée, une certaine conformité de nature avec ce à quoi il pense, par exemple avec une chose qui seulement est… Mais, demandera-t-on, comment une pensée peut-elle être conforme à une chose, qui seulement est, et qui, pour sa part, ne pense pas ? N’y a-t-il pas une différence essentielle de nature entre un être qui pense et un être qui seulement est ? Pour lever cette difficulté, on peut s’appuyer sur l’autorité d’Aristote. Selon lui, c’est le propre de l’esprit de pouvoir être toutes choses, d’une certaine manière. « L’âme est, en un sens, tous les êtres […] Aussi l’âme est-elle analogue à la main : comme la main est un instrument d’instruments, l’intellect (νοῦς) à son tour est forme des formes (εἶδος εἰδῶν)iii. » Mais, pour que l’intelligence puisse « être toutes choses », il faut qu’elle sache se rendre en quelque sorte « nue », « ouverte », et ainsi « libre » (de tout préjugé), afin de laisser entrer en elle toutes les formes différentes associées à toutes les choses qu’elle rencontre dans la réalité… Il faut que l’intelligence soit libre à l’égard de ce qui se manifeste, libre de s’« accorder », libre de se « conformer » à la « forme » de toutes les choses qu’elle désire « connaître ». De même que la main est libre de fabriquer n’importe quel instrument, l’intelligence est une « forme » libre de se conformer à la « forme » de toute chose. La notion de vérité découle de la possibilité d’une libre conformité des formes entre elles. C’est pourquoi, pour Heidegger, l’essence de la vérité est la libertéiv. Dans ce cas précis, il déclare entendre par essence [de la vérité] ce qui rend possible la libre adéquation de l’intelligence à la chose, et ce qui permet de juger [librement] de cette adéquation. La liberté est ce qui fonde la possibilité pour l’intelligence d’aller librement vers la chose, d’y reconnaître librement ce qui peut en être connu, et de juger librement de la part de vérité qu’elle contient. Mais, objectera-t-on, cette « liberté » implique-t-elle que la « vérité » se trouve en réalité dépendante de la pure subjectivité du sujet humain avec toutes ses possibles dérives (mensonge, tromperie, fausseté, hypocrisie, illusion, apparence) ?… On répondra que la vérité, comme on l’a déjà dit, ne relève pas seulement du plan humain, mais aussi de l’existence d’un plan supérieur, transcendantal, lequel rend possible l’existence et l’exercice de l’intelligence humaine en tant que « raison pure ». Il y a une vérité « en soi » qui règne « au-dessus » de l’homme, et qui n’est donc pas soumise à sa seule subjectivité. C’est la raison pour laquelle des esprits humains différents peuvent s’accorder entre eux. Il existe un plan de la vérité « en soi », indépendant des aléas propres aux divers sujets humains. C’est dans ce plan supérieur que l’on peut prendre conscience du véritable sens du mot vérité. La vérité correspond au dévoilement au moins partiel de la chose, et elle correspond aussi au fait même de ce dévoilement — le dévoilement de ce que la chose laisse voir, sentir, comprendre d’elle-même. Pour considérer adéquatement ce dévoilement, l’intelligence doit prendre un certain recul devant la chose, afin que celle-ci puisse se manifester en ce qu’elle est et comme ce qu’elle est par elle-même, — et non comme l’intelligence voudrait ou pourrait vouloir la voir… Mais comment être sûr que l’intelligence soit dénuée de tout a priori devant la chose ? Il lui faut décidément « laisser être » la chose. Cela signifie que l’intelligence doit « s’exposer », comme entièrement « nue », devant le phénomène, devant la chose. Elle doit « s’ouvrir » dans sa saisie de la chose, sans rien y mêler d’elle-même… Mais comment cela est-il possible ? Heidegger fournit cette réponse, dans un style compact, obscur, unissant et décomposant les mots : « Le laisser-être, c’est-à-dire la liberté, est en lui-même ex-position à l’étant, il est ek-sistant. L’essence de la liberté, vue à la lumière de l’essence de la vérité, apparaît comme ex-position [à l’étant] en tant qu’il a le caractère d’être dévoilév. » Autrement dit, si j’ai bien compris, la liberté de l’intelligence s’incarne comme un abandon au dévoilement de la chose quand celle-ci se révèle en tant que telle. La possibilité que la chose soit dévoilée est ainsi « ouverte » et « préservée » par l’« abandon » de l’intelligence (qui laisse la chose être ce qu’elle est, et qui la laisse se dévoiler en tant que telle)… Grâce à cet abandon, la « présence » de la chose est seulement ce qu’elle est, et non ce que l’on voudrait qu’elle soit. Par cet abandon, l’intelligence « existe », ou ek-siste : elle sort librement d’elle-même (au sens étymologique), et par cette liberté, elle se met en recherche de la vérité, elle cherche à s’enraciner dans la recherche même de la vérité. Elle s’ex-pose à la vérité qui se présente dans la chose, elle se laisse pénétrer par tout ce qui se dévoile de la chose même. Mais, parce que la vérité est liberté en essence, tout homme peut aussi décider (librement) de ne pas laisser la chose être seulement ce qu’elle est [ce qu’elle est en elle-même et telle qu’elle est]. Il peut la laisser « être », certes, mais il peut vouloir aussi conformer la chose à ce qu’il est lui-même, ou à ce que son intelligence veut en faire. Mais alors la chose se trouve par là-même « voilée », elle en est travestie et déformée. L’intelligence projette sur la chose ses propres ombres, ses propres biais, elle affirme ainsi sa puissance, mais en dénaturant ce sur quoi elle se projette. Dans cette projection surgit une autre sorte de vérité, qui est en fait une « non-vérité », une vérité non-essentielle, laquelle montre l’inadéquation, la non-conformité de la chose et de l’intelligence. Cette « non-vérité » ne résulte pas de la simple incapacité de l’intelligence humaine, ou de son biais. Tout au contraire, elle entretient aussi, paradoxalement, un rapport avec l’essence de la vérité. La « non-vérité » témoigne, bien malgré elle, d’un autre aspect de la vérité, qui est lié d’ailleurs à sa nature la plus profonde, la plus originaire. Mais comment saisir cette « non-vérité », ou cette « non-essence » ainsi associée à l’essence originaire de la vérité ? Quand une chose est mal connue, quand elle n’est qu’approximativement saisie, l’étendue de tout ce qu’elle ne donne pas à voir laisse deviner implicitement l’immensité de ce qui reste à connaître d’elle, et, par induction, l’infinité de ce qui reste à connaître de la totalité de tous les étants. En revanche, là où les choses sont aisément offertes à la connaissance, là où rien ne résiste aux investigations zélées des savoirs techniques, là où se développe un savoir nivelé, quantifié, numérisé, s’éloigne du même coup l’idée même de rechercher l’essence des choses. L’idée de la chose en soi s’enfonce dans l’obscurité. L’intelligence tombe quant à elle dans l’oubli de sa recherche la plus fondamentale. Elle s’assoupit, elle s’endort, elle se laisse progressivement envahir par les brumes de la dissimulation, par l’oubli de sa nature. Elle acquiert certes des savoirs partiels, mais perd le savoir essentiel — celui qu’existent des essences. Elle en oublie jusqu’à l’existence même de ce qui s’appelle l’essence ! Elle laisse bien volontiers les choses être toutes des choses « particulières », « singulières », se satisfaisant de ne les dévoiler qu’en partie. Mais ce faisant, mais elle occulte aussi sa propre et véritable essence, elle la recouvre de son indolence, de sa paresseuse indifférence. Le peu qu’elle sait des choses couvre, plutôt mal que bien, l’immensité ce tout qu’elle ignore. Elle ignore même ce fait décisif qu’elle a occulté l’idée même qu’existe une essence des choses, en croyant avoir acquis tel ou tel savoir sur elles. En réalité, elle est restée absolument ignorante du « tout » des choses, et notamment de sa « véritable » essence de ce « tout », de son origine, de son pourquoi, de sa fin, de sa raison d’être. Elle s’est grugée elle-même de tout savoir véritable, authentique, quant à l’essence du « tout » de la chose. Obnubilée par la recherche du détail, du fait, de la donnée, l’intelligence s’est aussi, et littéralement, obnubilée elle-même.
Le mot obnubilation, du latin obnūbilōvi (« être nuageux » ; « couvrir de nuages »), dénote l’obscurcissement de la pensée qui a oublié le soleil de ses possibles, et qui se livre au crépuscule de ses pauvres raisons. L’obnubilation de l’intelligence se traduit par sa mise inconsciente sous un voile. Sous ce voile, elle ne peut plus se dévoiler en tant que telle à elle-même. Mais cette obnubilation représente aussi, et en quelque sorte par contrecoup, une réalité plus originelle, une réalité qui se tient avant même la « vérité », une réalité qui la fonde et qui est la « véritable » essence de la « vérité ». Étant avant la « vérité », cette réalité n’est donc pas en soi « la » vérité, mais plutôt une « non-vérité », une « a-a-léthéïa », pour jouer sur l’étymologie du mot vérité en grec, et sur son caractère privatif, en le redoublant. L’obnubilation de l’essence de la réalité totale, de l’essence de l’étant total et de la totalité des étants, fait partie d’une vérité plus originelle, qui n’est pas de l’ordre de la seule « vérité » puisqu’elle se tient avant la vérité elle-même. Elle peut donc être appelée, au choix, une « pré-vérité », une « anté-vérité » ou même une « non-vérité », puisqu’elle fonde l’idée de la vérité elle-même. Cette obnubilation, ce voile nocturne, cette couverture obscure, ce brouillard initial, cet « ennuagement » originaire, sont plus anciens que toute révélation ultérieure, que toute apparition matutinale, que toute vision diurne, que tout soleil tardif. Ils sont plus anciens que l’ »être » et que le « laisser-être » eux-mêmes, qui, comme en témoigne leur dévoilement partiel, dissimulent toujours déjà quelque chose de plus fondamental, de plus originaire encore qu’eux-mêmes. Laisser « être » la chose préserve ce qui reste dissimulé en elle, mais occulte aussi la dissimulation comme telle. « Laisser être » la chose cache le fait que la chose est révélée en partie, mais aussi obnubilée dans sa totalité et dans son essence. De fait, « laisser être » la chose préserve son mystère, mais cèle l’idée même du mystère. En « laissant être », se révèle un premier dévoilement, mais se dissimule aussi le mystère le plus ancien, le plus fondamental. Le mystère (c’est-à-dire la dissimulation de tout ce qui est fondamentalement obnubilé) devient une vérité oubliée. Et, comme tels, le mystère et son oubli même, sont aujourd’hui totalement occultés dans la conscience de l’homme moderne.
Pour enfin répondre à la question posée au commencement de cet article, le « véritable » but à proposer à l’homme dit « moderne » est de se délivrer de toutes les « modes », et de retrouver la « véritable » voie du mystère, de dévoiler le voile dont l’existence même du mystère est recouverte. L’homme aujourd’hui doit dés-oublier tout ce qu’il a oublié de son origine. Il doit dés-obnubiler son esprit, et son âme même, de toutes les nuées qui les couvrent.
__________________________
iJn 18, 37-38
ii« Veritas est adaequatio rei et intellectus. Sed haec adaequatio non potest esse nisi in intellectu. Ergo nec veritas est nisi in intellectu. » Thomas d’Aquin. Quaestiones Disputatae de Veritate, art. II. Dans la Somme Théologique, Thomas d’Aquin cite plusieurs définitions de la vérité, correspondant à ses différents aspects : « La vérité est principalement dans l’intelligence, secondairement dans les choses, en tant que reliées à l’intelligence comme à leur principe. C’est pour cela qu’on a pu définir diversement la vérité. S. Augustin, dans son traité De la Vraie Religion la définit ainsi : ‘La vérité est ce par quoi est manifesté ce qui est’. S. Hilaire : ‘Le vrai est la déclaration ou la manifestation de l’être’. Et cela se rapporte à la vérité dans l’intelligence. Sur la vérité des choses rapportée à l’intelligence, on peut citer cette autre définition de S. Augustin : ‘La vérité est la parfaite similitude de chaque chose avec son vrai principe, sans aucune dissemblance.’ Et celle-ci, de S. Anselme : ‘La vérité est une rectitude que l’esprit seul peut percevoir. Car cela est droit ou correct qui concorde avec son principe. On cite encore cette définition d’Avicenne : ‘La vérité de chaque chose consiste dans la propriété de son être tel qu’il lui a été conféré’. Quant à la définition : ‘La vérité est l’adéquation entre la chose et l’intelligence’, elle peut se rapporter à l’un et l’autre aspect de la vérité. » Somme Théologique, Q. 16, Art. 1, Rép.
iiiAristote, De l’âme, III , 8
iv« La liberté est l’essence même de la vérité ». Martin Heidegger. Questions I et II. « De l’essence de la vérité ». Traduction par Alphonse de Waelhens et Walter Biemel. Gallimard. 1968, p. 173
vIbid. p. 176
viLes anciens faisaient le rapprochement sémantique et étymologique entre nūbō (se marier), d’où dérive obnūbō (se voiler la tête), et nūbēs (nue, nuée, nuage). Par son étymologie, le verbe nūbō implique pour la femme qui se marie le fait de perdre sa liberté, d’être voilée, d’être « couverte », d’être « enfermée » en son foyer, et d’être ainsi « protégée » en cette claustration.






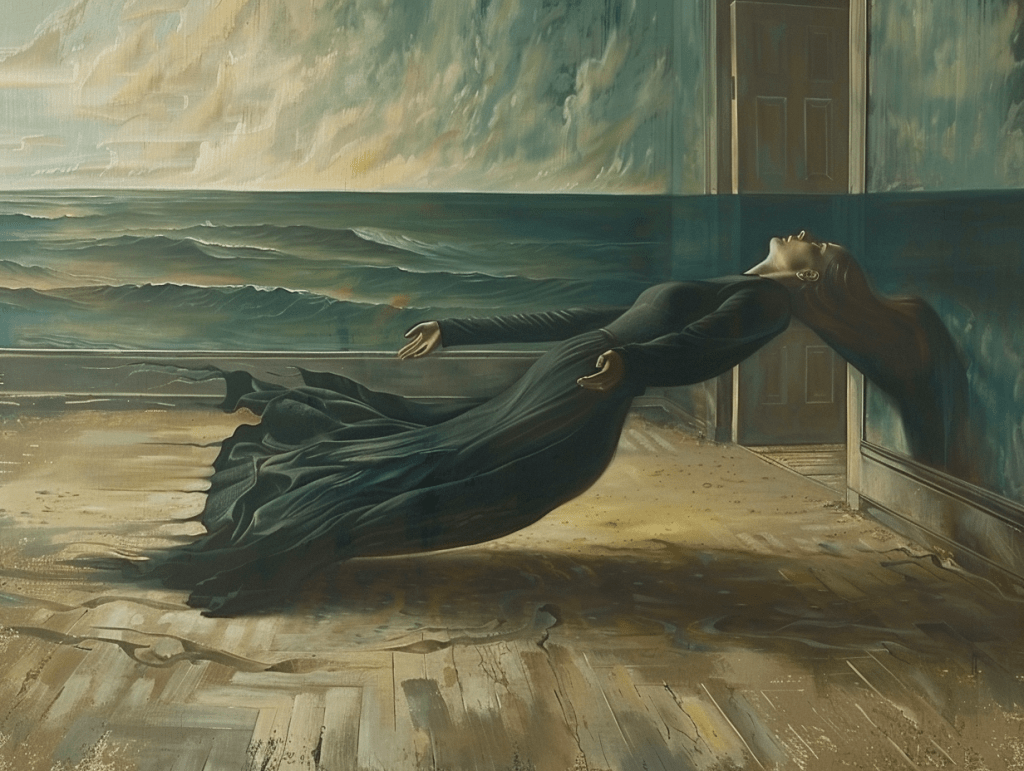







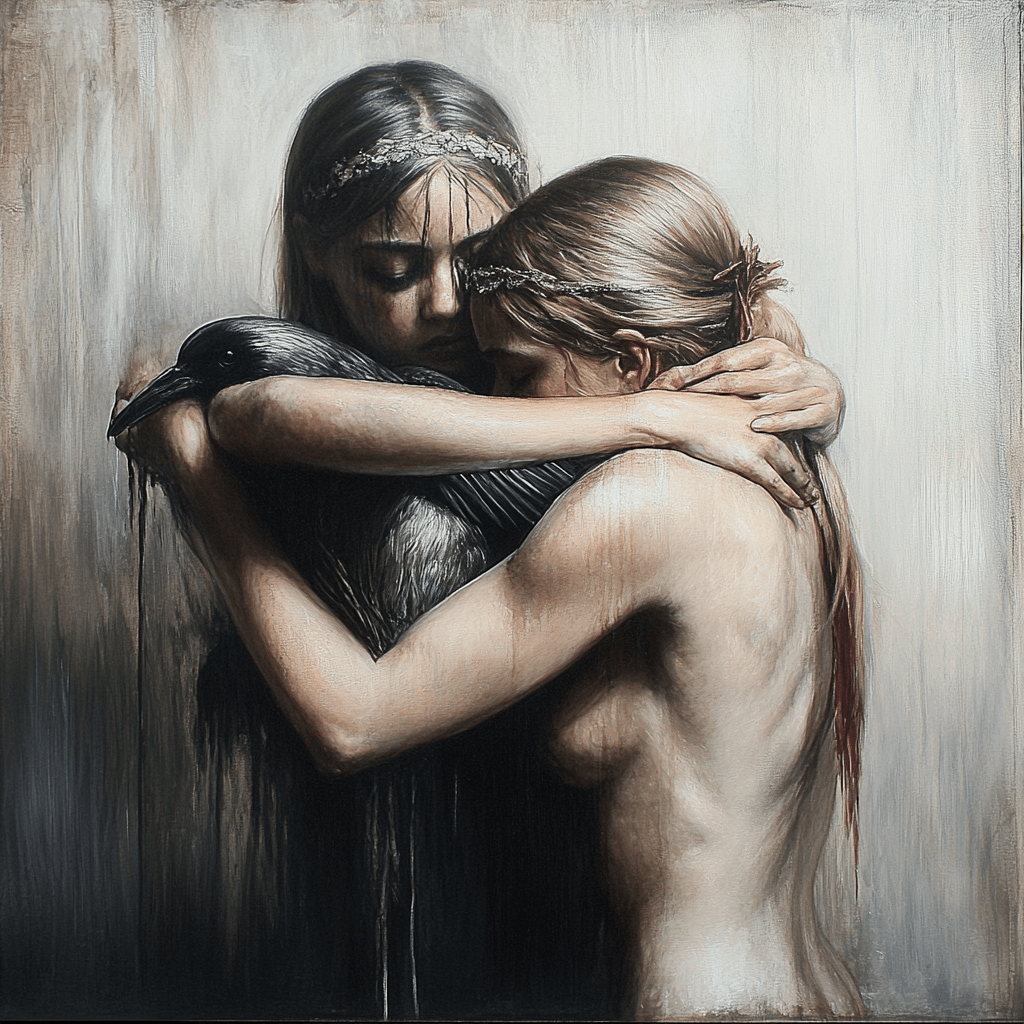




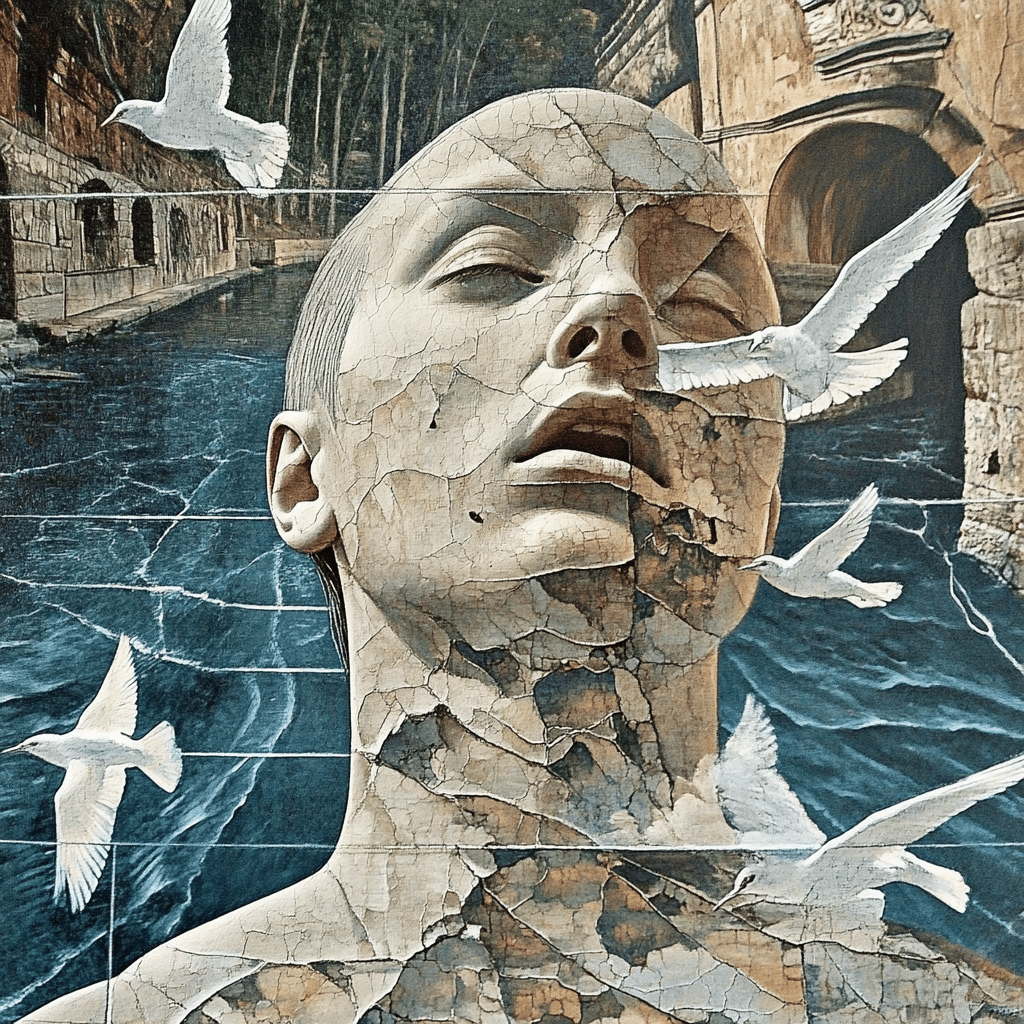


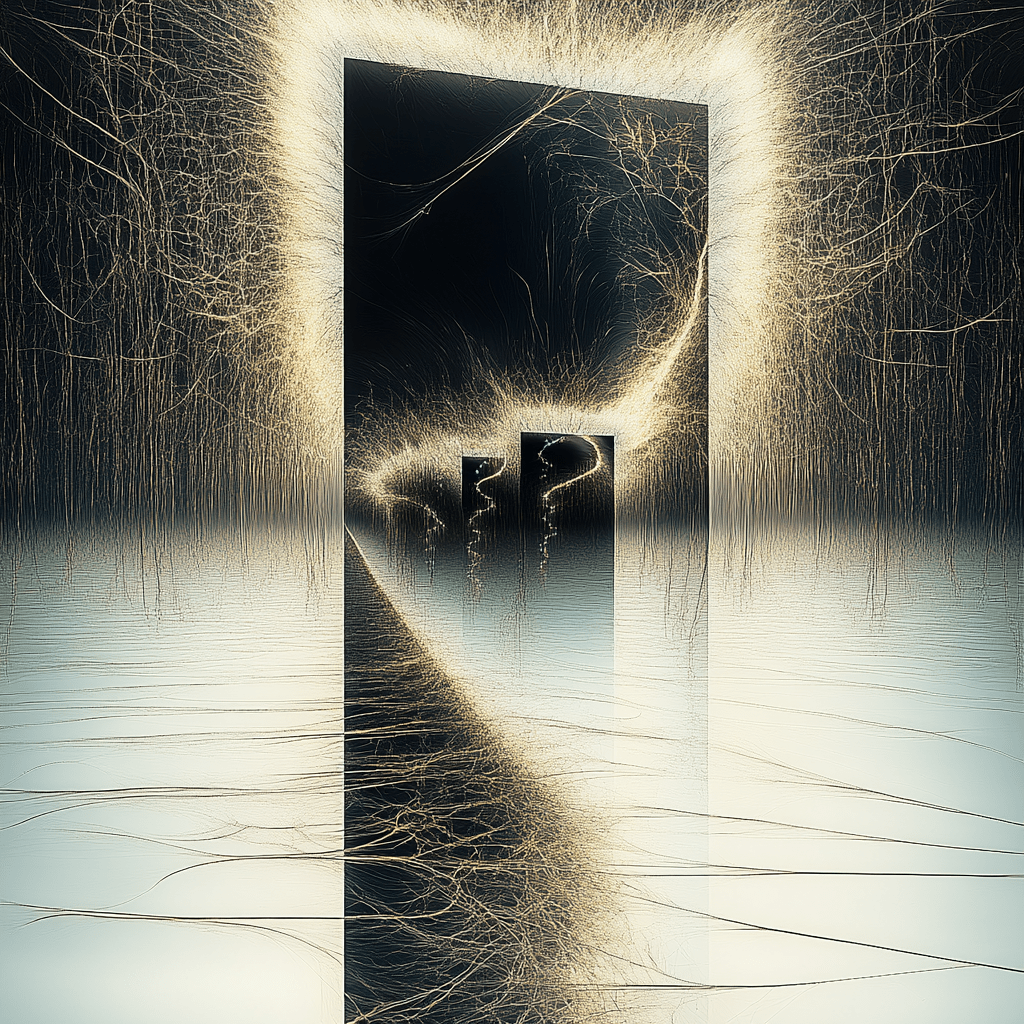


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.