
En lisant un grand nombre d’écrits mystiques, on est frappé par la récurrence de certains modes d’expression, parfois simples et directs, le plus souvent emphatiques, pompeux, et dans quelques cas succombant à une grande extravagance dans le fond et dans la forme, emplis de figures exubérantes et d’allégories déchaînées, accompagnées d’exégèses farfelues, abondantes en liens putatifs avec tels ou tels rites cultuels, surchargées de profondeurs symboliques, de pensées schématiques et d’analogies fantastiques et fantaisistes. Également caractéristique du style mystique est la complaisance pour l’obscurité et le brouillard. Ceci s’explique peut-être, avant tout, par l’inhabilité du langage à traduire des états censés être hors du commun. Il faut d’ailleurs souligner que peu de mystiques, en réalité, ont couché leurs expériences par écrit. Beaucoup se sont tus, gardant pour eux leurs visions et leurs expériences. Et ceux qui en ont parlé ne cessent de rapporter à quel point elles sont littéralement indicibles, ineffables. Le langage serait-il fondamentalement irréductible à l’expérience mystique? Sans le langage, pourtant, il faut bien le dire, aucune conscience philosophique, ni même aucune conscience humaine n’est vraiment concevable. On en déduit qu’à l’origine les fondements du langage n’ont pas dû être posés consciemment. Cette inconscience de la fondation du langage n’en diminue pas la valeur, bien au contraire. Plus on cherche à en pénétrer les fondements, plus il apparaît que leur « invention » dépasse de loin en profondeur, par ses implications, celles des élaborations claires et conscientes les plus élevées. Il en va des éléments et des structures du langage en général comme des traits de caractère des êtres humains pris en particulier ; nous pouvons penser qu’ils apparaissent de manière contingente, spontanée, inconsciente, sans raison apparente, mais nous ne pouvons douter de l’existence de quelque probable signification, certes insondable, mais se révélant en partie dans les moindres détails.
Considérons par exemple le rôle immanent des formes grammaticales dans la formation des concepts. Dans toutes les langues les plus développées grammaticalement, on observe les mêmes distinctions entre sujet et prédicat, entre sujet et objet, entre substantif, verbe et adjectif. On voit aussi que des structures analogues sont utilisées pour la construction des phrases. Dans les langues moins développées, ces mêmes formes fondamentales sont également présentes, sinon formellement, du moins de façon latente, et elles jouent leur rôle par leur position dans la phrase, ou en tirant partie des intonations ou des accentuations appropriées. Quiconque s’intéresse à l’histoire des idées en philosophie sait à quel point celles-ci peuvent être mises en relation avec les formes grammaticales qui les ont rendues possibles. Ainsi les abstractions des philosophes présocratiques doivent beaucoup à certaines caractéristiques spécifiques de la langue grecque. Le grec permet d’utiliser l’article défini (τὸ, to) pour l’associer à des formes verbales (au participe présent ou passé, à l’infinitif), qu’il transforme par ce procédé en substantifs. Par exemple: τὸ ἐόν (to eon), « ce qui est », mais littéralement « l’étant ». La célèbre formule employée par Parménide, τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι (to gar auto noein estin te kai einai) offre un riche bouquet de sens associés au verbe einai (« être »). Pour la traduire, il faut changer la place des mots. On fait porter estin, « il est », sur auto plutôt que sur noein : τὸ γὰρ αὐτὸ ἐστίν (togar auto estin) « car c’est la même chose », νοεῖν τε καὶ εἶναι (noein te kaieinai) « penser et être ». Mais, deux versets plus loin, on lit dans le poème de Parménide : Χρὴ τὸ λέγειν τε νοεῖν τ’ ἐὸν ἔμμεναι· ἔστι γὰρ εἶναι μηδὲν δ’ οὐκ ἔστιν· « Il faut que la parole et la pensée soient de l’être; car l’être existe, et le non-être n’est rien. » L’emploi de l’article τὸ avec l’infinitif substantive le sens du verbe. Dans ce vers de Parménide, l’article est employé devant legeïn, « parler », qui prend le sens de « la parole » (τὸ λέγειν), et, par distribution, devant noeïn, « penser » qui prend le sens de « la pensée »; mais il n’est pas présent devant eïnaï, « être », qui a cependant aussi pour sens, dans ce contexte: « l’être ». Ce tour de passe-passe grammatical donne au mot « être » comme aux mots « parler » et « penser » un sens profondément ontologique, dépassant de fort loin leur rôle habituel, qui dans le cas du verbe être est copulatif, mettant en relation un sujet et son prédicat. L’emploi du verbe être chez Parménide ou chez Héraclite transcende les usages courants et lui donne une portée nouvelle, immensément et ontologiquement signifiante. Héraclite fait muter en profondeur le mot « être » en modifiant son usage grammatical, mais aussi en jouant sur l’opposition être/non-être; en la mettant délibérément en scène, il donne à l’idée des « contraires » une portée elle-même ontologique. S’appuyant ou non sur l’article défini (to), il transmute leur sens, les élève à des degrés d’abstractions dépassant l’usage commun, et leur donne une aura quasi-sacrée. Héraclite n’hésite pas à conjuguer systématiquement le verbe être dans la même phrase (« il a été, il est, il sera »), évoquant par la succession des temps l’idée d’éternité. « Ce cosmos, ni dieu ni homme ne l’a fait, mais il a toujours été, il est, il sera: feu toujours vivant, s’allumant en mesure, s’éteignant en mesure i. » Les philosophes présocratiques utilisent sciemment les mots avec des registres de sens très différents; par ces différences mêmes, est impliquée de facto une métaphysique, sinon explicite du moins sous-jacente, immanente. La langue grecque s’y prête admirablement, et encourage ces constructions sémantiques et grammaticales, pour leur donner une portée philosophique. Il y a le registre des « noms divins » aux sens obscurs, mais possédant une tradition immémoriale. L’homme en perçoit la sacralité sans pouvoir toujours saisir le caractère censément révélateur, et même épiphanique, qu’ils eurent jadis. Il y a le registre de « noms divins » aux sens plus immédiats et transparents, entrant davantage en résonance avec les sentiments que l’homme éprouve spontanément. Ces noms désignent par exemple des phénomènes naturels et en quelque sorte démythifiés et démystifiés (comme la Nuit, l’Aurore, le Jour, l’Orage, le Tonnerre). Il y a aussi le registre de tous les noms qui ne sont rien que des noms, sans connotation symbolique particulière, mais qui gardent encore un pouvoir ancien d’incantation. Changeant de couleur d’époque en époque, ces mots et ces noms peuvent d’ailleurs être recyclés par les philosophes puis les théologiens pour prendre des sens adaptés à de nouvelles interprétations philosophiques ou théologiques, plus sophistiquées en un sens, mais condamnées à rester dans l’univers des réseaux métaphoriques. Elles cherchent à saisir autrement, sous de nouveaux angles, une partie des mystères que les mots anciens ne parviennent plus à évoquer pour des générations qui se succèdent sans cesse. Dès lors que ces registres de sens coexistent, ils facilitent le développement de diverses approches philosophiques, épistémiques et théologiques. Certains registres de sens conviennent à une physique naturaliste, d’autres à une ontologie philosophique, d’autres encore à des rêveries mystiques sur le sacré et des songeries sur les mystères.
Prendre conscience de l’inconscient du langage et de la grammaire qui le structure est impératif. Une grande partie — peut-être la plus grande partie — de la fonction de la raison, consiste à démembrer et à critiquer (au sens kantien) les notions qu’elle trouve déjà en elle-même. Pour faire quoi? Pour s’en tenir à distance, ou la réinventer autrement, si c’est possible.
Si l’être n’est qu’un mot dont le sens vacille, alors le philosophe, qui se veut sujet de l’être, peut aussi se considérer en tant que non-être, ou encore en tant que puissance d’être, ou être en puissance, ou même en tant qu’objet de l’être, en tant qu’être placé sous l’empire de l’Être.
Pour la puissance d’un seul individu, justement, la recherche des fondements est beaucoup trop compliquée, le travail serait sans fin, son achèvement hors de portée. Le langage est l’œuvre des peuples sur d’immenses périodes de temps. Leur instinct millénaire se manifeste dans l’ombre, comme vivent dans l’ombre la ruche et la fourmilière. D’ailleurs, bien que les langues bénéficient dans leur développement de différentes influences culturelles, sociales, religieuses, en rapport avec de multiples zones géographiques, leur évolution est cependant, dans l’ensemble, assez similaire, malgré les caractères nationaux les plus divers. La concordance des formes fondamentales des langues et des structures de la pensée qu’elles véhiculent, et qui se traduit dans les équivalences entre les langues parlées, à tous les stades de développement humain, n’est explicable que par l’existence d’un instinct commun à l’humanité. On pourrait aller jusqu’à imaginer qu’un « esprit » du langage, immanent et omniprésent, guide partout le développement des diverses langues selon les mêmes lois d’épanouissement et de déclin.
A première vue, le langage est un produit naturel de l’esprit humain ; il s’engendre de lui-même nécessairement, sans intention réfléchie ni conscience claire, poussé par l’instinct intérieur de cet « esprit ». Il n’est pas produit par des esprits subjectifs et particuliers, il ne résulte pas d’une conception réfléchie des individus en tant que tels, il émerge en un sens de cet esprit universel, qui fonde la raison dans son essence même. Par analogie avec l’instinct naturel des animaux, on pourrait considérer que le langage correspond à un instinct de la raison humaine, laquelle est en relation avec l’intelligence, la mémoire et la volonté. Le langage n’aurait pu être « inventé » si sa présence n’était pas latente dans la raison humaine. Le langage, d’ailleurs, n’est pas « inventable » ; il est consubstantiel à la raison et à l’intelligence humaines. En revanche, l’on a pu « aspirer » au langage, et ses puissances latentes ont pu être « évoquées » ou même « invoquées », comme s’il était une sorte de divinité silencieuse, qui, lentement, se pliant aux prières, se mettrait à s’exprimer par bribes, énonçant du sens, puis formulant des révélations. L’humanité dans son ensemble a certainement dû être prête, à certains moments, à favoriser les conditions de son émergence, puis à le laisser se développer de lui-même. Le langage n’est pas inné chez l’homme, il n’est pas « révélé » non plus. Ce n’est pas l’homme qui l’a produit en lui-même, et de lui-même ; ce n’est pas la nature organique de l’homme qui l’a engendré, c’est l’esprit qui en lui révèle son « inconscient ». L’esprit humain « conscient » et le langage « inconscient » viennent du même fondement primitif et commun, lequel appartient à l’Esprit universel. Quel est cet Esprit, toujours à l’œuvre dans les profondeurs de l’humanité ? Est-il lui-même conscient ou inconscient ? Réfléchir à l’être même du langage peut nous rapprocher de la réponse.
________________
iHéraclite. Fragment 30. (Trad. Clémence Ramnoux)

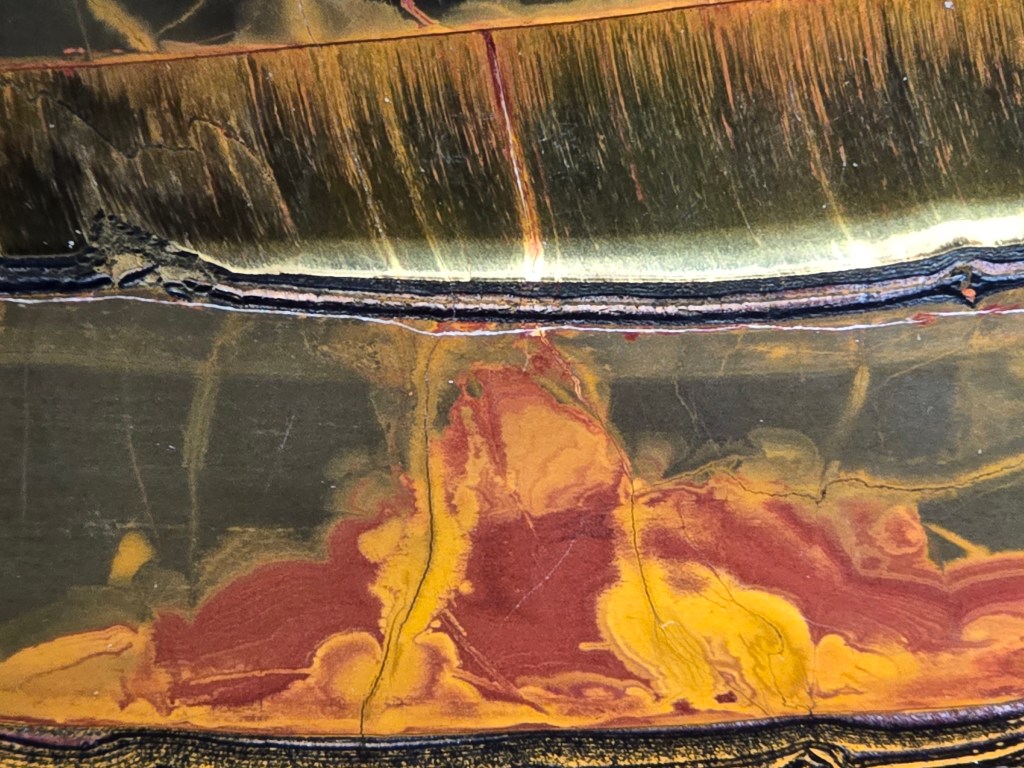
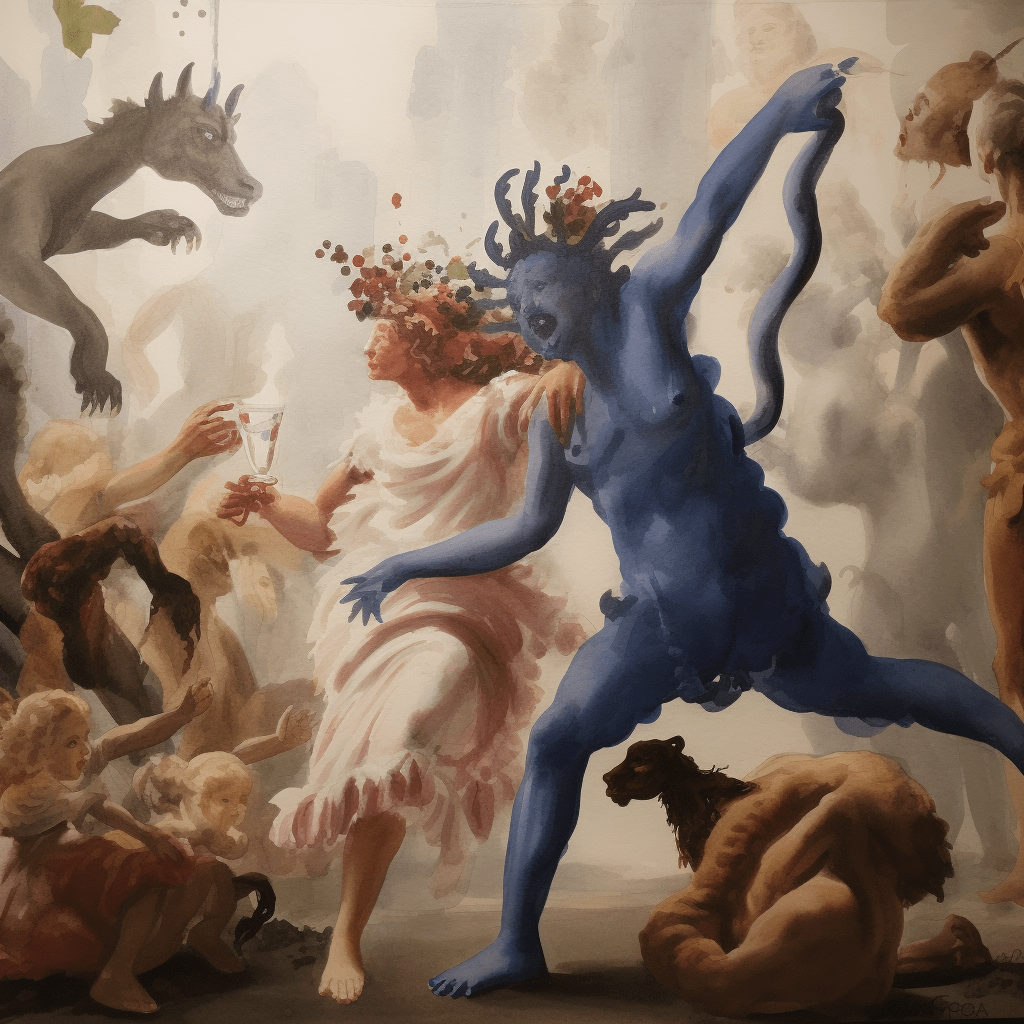
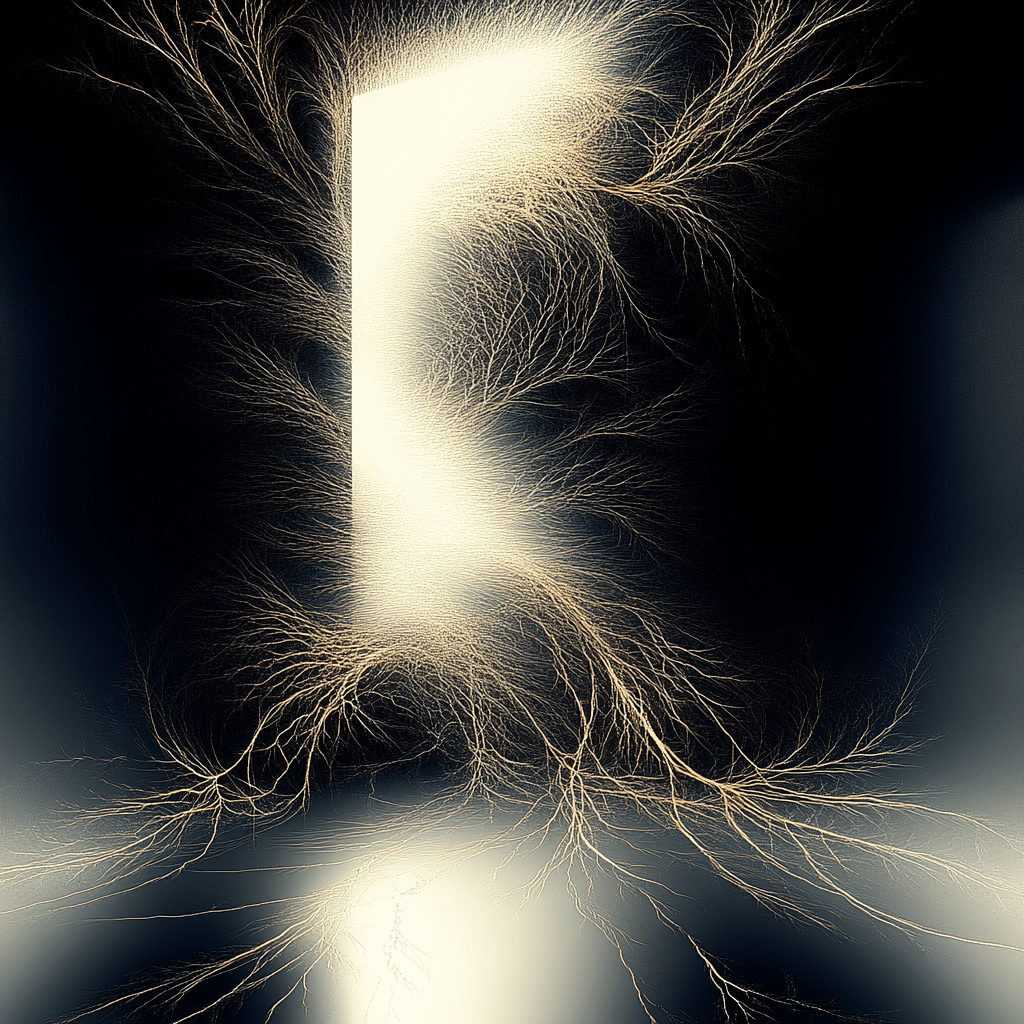

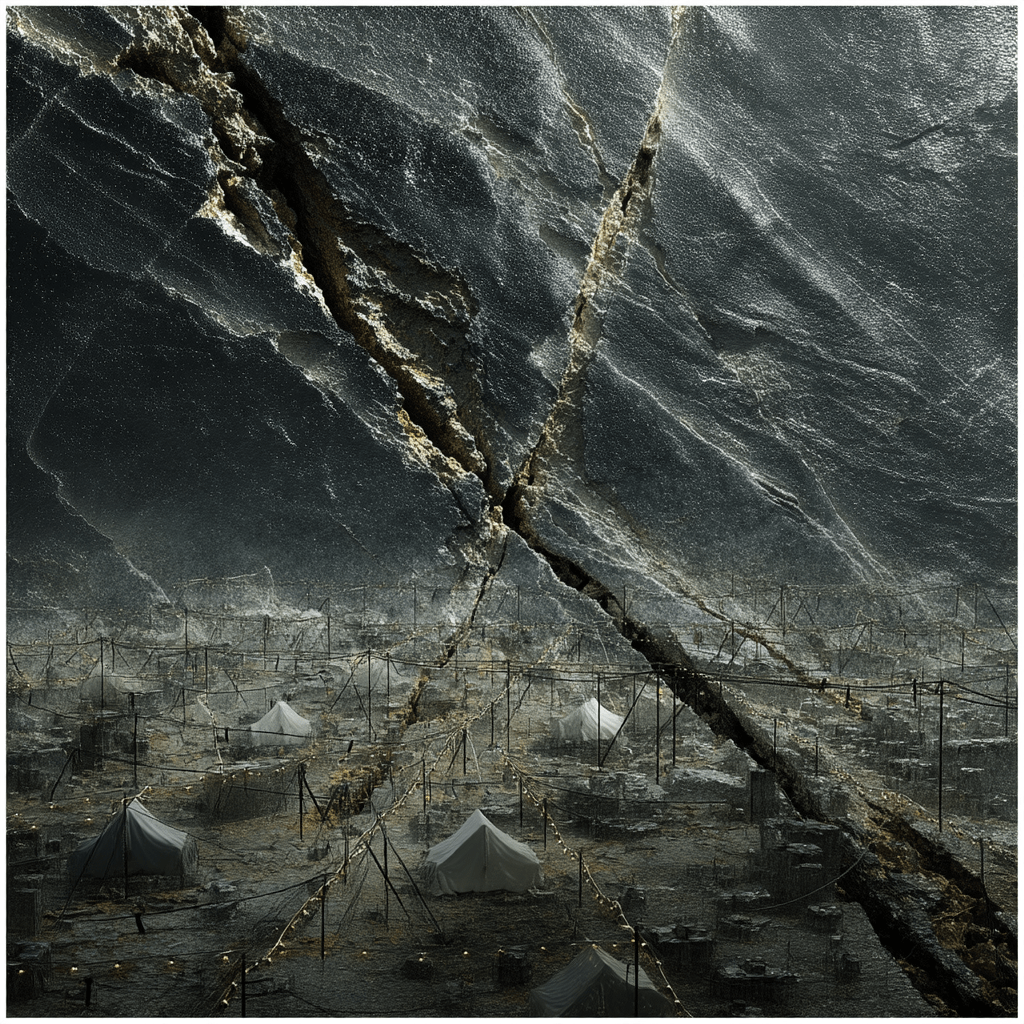


















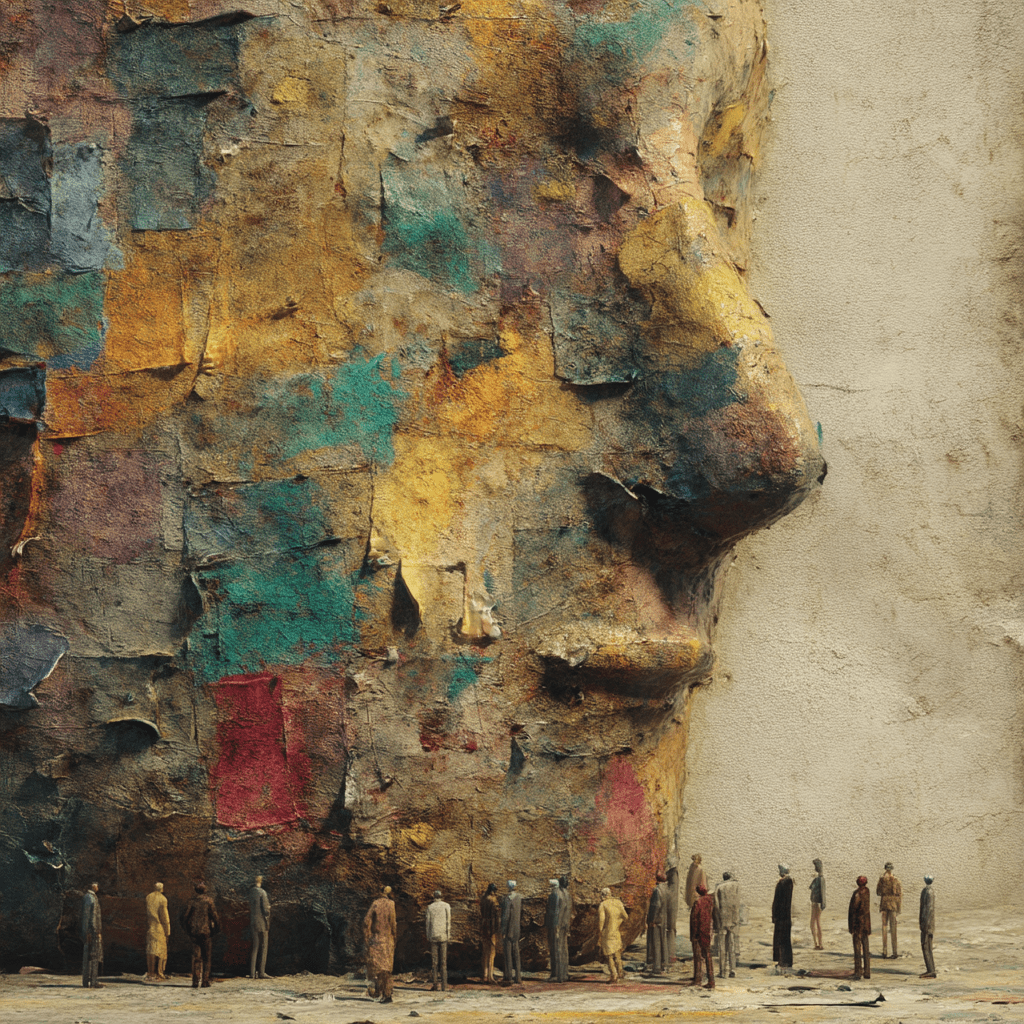





Vous devez être connecté pour poster un commentaire.