
J’aimerais parler de certaines choses obscures, dont je doute cependant qu’on puisse jamais jeter sur elles quelque lumière visible. Ceux qui auront vu la nuit, au moins une fois dans son essence, et ne fût-ce que fugacement, devineront peut-être d’emblée ce que je suis tenté d’évoquer. D’ailleurs, qu’importe au fond, ces termes peu adéquats, le « visible », ou l’« invisible » ! Je pense qu’ils sont intimement intriqués, et se signifient l’un par l’autre. C’est pourquoi je fais aussi volontiers le pari qu’un jour, sera révélée la raison pour laquelle l’âme d’un homme qui n’a jamais lu ni Platon, ni Plaute ou Plotin, ni Spinoza, Swedenborg ou Swinburne, d’un homme qui n’en aurait même jamais entendu parler, ne serait pas tout à fait ce qu’elle est, cette âme, si les êtres qui ont porté ces noms n’avaient jamais existé. Étrange présence, et intrication stupéfiante de l’absence objective et de la pénétration subjective. Les intuitions et les idées des âmes s’élancent, ondulent, s’étendent et s’entrelacent, universellement, et par-delà les âges. On ne peut pas ne pas avoir même seulement une vague conscience de la puissance de l’inconscient, de son renouvellement incessant, de sa vie subliminale et silencieuse. La moindre des pensées qui émerge à l’autre bout de la terre ne traverse-t-elle pas, sans doute sans effort, les cerveaux souvent inattentifs de l’ensemble des hommes ? Mais ils n’en sont pas conscients. Ils baignent jour et nuit dans les effluves du temps et de l’espace, et ignorent leurs rives les plus proches. Je ne sais pas ce qu’il faudrait dire pour persuader la foule pressée de penser l’abysse, sinon ceci. Je pense qu’aucune pensée, une fois pensée, ne se perd dès lors plus, et pour personne. Toute pensée, grande ou mince, énorme ou fine, lorsqu’elle émerge une fois de la soupe neuronale d’un cerveau singulier, se retrouve mystérieusement mais inéluctablement versée dans un « pot commun » mondial. Une copie de chaque pensée est stockée à jamais dans le vaste entrepôt de l’inconscient collectif. De cet abîme du « déjà une fois pensé », finissent alors par émerger, dans quelque autre cervelle, de brèves et brillantes lueurs, ou des sortes d’intuitions, non tout à fait originales, mais comme irrésistiblement extraites de la somme totale des pensées passées. Nous sommes, nous les humains, analogues à ces siphonophoresi, ces invertébrés gélatineux, composés de milliers de zooïdes spécialisés dans les tâches diverses qui sont nécessaires à la vie. Tapis dans les abysses marins, ils déroulent lentement leurs structures errantes et filiformes, pouvant dépasser la centaine de mètres, et ils brillent par intermittence d’éclats bioluminescents, tentant sans relâche de captiver quelque proie, pour la capturer, afin qu’elle profite à toute la colonie de leurs zoïdes, tous singuliers, et tous solidaires de leur siphonophore natal. L’espèce humaine pourrait se comparer à des colonies bigarrées de siphonophores de genres divers (car les siphonophores forment un ordre), se côtoyant dans un noir abyssal, les uns coopérant, les autres se combattant pour survivre dans un environnement aux ressources rares. Comme les siphonophores, qui sont inconscients, sans doute, de la conscience spécifique et singulière de chacun des zoïdes qui les constituent, nous les hommes, nous ne connaissons pas clairement les parties de nous-mêmes qui ne vivent que grâce à des pensées qui furent un jour pensées par d’autres hommes, et dont la plupart ne furent d’ailleurs jamais seulement exprimées, mais qui, pourtant, continuent d’influencer dans les profondeurs, nos vies individuelles et le destin de l’humanité tout entière. La conscience de tout homme a plusieurs degrés de profondeur, de largeur et de hauteur. Bien malin qui saurait déplier chacune des consciences dans son intégralité. Plus malin encore qui saurait relier par toutes leurs intrications effectives toutes les consciences passées et présentes, et saurait comprendre comment elles affectent aujourd’hui, en réalité, les consciences futures. Les plus sages ne mesurent pas de quelle inconscience (collective ou personnelle) la moindre poussée de conscience tire ses racines. Se nourrir de cet inconscient immense, immémorial et transcendantal, semble être l’activité première (quoique subliminale) de toute conscience, mais son activité seconde est aussi d’alimenter à son tour, et sans cesse, un désir insatiable et vorace produire des nouvelletés, pour les planter en ses propres profondeurs, sous forme de rêves ouverts. La conscience « intégrale » de l’humanité, c’est-à-dire la somme totale des consciences singulières, augmente donc toujours, et en s’augmentant, elle augmente d’autant l’épaisseur du mystère qui règne en nous, autour de nous, et au-dessus de nous. Serrés comme des bactéries dans un nuage de plancton au fond de l’abîme, nous cherchons à nous mouvoir un peu au-delà de notre sphère immédiate. Nous cherchons à extraire un peu de connaissance à partir de tout ce que nous ignorons, à partir de cette inimaginable inconnaissance, pour tenter de mesurer un peu mieux l’infinité de ce que nous ne pouvons pas connaître. A la manière du plancton, nous ne nous grandissons qu’en agrandissant jour après jour notre nuage originaire, et, depuis son obscurité, prisonniers de nos errances, nous envions les mouvements assurés de tout le necton qui, tout autour et loin de nous, semble savoir où aller (mais sans nous)… Le necton ? Quel necton ? Je pense au necton des pensées, et à leur puissant nectar. Nous sommes plongés dans ce nectar et dans ce mystère, et, de ce que nous en savons, rien n’émerge assez qui puisse aider à pénétrer véritablement au-dessous de la surface de ce que nous ignorons encore. Nous possédons un moi qui cèle en son profond toutes les ombres de ses absences insondées. Ces absences sans nombre prouvent que ce qui ne tend pas vers l’au-delà de la présence n’est pas digne de notre désir. Il arrive toujours un moment où la conscience se fatigue d’elle-même. Elle ne profite plus de sa propre vie et elle n’atteint pas non plus le cœur désirant de notre vraie vie, elle n’en devine plus l’abyssale profondeur, elle n’en décachète plus l’océan des plis scellés. Elle reste à sa surface, et ses racines mêmes ont peur du grand feu central de notre être. Notre âme ne pense pas, en effet, comme notre esprit ; elle vit d’une vie singulière, unique et cachée. Elle peut être blessée d’un regard ou d’un seul souffle, mais elle peut aussi mépriser les yeux de la foule ou le vent des tempêtes. Étrange puissance, colossale faiblesse. Il faut chercher ce qui la touche ; tout est là, car c’est aussi là que nous commençons. Rien n’est plus triste à l’âme et plus décevant qu’un chef-d’œuvre inabouti, sinon un autre qui, lui, ne serait qu’abouti. Rien ne montre davantage l’impuissance de l’homme devant le constat de sa grandeur — et de son impuissance. Son âme est certainement supérieure à ce qu’on l’on en dit toujours (dans les livres). Elle est plus abyssale qu’aucune de ses images ou de ses définitions. Un grand poète fait sentir en notre âme notre valeur, et alors, quelle ingratitude !, nous estimons moins ce qu’il a su évoquer. La meilleure chose qu’il nous lègue, en souvenir de son talent, c’est la distance qu’il nous permet de prendre d’avec sa supériorité. Baudelaire ou Rimbaud nous emportent dans des cieux sublimes, des paysages de mots, sans égal, éthérés, et nous suggèrent la profuse richesse de mondes à côté desquels le nôtre propre est comme atterré, comme s’il n’appartenait pas plus à la nature des choses que l’ombre fugitive du passant se reflétant dans l’eau du caniveau. Nous sommes des êtres en somme invisibles, qui ne vivent au grand jour qu’enfermés en eux-mêmes. Le visiteur de passage ne se doute jamais de rien. Il nous regarde comme si nous n’étions pas. Il se détourne bientôt comme s’il n’y avait évidemment rien à voir, sans se douter le moins du monde qu’il y eût quelque chose à voir, et dont il n’a pas idée, mais que notre âme fière ne condescend pas à laisser seulement soupçonner. C’est à l’endroit précis où la relation d’un homme avec son semblable semble sur le point de finir, qu’en théorie du moins, elle pourrait véritablement commencer. Mais ce sont là rêveries naïves. Ce que je voudrais principalement dire ici, c’est qu’il y a autre chose dans l’esprit que l’esprit. Ce n’est pas l’esprit qui nous relie à tout ce qui nous dépasse. Il est temps qu’on ne confonde plus sa force et sa gloire avec les fines puissances de l’âme.
_____________________
iCf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Siphonophorae . Une espèce abyssale de Siphonophore, du genre Apolemia atteindrait près de 120 m de longueur totale, ce qui en ferait l’organisme animal le plus long au monde. (Je remercie le Professeur Buydens de l’ULB de m’avoir fait découvrir cet étrange animal des profondeurs.)








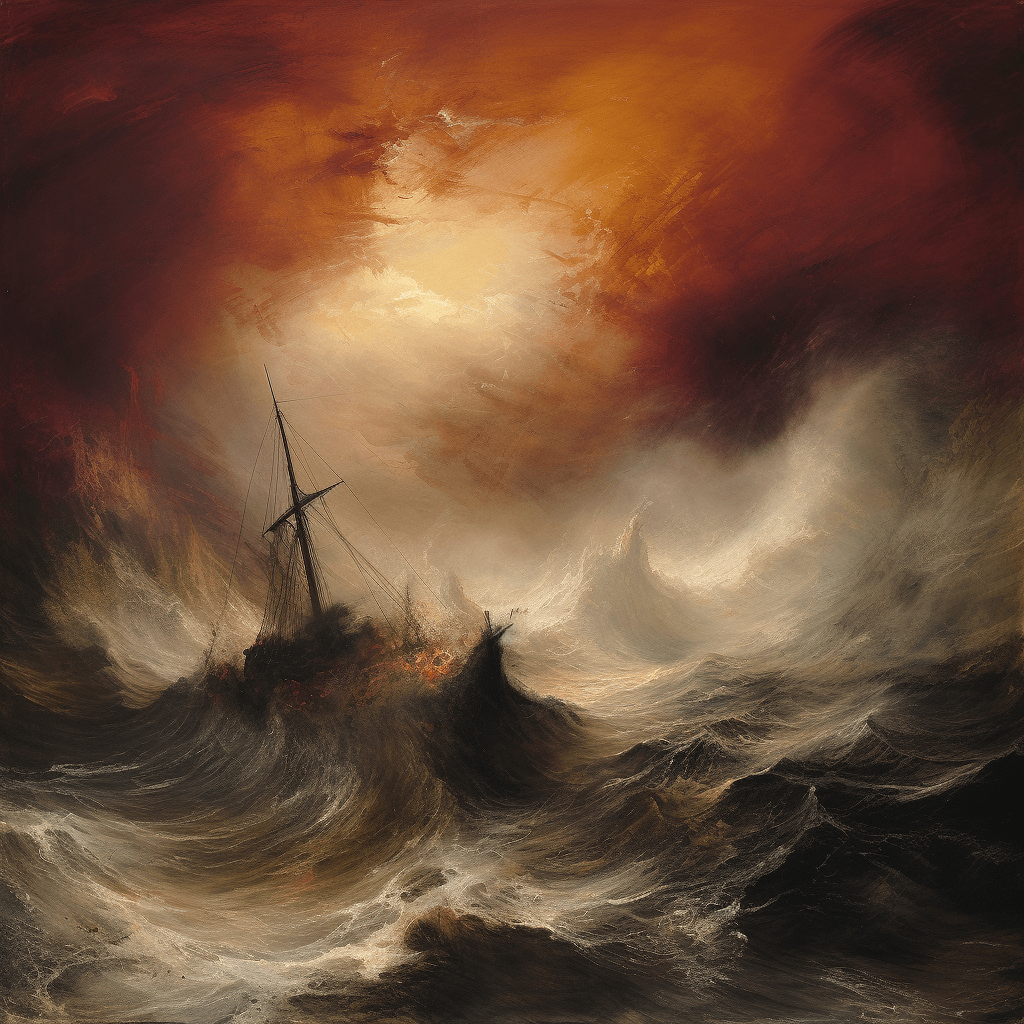





Vous devez être connecté pour poster un commentaire.