
Pourquoi la seule connaissance des faits ne déclenche-t-elle pas l’action ? Pourquoi une meilleure compréhension des enjeux mondiaux n’aiguise-t-elle pas les consciences et n’encourage-t-elle pas la prise de décision effective ? Pourquoi cette réalité-là : une crise planétaire, climatique et écologique, se développant concomitamment avec des guerres superfétatoires et oligarchiques, avec la démonétisation des démocraties et le durcissement des néo-impérialismes, s’accommodant de génocides assumés, de narco-états et de paradis savamment fiscaux, concourant à l’effondrement du droit international ‒ pourquoi cette réalité ne provoque-t-elle pas une réaction générale à la hauteur des périls ? Au-delà d’une explication par le déni, le cynisme ou l’impuissance, la cause profonde de l’apathie des peuples est peut-être à trouver dans l’impuissance des individus à comprendre par eux-mêmes les conditions de leur existence et de leur fin, dans un monde apparaissant dépourvu de sens, privé de toute idée directrice. La « modernité » néo-capitaliste, populiste et acculturée, dissimule à dessein les courants de désinformation et d’obscurantisme dont elle est traversée ; elle fragmente la perception de l’état réel des choses ; elle multiplie les filtres, elle favorise un « système », strié de travestissements, constellé de faussetés et de faux-semblants, organisant systématiquement l’impuissance à le penser. Diverses catastrophes se préparent au vu et au su de tous, mais l’apocalypse elle-même, la fin de ce monde-là, quoique pressentie, est d’autant plus impensable qu’elle reste essentiellement impensée ‒ elle échappe à tous les concepts disponibles, présents ou passés, elle est donc littéralement inconcevable. L’invisibilisation de l’essence de la réalité fait partie du « système » de cette « archéo-modernité » à l’agonie. Je l’appelle « archéo- », parce que cette modernité-là n’est certes pas « néo- », n’ayant en réalité aucun avenir, et qu’elle n’est pas non plus « post- », parce qu’elle semble n’avoir aucune souvenance de son passé récent, bien qu’elle semble parfois s’y ensabler ou s’y embourber. Il y a une vingtaine d’années, le cliché « moderne » par excellence était celui de l’émergence de la « société de l’information ». Plusieurs « sommets mondiaux » célébrèrent alors ce « concept » quelque peu arrogant. Aujourd’hui, on voit assez qu’il ne suffit pas à la société d’être « informée », ou même « sur-informée », si elle ne saisit pas d’abord l’essence du système duquel elle dépend entièrement, et dont elle n’est que l’un des rouages. Il existe en effet d’autres entités systémiques qui se tiennent à l’évidence en dehors des sociétés elles-mêmes, comme la « nature », ou encore comme le « telos » de l’évolution universelle, ou même, plus métaphysiquement encore, comme le « hasard », dont on sait qu’il contredit invinciblement les lois de la « nécessité »…
L’« archéo-modernité » se présente aujourd’hui comme un système total, qui dépasse et détermine les sociétés mêmes qui le composent. Mais c’est aussi un système fragile et fugace, dont la survie sans doute provisoire repose en grande partie sur la cécité et la paralysie des sociétés à son égard. En effet, jamais tant de menaçantes catastrophes n’ont été autant annoncées, documentées, modélisées. Depuis des décennies, les articles, les rapports et les livres s’empilent. Les courbes statistiques montent ou descendent. Les sommets en tous genres saturent l’espace médiatique, sans effet durable. Le « politique », à l’échelle internationale, arbore son impuissance, multiplie les euphémismes et les exhortations sans contenu, sans jamais la moindre remise en cause du système total, et pour cause. Ce « politique »-là est soit aveugle, soit impuissant, soit complice. La nécessité de changements structurels (politiques, idéologiques, économiques, fiscaux, légaux, climatiques, réglementaires, etc.) est flagrante, elle se fait urgente, et l’inaction alimente l’angoisse. Les sirènes d’alerte sonnent, mais aucun branle-bas général ne s’ensuit. Les sociétés sont saturées d’informations, la plupart d’une qualité très discutable, mais elles peinent à former une vision à long terme, et plus encore à la traduire en actions collectives. Plus inquiétant, après plusieurs phases de mobilisation citoyenne et politique, les réactions hostiles et contradictoires se multiplient, les premières velléités d’action sont mises en échec, la contre-révolution se met en place, provoquant la désespérance des vieux-croyants de l’écologie politique. L’accumulation des données, des analyses et même des preuves scientifiques, ne suffit plus à créer un large consensus politique, et à produire les conditions de l’action future. L’on pourrait penser que si les citoyens n’agissent pas, s’ils ne se mobilisent pas, c’est qu’ils ne sont pas assez « informés », pas assez « compétents », ou pas assez « conscients ». Mais le « politique », n’est-il pas vrai ?, n’est certes pas responsable de l’état des consciences. Il a déjà assez fait, il a donné des informations, il a fourni du matériel pédagogique, il a organisé des débats, il a entrepris quelques actions. Il fait en apparence tout ce qu’il peut pour préparer la transition future. Mais transition vers quoi ? La vision de ce futur reste confuse, nébuleuse, abstraite. Surtout, rien n’est fait pour dévoiler l’invisibilisation qui se déploie au cœur du « système ». Or, ce «système» est en échec ; ce n’est pas d’abord un échec cognitif, ou éducatif, ou éthique, ou politique, ou technologique, c’est tout cela à la fois. Autrement dit, c’est un échec « systémique ». Nous ne souffrons pas d’un manque de visibilité des enjeux, mais plutôt d’une sorte de surexposition aveuglante, et non suivie d’effet, quant à la nature du « système », et nous sommes aveuglés quant à notre aveuglement même. Le système est rendu invisible, par cet aveuglement, mais aussi parce que son essence est difficile à voir, à percevoir et à concevoir. Tant que cette invisibilité persistera, les problèmes de la planète ne seront jamais que des « para-réalités », des phénoménalités dérivées, de pures virtualités mentales, engagées, sans retour et sans espoir, dans les impasses organisées par le « système » lui-même; et elles sont si massivement distribuées dans le temps et l’espace qu’elles défient toute compréhension, toutes tentatives d’élucidation et de résolution. Les changements qu’il faudrait initier, d’urgence, devraient s’appliquer partout et en même temps ; mais la formulation de la stratégie générale censée les orienter est impalpable, insaisissable, et sa mise en route restera sans doute longtemps dans les limbes. Le système médiatique, pour sa part, fait partie du problème plus que de la solution ; il transforme les crises en un spectacle fragmenté, parsemé d’éructations passagères, de débats non-conclusifs, d’admonestations sans effets, quand il n’est pas désinformant, de façon flagrante. Des organisations politiques mobilisent des experts, produisent des rapports, s’appuient sur des sondages et des pseudo-consultations citoyennes, et proposent des stratégies improbables, censées structurer de futures temporalités, incertaines et vaporeuses, flottant au-dessus des vies quotidiennes, mais sans s’y impliquer. Elles ne sont pas si pressées de provoquer des effets directs, immédiats, concrets. C’est politiquement risqué. Ce sera aux futures générations de s’en préoccuper, si cela leur est possible ; pour le moment, ce sont les prochaines élections qui importent. D’ailleurs, si l’on détourne le regard des écrans pour observer la vraie vie, l’acuité de la crise semble légèrement s’émousser, l’urgence paraît s’éloigner quelque peu, et le stress se sublimer. Dans les supermarchés, les produits de toutes sortes s’accumulent sur les étalages et dans leurs emballages, insoupçonnables, innocentés. Le pétrole continue de couler à flot ; l’électricité est dite « proprei ». Pourtant, s’approfondit la rupture fondamentale entre, d’une part, ce que nous pressentons inconsciemment quant aux catastrophes possibles, vraisemblables, annoncées, et dont nous pouvons penser qu’elles pourraient converger vers quelque « parfaite apocalypse », et, d’autre part, ce que nous expérimentons tous les jours dans la normalité tiède, répétitive, d’un quotidien se présentant comme assuré de la pérennité de ses lendemains. L’inaction politique à l’échelle planétaire n’est donc pas le fruit d’un aveuglement subi, ou d’une ignorance entretenue, mais elle est d’abord le produit d’un système organisé d’occultation structurelle, et délibérée. Ce système d’occultation a méthodiquement séparé la production de la consommation, les causes de leurs conséquences et les corps vivants de leur environnement naturel. Son évolution, depuis plusieurs décennies, résulte de trois dynamiques interdépendantes – la main-mise croissante des oligopoles sur les ressources énergétiques et minérales, le renforcement des monopoles idéologiques et médiatiques, et la multiplication des fractionnements sociétaux, politiques, culturels et religieux. Se renforçant mutuellement, ces facteurs maintiennent le statu quo bien plus efficacement que ne pourrait le faire un pouvoir unique, totalitaire, doté en théorie d’une puissance de censure absolue. Le système de l’« archéo-modernité » continue son développement, et il tirera bien entendu nombre d’avantages tactiques de la soi-disant révolution de l’IA et du soi-disant « verdissement » des technologies. L’important est que le système total ne soit pas critiqué dans son essence même. Cette essence est invisible mais bien réelle, et elle affecte l’humanité entière. Elle est faite de courants titanesques, de métabolismes incessants, de la mise en flux permanente de toutes les formes d’énergie, et de l’accumulation concomitante de déchets éternels, tenus hors du champ de vision. Pour maintenir la séparation entre cette essence et la conscience commune, le capitalisme, allié au populisme, s’appuie sur des infrastructures conçues comme autant de « boîtes noires » apparemment distinctes. En réalité, les réseaux techniques (eau, électricité, transports, logistique, communications, traitement de l’information, IA) se caractérisent de plus en plus par leurs imbrications et leurs intrications. Tant que tous ces systèmes fonctionnent, le « système total » reste, en tant que tel, transparent, invisible, impénétrable à l’analyse. Mais si l’un des systèmes ou sous-systèmes dysfonctionne, le « système total » montre soudain toute son essentielle fragilité. Nous mesurons mal cette vulnérabilité, cette instabilité systémique, car nous n’interagissons plus avec la « réalité » elle-même, mais seulement avec de multiples « interfaces », dématérialisées, sans profondeur, sans signification, sans essence. Le système archéo-moderne alimente sans cesse cette déréalisation. Par exemple, le récit d’une prétendue « transition énergétiqueii » a installé l’idée d’un passage ‘propre’ et ‘indolore’ d’une énergie à l’autre. On les énumère souvent, comme en passant, dans leur diversité (bois, charbon, pétrole, nucléaire, solaire, éolien, hydrogène…) – mais nous nous masquons la réalité fondamentale de la société contemporaine : l’addiction à une consommation exponentielle d’énergie, menant inévitablement à une impasse « systémique ». Nous avons diversifié les sources d’énergie, mais nous avons aggravé sans cesse la dépendance de nos sociétés à la consommation d’énergie, et nous avons oblitéré le coût à long terme de cette dépendance. Nous vivons dans une bulle d’ignorance et d’aveuglement, qui nous isole de toutes les alarmes que la nature envoie. Certes, nous ne pouvons pas ne pas voir quelques catastrophes spectaculaires (incendies, inondations, sécheresses, typhons,…) mais celles-ci restent ponctuelles, passagères. Elles captent toute l’attention médiatique, alors que la crise proprement systémique (à la fois climatique, écologique, économique, démocratique, géopolitique, culturelle, éthique et idéologique…) se caractérise par une violence lente, progressive, atomisée, diffractée, mais irrésistible. Parce qu’elle se déroule hors de la saisie immédiate des sens et de l’intelligence des majorités « silencieuses », cette violence lente reste politiquement invisible, et est donc négligée par les décisionnaires. En chacun de nous, s’aggrave la dissonance entre l’intellect (qui enregistre et analyse) et l’inconscient (qui lentement accumule une énorme énergie latente, alimentée de frustration, d’incompréhension, d’impuissance, de révolte quant à l’irresponsabilité des supposés « responsables »).
Ce « système » est extrêmement instable. Les illusions de l’archéo-modernité peuvent être balayées en quelques jours, voire en quelques heures. Les crises financières, les pandémies, les guerres d’invasion, les « radhyationsiii » génocidaires, les frasques quasi-quotidiennes des populismes déchaînés, montrent toute la fragilité du « système » mondial, mais aussi son incapacité à prendre conscience de cette fragilité même, et du mortel danger collectif encouru. Cependant le « système » semble encore résilient. Très vite, les mécaniques politico-médiatiques se mobilisent pour détourner l’attention. Il faut orienter les esprits vers de nouveaux débats, empêcher que l’émotion ne se propage et amorce une volonté commune de rupture durable, fondamentale. Quelle que soit la gravité des crises, personne ne semble avoir ni la volonté ni la possibilité d’agir sur le système total. Tout est encore possible, mais seulement aux marges. Chacun est renvoyé à son impuissance propre, à son effacement individuel, face à la perspective de l’apocalypse commune. Quelques analyses s’efforcent de saisir l’essence de la situation. Mais le « système » (populiste, capitaliste et archéo-moderne) veut perdurer. Il lui faut masquer l’essence du problème qu’il représente lui-même ; il lui faut activement créer de l’incompréhension, du non-sens idéologique et du flou politique. Il faut brouiller toutes les formes d’intellection, toutes les tentatives de mise en lumière. Par exemple, l’industrie fossile a financé pendant des décennies de vastes campagnes de désinformation, déstabilisant le travail de construction des consensus scientifiques, afin de détruire toute possibilité de consensus politique. L’objectif n’était pas de prouver que le changement climatique n’existait pas, mais d’instiller assez de doute pour paralyser les décisions politiquesiv.
Le « citoyen mondial », ce sujet politique et moral, conceptuellement idéal mais presque impossible à faire émerger, est placé devant des situations conceptuellement insaisissables, omniprésentes par leurs symptômes mais abstraites quant à leur essence. Il est sur-informé mais quasi-inconscient quant à l’occultation de l’apocalypse. Il n’est pas conscient, il reste dans un demi-sommeil quant à la vulnérabilité de la planète, quant à la menace existentielle contre l’humanité et l’amorce de la spirale vers la catastrophe finale. Le refus de voir cette vulnérabilité et l’incapacité à comprendre cette menace équivalent à un déni complet de l’agonie terminale du système. Celui-ci perdure encore en cachant le plus longtemps possible les « impasses » critiques dans lesquelles le monde s’enferme. Il doit aussi voiler l’identité, la nature et les responsabilités de l’oligarchie mondiale, laquelle imposera sa loi jusqu’au bout de la nuit ‒ quel qu’en soit le coût, quelles que soient les souffrances causées. Il doit transformer l’absence de toute critique politique réellement pertinente en culpabilités et en angoisses individuelles, ou alors, quand c’est plus avantageux pour lui, en guerres civiles, sociales, culturelles, économiques ou militaires. L’inaction de facto ne doit donc pas s’interpréter comme une panne systémique, mais bien comme une preuve de la résistance du « système » à toute tentative de le changer. Le « système » veut perdurer, et pour cela il veut rester dans l’ombre. Mais ses effets induits ont au moins le mérite de mettre en pleine lumière son existence même, ainsi que le caractère impitoyable de ses objectifs. L’inaction, la soumission, la passivité politique, sociale, culturelle de l’énorme majorité de la population mondiale, font partie des buts recherchés par le « système ». Cette situation n’est pas près de changer, mais va plutôt s’aggraver au fur et à mesure que les crises deviendront plus visibles, plus prégnantes, et plus terribles dans leurs conséquences pratiques. Ces crises sont seulement au début de leurs courbes de croissance.
Le « système » organise donc sa propre dissimulation pour continuer de survivre. Il ne s’agit plus de convaincre les esprits par des informations, des raisonnements, des projections. Il faut changer de langage, il faut changer de vision, il faut changer de cadre, il faut transformer la structure des besoins, et les conditions matérielles et intellectuelles de notre expérience du monde. Il faut dévoiler l’opacité du « système » et montrer l’inanité de son essence, la nullité de ses promesses, la rapacité de ses ambitions. Sortir du « système » exigera bien des ruptures. Parmi les plus radicales : abandonner les idéaux populistes et capitalistes, destinés à rejoindre dans le compost de l’histoire les totalitarismes d’hier et les impérialismes d’avant-hier. Rendre visibles les limites matérielles de l’humanité tout entière, posée sur une goutte de boue séchée, de lave et de feu, dans un univers froid, infini et indifférent. Cartographier et suivre tous les flux informationnels, financiers, matériels. Refuser les lois d’un marché sans mémoire et sans géographie. Exposer la matérialité primaire et finie de l’énergie. Démontrer les limites du pouvoir humain sur le destin ultime de l’humanité. Remettre en cause les infrastructures politiques et économiques qui donnent un pouvoir sans partage aux oligarchies mondialisées.
Nous préférons collectivement un poison lent et invisible à des remèdes douloureux et visibles. Nous voyons qu’il y a des luttes, qu’il y a des guerres. Mais on ne voit pas assez que c’est la vie qui est menacée de mort, à l’échelle de l’humanité entière. Ce monde n’est pas bénin. On ne peut pas se contenter de le voir continuer ainsi, sans que l’on sache comment ni pourquoi il fonctionne de cette façon, et pas d’une autre. C’est un monde où les forces, les limitations, les possibilités, les impossibilités et leurs conséquences sont elles-mêmes sans cesse mouvantes. Pour penser à ce que l’avenir pourrait devenir, il faut commencer par recouvrer toute l’intelligence de la situation.
_____________________________
i« Au XIXe siècle, l’électrification a consisté à substituer aux nuisances locales et visibles (les lampes à gaz qui noircissaient les murs et les poumons) une technologie apparaissant ‘propre’ et ‘magique’ au point d’usage : l’ampoule incandescente. L’astuce, cependant, ne résidait pas dans la suppression de la pollution, mais dans sa délocalisation. Les tonnes de charbon brûlées et les scories de la centrale n’étaient plus dans les salons bourgeois, mais rejetées, hors de vue, dans le fleuve voisin ou les quartiers ouvriers. Le génie de la modernité a été d’inventer une technologie qui externalise les nuisances tout en programmant l’ignorance de ses utilisateurs. Ce modèle s’est généralisé pour former ce que nous pourrions appeler la ‘matière noire’ de l’économie contemporaine […] On nous promet la substitution d’un objet « sale » (le pot d’échappement qui fume) par un objet « propre » (la voiture silencieuse). Ce cadrage techno-optimiste permet de masquer, une fois de plus, la chaîne de valeur matérielle : l’extraction du lithium, le cobalt des mines congolaises, ou la fabrication énergivore des batteries. La pollution ne disparaît pas ; elle est repoussée plus loin, dans les nouvelles zones d’extraction du capitalisme vert. Plus profondément, la voiture électrique permet de sauver l’invisibilité du « système automobile » lui-même. En focalisant le débat sur le moteur, on naturalise l’infrastructure titanesque nécessaire à la mobilité individuelle : l’étalement urbain, l’artificialisation des sols et la dépendance à la voiture. L’innovation technologique sert ici de verrou (lock-in) : elle permet de tout changer en apparence pour que, structurellement, rien ne change à notre manière d’habiter le monde. Cette illusion de la substitution ne se limite pas à l’automobile ; elle structure l’ensemble de notre récit historique. » Hugues Draelants. L’occultation du changement climatique. La vie des idées. Publié le 2 décembre 2025.
iiJean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Paris, Seuil, 2024.
iiiGénocide | Metaxu. Le blog de Philippe Quéau
ivNaomi Oreskes, Erik M. Conway, Les Marchands de doute, Paris, PUF, 2012








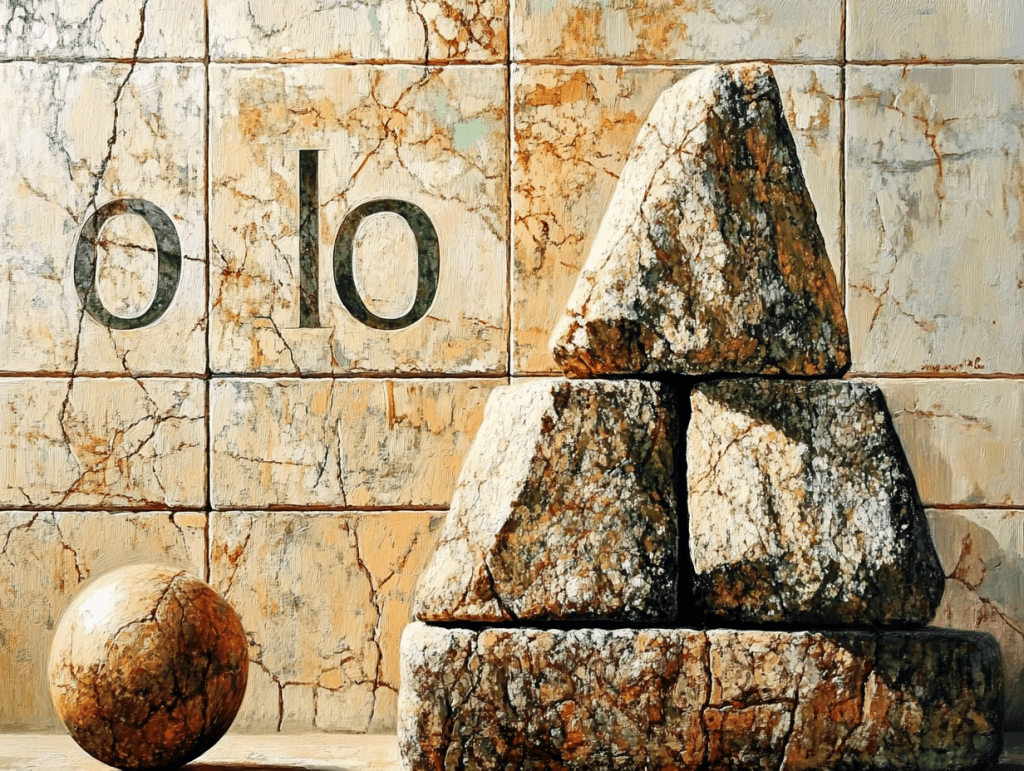




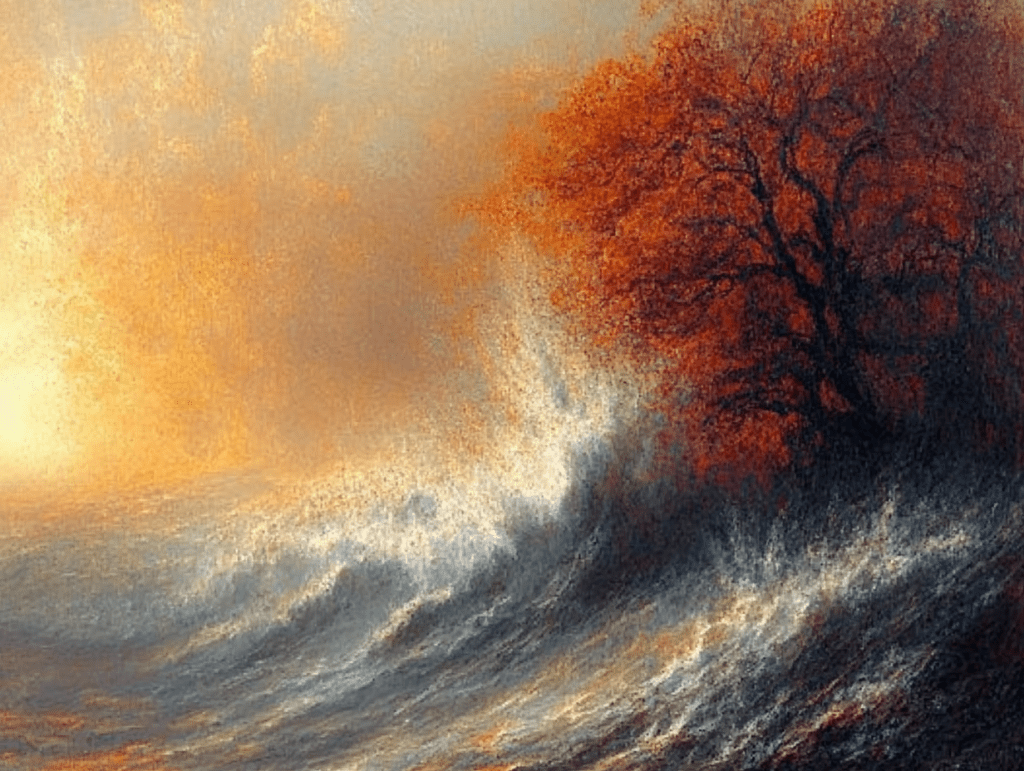



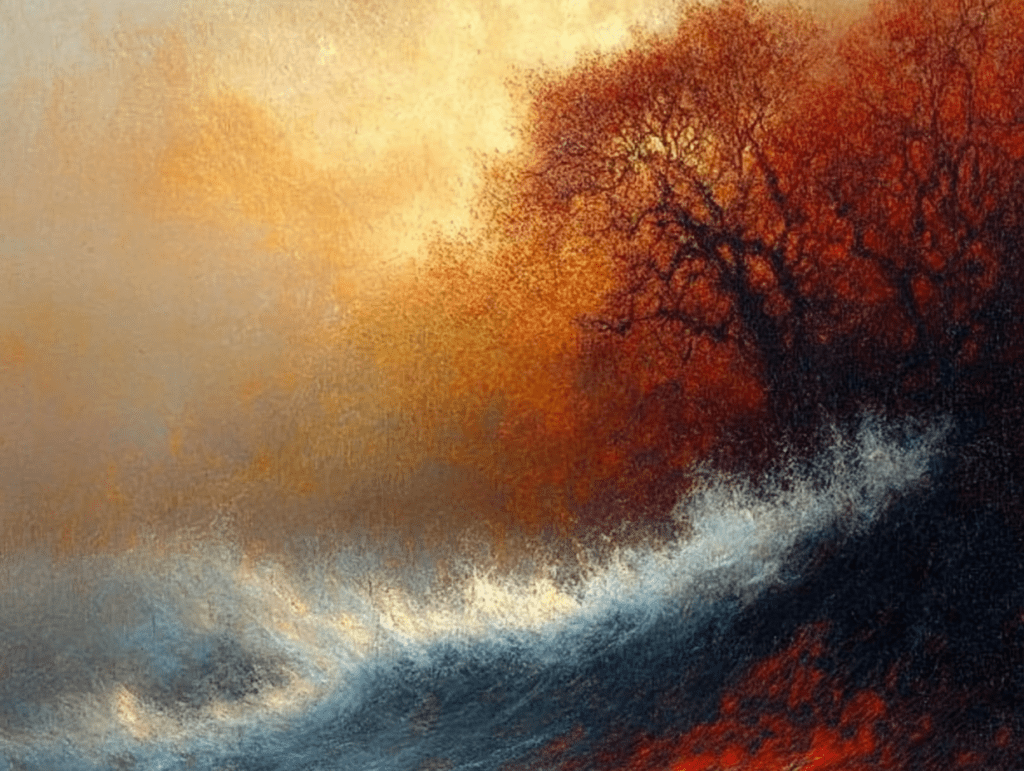
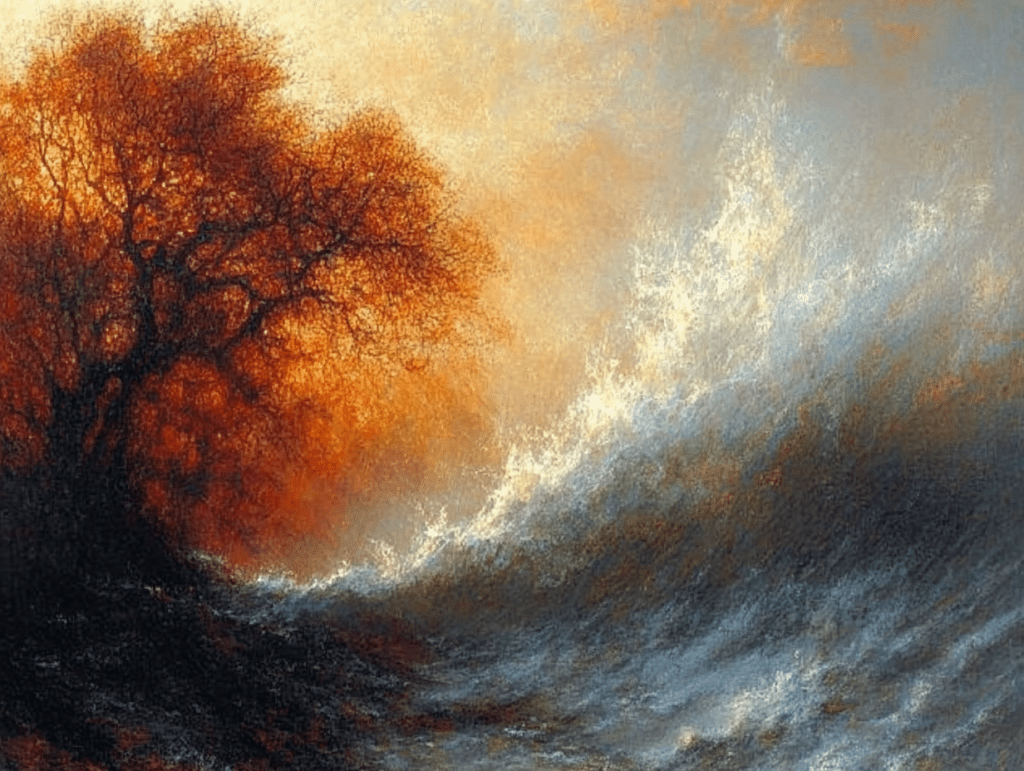
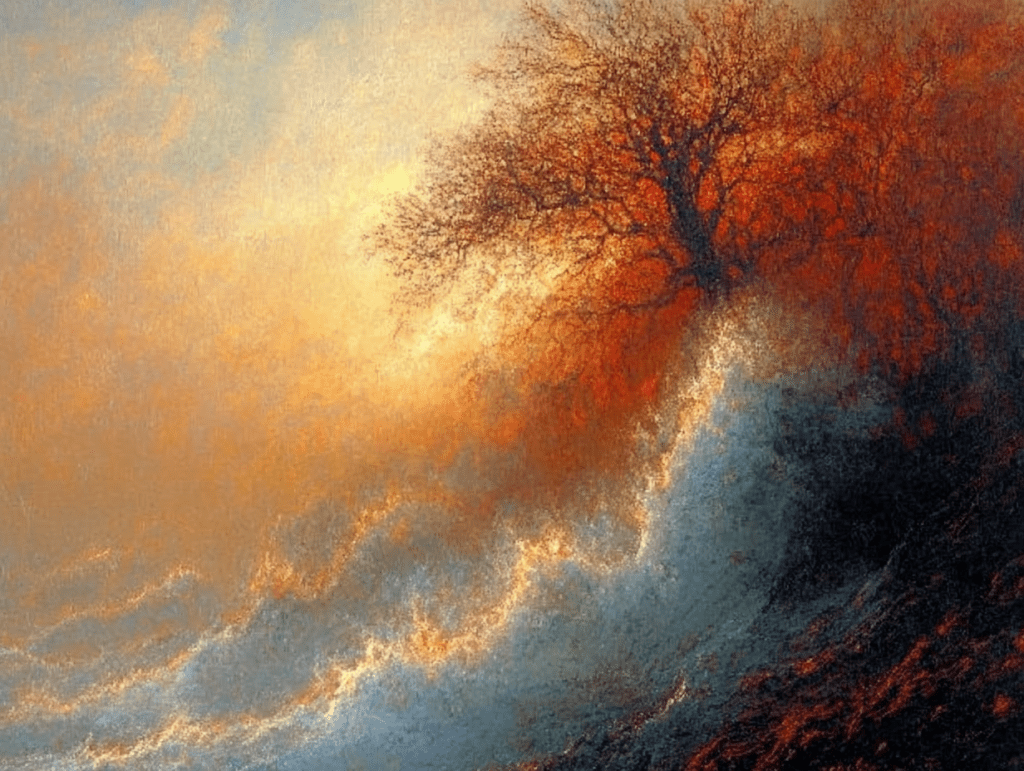




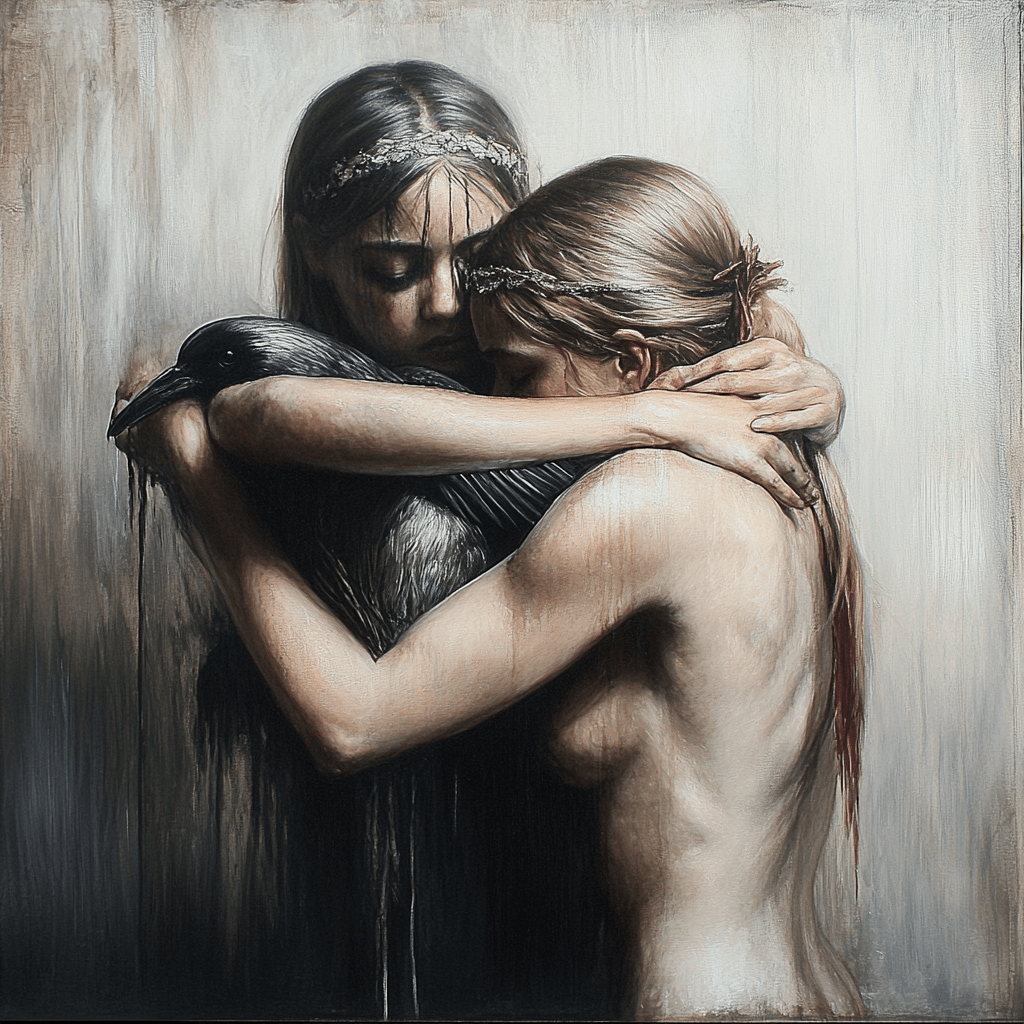














Vous devez être connecté pour poster un commentaire.