Longtemps chamaniste, l’ancienne Russie, dont on ne peut certes pas dire qu’elle n’avait pas le sens du mystère, devint « monothéiste » (et conséquemment « sainte ») vers le 9ème siècle, grâce à Cyrille et Méthode. Ces deux moines apportèrent l’écriture (cyrillique), et ils étendirent significativement le nombre des « croyants », moins d’un millénaire après les premières conversions opérées en Crimée, selon la légende, par saint André, le frère de saint Pierre.
Il vaut la peine de noter qu’en Russie, jusqu’au début du 20ème siècle, d’étranges coutumes faisaient toujours se côtoyer, à l’amiable pour ainsi dire, les niveaux de compréhension mutuelle entre plusieurs interprétations de l’idée du divin.
En 1911, dans le gouvernement de Kazan, chez les Votiaks, l’on fêtait encore, une fois l’an, le dieu Kérémet, sous la forme d’une poupée installée sur le clocher de l’église du village. Pendant la journée de cette célébration païenne et polythéiste, tous les représentants du clergé Orthodoxe (diacre, sacristain et marguillier) s’enfermaient dans une cabane, comme en une prison symbolique, pendant que la vieille divinité païenne sortait de sa geôle chrétienne et était fêtée par le peuple Votiak en liesse…i
Les Russes n’en avaient pas encore fini avec les dieux multiples.
On n’en finira pas non plus, avant longtemps, avec l’Un.
Un ou multiple, on propose ici de s’initier sans tarder à l’Infini. Et de s’affranchir un temps de la clôture des monologues, des soliloques des religions établies.
Mis en rapport sincère avec l’Infini, en balance avec la puissance des possibles, l’Un paraît, dans sa radicale simplicité, n’être jamais que l’ombre d’une amorce, le songe d’un commencement, l’inachèvement d’une idée.
Dans l’Infini toujours ouvert, sommeille, lointaine, la vision, jamais finale, – la révélation, l’‘apocalypse’ qui ‘dévoile’ non la vérité ou une fin, mais l’infinité de tout ce qui reste (toujours encore) à découvrir.
La route du voyage est longue, infiniment longue. Les carrefours perplexes et les impasses déçues y foisonnent, nécessairement. Mais les sentes adventices, les déviations inopinées, les voies invisibles, les échelles au ciel, les passerelles d’étoiles, quant à elles, prolifèrent, bien plus nombreuses encore.
Elle fatigue et scandalise l’esprit, la sempiternelle opposition, la mise en scène exacerbée du combat millénaire entre les « monothéistes », prétendant monopoliser l’évidence, et les « polythéistes », méprisés, dont on humilie l’imagination, l’intuition et le paganisme.
Le « paganisme » et les « païens » tirent leur nom du latin pāgus, ‘borne fichée en terre’, et par extension, ‘territoire rural délimitée par des bornes’. Pāgus est lié au verbe pango, pangere, ‘ficher, enfoncer, planter’, et, par métonymie, au mot pax, ‘paix’… De pāgus dérive pāgānus, ‘habitant du pāgus’, ‘paysan’. Dans la langue militaire, pāgānus prend le sens de ‘civil’ par opposition au soldat. Chez les chrétiens, pāgānus a désigné le ‘païen’.
Certes, tous les paysans ne sont pas polythéistes, et tous les polythéistes ne sont pas des païens. Mais l’arbre des mots offre à l’encan des grappes de sens, où la borne, le champ, la racine, le ‘pays’ et le ‘païen’ voisinent. Ces catégories se mêlaient jadis durablement dans l’imaginaire collectif.
Peut-être qu’elles continuent d’ailleurs de se mêler et de s’emmêler, à notre époque de repli local, de refus de l’unité et de haine de l’universel.
Les intuitions premières ne s’évanouissent pas facilement, après quelques millénaires. Il y a longtemps déjà que s’opposent Abel et Caïn, les éleveurs et les agriculteurs, la transhumance et le bornage, l’exode et l’agora, le tribal et le local.
Dans cette litanie de pugnacités irréductibles, les paradigmes, si nets, de l’Un et du Tout prennent par contraste l’apparence de hautes figures, épurées, abstraites, prêtes à s’entre-égorger à mort.
Face aux myriades éparses des divinité locales et confuses, l’intuition originelle de « l’Un », illuminant le cerveau de quelques prophètes ou de chamanes visionnaires, pourrait aisément passer pour la source profonde, anthropologique, du monothéisme.
Complémentaire, la considération (poétique et matérialiste) de la plénitude absolue du « Tout » pourrait sembler être, pour sa part, l’une des justifications des premières sensibilités « polythéistes ».
Les mots ici portent déjà, dans leur construction, leurs anathèmes implicites. De même que ce sont les chrétiens qui ont inventé le mot ‘païen’, ce sont les monothéistes qui ont fabriqué, pour les dénigrer, le néologisme stigmatisant les ‘polythéistes’.
Il est fort possible que les dits ‘polythéistes’ ne se reconnaissent pourtant aucunement dans ces épithètes importées et mal pensées.
Il est fort possible aussi, qu’excédé de stériles querelles, on préfère changer d’axe et de point de vue.
Plutôt que de se complaire dans l’opposition gréco-mécanique du mono– et du poly-, ne vaut-il pas mieux considérer comme plus opératoire, plus stimulant, le jeu de la transcendance et de l’immanence, qui met en regard l’au-delà et l’en-deçà, deux figures radicalement anthropologiques, plus anciennes que les travaux et les jours.
Surtout, l’au-delà et l’en-deçà (ou l’au-dehors et l’en-dedans) ne s’opposent frontalement mais ils se complémentent.
Il n’est pas a priori nécessaire que l’Un s’oppose irréductiblement au Tout, ni la transcendance à l’immanence.
Si l’Un est vraiment un, alors il est aussi le Tout… et le Tout n’est-il pas aussi, en quelque manière, en tant que tel, la principale figure de l’Un ?
L’Un et le Tout sont deux images, deux épiclèses d’une autre figure, bien plus haute, bien plus secrète, et dont le mystère se cache encore, au-delà de l’Un et en-deçà du Tout.
Les « monothéistes » et les « polythéistes », comme des grues et des mille-pattes dans un zoo, apportent seulement, à leur manière, quelques éléments aux myriades de niveaux de vue, aux multitudes de plans, aux innombrables béances. Ces vues, ces niveaux, ces plans de compréhension (relative), ces béances accumulent inévitablement de graves lacunes d’intellection, – amassent sans cesse les biais.
Depuis toujours, l’humain a été limité par nombre de biais, – la nature, le monde, le temps, l’étroitesse, l’existence même.
Et depuis toujours aussi, paradoxalement, l’humain a été saisi (élargi, élevé) par le divin, – dont la nature, la hauteur, la profondeur et l’infinité lui échappent absolument, essentiellement.
Il y a un million d’années, et sûrement bien avant, des hommes et des femmes, peu différents de nous, recueillis dans la profondeur suintante des grottes, réunis autour de feux clairs et dansants, ont médité sur l’au-delà des étoiles et sur l’origine du sombre, ils ont pensé à l’ailleurs et à l’après, à l’avant et à l’en-dedans.
Qui dira le nombre de leurs dieux, alors ? Étaient-ils un ou des monceaux ? Leurs figures divines étaient-elles solaire, lunaire, stellaires, ou chthoniennes ? Comptaient-ils dans le secret de leur âme le nombre des gouttes de la pluie et la lente infinité des sables ?
Le mono-, le poly– !
L’un et le milliard ne se soustraient pas l’un de l’autre, dira l’homme de calcul, mais ils s’ajoutent.
L’un et l’infini ne se combattent pas, dira le politique, mais ils s’allient.
L’un et le multiple ne se divisent pas, dira le philosophe, mais ils se multiplient.
Tout cela bourgeonne, vibrionne, fermente, prolifère.
Comment nommer d’un nom toutes ces multiplicités ?
Comment donner à l’Un tous les visages du monde ?
Le plus ancien des noms de Dieu archivés dans la mémoire de l’humanité n’est pas le nom hébreu, commun et éminemment pluriel, Elohim, ni le nom propre, יהוה, parfaitement singulier et indicible (sauf une fois l’an).
Le plus ancien des noms de Dieu est le mot sanskrit देव, deva, apparu deux millénaires avant qu’Abraham ait songé à payer un tribut à Melchisédech pour obtenir sa bénédiction. Le mot deva, ‘divin’, vient de div, ‘ciel’, ce qui dénote l’intuition première de l’au-delà de la lumière, pour dire le divin.
Après être apparu dans le Veda, deva fit belle carrière et engendra Dyaus, Zeus, Deus et Dieu.
Il y a bien d’autres noms de Dieu dans la tradition védique. Et certains ne sont ni communs ni propres, mais abstraits, comme le nom pūrṇam, ‘plein, infini’, qui s’applique à la divinité absolument suprême :
« Cela est infini ; ceci est infini. L’infini procède de l’infini. On retire l’infini de l’infini, il reste l’infini. »ii
Cette phrase est au cœur de la plus ancienne des Upaniṣad.
‘Cela’ y désigne le principe suprême, le brahman.
‘Ceci’ pointe vers le réel même, le monde visible et invisible, l’ordre et le cosmos tout entier.
L’Upaniṣad n’oppose par le mono– et le poly-, mais les unit.
C’est là l’une des plus antiques intuitions de l’humanité. La Dispersion appelle à la Réunion.
Juste avant de boire la ciguë, Socrate s’est souvenu d’une ‘antique parole’ (παλαιὸς λόγος) : « J’ai bon espoir qu’après la mort, il y a quelque chose, et que cela, ainsi du reste que le dit une antique parole, vaut beaucoup mieux pour les bons que pour les méchants. »iii
Il précise un peu plus loin ce que ce palaios logos enseigne:
« Mettre le plus possible l’âme à part du corps, l’habituer à se ramener, à se ramasser sur elle-même en partant de tous les points du corps, à vivre autant qu’elle peut, aussi bien dans le présent actuel que dans la suite, isolée et par elle-même, entièrement détachée du corps, comme si elle l’était de ses liens ? »iv
L’âme doit revenir à son unité, se ramasser sur elle-même, se détacher de tout ce qui n’est pas son essence.
Cette idée du recueil, du ramassement sur soi, est frappante. Elle évoque la nécessité pour l’âme de cheminer à rebours, de remonter la ‘descente’ que fit le Dieu créateur de l’humanité, lors de son sacrifice.
Dans la culture de la Grèce ancienne, c’est le démembrement de Dionysos qui illustre l’acte de démesure qui fut à l’origine de l’humanité.
Les Titans, ennemis des Olympiens, tuent l’enfant-Dieu Dionysos, fils de Zeus (et de Perséphone). Ils le dépècent, puis en font rôtir les membres pour les dévorer, à l’exception du cœur. En châtiment, Zeus les foudroie de ses éclairs et les consume de sa foudre. L’Homme naît de la cendre et de la suie qui résultent des restes calcinés des Titans. Les Titans ont voulu détruire l’enfant-Dieu, l’immortel Dionysos. Résultat : Dionysos est sacrifié à leur folie. Mais ce sacrifice divin sera la cause de la naissance de l’Humanité. Une fine suie est tout ce qui reste des Titans (consumés par le feu divin) et de l’enfant-Dieu (dont les Titans ont consommé la chair et le sang). Cette fine suie, cette cendre, cette poussière, d’origine indiscernablement divine et titanique, disperse l’immortalité divine en l’incarnant en autant d’« âmes », attribuées aux vivants.
La croyance orphique reprend en essence la vérité fondamentale déjà proclamée par le Veda il y a plus de quatre mille ans (le sacrifice originel de Prajāpati, Dieu suprême et Seigneur des créatures) et elle préfigure aussi, symboliquement, la foi chrétienne en un Dieu en croix, sauveur de l’humanité par Son sacrifice.
La croyance orphique pose surtout, et c’est là un sujet fascinant, la question du rôle de l’homme vis-à-vis du divin :
« L’homme n’a pas été ‘créé’ pour sacrifier ; il est né d’un sacrifice primordial (celui de Dionysos), synonyme de l’éparpillement de l’immortalité, et à ce titre, l’homme a la charge de sa recomposition. La séparation humain-divin est tromperie et imposture. De plus, à la distanciation (moteur du sacrifice sanglant rendu par la cité), les orphiques opposent l’assimilation avec le divin, et s’abstenir de viande c’est être comme les dieux. C’est refuser de définir l’homme en opposition à la divinité (postulat fondamental du règne de Zeus). L’unique sacrifice (…) c’est celui de Dionysos. Il doit précisément rester pour toujours unique. »v
Un sacrifice « unique », – dans la religion orphique, « polythéiste ».
La communion de la chair et du sang du Christ par tous les croyants, sacrifice infiniment répété, dans la suite des générations, – dans une religion « monothéiste ».
Il est temps de s’ouvrir à l’Infini des possibles.
iVassili Rozanov. Esseulement. Trad. Jacques Michaut. Editions L’âge d’homme. Lausanne, 1980, p. 32
iiBrihadaranyaka Upaniṣad 5.1.1
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
pūrṇam adaḥ, pūrṇam idaṃ, pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate.
iiiPlaton, Phédon, 63c
ivPlaton, Phédon, 67c
vReynal Sorel. Dictionnaire du paganisme grec. Les Belles Lettres. Paris, 2015, p. 437
Partage (et 'agitprop' ...) :



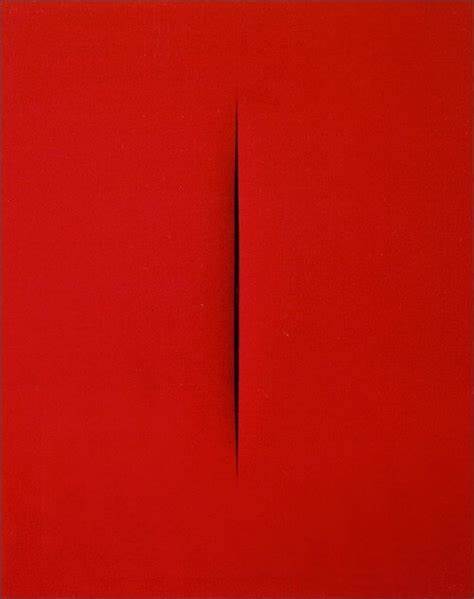
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.