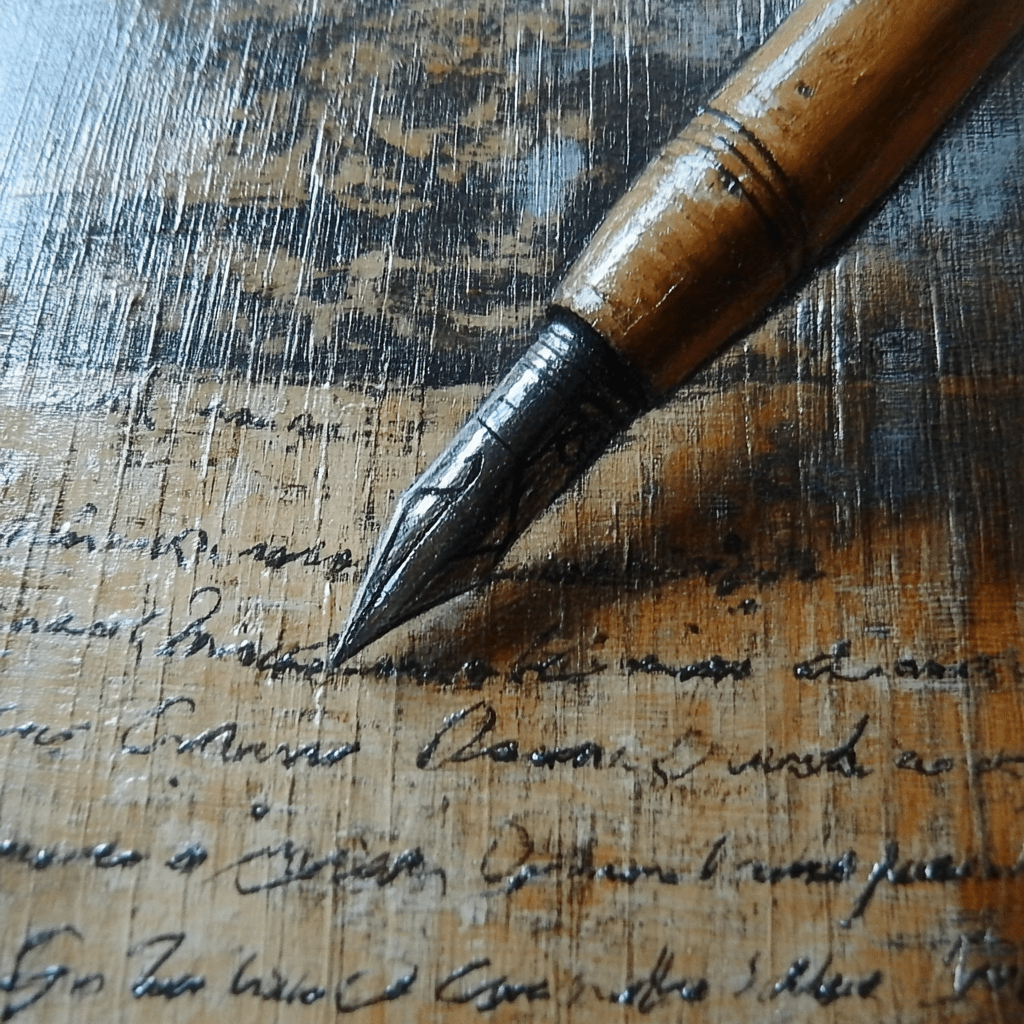
Le plaisir du texte, je le conçois au moment même où, lisant ce qu’écrit cet auteur-là, et non un autre, mon esprit va se mettre à suivre son propre mouvement, va incessamment s’émanciper, pour se livrer à son propre désir, et à celui-là seul. Car mon esprit a ses idées bien à lui, des idées que cet auteur n’a pas, puisqu’il a les siennes. Qu’il en jouisse donc, dans les cris de son écrit, pendant que je m’apprête à changer de métaphores. Je ne cherche pas le plaisir dans le texte de l’autre, ni quelque jouissance. Je cherche bien autre chose. Pour illustrer ce dire, je partirai d’un paragraphe de Barthes, que je ponctuerai de parenthèses : [ ]. Entre les lignes de cet auteur ici cité, chacune de ces parenthèses signifiera une sorte de risée, un possible souffle, une invite à gréer des voiles, un appel au large — toutes choses signifiantes (pour moi). Car ce que je cherche est un vent, un cap vers une sorte de Désirade, et mon désir se situe encore plus au loin, dans un autre océan même, dont quelque livre que ce soit ne serait jamais qu’un ponton de départ, un port d’où il convient appareiller au plus vite. Lisant, je largue enfin les amarres, et ma traversée sera toujours plus longue que ma lecture. « Le plaisir n’est-il qu’une petite jouissance? La jouissance n’est-elle qu’un plaisir extrême? [Ni l’un ni l’autre, assurément. En ces matières subtiles, il y a des solutions de continuité.] Le plaisir n’est-il qu’une jouissance affaiblie, acceptée — et déviée à travers un échelonnement de conciliations? La jouissance n’est-elle qu’un plaisir brutal, immédiat (sans médiation) ? [Il n’y a pas que le plaisir et la jouissance, il y a aussi l’extase. Pourquoi l’absence de toute référence à l’extase, dans ce texte-là, m’incite-t-elle justement à hisser le grand foc, ou encore à éructer un sonore « fuck ! »?] De la réponse (oui ou non) dépend la manière dont nous raconterons l’histoire de notre modernité. [Vraiment ? Là, j’ai envie de rire. Barthes ne manque pas d’air…] Car si je dis qu’entre le plaisir et la jouissance il n’y a qu’une différence de degré, je dis aussi que l’histoire est pacifiée [Ainsi, en 1973, on pouvait écrire que « l’histoire est pacifiée » ? Un demi-siècle plus tard, les temps ont bien changé!] : le texte de jouissance n’est que le développement logique, organique, historique, du texte de plaisir, l’avant-garde [Ah ! « l’avant-garde » ! Comme ce terme est daté ! On a vraiment changé d’époque!] n’est jamais que la forme progressive, émancipée, de la culture passée : aujourd’hui sort d’hier [Voilà un vrai cliché, sans doute presque entièrement faux, pour l’essentiel], Robbe Grillet est déjà dans Flaubert, Sollers dans Rabelais, [c’est Sollers qui édite Barthes au Seuil, autant ne pas rater l’occasion d’un ‘petit’ compliment, mais très flatteur, et comme en passant…] tout Nicolas de Staël dans deux cm2 de Cézanne [cette pointe, par contre, est rien moins qu’un compliment]. Mais si je crois au contraire que le plaisir et la jouissance sont des forces parallèles, qu’elles ne peuvent se rencontrer et qu’entre elles il y a plus qu’un combat : une incommunication, alors il me faut bien penser que l’histoire, notre histoire, n’est pas paisible, ni même peut-être intelligente [il ne faudrait pas dire ‘peut-être’, mais ‘sûrement pas’], que le texte de jouissance y surgit toujours à la façon d’un scandale (d’un boitement) [En quoi le boitement est-il scandaleux ? Serait-ce un trait à charge contre le handicap en général ? Pas très woke…], qu’il est toujours la trace d’une coupure, d’une affirmation (et non d’un épanouissement) [en quoi s’épanouir serait-il l’opposé d’une affirmation ? Ne pourrait-il y a avoir, en l’occurrence, union et conjonction de l’un et de l’autre, en somme ?], et que le sujet de cette histoire (ce sujet historique que je suis parmi d’autres), loin de pouvoir s’apaiser en menant de front le goût des œuvres passées et le soutien des œuvres modernes dans un beau mouvement dialectique de synthèse [Plus personne aujourd’hui ne peut sincèrement croire en la possibilité d’« un beau mouvement dialectique de synthèse ». Le temps de l’idéalisme hégélien est disparu corps et biens. Il faut donc se résoudre à voir combien, par ce genre de formule, et qu’il y croie ou non, Barthes se montre tellement de son temps, en plein dans son temps, et le fixant, génialement certes, par sa très parisienne prose, pour toujours, dans son immobile et fugace éternité…] n’est jamais qu’une « contradiction vivante »: un sujet clivé, qui jouit à la fois, à travers le texte, de la consistance de son moi et de sa chute. [A ce point du texte, je me mets à jouir, moi aussi, mais d’une tout autre image. Je jouis de me sentir dé-clivé, sortant extatiquement de ce texte clivant, et pensant à ma façon, non à la chute du moi, mais à son envolée soudaine, et aux vagues qui l’attendent, au-delà du port, et dont la crête commence à blanchir.]
Voici d’ailleurs, venu de la psychanalyse, un moyen indirect de fonder l’opposition du texte de plaisir et du texte de jouissance : le plaisir est dicible, la jouissance ne l’est pas. La jouissance est in-dicible, inter-dite. Je renvoie à Lacan (« Ce à quoi il faut se tenir, c’est que la jouissance est interdite à qui parle, comme tel, ou encore qu’elle ne puisse être dite qu’entre les lignes… ») [Ah : Lacan ! La provocation du paradoxe, et la jouissance de la provocation. Cette phrase, « La jouissance est interdite à qui parle », venant de quelqu’un qui gagna sa vie de parler du jouir et de jouir du parler… ] et à Leclaire (« … celui qui dit, par son dit, s’interdit la jouissance, ou corrélativement, celui qui jouit fait toute lettre — et tout dit possible — s’évanouir dans l’absolu de l’annulation qu’il célèbre. ») [Là, je l’avoue, j’ai rien compris… Mais c’était sans doute l’effet désiré, l’effet qui fait jouir Leclaire de l’impuissance à jouir de son lecteur…] L’écrivain de plaisir (et son lecteur) accepte la lettre; renonçant à la jouissance, il a le droit et le pouvoir de la dire : la lettre est son plaisir; il en est obsédé, comme le sont tous ceux qui aiment le langage (non la parole), tous les logophiles, écrivains, épistoliers, linguistes; des textes de plaisir, il est donc possible de parler (nul débat avec l’annulation de la jouissance) : la critique porte toujours sur des textes de plaisir, jamais sur des textes de jouissance [Et, quant aux textes d’extase, faut-il décidément les tenir sous le boisseau ? Curieuse élision, surprenant oubli. Heureusement Julia Kristeva, la femme de Sollers, commit quelque temps plus tard, sa réputation dûment faite et établie, un énorme pavé, tout gluant d’admiration, sur sainte Thérèse d’Avila] : Flaubert, Proust, Stendhal sont commentés inépuisablement; la critique dit alors du texte tuteur la jouissance vaine, la jouissance passée ou future : vous allez lire, j’ai lu : la critique est toujours historique ou prospective [Non ! Pas toujours ! Ma critique, ici, n’est ni historique, ni prospective. C’est une critique qui n’est même pas jouissive. Je cherche seulement à finir de gréer mon voilier mental, et je consulte la météo, qui n’est pas très bonne…]: le présent constatif, la présentation de la jouissance lui est interdite; sa matière de prédilection est donc la culture, qui est tout en nous sauf notre présent. [Belle formule, j’avoue, mais avec laquelle je suis en désaccord. Même si la culture était « tout en moi », ce dont je doute, pour ma part, pourquoi ne serait-elle pas aussi « notre présent » ? Pourquoi exclure le « présent » de la culture, et la culture du « présent »?] Avec l’écrivain de jouissance (et son lecteur) commence le texte intenable, le texte impossible. Ce texte est hors-plaisir, hors-critique, sauf à être atteint par un autre texte de jouissance : vous ne pouvez parler « sur » un tel texte, vous pouvez seulement parler « en » lui à sa manière [Oui ! C’est exactement ce que je cherche à faire ici, parler « en » ce texte-là, au sens littéral, mais à « ma » manière…], entrer dans un plagiat éperdu [Je ne plagie rien, ici, je cite, et je m’installe avec une certaine dose de jouissance, dans ces citations mêmes…], affirmer hystériquement le vide de jouissance (et non plus répéter obsessionnellement la lettre du plaisir)i. » [Je ne suis pas hystérique, me semble-t-il, ni vide de toute jouissance. Mais, en revanche, je veux bien reconnaître une certaine obsession de la lettre. Mais non pas la lettre du plaisir. Plutôt, celle, bien plus difficilement accessible, de l’extase. Laquelle n’a rien à voir, évidemment avec le sexe, ni avec le texte.]
_______________
iRoland Barthes. Le plaisir du texte. Seuil, 1973. p. 34-38


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.